Polisse & L.627 (06.11.2011)


****/****
Voir Polisse et prendre connaissance, au-delà de son succès public, des réactions de la presse, majoritairement très enthousiaste (*), amène à penser, même si l'on ne se sent guère proche des Cassandre annonçant régulièrement sa mort, que le cinéma a perdu la bataille, qu'il a été absorbé, qu'il n'y a plus que l'étiquette qui le distingue de la télévision. A quoi sert le "grand film" de Maïwenn ? Quelle est sa finalité ? Quel point de vue le soutient ? Sa seule utilité, à mon sens, est de permettre la tenue de débats sociologiques à l'issue des projections (celui auquel j'ai assisté était intéressant, bien plus que le film lui-même). Partout où ils sont organisés, probablement, les intervenants ont le même jugement, positif, sur l'authenticité de ce qui est montré à l'écran (une fois exprimées quelques légères réserves concernant la condensation du récit, l'aspect spectaculaire de certains dialogues ou l'adaptation parfois défaillante des propos adressés aux plus jeunes). Mais à quoi bon être authentique si l'on n'a que cela à proposer ? Il suffit, pour s'informer sur le sujet, pour être édifié, de regarder n'importe quel document télévisé sur l'enfance en souffrance. Polisse n'est pas un film, c'est la reconstitution d'un reportage de France 2.
Une fois ceci établi, se pose alors aussitôt le problème de la représentation et du défilé d'acteurs connus singeant des douleurs d'anonymes. Cette bourgeoise qui pleure sous le feu des questions de l'enquêtrice, ce n'est que Sandrine Kiberlain qui joue la détresse. Cette femme flic qui se fige devant un fœtus posé sur une table d'hopital, ce n'est que Marina Foïs qui fait sa grande scène choc. Cet écart est donc, déjà, trop grand, entre le réel et les figures supposées le débusquer. Il devient parfois abyssal lorsque Maïwenn s'enquiert de désamorcer ce qui serait trop douloureux ou dévalorisant pour l'image de cette police des mineurs. Le regroupement des enfants roms séparés de leurs parents se termine en comédie musicale rieuse, la crise de larmes d'un gamin laissé par sa mère est l'occasion de faire accéder Joey Starr au rang de "grand acteur", la grosse baffe que donne le même Joey soulage tout le monde car elle atteint un notable dégueulasse... Rendre compte d'une réalité complexe, ce n'est pas faire défiler les victimes comme autant de cas, ni coller l'une à l'autre une séquence sur un intégriste et une séquence sur une formidable famille cosmopolite, ni dérouler à la cantine une discussion entre pro- et anti-Sarkozy. Tout cela ne sert qu'à contenter tout le monde (sauf les pédophiles).
Pour ce qui est de l'énergie (tant vantée depuis la présentation du film à Cannes), Maïwenn pense qu'elle naît de l'entassement dans le cadre et de la caméra portée. Certes, ça bouge mais aucune dynamique cinématographique n'est créée. Si Maïwenn a pour modèle Pialat ou, plus près de nous, Cantet ou Kechiche, qu'en est-il des notions de temps, de flux et d'épuisement du plan ?
Surtout, sur quoi et comment porte son regard ? L'actrice-réalisatrice s'est réservée le rôle d'une photographe intégrée provisoirement à la brigade (inutile de penser à Depardon, la piste ne mène nulle part). Or, son personnage ne sort pas un mot, ou presque, de tout le film. Cette fille n'est là que, d'une part, pour jouer la love story avec Joey et, d'autre part, pour servir de relai au spectateur découvrant ce monde particulier. Et encore le fait-elle mollement, sans conviction. Ses photos ? Nous n'en verrons aucune. L'absence cruelle de point de vue se ressent également à un autre niveau. La caméra colle tout d'abord aux basques des policiers, puis ce pacte est brisé lorsque sont mis en scène des moments qui sont extérieurs à la vie de l'équipe, des représentations d'abus s'intercalant alors jusqu'au dénouement, ahurissant point d'orgue en montage alterné d'une entreprise perdue d'avance puisque son initiatrice n'avait finalement rien d'autre à dire que "détruire l'enfance, c'est mal" et "le métier de policier est difficile".
Polisse est un reportage mal dramatisé soumis au nivellement formel et moral télévisuel. L.627 est un film de cinéma. Il y a près de vingt ans de cela, il suscita lui aussi nombre de débats et son authenticité fut également saluée par les policiers. Mais Bertrand Tavernier, lui, ne s'arrêtait pas là. Sur la représentation de la police (et des délinquants) à l'écran, sur la frontière poreuse entre documentaire et fiction, sur la valeur d'une image, le cinéaste exprime des choses que Maïwenn est à cent lieues de laisser percevoir tant son abdication sur la forme est totale.
Ici aussi le spectateur trouve un relai avec le personnage joué par un excellent Didier Bezace. Mais le respect de ce point de vue est strict et devient clairement celui de Tavernier. L'introduction à un groupe n'a rien d'artificiel : notre homme n'est pas un "bleu", c'est un nom connu dans la police, la première demi-heure étant d'ailleurs consacrée, de façon assez audacieuse sur le plan narratif, à illustrer ses déboires, ses renvois d'une brigade à l'autre, avant qu'il ne se pose à l'endroit attendu. Et cet endroit, il est vu à travers son regard seulement (ajoutons que l'homme est passionné de vidéo et que nous le voyons, à un moment, en mission, s'arrêter de filmer une scène de rue parce que son acte tourne au voyeurisme). Tavernier n'éclaire qu'une intimité, celle de son personnage principal, sans pour autant tout en dire, tout expliquer. Des zones d'ombre subsistent partout, des histoires ne sont pas bouclées.
La progression dramaturgique est remarquable, ménageant des pauses musicales et s'appuyant sur un découpage judicieux. Le professionnel et l'intime alternent à l'écran et l'un influe sur l'autre souterrainement et non pas lourdement pour fournir des explications faciles à des situations inconfortables (pas d'équivalent chez Tavernier au "fœtus de Marina"). De belle manière ces deux flux se rejoindront dans la dernière scène, ponctuant la montée d'une sensation de pessimisme et de lassitude.
Les dérives, pour Tavernier, ne tiennent pas seulement au manque de moyens, à la compétition entre les polices et à la pesanteur hiérarchique. Les hommes ne sont pas dédouanés. Chez lui, la complexité et l'ambivalence doivent être dans le plan lui-même et non pas advenir par l'assemblage scolaire de deux séquences opposées. Par exemple, les bons mots, qui encombrent un peu, il est vrai, le début du film (l'argot parlé par les policiers sonne plus ou moins bien selon les acteurs), le cinéaste s'abstient de toujours les mettre en avant, de toujours finir ses plans avec eux. De plus, il laisse ceux qui, assurément, sont navrants. Plus significativement encore, on peut différencier la façon dont Maïwenn court immédiatement vers les moments les plus forts, les plus édifiants, de celle dont Tavernier garde les séquences qui ne font rien avancer dramatiquement et qui n'ont aucune valeur d'exemple. Les scènes d'action (et il y en a plusieurs dans L.627) sont filmés à la bonne distance et ne sont pas "dramatisées" : ce n'est jamais un seul personnage qui en porte la charge, aucun n'est mis ainsi en valeur par un coup de scénario.
Enfin, disons que filmer la brigade de protection des mineurs est peut-être plus douloureux sur le plan personnel mais bien moins périlleux sur ceux de la morale, du social et du politique, que s'attacher à décrire le travail des stups. Dans Polisse, un sale pédophile friqué se prend une torgnole. Dans L.627, des dealers, noirs et arabes, ne cessent d'encaisser des coups. Maïwenn termine son film avec un beau slogan en image : "Un flic s'éteint. Un enfant renaît." Tavernier, lui, le fait en laissant la route et la ville s'éloigner sous les yeux de son personnage noyé dans la pénombre à l'arrière de son Trafic.
(*) : On appréciera d'autant plus la détonnante sortie de Pierre Murat dans le Télérama de cette semaine, à l'occasion de la sortie de la comédie Intouchables : "Décidément, 2011 risque d'être une sale année pour les fans du cinéma français qui croient encore à la mise en scène. Il y en avait peu dans La guerre est déclarée. Presque pas dans Polisse. Et plus du tout ici. D'accord, on a parfaitement le droit de prôner, désormais, un cinéma où le cinéma n'a plus de raison d'être. Mais alors, il faut se l'avouer et le dire."
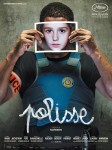
 POLISSE
POLISSE
de Maïwenn Le Besco
(France / 127 min / 2011)
L.627
de Bertrand Tavernier
(France / 145 min / 1992)
| Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : le besco, tavernier, france, polar, 2010s, 90s |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Commentaires
Ce que tu dis de Polisse confirme mes craintes, j'attendrai de voir ce film par des moyens non-coûteux pour, je le crains donc, le détester...
Écrit par : Rémi | 07.11.2011
Quelle tronche de merde elle a, quand même, cette Malwënne ! POuaaaaaaaaarshargh !!
Écrit par : Robert Obscène | 07.11.2011
Je trouve Murat vraiment casse bonbon avec sa manière de décréter ce qui est du cinéma et ce qui n'en est pas, et sa vision hyper relou de ce que serait la "misenscène".
Mais bon, il faut bien avouer que pour le coup Maïwenn fait fort dans le genre zéro mise en scène zéro regard zéro point de vue, avec du coup une naïveté qui vire à l'indécence 2 fois sur 3. Je crois que la blogosphère fait bien son boulot avec ce film et permet de tempérer les ardeurs bizarres de la critique (et pourquoi les Inrocks publient toujours la critique positive de Kaganski quand presque tous ses collègues ont détesté, je ne saisis pas...).
Je n'ai jamais vu L627 mais tu me donnes envie !
Écrit par : Anna | 07.11.2011
Dans l'mille, again, l'Ed. Bravo mon p'tit père.
Écrit par : mariaque | 07.11.2011
Rémi : Prends ton temps...
Anna : Je ne suis pas un admirateur de la plume (ou des idées sur le cinéma) de Murat, mais j'ai été heureux de lire ces quelques lignes, tant nous avons été noyés dans l'unanimisme critique autour de ces films.
La raison du choix des Inrocks ? attends, je cherche... euh... c'est plus vendeur, peut-être... :)
Mariaque : Merci l'ami.
Écrit par : Edouard | 07.11.2011
Maïween devrait déjà commencer à éviter de parasiter son film en filmant son nombril, ça nous ferait des vacances !
Écrit par : FredMJG | 07.11.2011
Je ne l'ai pas vu, je n'irai pas le voir puisque ça m'a l'air de ressembler à du cinéma comme moi à une danseuse de ballet et que tout ce que je lis d'un tant soit peu sérieux me confirme dans cette idée.
Mais tes premières lignes viennent renforcer l'état de mes réflexions à l'issue de la vision de L'Exercice de l'Etat. La voie est quand même ténue: l'art doit interroger, ne pas offrir une réponse toute faite, ouvrir mais ne pas simplement servir de prétexte à des débats - sociologiques ou autres (ce qui, souvent, correspond à la volonté des spectateurs qui regrettent que le traitement "abime" le sujet quand il faut aussi et pourtant que le sujet serve le traitement). Bref...
Enfin, bon, au moins Polisse, ça a l'air nul.
Écrit par : Antoine | 07.11.2011
Fred : Quoique, voir vraiment son nombril aurait sans doute été plus intéressant...
Antoine : Maïwenn, manifestement, la question de cette voie étroite, elle ne se l'est pas poséé. Elle a proposé un témoignage, en l'habillant d'une esthétique pseudo-réaliste, d'un filmage "à l'estomac", pour un résultat supposé bouleverser, émouvoir, révolter, faire rire pour décompresser, mais jamais réfléchir (au fait, dans Polisse, à aucun moment n'est remise en question cette triple règle : un accusé ment forcément, une victime dit la vérité, un flic a bon fond).
Écrit par : Edouard | 08.11.2011
Nous sommes d'accord sur le film de Maïwenn, moins sur celui de Tavernier que j'avais trouvé aussi extrêmement moralisateur et adoptant sans vergogne un point de vue flic assez déplaisant (comme dans son très médiocre "L'appat")
Écrit par : Dr Orlof | 08.11.2011
Tavernier adopte le point de vue d'UN flic. Et l'aspect moralisateur, je ne le ressens pas. Par exemple le personnage de Bezace traque les dealers, s'emporte de voir sa "copine" s'enfoncer dans la dope etc. mais la souplesse du jeu et de la mise en scène, la complexité des caractères font que cela n'apparaît jamais comme un gros message à faire passer au spectateur. Il n'y a pas de moments "édifiants" dans le film, à l'inverse du Maïwenn.
PS : tu veux me faire revoir L'appât ou quoi ? :)
Écrit par : Edouard | 08.11.2011
Oui, c'était bien, "L'appât", mais Tavernier c'est (presque) toujours bien :)
Écrit par : Vincent | 09.11.2011
Essentiellement d'accord avec vous sur ce film, en particulier quand vous demandez : "qu'en est-il des notions de temps, de flux et d'épuisement du plan ?", et suis assez stupéfait aussi par l'absence totale de "dynamique cinématographique". La question du temps ne pardonne pas, et le film porte haut la confusion entre excitation/agitation (alignement des climax supposés de chaque scène envisagée) et énergie dont le film me semble en fait profondément dépourvu, c'est ce qui m'aura le plus surpris vu le buzz médiatique.
"L.627" est trop loin pour moi, mais je suppose que je le reverrai.
Tout cela dit, Maïwenn se plante complet, mais je ne partage pas la détestation qui s'exprime aussi volontiers à son égard. Je trouve d'ailleurs votre texte d'autant plus pertinent qu'il se passe de cette béquille.
Écrit par : D&D | 11.11.2011
D&D : Comme je n'ai vu aucune autre réalisation de Maïwenn, que je ne sais pas si je l'ai déjà vu jouer ailleurs, que je n'ai pas lu d'entretiens sur Polisse et, surtout, que je ne regarde aucune émission de télé à part une qui ne traite que de football, je n'ai pas de raison de m'acharner sur cette personne au-delà de son (mauvais) film...
Je n'ai écouté que ces jours-ci le Masque et la Plume d'il y a deux semaines et j'ai été plutôt soulagé d'entendre enfin, venant d'une partie de la critique, de sérieuses réserves sur Polisse, sur sa prétendue "vérité", sur sa mise en scène à base de pics émotionnels, sur sa complaisance avec le métier etc.
Écrit par : Edouard | 11.11.2011
Voilà, je peux tout à fait concevoir qu'on puisse ne pas aimer ce film, mais j'ai l'impression en lisant les critiques négatives de retrouver les mêmes accusations et, je me trompe peut être, une sorte d'acharnement à vouloir lui trouver des reproches, parce que c'est un film qui a eu du succès auprès du grand public, parce que tout le monde crie trop vite au génie etc... Vous reprochez le coté manichéen et la facilité avec laquelle la réalisatrice essaie d'enjoliver les choses, par exemple la scène des enfants roms, mais je prend justement celle ci en exemple parce que j'ai vu le reportage à l'origine du film et... le coup des enfants qui dansent dans le bus après avoir été séparé de leurs familles a dû marquer la réalisatrice puisque que cet épisode est en tout point inspiré du reportage. On retrouve d'ailleurs beaucoup de ce reportage, de France 3 je crois...
Ce n'est certainement pas un grand film mais c'est un film franchement intéressant voir passionnant non pas par sa mise en scène mais parce qu'il touche un sujet assez méconnu qui fait que à la limite, on s'en fiche que le résultat donne un simili documentaire, que des éléments beaucoup trop prévisibles, que Maiwenn se soit carrément mise en scène autour d'une histoire d'amour totalement inintéressante, il n'y a pas de mauvais jeu d'acteur et c'est un film qui a au moins le mérite de faire discuter les gens à la sortie. Il est fait pour ça à l'origine, encore une foi, c'est un aspect que l'on peut critiquer.
Écrit par : Avis | 16.01.2012
Si l'on trouve dans les critiques négatives à l'encontre de Polisse les "mêmes accusations", c'est peut-être parce qu'elles sont fondées. En tout cas, ce n'est certainement pas l'envie de taper sur un film qui marche qui a motivé ma note (et celles que j'ai pu lire par ailleurs). Il y a trop de films à voir pour que je perde mon temps à ce petit jeu.
Si j'ai été voir Polisse, c'est parce que je pensais y trouver quelque intérêt. Or il n'en a rien été.
Vous parlez du reportage d'origine de France 3. Je ne l'ai pas vu et je ne savais pas qu'il existait. Mais un reportage peut aussi être mauvais, malvenu, orienté etc...
Le mérite de faire discuter les gens, je l'ai souligné au début de mon texte. Mais c'est bien le seul de Polisse. Donc, à partir de là, peut-on parler de cinéma ? Si il n'y a pas de mise en scène, si tout est prévisible, si le jeu d'acteur se limite à un numéro réaliste, si l'approche est faussement documentaire, que reste-t-il ?
On peut estimer que le cinéma est un moyen comme un autre de faire passer l'information, mais ce n'est alors pas le cinéma qui me concerne. Pour m'informer aussi basiquement, je passe par d'autres canaux. De toute façon, je pense que Maïwenn se pense en grande cinéaste, dans la lignée de Pialat par exemple, fière de dégager une énergie. Il faut donc aussi juger son film d'un point de vue esthétique et moral. Et là il devient, à mon sens, affligeant...
Écrit par : Edouard | 16.01.2012
Il s'agissait d'un reportage sans prétention, qui n'apportait aucune réponse et ne soulevait pas de question particulières, juste un enchainement des affaires les plus courantes rencontrées à la brigade des mineurs. Ce qui est le but du film j'imagine. En plus de mettre au premier plan un sujet méconnu (dur de trouver des informations intéressantes sur ce sujet en particulier) mais je ne limite évidemment pas le cinéma à la seule possibilité de transmettre une information.
Vos critiques sont pertinentes, mais je pense qu'il faut nuancer.
Écrit par : Avis | 19.01.2012
Sans doute le manque de "nuances" d'un côté (l'enthousiasme de plusieurs journaux), entraîne la même chose de l'autre côté. Mais quand un film exaspère, il faut le dire...
Et encore une fois, ce que vous me dites là ne fait que confirmer ce que je pensais : certes Polisse existe pour faire prendre conscience de dures réalités à un plus grand nombre de personnes mais, à mon sens, il ne propose rien de plus que le reportage dont vous parlez, signe d'un "échec de cinéma".
Écrit par : Edouard | 20.01.2012