
Commençons par la fin. Le policier se termine sur une confrontation, mais dans laquelle l'un des deux antagonistes reste en position dominante. L'insistance sur son regard, dirigé vers l'autre, a pour but de faire naître sans doute le sentiment d'une prise de conscience. Le dernier plan est pour lui, comme l'est le titre du film, qui ne s'appelle pas Le policier et la terroriste.
Pourtant, la construction s'affiche en deux panneaux, deux parties successives et bien distinctes, dont les ingrédients ne se voient mêlés que dans une troisième. La synthèse succède ainsi à la thèse et à l'antithèse. Il me semble cependant que, au-delà des détails que j'ai évoqués en introduction, l'édifice est déséquilibré.
La première partie est très supérieure à la deuxième. On y sent une adéquation entre la rigueur de la mise en scène (espace et temps) et la description d'une vie placée sous le signe unique du rite social. Si le membre de la brigade israélienne anti-terroriste qui nous est longuement présenté n'est pas montré en action mais avec sa femme enceinte, sa famille et ses amis (qui sont aussi ses collègues), ses activités domestiques ou de loisirs s'avèrent aussi ritualisées que son travail. Par ce seul biais du quotidien, le cinéaste montre très bien la puissance d'une idéologie particulière, fondée sur le conservatisme, le sens de l'honneur, le machisme, la virilité, le culte du corps, l'esprit de groupe. En apparence chaleureux (soins tendres prodigués à l'épouse, tapes amicales et incessantes dans le dos des copains, amitiés indéfectibles), le portrait du policier laisse peu à peu deviner l'envers du tableau et finit par faire froid dans le dos, la rigidité, déjà peu attirante, du bonhomme masquant des arrangements moraux plus détestables encore. Cette sensation culminerait avec l'affreux "gag" du collègue cancéreux tabassant, bien après les autres, le temps d'arriver essouflé, le voleur de fleurs du cimetière. Nul doute qu'à travers son personnage de policier c'est la société elle-même que cherche à démasquer Nadav Lapid.
Il continue dans la deuxième partie. Seulement, en voulant celle-ci en miroir, il impose un discours qui paraissait jusque là plus subtil. Délaissant son flic, il s'intéresse à quatre gauchistes décidés à passer à la lutte armée contre les riches. Cette fois, la vacuité de l'action est évidente, pointée dès le départ. Ces jeunes révolutionnaires bien nés, se réunissant dans le loft luxueux de parents, nous sont tout de suite antipathiques. Le regard de Lapid est trop distant et comme sa méthode reste la même, les états d'âme et les préparatifs du commando deviennent assez mornes. La réflexion n'est plus prolongée par la mise en scène, l'image ne disant rien de plus que ce qu'elle montre.
Le film a alors du mal à repartir avec sa troisième et dernière partie, longue et froide. Froide alors qu'elle aurait dû être réchauffée par quelque émotion ou bien, à l'opposé, complètement glaçante (la "politique-fiction" est peut-être trop évidente pour que l'on soit véritablement bouleversé ou sidéré). Voulant établir, sous un angle assez original, un constat inquiétant sur les maux endémiques de son pays, Nadav Lapid, qui ne semble pas manquer de talent, s'est fait en partie piégé par son appareil théorique.
****
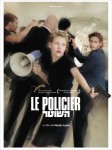 LE POLICIER (Ha-shoter)
LE POLICIER (Ha-shoter)
de Nadav Lapid
(Israël / 105 min / 2011)
 Bien qu'il me fut chaudement recommandé, je dois dire que Lebanon m'a laissé pour le moins circonspect. Le dernier Lion d'or de Venise est un film "à dispositif", la place de la caméra y étant strictement circonscrite à l'intérieur d'un tank. Les seules images de l'extérieur nous viennent du viseur de l'un des quatre membres de cet équipage partant en opération au premier jour de la guerre du Liban (en 1982).
Bien qu'il me fut chaudement recommandé, je dois dire que Lebanon m'a laissé pour le moins circonspect. Le dernier Lion d'or de Venise est un film "à dispositif", la place de la caméra y étant strictement circonscrite à l'intérieur d'un tank. Les seules images de l'extérieur nous viennent du viseur de l'un des quatre membres de cet équipage partant en opération au premier jour de la guerre du Liban (en 1982). En un long plan-séquence serré, Amos Gitai filme Natalie Portman en pleurs, assise à l'arrière d'une voiture, au son d'une chanson israélienne jouant sur la répétition des phrases. Les premières minutes de Free Zone sont aussi radicales que l'étaient les dernières du Vive l'amour de Tsai Ming-liang (1994) où l'on voyait de même une femme se mettre à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Ici, les gestes de l'actrice américaine qui, en essuyant ses joues perd son maquillage, prennent la forme d'un dépouillement des artifices, nécessaire à l'immersion d'une figure occidentale dans la réalité brute du Proche-Orient. En imposant ce dispositif d'emblée, le cinéaste accroche le spectateur mais, en ne s'y tenant pas exclusivement par la suite, prend le risque de relâcher la pression.
En un long plan-séquence serré, Amos Gitai filme Natalie Portman en pleurs, assise à l'arrière d'une voiture, au son d'une chanson israélienne jouant sur la répétition des phrases. Les premières minutes de Free Zone sont aussi radicales que l'étaient les dernières du Vive l'amour de Tsai Ming-liang (1994) où l'on voyait de même une femme se mettre à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Ici, les gestes de l'actrice américaine qui, en essuyant ses joues perd son maquillage, prennent la forme d'un dépouillement des artifices, nécessaire à l'immersion d'une figure occidentale dans la réalité brute du Proche-Orient. En imposant ce dispositif d'emblée, le cinéaste accroche le spectateur mais, en ne s'y tenant pas exclusivement par la suite, prend le risque de relâcher la pression. Si la frontière entre documentaire et fiction a été, dès le départ, arpentée par bien des cinéastes, on assiste depuis plusieurs années à une flambée de projets mêlant indissociablement les deux registres, le spectre allant des pires docu-fictions télévisées aux oeuvres les plus originales de grands documentaristes. Dans son programme, le festival de Cannes 2008 nous promettait vaguement un "documentaire d'animation" en sélection officielle. Au final, Valse avec Bachir surprenait tout le monde (sauf le jury cannois) et s'imposait comme l'un des grands films de l'année écoulée, dépassant totalement son statut initial de curiosité cinématographique...
Si la frontière entre documentaire et fiction a été, dès le départ, arpentée par bien des cinéastes, on assiste depuis plusieurs années à une flambée de projets mêlant indissociablement les deux registres, le spectre allant des pires docu-fictions télévisées aux oeuvres les plus originales de grands documentaristes. Dans son programme, le festival de Cannes 2008 nous promettait vaguement un "documentaire d'animation" en sélection officielle. Au final, Valse avec Bachir surprenait tout le monde (sauf le jury cannois) et s'imposait comme l'un des grands films de l'année écoulée, dépassant totalement son statut initial de curiosité cinématographique... Valse avec Bachir (Waltz with Bashir) est, au départ, un documentaire, auquel s’ajoutent des séquences de rêves et de souvenirs, de fiction donc, le tout étant soumis, chacun le sait maintenant, au traitement du cinéma d'animation. Documentaire et fiction : le voisinage de ces deux termes au sein d’une oeuvre cinématographique est toujours extrêmement délicat à manier. Il se trouve qu'ils sont ici dépassés, neutralisés et unifiés par le troisième, l'animation. Quelque chose d'unique se produit sous nos yeux (comme tout le monde, sans en être totalement sûr, je suppose qu’Ari Folman agit en précurseur et crée un nouveau genre) : la question de la frontière entre réalité et fiction ne se pose absolument pas, l'entremêlement des divers registres n’est jamais un problème. Avant la projection, je croyais que le mode d’expression choisi permettait à l’auteur de toucher le non-représentable. Or, il ne s’agit pas vraiment de trouver une autre voie pour approcher l'insoutenable (la guerre et les massacres). Les images dessinées de Valse avec Bachir ne brisent pas de tabou et la violence qu'elles montrent ne va pas au-delà des limites de la représentation habituelle. Non, l'intérêt est ailleurs : dans la création d'un objet esthétique singulier et cohérent, qui agrège des éléments aussi disparates que des entretiens enregistrés, des récits de guerre et des cauchemars. Valse avec Bachir, c'est une certaine ambiance, une certaine lumière.
Valse avec Bachir (Waltz with Bashir) est, au départ, un documentaire, auquel s’ajoutent des séquences de rêves et de souvenirs, de fiction donc, le tout étant soumis, chacun le sait maintenant, au traitement du cinéma d'animation. Documentaire et fiction : le voisinage de ces deux termes au sein d’une oeuvre cinématographique est toujours extrêmement délicat à manier. Il se trouve qu'ils sont ici dépassés, neutralisés et unifiés par le troisième, l'animation. Quelque chose d'unique se produit sous nos yeux (comme tout le monde, sans en être totalement sûr, je suppose qu’Ari Folman agit en précurseur et crée un nouveau genre) : la question de la frontière entre réalité et fiction ne se pose absolument pas, l'entremêlement des divers registres n’est jamais un problème. Avant la projection, je croyais que le mode d’expression choisi permettait à l’auteur de toucher le non-représentable. Or, il ne s’agit pas vraiment de trouver une autre voie pour approcher l'insoutenable (la guerre et les massacres). Les images dessinées de Valse avec Bachir ne brisent pas de tabou et la violence qu'elles montrent ne va pas au-delà des limites de la représentation habituelle. Non, l'intérêt est ailleurs : dans la création d'un objet esthétique singulier et cohérent, qui agrège des éléments aussi disparates que des entretiens enregistrés, des récits de guerre et des cauchemars. Valse avec Bachir, c'est une certaine ambiance, une certaine lumière. Séance de rattrapage du film-surprise de la fin de l'année dernière. Un peu partout ont été salués, à juste titre, la finesse du traitement, la qualité de l'interprétation, l'humour pointilliste et la belle manière de dire beaucoup à partir de trois fois rien. L'éclatante réussite du premier film d'Eran Kolirin tient d'abord à la volonté de confronter non pas deux cultures, mais des solitudes. Aucune allusion politique directe n'est faîte. Ce ne sont que des histoires personnelles qui s'échangent.
Séance de rattrapage du film-surprise de la fin de l'année dernière. Un peu partout ont été salués, à juste titre, la finesse du traitement, la qualité de l'interprétation, l'humour pointilliste et la belle manière de dire beaucoup à partir de trois fois rien. L'éclatante réussite du premier film d'Eran Kolirin tient d'abord à la volonté de confronter non pas deux cultures, mais des solitudes. Aucune allusion politique directe n'est faîte. Ce ne sont que des histoires personnelles qui s'échangent.