**
Pour prolonger mes vacances à Rome... quoique, dans ce film, on n'apprend pas grand chose sur la vie quotidienne au premier siècle de notre ère. Pas vraiment le but non plus. Les connaissances restent de toute façon tellement lacunaires, au-delà des aspects matériels, que pour représenter l'époque à l'écran, l'une des meilleures voies reste celle de l'imaginaire et du fantasme, ce qu'avait déjà compris Fellini pour Satyricon. Caligula (version "intégrale", "pornographique", la première distribuée et reniée par presque tous les participants, si j'ai bien compris l'histoire compliquée d'après tournage) est moins poétique et mystérieux (une succession de tableaux grandioses, fermés sur eux-mêmes et montrés frontalement, là où la caméra de Fellini glissait vers des ouvertures insoupçonnées pour donner à voir l'univers entier) mais son étrangeté accroche suffisamment. Les inserts hard ont finalement leur logique puisque l'excès est ici la règle et qu'ils rajoutent encore de l'impureté. Par ailleurs, de manière assez "honnête", ils produisent un jeu de champ-contrechamp : soit les actes sont regardés par les personnages principaux, soit ils redoublent les leurs (le montage alterné entre les caresses soft de McDowell, Mirren et Savoy et, de l'autre côté du mur, les léchouilles non simulées de deux actrices Penthouse). La violence va, elle aussi, au plus loin, lors de séquences me semblant beaucoup plus apparentées aux "passions" contées par le Marquis de Sade qu'à des sources antiques (mais là aussi, je peux me tromper). L'une des limites du film (dans cette version ?), est de laisser le personnage de Caligula assez impénétrable, même si ses rapports esquissés avec son premier allié, Macron (mdr), puis la femme qu'il se choisit (Helen Mirren très bien), sont intéressants. Quant à l'aspect politique, le fait que le pouvoir absolu mène à la folie est une évidence. Forcément inégale, à jamais inaboutie, follement ambitieuse, tiraillée de toutes parts, originale mais renvoyant constamment à d'autres images (Fellini, Pasolini, Borowczyk, Oshima, Jancso, le gore et le X des années 70...) la chose est à voir (j'aurais mis le temps !) si l'on a l'estomac solide.
 Under fire de Roger Spottiswoode est l'un des films de reporters les plus solides (un genre assez prisé à l'époque, de L'année de tous les dangers à Salvador), qui doit beaucoup à son scénario et ses interprètes : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy et Jean-Louis Trintignant en grand manipulateur. Un léger mais bon souvenir enrobe le documentaire (découvert plus tard à la télévision) co-signé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Mississippi blues, une ballade musicale dans le sud des Etats-Unis, à la rencontre de populations délaissées. Et c'est à peu près tout pour les films connus de mes services... Je pense seulement avoir vu (à la faveur d'une diffusion TV ?), sans émotion particulière, le Pinot simple flic de Jugnot (première réalisation de l'ex-Splendid, avec une Fanny Bastien qui bouleversait alors nos sens de pré-ados).
Under fire de Roger Spottiswoode est l'un des films de reporters les plus solides (un genre assez prisé à l'époque, de L'année de tous les dangers à Salvador), qui doit beaucoup à son scénario et ses interprètes : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy et Jean-Louis Trintignant en grand manipulateur. Un léger mais bon souvenir enrobe le documentaire (découvert plus tard à la télévision) co-signé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Mississippi blues, une ballade musicale dans le sud des Etats-Unis, à la rencontre de populations délaissées. Et c'est à peu près tout pour les films connus de mes services... Je pense seulement avoir vu (à la faveur d'une diffusion TV ?), sans émotion particulière, le Pinot simple flic de Jugnot (première réalisation de l'ex-Splendid, avec une Fanny Bastien qui bouleversait alors nos sens de pré-ados).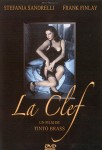 Qu'ai-je raté ? A priori, pas grand chose, si ce n'est quelques propositions italiennes. Il n'était bien évidemment pas question, à l'époque, d'aller voir l'interdit aux moins de 18 ans La clé, du sulfureux Tinto Brass (avec Stefania Sandrelli) mais aujourd'hui que je suis un peu plus mûr, j'irai bien jeter un coup d'oeil à travers la serrure. Mes chers amis N°2, toujours avec Philippe Noiret et Ugo Tognazzi, se fit moins remarqué que le premier volet (sorti en 1975) mais Mario Monicelli semblait y distiller encore quelques plaisirs. Quartetto Basileus (film sur la musique de Fabio Carpi) avait plusieurs défenseurs dans la presse, Rosa (vaudeville olé-olé de Salvatore Samperi, avec Laura Antonelli et Fernando Rey) beaucoup moins. Rattachons à ce groupe Gabriela (brésilien, de Bruno Barreto, avec Marcello Mastroianni et Sonia Braga).
Qu'ai-je raté ? A priori, pas grand chose, si ce n'est quelques propositions italiennes. Il n'était bien évidemment pas question, à l'époque, d'aller voir l'interdit aux moins de 18 ans La clé, du sulfureux Tinto Brass (avec Stefania Sandrelli) mais aujourd'hui que je suis un peu plus mûr, j'irai bien jeter un coup d'oeil à travers la serrure. Mes chers amis N°2, toujours avec Philippe Noiret et Ugo Tognazzi, se fit moins remarqué que le premier volet (sorti en 1975) mais Mario Monicelli semblait y distiller encore quelques plaisirs. Quartetto Basileus (film sur la musique de Fabio Carpi) avait plusieurs défenseurs dans la presse, Rosa (vaudeville olé-olé de Salvatore Samperi, avec Laura Antonelli et Fernando Rey) beaucoup moins. Rattachons à ce groupe Gabriela (brésilien, de Bruno Barreto, avec Marcello Mastroianni et Sonia Braga).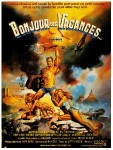 Curiosité du mois, l'affirmation d'un filon hip-hop : Beat street (Stan Lathan) et Break street 84 (Joel Silberg) tentent de rendre compte de la naissance du mouvement musical et culturel (ou de le récupérer ?). Les comédies proposées, à part peut-être Bonjour les vacances (d'Harold Ramis avec Chevy Chase, revu à la hausse par notre véhachessien voisin
Curiosité du mois, l'affirmation d'un filon hip-hop : Beat street (Stan Lathan) et Break street 84 (Joel Silberg) tentent de rendre compte de la naissance du mouvement musical et culturel (ou de le récupérer ?). Les comédies proposées, à part peut-être Bonjour les vacances (d'Harold Ramis avec Chevy Chase, revu à la hausse par notre véhachessien voisin 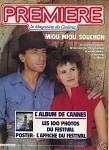 En ce mois de juin faiblard, hormis Positif (280) qui fait sa une sur Under fire, les revues prennent la tangente. Les Cahiers du Cinéma (360-361) parlent déjà de Paris, Texas et des films de Cannes, dans un numéro qui couvrira en fait tout l'été et Première (87) rencontre Miou Miou et Souchon à l'occasion d'un imminent Vol du sphinx. Les autres continuent à mettre en avant les films sortis fin mai : Notre histoire (Cinématographe, 101), La pirate (La Revue du Cinéma, 395), Il était une fois en Amérique (Starfix, 16, et Cinéma 84, 306).
En ce mois de juin faiblard, hormis Positif (280) qui fait sa une sur Under fire, les revues prennent la tangente. Les Cahiers du Cinéma (360-361) parlent déjà de Paris, Texas et des films de Cannes, dans un numéro qui couvrira en fait tout l'été et Première (87) rencontre Miou Miou et Souchon à l'occasion d'un imminent Vol du sphinx. Les autres continuent à mettre en avant les films sortis fin mai : Notre histoire (Cinématographe, 101), La pirate (La Revue du Cinéma, 395), Il était une fois en Amérique (Starfix, 16, et Cinéma 84, 306).