Adieu Octobre. Tournons la page et passons au chapitre suivant de notre album-souvenirs pour nous enquérir des sorties cinéma du mois de Novembre 1985 :
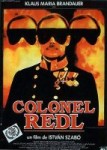 La récolte nous gratifie d'une cuvée de qualité assez élevée, riche d'arômes différents. Trois échantillons se détachent parmi ceux que j'ai pu goûter moi-même. A cette époque-là, Istvan Szabo atteignait le pic de sa renommée internationale grâce à son Colonel Redl, intensément porté par Klaus Maria Brandauer. Dans mon souvenir, ce récit de l'ascension et de la chute d'un militaire dans l'empire austro-hongrois du début du XXe constitue un film glacé et brûlant à la fois, faussement académique. Comme à son habitude, Michael Cimino avec L'année du dragon créait l'événement et la controverse, soupçonné qu'il était de complaisance dans sa façon de montrer la violence et de racisme anti-asiatique dans sa description de la mafia régnant sur Chinatown. Personnellement, nous y vîmes surtout un polar d'une puissance inégalable. Ce que nous ne savions pas, c'est que celui-ci serait le dernier grand film du cinéaste. Tangos, l'exil de Gardel fut pour nous une très belle découverte - bientôt prolongée par celle, toute aussi réjouissante du Sud (1988). Fernando E. Solanas tissait une toile complexe à partir de la création d'un spectacle de tango à Paris. Les niveaux de lectures se multipliaient au gré des allers-retours géographiques et temporels, dans un mélange de genres où l'on nous entretenait à la fois des tracas des éxilés argentins et de la persistance du fantôme de Gardel.
La récolte nous gratifie d'une cuvée de qualité assez élevée, riche d'arômes différents. Trois échantillons se détachent parmi ceux que j'ai pu goûter moi-même. A cette époque-là, Istvan Szabo atteignait le pic de sa renommée internationale grâce à son Colonel Redl, intensément porté par Klaus Maria Brandauer. Dans mon souvenir, ce récit de l'ascension et de la chute d'un militaire dans l'empire austro-hongrois du début du XXe constitue un film glacé et brûlant à la fois, faussement académique. Comme à son habitude, Michael Cimino avec L'année du dragon créait l'événement et la controverse, soupçonné qu'il était de complaisance dans sa façon de montrer la violence et de racisme anti-asiatique dans sa description de la mafia régnant sur Chinatown. Personnellement, nous y vîmes surtout un polar d'une puissance inégalable. Ce que nous ne savions pas, c'est que celui-ci serait le dernier grand film du cinéaste. Tangos, l'exil de Gardel fut pour nous une très belle découverte - bientôt prolongée par celle, toute aussi réjouissante du Sud (1988). Fernando E. Solanas tissait une toile complexe à partir de la création d'un spectacle de tango à Paris. Les niveaux de lectures se multipliaient au gré des allers-retours géographiques et temporels, dans un mélange de genres où l'on nous entretenait à la fois des tracas des éxilés argentins et de la persistance du fantôme de Gardel.
D'autres noms présents sur la liste du mois retiennent l'attention. Si Nikita Mikhalkov n'avait pas encore le statut que ses films de la fin des années 70 (Partition inachevée..., Cinq soirées, Oblomov...) auraient déjà dû lui conférer, il ne lui restait que quelques mois à patienter (Les yeux noirs, 1987). Pour l'heure, nous arrivait tardivement sa comédie satirique de 81, La parentèle. Raymond Depardon avec Une femme en Afrique (Empty quarter) gardait son regard documenté mais se frottait cette fois-ci à la fiction. Wim Wenders, lui, faisait le chemin inverse et livrait son journal filmé, sur les traces de Yasujiro Ozu, Tokyo-Ga. La sortie d'un nouveau film de Nelson Pereira dos Santos, Mémoires de prison, sur la lutte de l'écrivain Graciliano Ramos sous la dictature Vargas pendant les années 30, était accompagnée de celle de Rio, Zone Nord, classique de 1957 mêlant social et samba et annonçant le Cinema Novo des années 60 dont le cinéaste allait être l'un des fers de lance. Ce dernier titre n'était d'ailleurs pas le seul à être tiré de l'oubli par les distributeurs puisque Corbeaux et moineaux de Zheng Junli, incunable de 1949, refaisait également surface. Tourné à Shanghaï, dans une période particulièrement troublée de l'histoire chinoise, ce remarquable film choral avait déjà retenu les leçons du néoréalisme italien et faisait preuve, vu le contexte, d'une étonnante justesse.
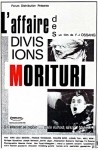 Deux premiers films français singuliers trouvaient à se faufiler dans le programme chargé du mois : L'affaire des divisions Morituri, manifeste post-punk de F.J. Ossang et L'amour ou presque, rappel du réalisme poétique par Pierre Gautier. Le temps détruit de Pierre Beuchot, basé sur la lecture de lettres écrites par les soldats Maurice Jaubert, Paul Nizan et Roger Beuchot, plongés dans la drôle de guerre de 39-40 et Vertiges de Christine Laurent, un jeu entre théâtre et réalité autour des Noces de Figaro de Mozart, pouvaient également piquer la curiosité. En revanche, un tri plus sélectif était sans doute à faire entre Le voyage à Paimpol (drame ouvrier de John Berry avec Myriam Boyer et Michel Boujenah), Le transfuge (de Philippe Lefebvre, film d'espionnage avec Bruno Cremer), Une femme ou deux (de Daniel Vigne, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver, une comédie sur fond de paléontologie), Les bons débarras (drame canadien de Francis Mankiewicz), L'homme aux yeux d'argent (policier de Pierre Granier-Deferre), Lune de miel (de Patrick Jamain, un thriller franco-canadien qui suit Nathalie Baye à New York) et Passage secret (de Laurent Perrin). De mon côté, j'eus la joie de découvrir en ce temps-là trois films que je ne suis guère enclin à revisiter : Rouge baiser ou l'itinéraire sentimentalo-politique d'une jeune femme des années 50 filmé par Véra Belmont (turbulences adolescentes obligent, je tombais amoureux d'une nouvelle actrice tous les mois : en novembre, elle se nommait Charlotte Valandrey), Scout toujours, deuxième réalisation plutôt anecdotique de Gérard Jugnot, et La cage aux folles III, "Elles" se marient, grosse farce de Georges Lautner, suite très dispensable des aventures du couple Serrault-Tognazzi.
Deux premiers films français singuliers trouvaient à se faufiler dans le programme chargé du mois : L'affaire des divisions Morituri, manifeste post-punk de F.J. Ossang et L'amour ou presque, rappel du réalisme poétique par Pierre Gautier. Le temps détruit de Pierre Beuchot, basé sur la lecture de lettres écrites par les soldats Maurice Jaubert, Paul Nizan et Roger Beuchot, plongés dans la drôle de guerre de 39-40 et Vertiges de Christine Laurent, un jeu entre théâtre et réalité autour des Noces de Figaro de Mozart, pouvaient également piquer la curiosité. En revanche, un tri plus sélectif était sans doute à faire entre Le voyage à Paimpol (drame ouvrier de John Berry avec Myriam Boyer et Michel Boujenah), Le transfuge (de Philippe Lefebvre, film d'espionnage avec Bruno Cremer), Une femme ou deux (de Daniel Vigne, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver, une comédie sur fond de paléontologie), Les bons débarras (drame canadien de Francis Mankiewicz), L'homme aux yeux d'argent (policier de Pierre Granier-Deferre), Lune de miel (de Patrick Jamain, un thriller franco-canadien qui suit Nathalie Baye à New York) et Passage secret (de Laurent Perrin). De mon côté, j'eus la joie de découvrir en ce temps-là trois films que je ne suis guère enclin à revisiter : Rouge baiser ou l'itinéraire sentimentalo-politique d'une jeune femme des années 50 filmé par Véra Belmont (turbulences adolescentes obligent, je tombais amoureux d'une nouvelle actrice tous les mois : en novembre, elle se nommait Charlotte Valandrey), Scout toujours, deuxième réalisation plutôt anecdotique de Gérard Jugnot, et La cage aux folles III, "Elles" se marient, grosse farce de Georges Lautner, suite très dispensable des aventures du couple Serrault-Tognazzi.
 Nous et l'ensemble du grand public étions mieux récompensés par Cocoon signé d'un Ron Howard renouvelant alors la bonne pêche de Splash en contant cette fois-ci l'histoire de trois vieillards (Hume Cronyn, Wilford Brimley et Don Ameche) qui trouvent une seconde jeunesse dans une eau régénérée par des cocons extraterrestres, ainsi que par Fletch aux trousses de Michael Ritchie, polar décontracté bénéficiant de l'abattage de Chevy Chase. Mais nous l'étions sans doute un peu moins par Harem d'Arthur Joffé (ou les aventures exotiques et romantiques de Ben Kingsley et Nastassja Kinski) et Taram et le chaudron magique de Ted Berman et Richard Rich (un Walt Disney lorgnant vers la fantasy). Pour terminer, il serait dommage d'oublier de mentionner Le châtiment de la pierre magique de Tim Burstall, western en terre aborigène, Exterminator 2 de Mark Buntzmann et William Sachs, série B post-Vietnam prônant l'autodéfense dans les rues mal fréquentées de New York, Monkey Kung Fu contre le Cobra d'or de Joe Law ou Portés disparus n°2 : Pourquoi ? (c'est vrai ça, pourquoi ?) de Lance Hool, nouvelle croisade anti-jaunes de Chuck Norris.
Nous et l'ensemble du grand public étions mieux récompensés par Cocoon signé d'un Ron Howard renouvelant alors la bonne pêche de Splash en contant cette fois-ci l'histoire de trois vieillards (Hume Cronyn, Wilford Brimley et Don Ameche) qui trouvent une seconde jeunesse dans une eau régénérée par des cocons extraterrestres, ainsi que par Fletch aux trousses de Michael Ritchie, polar décontracté bénéficiant de l'abattage de Chevy Chase. Mais nous l'étions sans doute un peu moins par Harem d'Arthur Joffé (ou les aventures exotiques et romantiques de Ben Kingsley et Nastassja Kinski) et Taram et le chaudron magique de Ted Berman et Richard Rich (un Walt Disney lorgnant vers la fantasy). Pour terminer, il serait dommage d'oublier de mentionner Le châtiment de la pierre magique de Tim Burstall, western en terre aborigène, Exterminator 2 de Mark Buntzmann et William Sachs, série B post-Vietnam prônant l'autodéfense dans les rues mal fréquentées de New York, Monkey Kung Fu contre le Cobra d'or de Joe Law ou Portés disparus n°2 : Pourquoi ? (c'est vrai ça, pourquoi ?) de Lance Hool, nouvelle croisade anti-jaunes de Chuck Norris.

Voilà pour novembre 1985. La suite le mois prochain...
Pour en savoir plus : Taram et le chaudron magique, L'année du dragon et Portés disparus n°2 vus par Mariaque et encore L'année du dragon par Raphaël.
 Under fire de Roger Spottiswoode est l'un des films de reporters les plus solides (un genre assez prisé à l'époque, de L'année de tous les dangers à Salvador), qui doit beaucoup à son scénario et ses interprètes : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy et Jean-Louis Trintignant en grand manipulateur. Un léger mais bon souvenir enrobe le documentaire (découvert plus tard à la télévision) co-signé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Mississippi blues, une ballade musicale dans le sud des Etats-Unis, à la rencontre de populations délaissées. Et c'est à peu près tout pour les films connus de mes services... Je pense seulement avoir vu (à la faveur d'une diffusion TV ?), sans émotion particulière, le Pinot simple flic de Jugnot (première réalisation de l'ex-Splendid, avec une Fanny Bastien qui bouleversait alors nos sens de pré-ados).
Under fire de Roger Spottiswoode est l'un des films de reporters les plus solides (un genre assez prisé à l'époque, de L'année de tous les dangers à Salvador), qui doit beaucoup à son scénario et ses interprètes : Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy et Jean-Louis Trintignant en grand manipulateur. Un léger mais bon souvenir enrobe le documentaire (découvert plus tard à la télévision) co-signé par Bertrand Tavernier et Robert Parrish, Mississippi blues, une ballade musicale dans le sud des Etats-Unis, à la rencontre de populations délaissées. Et c'est à peu près tout pour les films connus de mes services... Je pense seulement avoir vu (à la faveur d'une diffusion TV ?), sans émotion particulière, le Pinot simple flic de Jugnot (première réalisation de l'ex-Splendid, avec une Fanny Bastien qui bouleversait alors nos sens de pré-ados).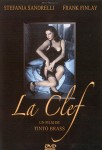 Qu'ai-je raté ? A priori, pas grand chose, si ce n'est quelques propositions italiennes. Il n'était bien évidemment pas question, à l'époque, d'aller voir l'interdit aux moins de 18 ans La clé, du sulfureux Tinto Brass (avec Stefania Sandrelli) mais aujourd'hui que je suis un peu plus mûr, j'irai bien jeter un coup d'oeil à travers la serrure. Mes chers amis N°2, toujours avec Philippe Noiret et Ugo Tognazzi, se fit moins remarqué que le premier volet (sorti en 1975) mais Mario Monicelli semblait y distiller encore quelques plaisirs. Quartetto Basileus (film sur la musique de Fabio Carpi) avait plusieurs défenseurs dans la presse, Rosa (vaudeville olé-olé de Salvatore Samperi, avec Laura Antonelli et Fernando Rey) beaucoup moins. Rattachons à ce groupe Gabriela (brésilien, de Bruno Barreto, avec Marcello Mastroianni et Sonia Braga).
Qu'ai-je raté ? A priori, pas grand chose, si ce n'est quelques propositions italiennes. Il n'était bien évidemment pas question, à l'époque, d'aller voir l'interdit aux moins de 18 ans La clé, du sulfureux Tinto Brass (avec Stefania Sandrelli) mais aujourd'hui que je suis un peu plus mûr, j'irai bien jeter un coup d'oeil à travers la serrure. Mes chers amis N°2, toujours avec Philippe Noiret et Ugo Tognazzi, se fit moins remarqué que le premier volet (sorti en 1975) mais Mario Monicelli semblait y distiller encore quelques plaisirs. Quartetto Basileus (film sur la musique de Fabio Carpi) avait plusieurs défenseurs dans la presse, Rosa (vaudeville olé-olé de Salvatore Samperi, avec Laura Antonelli et Fernando Rey) beaucoup moins. Rattachons à ce groupe Gabriela (brésilien, de Bruno Barreto, avec Marcello Mastroianni et Sonia Braga).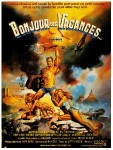 Curiosité du mois, l'affirmation d'un filon hip-hop : Beat street (Stan Lathan) et Break street 84 (Joel Silberg) tentent de rendre compte de la naissance du mouvement musical et culturel (ou de le récupérer ?). Les comédies proposées, à part peut-être Bonjour les vacances (d'Harold Ramis avec Chevy Chase, revu à la hausse par notre véhachessien voisin
Curiosité du mois, l'affirmation d'un filon hip-hop : Beat street (Stan Lathan) et Break street 84 (Joel Silberg) tentent de rendre compte de la naissance du mouvement musical et culturel (ou de le récupérer ?). Les comédies proposées, à part peut-être Bonjour les vacances (d'Harold Ramis avec Chevy Chase, revu à la hausse par notre véhachessien voisin 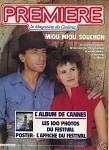 En ce mois de juin faiblard, hormis Positif (280) qui fait sa une sur Under fire, les revues prennent la tangente. Les Cahiers du Cinéma (360-361) parlent déjà de Paris, Texas et des films de Cannes, dans un numéro qui couvrira en fait tout l'été et Première (87) rencontre Miou Miou et Souchon à l'occasion d'un imminent Vol du sphinx. Les autres continuent à mettre en avant les films sortis fin mai : Notre histoire (Cinématographe, 101), La pirate (La Revue du Cinéma, 395), Il était une fois en Amérique (Starfix, 16, et Cinéma 84, 306).
En ce mois de juin faiblard, hormis Positif (280) qui fait sa une sur Under fire, les revues prennent la tangente. Les Cahiers du Cinéma (360-361) parlent déjà de Paris, Texas et des films de Cannes, dans un numéro qui couvrira en fait tout l'été et Première (87) rencontre Miou Miou et Souchon à l'occasion d'un imminent Vol du sphinx. Les autres continuent à mettre en avant les films sortis fin mai : Notre histoire (Cinématographe, 101), La pirate (La Revue du Cinéma, 395), Il était une fois en Amérique (Starfix, 16, et Cinéma 84, 306). La découverte très tardive d'Une époque formidable est pour moi une bonne surprise. Tout d'abord, cette déchéance d'un cadre vers la clochardisation, bénéficie avec Jugnot-acteur de la personne adéquate pour incarner le personnage principal de Michel Berthier. Son registre de français médiocre, peaufiné au fil des ans, rend parfaitement crédible la trajectoire vers le bas décrite ici. Quand débute l'histoire (après un savoureux prologue relatant un cauchemar du héros), Berthier est déjà licencié et, ressort classique, il fait croire à sa compagne qu'il travaille toujours. Le récit de la déchéance est très bien amené, dans un enchaînement autant dramatique que, chose plus difficile, comique. On relève bien une scène trop facile de rébellion envers une journaliste interviewant complaisamment les SDF et un inévitable clin d'oeil au "Salauds de pauvres !" de La traversée de Paris. Ces excès sont cependant bien rares, au milieu de répliques bien senties, modulées de salves vulgaires en mots d'auteurs plus écrits. Bien rythmé, solidement interprété jusque dans les personnages secondaires (Charlotte de Turkheim, pas mal en prostituée de garage beuglant "Au suivant..."), le film a une vraie mise en scène, utilisant très bien les espaces urbains. La musique, souvent atroce dans ce genre de production, n'est pas désagréable (on se pince d'autant plus en découvrant qu'elle est signée de Francis Cabrel).
La découverte très tardive d'Une époque formidable est pour moi une bonne surprise. Tout d'abord, cette déchéance d'un cadre vers la clochardisation, bénéficie avec Jugnot-acteur de la personne adéquate pour incarner le personnage principal de Michel Berthier. Son registre de français médiocre, peaufiné au fil des ans, rend parfaitement crédible la trajectoire vers le bas décrite ici. Quand débute l'histoire (après un savoureux prologue relatant un cauchemar du héros), Berthier est déjà licencié et, ressort classique, il fait croire à sa compagne qu'il travaille toujours. Le récit de la déchéance est très bien amené, dans un enchaînement autant dramatique que, chose plus difficile, comique. On relève bien une scène trop facile de rébellion envers une journaliste interviewant complaisamment les SDF et un inévitable clin d'oeil au "Salauds de pauvres !" de La traversée de Paris. Ces excès sont cependant bien rares, au milieu de répliques bien senties, modulées de salves vulgaires en mots d'auteurs plus écrits. Bien rythmé, solidement interprété jusque dans les personnages secondaires (Charlotte de Turkheim, pas mal en prostituée de garage beuglant "Au suivant..."), le film a une vraie mise en scène, utilisant très bien les espaces urbains. La musique, souvent atroce dans ce genre de production, n'est pas désagréable (on se pince d'autant plus en découvrant qu'elle est signée de Francis Cabrel).