demme
-
Rachel se marie (Jonathan Demme, 2008)
°Toujours partant pour découvrir les quelques Jonathan Demme que je n'ai pas pu voir à leur époque, je ne m'attendais pas à cette imitation tardive du Dogme95, dix ans après Festen, avec caméra portée, cadrages volontairement imparfaits, musique diégétique, phrases et mouvements coupés en plein milieu... La mention d'Altman au générique de fin ne peut être qu'une preuve d'admiration générale, non un remerciement pour l'inspiration venant d'Un mariage tant les divergences sont grandes : ici, le rituel n'est jamais remis en question, le vernis des convenances ne craque que provisoirement pour ouvrir sur de la psychologie lourde, la choralité n'est qu'apparente, les personnages n'ayant clairement pas tous les mêmes chances d'orienter le récit. Dans ce cadre bourgeois démocrate, cultivé et métissé, les préparatifs sont d'un ennui total, le premier repas est un sommet de gêne avec des interventions pathétiques, la remontée du passé traumatisant entraîne dans un psychodrame interminable, la cérémonie et la fête apaisent les tensions à force de petites larmes et de gros câlins. Même l'amour de Demme pour la musique lui joue des tours. On se sent aussi inutile que dans un mariage où l'on ne connaîtrait personne parmi des gens surjouant l'enthousiasme festif. Grande déception. -
Neil Young : Heart of gold
(Jonathan Demme / Etats-Unis / 2006)
■■■□
 En août 2005, l'année de ses 60 ans, Neil Young remonte sur scène à Nashville après plusieurs mois d'absence, suite à une rupture d'anévrisme et un opération au cerveau. Il y joue les morceaux de Prairie wind, l'album qu'il vient de publier, ainsi qu'une poignée de ses classiques. Le concert est filmé par l'un des cinéastes sachant le mieux mettre en valeur la musique devant une caméra : Jonathan Demme.
En août 2005, l'année de ses 60 ans, Neil Young remonte sur scène à Nashville après plusieurs mois d'absence, suite à une rupture d'anévrisme et un opération au cerveau. Il y joue les morceaux de Prairie wind, l'album qu'il vient de publier, ainsi qu'une poignée de ses classiques. Le concert est filmé par l'un des cinéastes sachant le mieux mettre en valeur la musique devant une caméra : Jonathan Demme.Demme a tout d'abord l'intelligence de faire simple. Le contexte est posé en cinq minutes, par le montage de bribes d'entretiens réalisés à la volée auprés des divers musiciens réunis autour de Young pour ce projet. Le concert peut ensuite débuter et rien ne viendra le perturber jusqu'au dernier morceau. Englobant le lever de rideau et le début de la première chanson, le plan introductif donne le ton, lent travelling avant et discrètement aérien. Demme refuse de hacher les séquences, d'étaler sa virtuosité et de s'enivrer de ses moyens techniques. Sur différentes échelles, cadrant toute la scène ou le chanteur de manière reserrée, les plans longs sont la norme (The needle and the damage done, chanson certes la plus courte du lot, tient d'ailleurs en un seul). La mise en scène se met entièrement au service de la musique, lui offrant un écrin sobre, fluide, calme, la faisant entendre au spectateur de la plus belle des manières. Les performances enregistrées par Jim Jarmusch pour Year of the horse (1997) souffraient d'être entrecoupées d'intermèdes sans grand intérêt, celle qui le fut par Young lui-même pour Rust never sleeps (1979) ne bénéficiait pas d'une image particulièrement soignée. A ces deux tentatives précédentes, on préfère donc largement ce Heart of gold.
Le show se déroule en deux parties distinctes (la reprise du même lent mouvement avant de la caméra qu'au début du concert signale l'ouverture du second temps), sans que l'une paraisse inférieure à l'autre. Neil Young, en effet, a toujours cette vigueur qui lui permet d'aligner de récents morceaux qui ne déparent nullement aux côtés de ses classiques des périodes précédentes. Difficile d'imaginer les Stones ou Dylan faire de même. Ici, The painter, This old guitar, Far from home et le formidable Prairie wind ont la même tenue que les impérissables Old man ou Comes a time. Le cadre (une salle mythique de Nashville), la moyenne d'âge des musiciens et les allusions de Young aux grands noms de la country ne doivent pas laisser penser à un spectacle confortablement passéiste (voire réactionnaire, selon l'étiquette qui colle abusivement au genre et à la ville). Le parcours du musicien depuis les années 60, navigant constamment entre tradition et modernité, des ballades folk aux défèrlements bruitistes, le met à l'abri d'une telle tentation. Sur scène, alors qu'il chante toujours avec la même ferveur, nous l'observons et le sentons entouré de ses multiples fantômes, souriant. Loin de l'entraver, ceux-ci semblent encore le pousser vers la vie et une création inépuisable.
A lire aussi : cette note très informée et passionnée.
-
C'était mieux avant... (Été 1985)
Comme promis, après la version espagnole, vient la VF.
*****
Juin n'est déjà qu'un lointain souvenir. Abordons donc les rivages cinématographiques qui s'offraient à nous en Juillet-Août 1985 :
Une fois que le tri est fait, afin de garder le meilleur pour la fin, nous nous retrouvons devant une vague estivale de sous-produits qui commence par donner à ce panorama l'apparence d'un morne catalogue de médiocrités. Anciennes réalisations de metteurs en scène ayant entre-temps rencontré le succès, productions plagiant sans vergogne des réussites antérieures, suites à l'utilité contestable, films de série dont on se débarasse en attendant la rentrée... en cette période, rien n'est épargné au spectateur.
 Qu'il vienne de France, d'Angleterre ou des Etats-Unis, le genre comique n'offre a priori rien de remarquable, à en juger par cette série de titres : Le facteur de Saint-Tropez (de Richard Balducci, avec Paul Préboist), L'amour propre (premier film de Martin Veyron), Les débiles de l'espace (de Mike Hodges), Les zéros de conduite (de Neal Israel), Police Academy 2 : Au boulot ! (de Jerry Paris), Porky's contre-attaque (de James Komack), Une défense canon (de Willard Huyck avec Dudley Moore et Eddie Murphy). On suppose tout de même moins insignifiants Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill (avec Richard Pryor) et les deux premiers longs métrages d'un Robert Zemeckis profitant du récent succès public de son A la poursuite du diamant vert (Crazy day, 1978, chronique autour de la Beatlemania en 64 aux USA et La grosse magouille, 1980, satire de l'Amérique profonde avec Kurt Russell).
Qu'il vienne de France, d'Angleterre ou des Etats-Unis, le genre comique n'offre a priori rien de remarquable, à en juger par cette série de titres : Le facteur de Saint-Tropez (de Richard Balducci, avec Paul Préboist), L'amour propre (premier film de Martin Veyron), Les débiles de l'espace (de Mike Hodges), Les zéros de conduite (de Neal Israel), Police Academy 2 : Au boulot ! (de Jerry Paris), Porky's contre-attaque (de James Komack), Une défense canon (de Willard Huyck avec Dudley Moore et Eddie Murphy). On suppose tout de même moins insignifiants Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill (avec Richard Pryor) et les deux premiers longs métrages d'un Robert Zemeckis profitant du récent succès public de son A la poursuite du diamant vert (Crazy day, 1978, chronique autour de la Beatlemania en 64 aux USA et La grosse magouille, 1980, satire de l'Amérique profonde avec Kurt Russell).Dans le film d'action, l'heure est au cassage de gueule des Jaunes (Nom de code : Oies sauvages, italo-ouest-allemand d'Antonio Margheriti, avec Lee Van Cleef, Klaus Kinski et Ernest Borgnine ; Gymkata, de Robert Clouse, dans lequel un brave Américain gagne une chasse à l'homme organisée dans un petit royaume d'Asie) et à la dénonciation des Rouges (Goulag de Roger Young, dont le héros est un journaliste sportif, encore une fois américain, qui s'évade d'un camp soviétique). Avec Amazonia, la jungle blanche, l'Italien Ruggero Deodato, réalisateur de Cannibal Holocaust, nous éclaire (?) sur le trafic de drogue en Amazonie, avec La cavale impossible, Stephen Gyllenhaal invente la virée entre femmes bien avant Thelma et Louise, avec Marathon killer, Robert L. Rosen filme un énième survival, avec Même les anges tirent à droite, E.B. Clucher donne une suite (datée de 1974) aux Anges mangent aussi des fayots, avec Prison de femmes en furie, Michele Massimo Tarantini propose une nouvelle variation dans le sous genre... prison de femmes.
 Au rayon SF et horreur, nous ne sommes pas mieux lotis avec 2072, les mercenaires du futur (de Lucio Fulci), Diesel (de Robert Kramer, dans lequel Gérard Klein, Agnès Soral, Richard Bohringer et Niels Arestrup jouent à Mad Max), Horror (de Philippe Mora, avec Christopher Lee), Les frénétiques (de David Winters, crimes au Festival de Cannes, vus sous l'angle parodique, dix ans avant Les Nuls) et Vendredi 13 – Chapitre 5 (de Danny Steinmann, où l'on se rend compte que le "chapitre final" sorti quelques mois auparavant n'était donc pas le dernier...). Dans ce désert, ne semblent exister que quatre oasis éventuelles. Dreamscape, de Joseph Ruben, montre un homme, Dennis Quaid, qui se bat dans les rêves des autres. Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, conte le combat mené par Tom Selleck contre les robots. De son côté, Ridley Scott, sortant d'Alien et de Blade runner, proposait sa fable médiévalisante et merveilleuse Legend. Derrière le travail visuel époustouflant, perce-t-il quelque chose de consistant ? A vrai dire, ma mémoire me trahit... Enfin, Starman, avec sa trame ET-esque de la créature venue d'ailleurs, ne semble pas vraiment être considéré comme un John Carpenter majeur mais mérite sans doute le détour.
Au rayon SF et horreur, nous ne sommes pas mieux lotis avec 2072, les mercenaires du futur (de Lucio Fulci), Diesel (de Robert Kramer, dans lequel Gérard Klein, Agnès Soral, Richard Bohringer et Niels Arestrup jouent à Mad Max), Horror (de Philippe Mora, avec Christopher Lee), Les frénétiques (de David Winters, crimes au Festival de Cannes, vus sous l'angle parodique, dix ans avant Les Nuls) et Vendredi 13 – Chapitre 5 (de Danny Steinmann, où l'on se rend compte que le "chapitre final" sorti quelques mois auparavant n'était donc pas le dernier...). Dans ce désert, ne semblent exister que quatre oasis éventuelles. Dreamscape, de Joseph Ruben, montre un homme, Dennis Quaid, qui se bat dans les rêves des autres. Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, conte le combat mené par Tom Selleck contre les robots. De son côté, Ridley Scott, sortant d'Alien et de Blade runner, proposait sa fable médiévalisante et merveilleuse Legend. Derrière le travail visuel époustouflant, perce-t-il quelque chose de consistant ? A vrai dire, ma mémoire me trahit... Enfin, Starman, avec sa trame ET-esque de la créature venue d'ailleurs, ne semble pas vraiment être considéré comme un John Carpenter majeur mais mérite sans doute le détour.En cet été 85, les polars de série, eux aussi, étaient légion, la plupart du temps ressassant le thème de la vengeance personnelle. Alain Delon était de retour en ex-policier devenu justicier (Parole de flic de José Pinheiro), après les promesses de Tir groupé, Jean-Claude Missiaen continuait de décevoir avec son nouveau polar banlieusard La baston, Michel Gérard se mettait au cinéma "sérieux" en réalisant Blessure, film noir situé dans le milieu du rock et interprété et co-écrit par Florent Pagny (!), tandis que Michel Vianney signait Spécial police. Habitués du genre, Chuck Norris et Burt Reynolds occupaient toujours l'espace, avec, respectivement, Sale temps pour un flic d'Andy Davis et Stick, le justicier de Miami de Reynolds lui-même. Mentionnons également Un été pourri de Phillip Borsos, polar journalistique avec Kurt Russell. En ce qui concerne le film de kung fu, on note, en plus des productions courantes (Les enragés du kung fu et La rage bouddhiste du kung fu de Godfrey Ho, Shaolin contre Mandchou de Marlon Lee, Shaolin, temple de la tradition de Kwok Siu Ho), quelques hybridations trans-continentales entre l'Asie et l'Amérique (Le dernier dragon de Michael Schultz, Le retour du Chinois de James Glickenhaus, avec Jackie Chan qui s'associe à Danny Aiello et va de NY à HK).
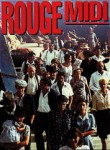 Dans des démarches plus auteuristes, les propositions de Dominique Crevecœur (le film-rêve Contes clandestins), de Lazlo Szabo (le décousu David, Thomas et les autres, production franco-hongroise avec Trintignant, Rochefort et Cottençon) et de Joy Fleury (Tristesse et beauté, d'après Yasunari Kawabata, avec Charlotte Rampling et Andrzej Zulawski) n'ont guère fait date, mais Pierre Jolivet séduisait avec son premier film, Strictement personnel, polar rêveur avec Pierre Arditti, Alain Tanner poursuivait son singulier parcours avec No man's land (quelques personnages, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, exposent leur désir de vivre une autre vie) et Robert Guédiguian faisait déjà preuve d'une belle ambition en contant 50 ans de la vie d'un quartier marseillais dans Rouge midi (avec, bien sûr, Gérard Meylan et Ariane Ascaride). Toutefois, le projet le plus intrigant est à chercher du côté des Etats-Unis : dans Strangers kiss, Matthew Chapman imagine ce qui aurait pu se passer lors du tournage du Baiser du tueur (Killer's kiss, 1955), le deuxième long métrage de Stanley Kubrick, les interprètes vivant dans la réalité, peu ou prou, les mêmes (més)aventures que dans la fiction.
Dans des démarches plus auteuristes, les propositions de Dominique Crevecœur (le film-rêve Contes clandestins), de Lazlo Szabo (le décousu David, Thomas et les autres, production franco-hongroise avec Trintignant, Rochefort et Cottençon) et de Joy Fleury (Tristesse et beauté, d'après Yasunari Kawabata, avec Charlotte Rampling et Andrzej Zulawski) n'ont guère fait date, mais Pierre Jolivet séduisait avec son premier film, Strictement personnel, polar rêveur avec Pierre Arditti, Alain Tanner poursuivait son singulier parcours avec No man's land (quelques personnages, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, exposent leur désir de vivre une autre vie) et Robert Guédiguian faisait déjà preuve d'une belle ambition en contant 50 ans de la vie d'un quartier marseillais dans Rouge midi (avec, bien sûr, Gérard Meylan et Ariane Ascaride). Toutefois, le projet le plus intrigant est à chercher du côté des Etats-Unis : dans Strangers kiss, Matthew Chapman imagine ce qui aurait pu se passer lors du tournage du Baiser du tueur (Killer's kiss, 1955), le deuxième long métrage de Stanley Kubrick, les interprètes vivant dans la réalité, peu ou prou, les mêmes (més)aventures que dans la fiction. Pour beaucoup, l'événement de l'été fut la sortie de Pale rider de Clint Eastwood. Ce western à la fois classique et détaché, mythique et réaliste, j'avoue l'avoir apprécié à chaque vision mais jamais "totalement". Le caractère non-chronologique de ma découverte de l'œuvre eastwoodienne y est sans doute pour quelque chose mais j'ai toujours préféré à ce titre Josey Wales ou Impitoyable. Le véritable film-phare de juillet-août 85 serait alors le Sang pour sang de Joel Coen (à peine mentionnait-on à l'époque le prénom de son frère-scénariste Ethan). Le jugement me paraît cependant légèrement biaisé : l'amour que l'on peut lui porter dépendant à mon sens beaucoup plus de ce que l'on connaît de la suite que de la réalité du film lui-même, habile exercice de style annonçant des vertiges plus prononcés. Pour moi, donc, le chef-d'œuvre est ailleurs. Dans la case "Documentaire". Il ne s'agit certes pas de Carné, l'homme à la caméra, hommage plan-plan au réalisateur du Jour se lève par Christian-Jacque, ni de Pumping Iron 2, l'enquête de George Butler sur le culturisme féminin, mais de Stop making sense, indépassable sommet du film-concert. Derrière la caméra : Jonathan Demme (dont le premier film, Cinq femmes à abattre, série B cormanienne de 1974 sortait au même moment). Devant : David Byrne et ses Talking Heads. Scénographie, son, lumières, montage : tout concourt à faire de cette prestation, donnée spécialement pour le film et gardant pourtant la fraîcheur et l'intensité d'un live "classique", le modèle du genre. Le génie du groupe et l'amour du réalisateur pour la musique achèvent de rendre le résultat miraculeux.
Pour beaucoup, l'événement de l'été fut la sortie de Pale rider de Clint Eastwood. Ce western à la fois classique et détaché, mythique et réaliste, j'avoue l'avoir apprécié à chaque vision mais jamais "totalement". Le caractère non-chronologique de ma découverte de l'œuvre eastwoodienne y est sans doute pour quelque chose mais j'ai toujours préféré à ce titre Josey Wales ou Impitoyable. Le véritable film-phare de juillet-août 85 serait alors le Sang pour sang de Joel Coen (à peine mentionnait-on à l'époque le prénom de son frère-scénariste Ethan). Le jugement me paraît cependant légèrement biaisé : l'amour que l'on peut lui porter dépendant à mon sens beaucoup plus de ce que l'on connaît de la suite que de la réalité du film lui-même, habile exercice de style annonçant des vertiges plus prononcés. Pour moi, donc, le chef-d'œuvre est ailleurs. Dans la case "Documentaire". Il ne s'agit certes pas de Carné, l'homme à la caméra, hommage plan-plan au réalisateur du Jour se lève par Christian-Jacque, ni de Pumping Iron 2, l'enquête de George Butler sur le culturisme féminin, mais de Stop making sense, indépassable sommet du film-concert. Derrière la caméra : Jonathan Demme (dont le premier film, Cinq femmes à abattre, série B cormanienne de 1974 sortait au même moment). Devant : David Byrne et ses Talking Heads. Scénographie, son, lumières, montage : tout concourt à faire de cette prestation, donnée spécialement pour le film et gardant pourtant la fraîcheur et l'intensité d'un live "classique", le modèle du genre. Le génie du groupe et l'amour du réalisateur pour la musique achèvent de rendre le résultat miraculeux.Terminons notre survol de façon plus anecdotique en remarquant qu'à côté des (soft) Nuits chaudes de Cléopâtre (de Cesar Todd) et parmi les films X distribués alors mais dont nous rechignons à égrenner les titres, se retrouvent pas moins de six réalisations de José Benazeraf (Olinka, grande prêtresse de l'amour, Le yacht des partouzes, Perverse Isabelle, Orgies révolutionnaires, Le cul des mille plaisirs et Lady Winter, perversités à l'Anglaise).
 Dans les kiosques, hormis Positif (293-294) et La Revue du Cinéma (407) qui mettent le même film en couverture (La forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en juin), les revues et magazines font preuve de diversité. Le choix se porte sur le Nostalghia d'Andreï Tarkovski (sorti en mai) pour Cinéma 85 (319-320), sur Les enfants de Marguerite Duras (sorti en mai) pour les Cahiers du Cinéma (374), sur l'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine (sorti en mai) pour Jeune Cinéma (168), sur Starman pour L'Ecran Fantastique (58). Du côté de Cinématographe (112), on propose un dossier sur le cinéma beur (avec Abdellatif Kechiche, alors acteur, en couverture) et à Premiere, on fête le centième numéro.
Dans les kiosques, hormis Positif (293-294) et La Revue du Cinéma (407) qui mettent le même film en couverture (La forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en juin), les revues et magazines font preuve de diversité. Le choix se porte sur le Nostalghia d'Andreï Tarkovski (sorti en mai) pour Cinéma 85 (319-320), sur Les enfants de Marguerite Duras (sorti en mai) pour les Cahiers du Cinéma (374), sur l'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine (sorti en mai) pour Jeune Cinéma (168), sur Starman pour L'Ecran Fantastique (58). Du côté de Cinématographe (112), on propose un dossier sur le cinéma beur (avec Abdellatif Kechiche, alors acteur, en couverture) et à Premiere, on fête le centième numéro.Voilà pour l'été 1985. La suite à la rentrée...