
****
Présenter Le convoi comme un titre mineur mais s'intégrant parfaitement dans la filmographie de Sam Peckinpah cela a plus d'allure et plus d'attrait que de le qualifier de lourde comédie d'action relatant les aventures d'un groupe de routiers sympas. Pourtant, durant sa première partie, le film n'est rien d'autre que cela. Le cinéaste n'y va pas de main morte pour s'installer dans ce genre, osant notamment une bagarre de "saloon" résolument parodique à voir l'usage du ralenti qui est fait, tendant ici à déréaliser et à épaissir le trait. Cette course poursuite entre trois chauffeurs et un policier pervers n'est ni très glorieuse ni très intéressante, à l'image des conversations codées ayant cours entre les routiers à travers leur CB.
Ces échanges continus par ondes radio, si réalistes qu'ils soient, contribuent à une saturation des plans particulièrement éreintante. Car ce n'est pas tant le rythme qui fatigue mais l'accumulation à l'intérieur du cadre et d'une séquence à l'autre. Le film de Peckinpah nous saoule de messages, de sirènes de voiture de police, de klaxons de camions, d'une musique country que l'on apprécierait peut-être si elle était utilisée moins systématiquement, de défilés de poids lourds (un, puis deux, puis trois... jusqu'à cinquante, cent ?), de nuages de poussière et de fumées noires. Dans le même élan, le comique s'affiche grossièrement et nous empèche de prendre au sérieux tout ce qui se passe sur l'écran y compris lorsque la violence et le drame pointent leur nez (passage à tabac d'un Noir, lutte "à mort" entre le leader et le policier).
La dimension politique du Convoi a également du mal à s'affirmer clairement au milieu de ce cirque mais elle nous retient assez pour ne pas rendre le film totalement négligeable. Suite à un acte de rébellion contre l'ordre policier, Rubber Duck se retrouve en tête d'un groupe de routiers auquel se joignent tous les éléments contestataires de la société américaine croisés dans les régions traversées pour atteindre le Mexique. Des hippies aux femmes libérées, du Noir opprimé à l'individualiste réfractaire, l'échantillon représentatif n'est pas mis en évidence de manière très fine mais dans la partie centrale du film, la plus intéressante et la moins lourde, on sent très bien, au-delà d'une amusante tentative de récupération politique par les autorités, que les diverses espérances et revendications formulées ne fusionnent jamais véritablement et que la vision désenchantée, détachée et pessimiste de Duck prédomine (soit, par extension, celle de Peckinpah).
L'aventure se poursuit malheureusement dans un troisième acte au scénario toujours à la lisière de la bêtise (la crédibilité fut apparemment le moindre des soucis des auteurs), sacrifié, comme tout le reste, à la recherche de l'effet. L'évidence de la transposition dans l'univers du western éclate en plein jour mais celle-ci, d'une part, donne un tour plus attendu encore au récit (poursuite, vengeance, duel) et, d'autre part, pousse le cinéaste à composer des plans plutôt risibles, comme celui qui présente avant l'assaut un alignement de camions comme autant de cavaliers sur la colline. L'éclat de rire final, en plein chaos (comique), devient une figure "Peckinpahienne" inopérante car accusant la vanité non seulement du monde décrit mais surtout de sa représentation à travers ce film décevant, dont je garderai tout de même l'image d'Ali McGraw conduisant sa décapotable les jambes écartées et la jupe relevée sur les cuisses.
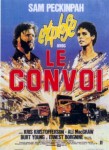 LE CONVOI (Convoy)
LE CONVOI (Convoy)
de Sam Peckinpah
(Etats-Unis / 110 min / 1978)
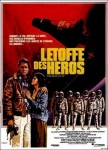 L'étoffe des héros de Philip Kaufman n'eut guère de mal à voler à cent coudées au-dessus du reste des sorties de ce mois-là. Il me semble l'avoir découvert en vhs plutôt qu'en salles et je ne pense pas l'avoir revu depuis mais son souvenir est resté assez vivace : celui d'une formidable épopée américaine, portée par une sacrée distribution (Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Ed Harris, Fred Ward et Barbara Hershey).
L'étoffe des héros de Philip Kaufman n'eut guère de mal à voler à cent coudées au-dessus du reste des sorties de ce mois-là. Il me semble l'avoir découvert en vhs plutôt qu'en salles et je ne pense pas l'avoir revu depuis mais son souvenir est resté assez vivace : celui d'une formidable épopée américaine, portée par une sacrée distribution (Sam Shepard, Scott Glenn, Dennis Quaid, Ed Harris, Fred Ward et Barbara Hershey).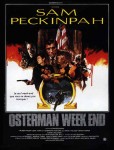 A peu près dans le même panier, on trouvait Les fauves, de Jean-Louis Daniel avec Daniel Auteuil et Philippe Léotard. Il me semble l'avoir vu lui aussi à l'époque, mais rien ne m'en est resté. Idem pour Osterman Weekend du grand Sam (Peckinpah), film d'espionnage confus et généralement peu aimé, y compris par les admirateurs du cinéaste, dans lequel Rutger Hauer se débattait sous les yeux de la CIA. Idem pour Retour vers l'enfer (celui du Vietnam évidemment) de Ted Kotcheff.
A peu près dans le même panier, on trouvait Les fauves, de Jean-Louis Daniel avec Daniel Auteuil et Philippe Léotard. Il me semble l'avoir vu lui aussi à l'époque, mais rien ne m'en est resté. Idem pour Osterman Weekend du grand Sam (Peckinpah), film d'espionnage confus et généralement peu aimé, y compris par les admirateurs du cinéaste, dans lequel Rutger Hauer se débattait sous les yeux de la CIA. Idem pour Retour vers l'enfer (celui du Vietnam évidemment) de Ted Kotcheff.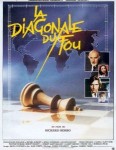 Moins réputés, parfois complètement oubliés, d'autres pourraient réserver, pourquoi pas, des surprises : Guerres froides (britannique de Richard Eyre), Peppermint frieden (film historique et personnel, signé par l'Allemande Marianne Rosenbaum), L'ange (un trip de Patrick Bokanowski), Un homme parmi les loups (une production Disney apparemment très regardable de Carroll Ballard), Clin d'oeil (un délire bunuelien de Jorge Amat), Le juge (de Philippe Lefebvre avec Jacques Perrin dans le rôle du juge Michel, assassiné à Marseille alors qui enquêtait sur un trafic de drogue), Panique (du fantastique à l'Espagnole par Anthony Richmond), Cent jours à Palerme (de Giuseppe Ferrara avec Lino Ventura menacé par la mafia, huit ans après Cadavres exquis, l'un des meilleurs Rosi), Vent de sable (de Mohammed Lakhdar-Amina, spécialiste des fresques historiques algériennes), Naïtou (du Guinéen Moussa Kémoko Diakité), La diagonale du fou (dans lequel Richard Dembo fait jouer Piccoli aux échecs), Forbidden Zone (collage absurde par Richard Elfman).
Moins réputés, parfois complètement oubliés, d'autres pourraient réserver, pourquoi pas, des surprises : Guerres froides (britannique de Richard Eyre), Peppermint frieden (film historique et personnel, signé par l'Allemande Marianne Rosenbaum), L'ange (un trip de Patrick Bokanowski), Un homme parmi les loups (une production Disney apparemment très regardable de Carroll Ballard), Clin d'oeil (un délire bunuelien de Jorge Amat), Le juge (de Philippe Lefebvre avec Jacques Perrin dans le rôle du juge Michel, assassiné à Marseille alors qui enquêtait sur un trafic de drogue), Panique (du fantastique à l'Espagnole par Anthony Richmond), Cent jours à Palerme (de Giuseppe Ferrara avec Lino Ventura menacé par la mafia, huit ans après Cadavres exquis, l'un des meilleurs Rosi), Vent de sable (de Mohammed Lakhdar-Amina, spécialiste des fresques historiques algériennes), Naïtou (du Guinéen Moussa Kémoko Diakité), La diagonale du fou (dans lequel Richard Dembo fait jouer Piccoli aux échecs), Forbidden Zone (collage absurde par Richard Elfman).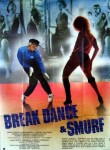 Notons encore trois documentaires-portraits : Ecoutez Bizeau et Ecoutez Mary Picqueray de Bernard Baissat (entretiens avec deux figures de l'anarchisme) et William Burroughs (de Howard Brookner). Et pour les plus courageux (ou les plus pervers) : Break dance and smurf ou comment concilier eau de rose et hip-hop naissant (Vittorio de Sisti), Aldo et Junior (Patrick Schulmann d'après Wolinski), New York nights (porno soft à sketches de Romano Vanderbes) et le croquignolet Sahara (d'Andrew McLaglen avec Brooke Shields et notre Lambert Wilson national). Enfin, ce tour d'horizon, pas très brillant, serait incomplet sans l'évocation des productions de Hong-Kong qui déboulaient en masse en ce temps-là : L'espionne qui venait du soleil levant (Ting Shan-hsi), La fureur des maîtres de Shaolin (Sammy Li), L'incroyable coup de tonnerre de Shaolin (Godfrey Ho), L'Aigle ne pardonne pas (Ho Chung Ty), Shao Lin contre Ninja (Robert Tai).
Notons encore trois documentaires-portraits : Ecoutez Bizeau et Ecoutez Mary Picqueray de Bernard Baissat (entretiens avec deux figures de l'anarchisme) et William Burroughs (de Howard Brookner). Et pour les plus courageux (ou les plus pervers) : Break dance and smurf ou comment concilier eau de rose et hip-hop naissant (Vittorio de Sisti), Aldo et Junior (Patrick Schulmann d'après Wolinski), New York nights (porno soft à sketches de Romano Vanderbes) et le croquignolet Sahara (d'Andrew McLaglen avec Brooke Shields et notre Lambert Wilson national). Enfin, ce tour d'horizon, pas très brillant, serait incomplet sans l'évocation des productions de Hong-Kong qui déboulaient en masse en ce temps-là : L'espionne qui venait du soleil levant (Ting Shan-hsi), La fureur des maîtres de Shaolin (Sammy Li), L'incroyable coup de tonnerre de Shaolin (Godfrey Ho), L'Aigle ne pardonne pas (Ho Chung Ty), Shao Lin contre Ninja (Robert Tai).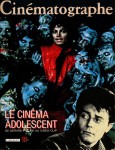 Dans les kiosques (mais pas encore dans les supermarchés), nous pouvions voir que Cinématographe (99) osait un drôle de télescopage sur sa une en annonçant un dossier sur Le cinéma adolescent : de Gérard Philipe au vidéo-clip. Cinéma 84 (304) poursuivait son étude du cinéma allemand entamé le mois précédent et mettait Ingrid Caven en couverture. Positif (278) choisissait Carmen de Rosi (voir le mois de mars), La Revue du Cinéma (393) le film de Tavernier et Première (85) s'entretenait avec Ventura. Pour le meilleur film du mois (celui de Kaufman donc), il restait les couves de Starfix (14) et des Cahiers du Cinéma (358).
Dans les kiosques (mais pas encore dans les supermarchés), nous pouvions voir que Cinématographe (99) osait un drôle de télescopage sur sa une en annonçant un dossier sur Le cinéma adolescent : de Gérard Philipe au vidéo-clip. Cinéma 84 (304) poursuivait son étude du cinéma allemand entamé le mois précédent et mettait Ingrid Caven en couverture. Positif (278) choisissait Carmen de Rosi (voir le mois de mars), La Revue du Cinéma (393) le film de Tavernier et Première (85) s'entretenait avec Ventura. Pour le meilleur film du mois (celui de Kaufman donc), il restait les couves de Starfix (14) et des Cahiers du Cinéma (358). Pour ma part, je le suis assez, mais sans excès. Le cinéma de Sam Peckinpah est peu aimable, son style assez heurté, son propos loin du politiquement correct. La horde sauvage et surtout Les chiens de paille, qui sont souvent ceux que l'on découvre en premier, sont des expériences fortes qui restent en mémoire des années après. Pat Garrett et Billy the Kid, à l'opposé des éclats de violence des deux précédents, est un superbe western désabusé. Plus récemment pour moi, la découverte de Croix de ferfut importante. Peu mis en avant, datant d'une période plus chaotique pour l'auteur, souffrant d'un budget plus que modeste, il s'avère être l'un des meilleurs films de guerre de l'époque. Pour ce qui est des autres, j'avoue que j'aimerais revoir Alfredo Garcia, l'opus qui, au sein de la filmographie de Peckinpah, n'a cessé ces dernières années de voir sa côte grimper auprès des cinéphiles.
Pour ma part, je le suis assez, mais sans excès. Le cinéma de Sam Peckinpah est peu aimable, son style assez heurté, son propos loin du politiquement correct. La horde sauvage et surtout Les chiens de paille, qui sont souvent ceux que l'on découvre en premier, sont des expériences fortes qui restent en mémoire des années après. Pat Garrett et Billy the Kid, à l'opposé des éclats de violence des deux précédents, est un superbe western désabusé. Plus récemment pour moi, la découverte de Croix de ferfut importante. Peu mis en avant, datant d'une période plus chaotique pour l'auteur, souffrant d'un budget plus que modeste, il s'avère être l'un des meilleurs films de guerre de l'époque. Pour ce qui est des autres, j'avoue que j'aimerais revoir Alfredo Garcia, l'opus qui, au sein de la filmographie de Peckinpah, n'a cessé ces dernières années de voir sa côte grimper auprès des cinéphiles.