
****
Drive, c'est l'histoire d'un chevalier blanc qui ne peut empêcher sa tunique immaculée d'être souillée de noir et de rouge. Le driver (puisqu'il n'est toujours nommé qu'à travers sa fonction) est un as du volant, un cascadeur-garagiste vendant ses services de nuit aux braqueurs de Los Angeles. Dans ce cadre, il se charge de la fuite après le casse, et ne veut pas savoir qui en a la responsabilité ni ce qu'il se passe en dehors de sa voiture garée près de l'endroit attaqué, prête à démarrer en trombe. Ne pas être impliqué plus avant, telle est sa règle d'or. Mais voilà qu'il prend soudain parti en posant une question (Qui étaient ces types ?) et cela pour une bonne raison : la protection d'une femme et de son enfant. Fatalement, la machinerie infernale est lancée à cet instant.
En faisant preuve de bienveillance et de fidélité, le driver provoque un nouveau cycle de violence à la force décuplée. Ce n'est pas le seul paradoxe à l'œuvre dans ce film époustouflant. Il en contient beaucoup d'autres. Une scène partout citée (à juste titre) montre très clairement que c'est juste après s'être approché au plus près de la fille aimée que le driver réalise les gestes qui, certes, les sauvent elle et lui, mais surtout l'éloignent, choquée, stupéfaite. Le visage du héros est ensanglanté, son blouson blanc l'est tout autant.
Dans ce monde-là, protéger c'est s'effacer, disparaître à la place. Après tout, le driver était destiné à cela. Dans l'organisation des casses, il est celui qui assure la fuite, n'intervient que ce temps-là et n'est plus joignable après le coup (il précise également que si les braqueurs tardent trop, il s'évapore au bout de cinq minutes). De même, au cinéma, le cascadeur est bien celui qui n'apparaît jamais à l'écran avec son propre visage. La mise en scène de Nicolas Winding Refn se charge de rendre sensible ce retrait. La tuerie au motel se clôt sur un ralenti accompagnant l'effacement progressif du visage du driver derrière une cloison et, logiquement, son grand coup d'éclat, celui-ci l'effectuera en portant un masque. L'homme disparaît peu à peu, ne laissant qu'une ombre sur le bitume, une enveloppe, celle d'un fantôme à la fois présent et absent. A la fin, la voiture redémarre mais la porte de l'appartement reste fermée.
Le laconisme du driver le plaçait dès le début "ailleurs". C'est un choix de mise en scène (qui avait déjà été fait par le cinéaste pour Valhalla rising). Certes, le silence, ou du moins la rareté de la parole, est un trait de caractère du personnage. Mais, comme dans la vie, ce silence se propage aux interlocuteurs (Irene et son fils), peut gêner et provoquer involontairement le malaise (le peu d'empressement à répondre à une question posée par le mari fait naître un doute). Ce silence n'est pas celui du justicier des années 70 qui en imposait à tout le monde. C'est plutôt une nécessité qu'a bien intégré le héros, dans cette jungle du crime qu'il connaît pour la fréquenter chaque jour. Dire que l'on a un "plan", aller dans l'échange au-delà de "je peux te proposer un coup", c'est déjà enclencher un mécanisme dans lequel le driver ne veut pas mettre le doigt. Bien évidemment, l'un des engrenages les plus déterminants est actionné par l'émission d'une parole de trop qui vaut trahison.
Ainsi justifiée, la réserve dans l'expression verbale, comme la suspension du temps, échappe à la pose. Mais il existe une autre raison à l'évitement de cet écueil : la vie ne fuit jamais ces moments arrêtés. Lors de la première soirée qu'ils passent ensemble, le héros et sa future protégée sont montrés face à face, ne disant rien, et avec ce plan étiré, nous écoutons le silence qui s'installe mais en même temps nous voyons comme Irene, troublée, respire fort. Plus tard, dans le peep show, une spectaculaire contre-plongée fige le driver debout, tenant en joue l'homme qu'il recherchait, à terre. Là aussi le plan est long et il s'arrache encore au maniérisme par le choix de faire apparaître soudain le héros en sueur, une sueur qui traduit son extrême tension et qui renvoie à sa tenue, opposée à la nudité des filles qui l'entourent.
Le cinéma de Nicolas Winding Refn est un cinéma de la sensation, mais non gratuite ou déconnectée. Ici : sensation de la lumière, des matières, de la musique (une électro-pop donnant un cachet 80's et évitant l'usage d'un rock'n'roll trop attendu). Sensation, surtout, de la vitesse. Drive n'est qu'accélérations et décélérations, jeux rythmiques génialement transposés au-delà des seules scènes de poursuites, déjà particulièrement brillantes. Celle qui ouvre le film, par les mutliples variations qu'elle peut offrir dans ce domaine, donne le la. Par la suite, la violence arrive par vagues imprévisibles et se retirant aussitôt. Une virée en voiture dans la canal asséché se termine en pause au bord de l'eau. Au supermarché, le driver avance dans les allées et les étalages défilent de chaque côté avant que le mouvement soit stoppé net par la vision d'Irene.
Enthousiasmant par ses propositions plastiques et rythmiques, Drive touche juste aussi dans le traitement des personnages. Le sentiment amoureux est là, et bien d'autres encore. On apprécie le frisson qui passe lorsque le petit garçon se retrouve avec une balle de flingue dans la main, on aime le changement d'éclairage sur le mari provoqué par le flash back, non présenté comme tel et inséré au milieu de la séquence du repas à quatre...
Ainsi, l'éloge de Drive peut aussi bien se faire en l'abordant comme un objet homogène et compact qu'en détaillant chacune de ses fulgurances et de ses beautés plus discrètes. Il est à placer au rayon Grands films noirs entre Le point de non retour de Boorman et En quatrième vitesse d'Aldrich, tout près de Reservoir dogs, rien que cela. Plaisir cinématographique de l'année, direct.
Nicolas Winding Refn sur Nightswimming : Pusher, Pusher II, Pusher III, Bronson, Valhalla rising.
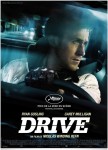 DRIVE
DRIVE
de Nicolas Winding Refn
(Etats-Unis / 100 min / 2011)
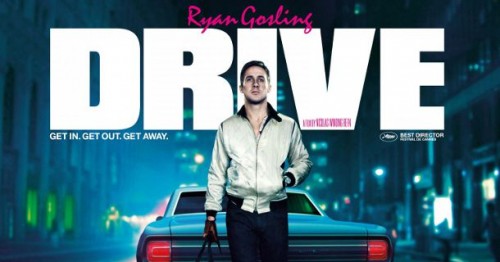

 VALHALLA RISING - LE GUERRIER SILENCIEUX
VALHALLA RISING - LE GUERRIER SILENCIEUX Retraçant l'histoire du "prisonnier le plus dangereux d'Angleterre", "ce film est basé sur des événements réels". Bien avant le terme des quatre-vingt dix minutes, on se dit pourtant que non seulement Nicolas Winding Refn a pris un malin plaisir à bousculer les règles du biopic traditionnel, mais qu'il a surtout réussi à éviscérer le genre, à le vider littéralement de sa morale, de son idéologie, de ses visées édifiantes. Le cinéaste danois n'est bien évidemment pas le premier à jouer au déconstructeur de biographie. En revanche, l'ironie féroce avec laquelle il recouvre le passage obligé des souvenirs d'enfance et d'adolescence démontre bien le peu de cas qu'il fait de la recherche d'un éclairage psychologique sur son héros. De plus, le véritable Michael Peterson, alias Bronson, est devenu une personnalité reconnue exposant ses œuvres dans les musées internationaux. Or, la dernière partie du film substitue à la découverte salvatrice et apaisante de l'art plastique un happening violent et absurde.
Retraçant l'histoire du "prisonnier le plus dangereux d'Angleterre", "ce film est basé sur des événements réels". Bien avant le terme des quatre-vingt dix minutes, on se dit pourtant que non seulement Nicolas Winding Refn a pris un malin plaisir à bousculer les règles du biopic traditionnel, mais qu'il a surtout réussi à éviscérer le genre, à le vider littéralement de sa morale, de son idéologie, de ses visées édifiantes. Le cinéaste danois n'est bien évidemment pas le premier à jouer au déconstructeur de biographie. En revanche, l'ironie féroce avec laquelle il recouvre le passage obligé des souvenirs d'enfance et d'adolescence démontre bien le peu de cas qu'il fait de la recherche d'un éclairage psychologique sur son héros. De plus, le véritable Michael Peterson, alias Bronson, est devenu une personnalité reconnue exposant ses œuvres dans les musées internationaux. Or, la dernière partie du film substitue à la découverte salvatrice et apaisante de l'art plastique un happening violent et absurde. Dans Pusher III vient le tour de Milo, le serbe, qui tente de décrocher de l'usage de la drogue mais pas de son trafic. Aujourd'hui, il doit assurer le repas d'anniversaire de sa fille Milena tout en démêlant une sale histoire de cachets d'ecstasy envolés dans la nature et réclamés par ses associés albanais.
Dans Pusher III vient le tour de Milo, le serbe, qui tente de décrocher de l'usage de la drogue mais pas de son trafic. Aujourd'hui, il doit assurer le repas d'anniversaire de sa fille Milena tout en démêlant une sale histoire de cachets d'ecstasy envolés dans la nature et réclamés par ses associés albanais. Huit ans après, Pusher II n'embraye pas directement sur la fin du premier volet. On ne repart pas avec Frank, qu'apparemment personne n'a revu, si l'on en croit une brève allusion dans une discussion, mais avec Tonny, son ancien partenaire qui sort tout juste de prison. Première surprise donc : Nicolas Winding Refn change de personnage principal. Mieux encore, il creuse un peu plus les psychologies, change de rythme et affine son style. Tonny refait donc surface et réintègre le garage de son père. Le fait d'être désintoxiqué ne l'empêche pas de sniffer à l'occasion et sa liberté surveillée ne le freine pas trop au moment de voler des voitures. Il est vrai que derrière la facade de respectabilité et la méfiance envers ce fils allumé, le père s'avère être un puissant mafieux, aux activités et réactions bien plus ignobles que celles de Tonny. Autre choc sur la route du retour à la vie "normale" : la découverte d'un fils, âgé de quelques mois à peine.
Huit ans après, Pusher II n'embraye pas directement sur la fin du premier volet. On ne repart pas avec Frank, qu'apparemment personne n'a revu, si l'on en croit une brève allusion dans une discussion, mais avec Tonny, son ancien partenaire qui sort tout juste de prison. Première surprise donc : Nicolas Winding Refn change de personnage principal. Mieux encore, il creuse un peu plus les psychologies, change de rythme et affine son style. Tonny refait donc surface et réintègre le garage de son père. Le fait d'être désintoxiqué ne l'empêche pas de sniffer à l'occasion et sa liberté surveillée ne le freine pas trop au moment de voler des voitures. Il est vrai que derrière la facade de respectabilité et la méfiance envers ce fils allumé, le père s'avère être un puissant mafieux, aux activités et réactions bien plus ignobles que celles de Tonny. Autre choc sur la route du retour à la vie "normale" : la découverte d'un fils, âgé de quelques mois à peine. Pusher est le premier long-métrage de Nicolas Winding Refn. Il s'attache à décrire les magouilles de Frank, dealer de son état. Un gros approvisionnement en cocaïne ayant mal tourné et l'ayant conduit pour 24 heures chez les flics, notre homme se retrouve coincé, incapable de rendre à son fournisseur ni la came ni le fric promis. Commence pour lui un compte à rebours infernal où il doit courir partout récupérer de l'argent et gagner du temps, sous peine d'y laisser la peau. Winding Refn suit ainsi Frank dans la semaine où tout se joue pour lui, bornant son récit par des cartons annonçant chaque nouvelle journée. Pour sa mise en scène, il choisit la nervosité d'une caméra portée aux mouvements incessants. Aujourd'hui, cette forme paraît peu originale, mais il faut bien se rappeller que le film date de 1996, soit l'année précise où les Dardenne et Lars Von Trier mettent en place leur esthétique respective avec La promesse et Breaking the waves. Plus étrange est l'impression qui se dégage parfois, celle d'assister à une tentative de sitcom trash, une sorte de Plus destroy la vie (qui serait bien filmé, écrit et interprété), dans cette construction, dans ces scènes de rue sans moyens, dans l'utilisation de la musique essentiellement comme outil de transition d'une séquence à l'autre (une musique lourde, du hard au punk avec des touches de techno). Bien sûr, là aussi, pour cet aspect feuilleton télévisé, le décalage de 10 ans fausse la perspective et trahit quelque peu la singularité de départ.
Pusher est le premier long-métrage de Nicolas Winding Refn. Il s'attache à décrire les magouilles de Frank, dealer de son état. Un gros approvisionnement en cocaïne ayant mal tourné et l'ayant conduit pour 24 heures chez les flics, notre homme se retrouve coincé, incapable de rendre à son fournisseur ni la came ni le fric promis. Commence pour lui un compte à rebours infernal où il doit courir partout récupérer de l'argent et gagner du temps, sous peine d'y laisser la peau. Winding Refn suit ainsi Frank dans la semaine où tout se joue pour lui, bornant son récit par des cartons annonçant chaque nouvelle journée. Pour sa mise en scène, il choisit la nervosité d'une caméra portée aux mouvements incessants. Aujourd'hui, cette forme paraît peu originale, mais il faut bien se rappeller que le film date de 1996, soit l'année précise où les Dardenne et Lars Von Trier mettent en place leur esthétique respective avec La promesse et Breaking the waves. Plus étrange est l'impression qui se dégage parfois, celle d'assister à une tentative de sitcom trash, une sorte de Plus destroy la vie (qui serait bien filmé, écrit et interprété), dans cette construction, dans ces scènes de rue sans moyens, dans l'utilisation de la musique essentiellement comme outil de transition d'une séquence à l'autre (une musique lourde, du hard au punk avec des touches de techno). Bien sûr, là aussi, pour cet aspect feuilleton télévisé, le décalage de 10 ans fausse la perspective et trahit quelque peu la singularité de départ.