
Leonera s'ouvre sur une situation confuse, un brouillard qui ne sera jamais réellement dissipé, puis montre la mise en marche de la machine judiciaire et carcérale avec notamment l'important passage au bureau d'enregistrement de la prison, dans lequel Julia doit décliner son identité. Près de deux heures plus tard, le film ira sur sa fin quand la jeune femme traversera à nouveau cette pièce transitoire mais pour, cette fois-ci, sortir en permission et il se termine sur une autre incertitude, pas plus reposante que la première mais chargée de plus d'espoir.
Le récit est bouclé, ce qui est assez logique pour un film de prison. Le genre est difficile à revisiter tant l'univers est déjà codé, et rendu sur-codé par le cinéma lui-même. Pablo Trapero privilégiant depuis ses débuts une approche réaliste, Leonera ne peut pas tout à fait échapper à quelques tunnels conventionnels, surtout dans sa première moitié qui, s'attachant à rendre compte du chemin de croix d'une femme incarcérée, prend l'aspect d'un film-dossier. La mise en scène en passe donc par des travellings latéraux sur les cellules, la narration éclaire les différentes étapes déterminantes au fil des premiers mois et l'ambiance est alternativement à la révolte, au désespoir et à la solidarité. Tout de même, l'attention de Trapero et son travail avec ses actrices permettent de dépasser certains clichés (l'homosexualité entre détenues par exemple).
Cette tendresse pour les personnages fait l'intérêt de cette partie, plus, finalement, que l'originalité que constitue à nos yeux la vision de ce lieu où les enfants en bas âge ne quittent jamais leur mère condamnée. Cette originalité est parfois un peu trop pointée dans certaines compositions du cadre, bien qu'elle puisse bien sûr contribuer à notre attachement. Le parcours de l'héroïne, s'il est placé dans cet environnement singulier, une prison qui l'est un peu moins que les autres, reste des plus classiques.
Il faut donc être patient pour voir le film se singulariser de manière plus profonde, attendre qu'il déleste son portrait de femme de sa dimension d'exemplarité et du soupçon de thèse. Peu à peu, les personnages s'enrichissent mutuellement, pendant que l'histoire se reserre sur des enjeux bien délimités à ce cas précis, suffisamment complexe pour apparaître unique. Le cinéaste fait d'ailleurs le bon choix en reserrant ainsi mais sans jamais permettre de trancher sur la culpabilité, laissant les protagonistes dans un flou de la mémoire particulièrement douloureux. Alors, il n'est pas jusqu'aux procédés habituels comme le plan séquence accompagnant la première sortie qui ne se transforment avec force en belle évidence, nous préparant à des scènes finales franchement émouvantes, bien que suspendues à un fil.
Pablo Trapero sur Nightswimming : Voyage en famille, Carancho
****
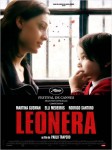 LEONERA
LEONERA
de Pablo Trapero
(Argentine - Brésil / 113 min / 2008)

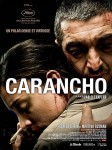 CARANCHO
CARANCHO Comme Guillaume Canet, l'Argentin Martin Rejtman fait un cinéma "générationnel" et cela à plus d'un titre. Tout d'abord, les deux œuvres réunies dans ce coffret semblent adressées prioritairement à une génération précise, celle des gens qui avaient la vingtaine en 92 et la trentaine en 2003. Ensuite, leurs récits sont exclusivement consacrés à des personnages appartenant à celle-ci. Enfin, le premier des deux films proposés, Rapado, est lui-même à l'origine d'une naissance, celle du jeune cinéma argentin de la fin des années 90 dont les principaux représentants se nomment Pablo Trapero, Lucrecia Martel et Lisandro Alonso. Comme il arrive parfois, la reconnaissance rapide des talentueux chefs de file du mouvement a eu pour effet de laisser quelque peu dans l'ombre le réel initiateur - reconnu comme tel par ses cadets. Ainsi, ni Rapado ni Les gants magiques n'ont eu l'honneur d'être distribués dans les salles françaises (le second a tout de même été diffusé en 2006 sur Arte, chaîne coproductrice du film, ce qui avait alors permis à certains d'entre nous de le découvrir avec bonheur), à l'inverse de Silvia Prieto, deuxième long métrage de Rejtman datant de 1999 et sorti ici en... 2004. Depuis, plus rien ou presque (les filmographies indiquent seulement deux titres d'œuvres courtes et énigmatiques, réalisées après Les gants magiques). Cette livraison des Editions Epicentre est donc précieuse, imposant à nos yeux un auteur des plus attachants.
Comme Guillaume Canet, l'Argentin Martin Rejtman fait un cinéma "générationnel" et cela à plus d'un titre. Tout d'abord, les deux œuvres réunies dans ce coffret semblent adressées prioritairement à une génération précise, celle des gens qui avaient la vingtaine en 92 et la trentaine en 2003. Ensuite, leurs récits sont exclusivement consacrés à des personnages appartenant à celle-ci. Enfin, le premier des deux films proposés, Rapado, est lui-même à l'origine d'une naissance, celle du jeune cinéma argentin de la fin des années 90 dont les principaux représentants se nomment Pablo Trapero, Lucrecia Martel et Lisandro Alonso. Comme il arrive parfois, la reconnaissance rapide des talentueux chefs de file du mouvement a eu pour effet de laisser quelque peu dans l'ombre le réel initiateur - reconnu comme tel par ses cadets. Ainsi, ni Rapado ni Les gants magiques n'ont eu l'honneur d'être distribués dans les salles françaises (le second a tout de même été diffusé en 2006 sur Arte, chaîne coproductrice du film, ce qui avait alors permis à certains d'entre nous de le découvrir avec bonheur), à l'inverse de Silvia Prieto, deuxième long métrage de Rejtman datant de 1999 et sorti ici en... 2004. Depuis, plus rien ou presque (les filmographies indiquent seulement deux titres d'œuvres courtes et énigmatiques, réalisées après Les gants magiques). Cette livraison des Editions Epicentre est donc précieuse, imposant à nos yeux un auteur des plus attachants. Les films de Martin Rejtman se tiennent en équilibre entre l'ironie et la tendresse, donnant l'étrange sentiment d'une sincérité et d'une vérité qui se verraient légèrement distanciées. L'humour y est permanent mais léger et empreint de mélancolie. Il nait surtout d'un brillant montage. Ce qui arrive aux personnages est loin d'être drôle, ce n'est que l'assemblage de leurs déboires qui l'est. L'art du cinéaste est un art de la rime visuelle délicate, du running gag offert comme en passant, de la subtile variation des motifs, de l'ellipse souriante et de la concision (1h10 pour l'un, 1h25 pour l'autre).
Les films de Martin Rejtman se tiennent en équilibre entre l'ironie et la tendresse, donnant l'étrange sentiment d'une sincérité et d'une vérité qui se verraient légèrement distanciées. L'humour y est permanent mais léger et empreint de mélancolie. Il nait surtout d'un brillant montage. Ce qui arrive aux personnages est loin d'être drôle, ce n'est que l'assemblage de leurs déboires qui l'est. L'art du cinéaste est un art de la rime visuelle délicate, du running gag offert comme en passant, de la subtile variation des motifs, de l'ellipse souriante et de la concision (1h10 pour l'un, 1h25 pour l'autre).
 Je n'avais jamais entendu parler de ce jeune cinéaste mais après avoir découvert son premier long-métrage, le dénommé Tetro, j'ai envie de saluer son audace malgré l'impression de ratage presque total que j'ai pu ressentir.
Je n'avais jamais entendu parler de ce jeune cinéaste mais après avoir découvert son premier long-métrage, le dénommé Tetro, j'ai envie de saluer son audace malgré l'impression de ratage presque total que j'ai pu ressentir. Premier film de Lucrecia Martel, La Ciénaga est une chronique familiale grinçante, tendre et terrible à la fois. Dès les premiers plans sont dévoilés les corps avachis du couple formé par Mecha et Gregorio et de ceux de leurs invités, corps titubant sous les effets de l'alcool, affligés par la moiteur et comme paralysés sous le poids de leur classe. Quand Mecha tombe et se coupe avec son verre, personne ne lève le petit doigt et chacun attend que la domestique vienne faire son travail. Inertes, les propriétaires de cette maison ne savent que se traîner de la piscine à l'eau croupie jusqu'à leur lit, cela en médisant constamment sur leurs bonnes et les Indiens en général, ces "barbares".
Premier film de Lucrecia Martel, La Ciénaga est une chronique familiale grinçante, tendre et terrible à la fois. Dès les premiers plans sont dévoilés les corps avachis du couple formé par Mecha et Gregorio et de ceux de leurs invités, corps titubant sous les effets de l'alcool, affligés par la moiteur et comme paralysés sous le poids de leur classe. Quand Mecha tombe et se coupe avec son verre, personne ne lève le petit doigt et chacun attend que la domestique vienne faire son travail. Inertes, les propriétaires de cette maison ne savent que se traîner de la piscine à l'eau croupie jusqu'à leur lit, cela en médisant constamment sur leurs bonnes et les Indiens en général, ces "barbares". Le voyage du titre français est celui qu'entame une douzaine de membres d'une famille de Buenos Aires, sous l'impulsion de l'arrière-grand-mère Emilia, afin de rallier en camping-car Misiones, au nord-est du pays, là où doit se dérouler le mariage d'une petite nièce. Le récit n'est constitué que de ce périple de plus de mille kilomètres, au cours duquel la chaleur écrasante et les ennuis mécaniques vont vite révéler les tensions familiales.
Le voyage du titre français est celui qu'entame une douzaine de membres d'une famille de Buenos Aires, sous l'impulsion de l'arrière-grand-mère Emilia, afin de rallier en camping-car Misiones, au nord-est du pays, là où doit se dérouler le mariage d'une petite nièce. Le récit n'est constitué que de ce périple de plus de mille kilomètres, au cours duquel la chaleur écrasante et les ennuis mécaniques vont vite révéler les tensions familiales. Historias minimasest un petit film argentin qui a le charme et les limites de son projet tout entier contenu dans son titre. Ce road movie nous propose de suivre trois trajectoires distinctes mais convergeant vers un même point géographique : la ville de San Julian, en Patagonie. Le vieux Don Justo s'y rend en stop et en cachette de son fils pour récupérer son chien fugueur, Maria, partant du même village, son bébé dans les bras, prend le bus pour participer à la finale d'un jeu télévisé et Roberto, le représentant de commerce, doit conduire pour visiter une cliente qu'il semble apprécier particulièrement.
Historias minimasest un petit film argentin qui a le charme et les limites de son projet tout entier contenu dans son titre. Ce road movie nous propose de suivre trois trajectoires distinctes mais convergeant vers un même point géographique : la ville de San Julian, en Patagonie. Le vieux Don Justo s'y rend en stop et en cachette de son fils pour récupérer son chien fugueur, Maria, partant du même village, son bébé dans les bras, prend le bus pour participer à la finale d'un jeu télévisé et Roberto, le représentant de commerce, doit conduire pour visiter une cliente qu'il semble apprécier particulièrement. On entre dans Los muertospar un beau plan sinueux qui, dans l'épaisseur d'une forêt tropicale, nous laisse entrevoir deux corps ensanglantés puis une silhouette d'homme tenant une machette à la main. Promesse d'une tragédie fiévreuse ? Que nenni. De toute évidence, nous sommes bel et bien en présence de l'un des champions de l'Internationale Auteuriste, mouvance proposant des oeuvres radicales à la narration dégraissée jusqu'au néant et ayant pour chefs de file le thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, le portugais Pedro Costa ou le mexicain Carlos Reygadas (n'écoutant que mon courage, je découvrirai bientôt, de ce dernier, Japon). Toujours fort de qualités plastiques indéniables, ce cinéma-là commence à devenir tout aussi prévisible que le versant classique auquel il est censé s'opposer. Dans Los muertos, au bout de vingt minutes, nous avons ainsi droit à l'inévitable séquence sexuelle filmée dans toute sa crudité, s'arrêtant comme elle a déboulé, de manière abrupte entre deux plans contemplatifs. Autre geste de cinéaste censé authentifier la radicalité de l'ensemble : filmer un rituel in extenso. Ici, on voit longuement le héros attraper, tuer et vider une chèvre. Bon manque de bol pour moi, j'ai déjà vu faire ça dans la famille, à la campagne. C'était sur des moutons, mais les gestes sont les mêmes. L'intérêt documentaire se révèle donc nul.
On entre dans Los muertospar un beau plan sinueux qui, dans l'épaisseur d'une forêt tropicale, nous laisse entrevoir deux corps ensanglantés puis une silhouette d'homme tenant une machette à la main. Promesse d'une tragédie fiévreuse ? Que nenni. De toute évidence, nous sommes bel et bien en présence de l'un des champions de l'Internationale Auteuriste, mouvance proposant des oeuvres radicales à la narration dégraissée jusqu'au néant et ayant pour chefs de file le thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, le portugais Pedro Costa ou le mexicain Carlos Reygadas (n'écoutant que mon courage, je découvrirai bientôt, de ce dernier, Japon). Toujours fort de qualités plastiques indéniables, ce cinéma-là commence à devenir tout aussi prévisible que le versant classique auquel il est censé s'opposer. Dans Los muertos, au bout de vingt minutes, nous avons ainsi droit à l'inévitable séquence sexuelle filmée dans toute sa crudité, s'arrêtant comme elle a déboulé, de manière abrupte entre deux plans contemplatifs. Autre geste de cinéaste censé authentifier la radicalité de l'ensemble : filmer un rituel in extenso. Ici, on voit longuement le héros attraper, tuer et vider une chèvre. Bon manque de bol pour moi, j'ai déjà vu faire ça dans la famille, à la campagne. C'était sur des moutons, mais les gestes sont les mêmes. L'intérêt documentaire se révèle donc nul.