(David Fincher / Etats-Unis / 2007)
■■■□
 David Fincher est connu pour ses constructions scénaristiques complexes et pour sa mise en scène virtuose. Pour ma part, je trouvais que ce talent visuel fonctionnait à plein dans Seven, un peu moins dans The game, puis plus du tout dans Fight club (je n'avais rien trouvé de particulier à son volet d'Alien et je n'ai pas vu Panic room). C'est avec plaisir que j'ai donc constaté dans son récent Zodiac la maîtrise d'une mise en scène plus classique. Fincher n'y abuse pas d'effets gratuits, ni de retournements douteux.
David Fincher est connu pour ses constructions scénaristiques complexes et pour sa mise en scène virtuose. Pour ma part, je trouvais que ce talent visuel fonctionnait à plein dans Seven, un peu moins dans The game, puis plus du tout dans Fight club (je n'avais rien trouvé de particulier à son volet d'Alien et je n'ai pas vu Panic room). C'est avec plaisir que j'ai donc constaté dans son récent Zodiac la maîtrise d'une mise en scène plus classique. Fincher n'y abuse pas d'effets gratuits, ni de retournements douteux.
Toute la première partie, alternant meurtres et enquête, adopte un style proche des fictions équivalentes du cinéma américain des années 70 (Pakula, Pollack...). Le pari, réussi, de Fincher est de ne pas changer de tempo tout du long, à quelques exceptions près (dont la scène de l'entretien entre Graysmith et le projectionniste dans l'inquiétant sous-sol de ce dernier, Graysmith se croyant tout à coup en danger dans cette atmosphère à la... Seven). A partir du moment où les meurtres s'arrêtent, le film devient particulièrement passionnant dans le récit des piétinements et des impasses de l'investigation et également dans la description des réactions de chacun des trois principaux protagonistes à cette faillite, réactions nuancées du fatalisme à l'obsession maladive. Ainsi, la volonté du dessinateur de presse de reprendre plusieurs fois tout à zéro a, il me semble, était rarement montrée dans le genre policier.
Porté par une distribution impeccable, de Jake Gyllenhaal au très grand Mark Ruffalo, cette belle réflexion sur le doute rejoint un groupe restreint de films consacrés à une quête restée inachevée. Cet inachèvement est souvent la caractéristique d'oeuvres attachantes et singulières, qui sous le déroulement classique d'une enquête criminelle éclaire les zones d'ombres de chacun. Dans sa rigueur, Zodiac se rapproche par exemple du tragi-comique Memories of murder, l'excellent polar coréen de Bong Jun-ho qui relatait une traque de tueur en série similaire et qui se terminait par un regard-caméra inoubliable d'un des enquêteurs, hanté par le fantôme de celui qu'il n'aura jamais réussi à arrêter.
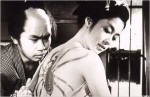 L'argument de Tatouage pourrait donner un petit conte horrifique et érotique de série B. L'amour contrarié d'une jeune femme pour le commis de son père la pousse à s'enfuir. Enlevée, poussée vers la prostitution, elle se fait tatouer de force une gigantesque araignée dans le dos. Dès lors, les cadavres s'accumuleront autour d'elle. Masumura place audacieusement la scène du tatouage en tout début de film avant de revenir en arrière, sans crier gare, et de déployer tout son récit, procédé intriguant et déstabilisant. Autre qualité qui éloigne le film du tout-venant : le soin apporté aux cadrages (et sur-cadrages : d'innombrables plans sont obstrués dans leur partie gauche par un élément du décor).
L'argument de Tatouage pourrait donner un petit conte horrifique et érotique de série B. L'amour contrarié d'une jeune femme pour le commis de son père la pousse à s'enfuir. Enlevée, poussée vers la prostitution, elle se fait tatouer de force une gigantesque araignée dans le dos. Dès lors, les cadavres s'accumuleront autour d'elle. Masumura place audacieusement la scène du tatouage en tout début de film avant de revenir en arrière, sans crier gare, et de déployer tout son récit, procédé intriguant et déstabilisant. Autre qualité qui éloigne le film du tout-venant : le soin apporté aux cadrages (et sur-cadrages : d'innombrables plans sont obstrués dans leur partie gauche par un élément du décor). Moins abouti, La bête aveugle révèle des comportements tout aussi tordus. L'aveugle du titre kidnappe une top model afin de réaliser une sculpture unique dans son atelier-prison. Bien réalisé, la partie séquestration développe des étapes trop classiques (rébellion, duperies pour s'échapper...). La psychologie des personnages n'est pas le point fort du film non plus, l'aveugle vivant par exemple reclus avec sa mère. Ce ménage à trois produit tout de même des moments troublants ou étonnants (la scène de séduction sous le regard de la mère, le retournement de celle-ci pour aider à une évasion).
Moins abouti, La bête aveugle révèle des comportements tout aussi tordus. L'aveugle du titre kidnappe une top model afin de réaliser une sculpture unique dans son atelier-prison. Bien réalisé, la partie séquestration développe des étapes trop classiques (rébellion, duperies pour s'échapper...). La psychologie des personnages n'est pas le point fort du film non plus, l'aveugle vivant par exemple reclus avec sa mère. Ce ménage à trois produit tout de même des moments troublants ou étonnants (la scène de séduction sous le regard de la mère, le retournement de celle-ci pour aider à une évasion). Hasard d'une première note liée à la nouvelle vision du film de Tavernier sur Arte. Que la fête commence donc, mais qu'elle se finisse mieux.
Hasard d'une première note liée à la nouvelle vision du film de Tavernier sur Arte. Que la fête commence donc, mais qu'elle se finisse mieux.