(Fred Zinnemann / Etats-Unis / 1953)
■■■□
 La cause semble entendue. Le message étant martelé depuis des décennies, le moindre cinéphile le sait, parfois même sans l'avoir vu : Tant qu'il y aura des hommes (From here to eternity) (et par extension l'œuvre entière de Zinnemann...) est un film de prestige académique au vieillissement prématuré, rempli de fausses audaces, à peine sauvé par quelques éclairs et des numéros d'acteurs.
La cause semble entendue. Le message étant martelé depuis des décennies, le moindre cinéphile le sait, parfois même sans l'avoir vu : Tant qu'il y aura des hommes (From here to eternity) (et par extension l'œuvre entière de Zinnemann...) est un film de prestige académique au vieillissement prématuré, rempli de fausses audaces, à peine sauvé par quelques éclairs et des numéros d'acteurs.
Personnellement, je le trouve assez beau.
La forme est classique, tantôt discrète, tantôt appuyée. Ce balancement a très vite été convoqué pour établir la preuve d'un manque de style propre. Or, on peut tout aussi bien le juger nécessaire à un film construit sur une série de tensions-explosions. De la fameuse scène de baignade amoureuse entre Deborah Kerr et Burt Lancaster, nous apprécions moins les fougueux baisers que la hâte fiévreuse avec laquelle les deux futurs amants ôtent leurs vêtements pour se tenir face-à-face en tenue de bain (Lancaster étant même, à ce moment-là, cadré au niveau du torse seulement), gestes brusques et libérateurs, que les plans de vagues déchaînées surlignent un peu inutilement. Plus loin, la première des trois explosions de violence jalonnant le récit saisit par sa sècheresse et vient rappeler que Zinnemann signa cinq ans auparavant l'un des meilleurs films noirs de l'après-guerre, Acte de violence. L'affrontement dans ce bar, qui reste finalement au stade de la menace de mort, donne à voir une vivacité de réaction des corps impressionnante. Lancaster notamment semble alors être traversé par une tension phénoménale. Dans ce registre de la force intérieure difficilement canalisée, son partenaire Montgomery Clift n'a bien sûr rien à lui envier. Tous les acteurs du film jouent d'ailleurs magnifiquement, y compris Frank Sinatra dans un rôle pourtant basé en partie sur le pittoresque (celui du "Rital"). Zinnemann les dirige avec précision et la qualité du scénario et des dialogues font le reste.
En effet, l'écriture y est remarquable, donnant l'impression d'un film choral tout en donnant une importance graduée aux différents protagonistes, le principal étant le soldat Prewitt interprété par Clift, dont la destinée éclaire indirectement celle des autres. Cette excellence de l’écriture est perceptible dès le début, les rapports, parfois complexes, s’établissant entre les personnages nous intéressant aussitôt. Cet épisode de la vie d’une caserne américaine du Pacifique, clairement situé dans le temps à la toute fin du récit (juste avant, un panneau de signalisation brièvement aperçu à l’arrière-plan fit office, pour moi, de révélation soudaine), est habilement conté en établissant des parallèles assez souple entre deux couples et entre quelques individualités. L’audace que l’on prêtait à Tant qu’il y aura des hommes à l’époque de sa sortie n’est certes guère décelable aujourd’hui. Tout juste distingue-t-on un possible sous-texte homosexuel, passant à travers les regards et les gestes d’affection de Lancaster à l’attention de Clift. Ce qui intéresse le plus n’est de toute façon pas là. Si audace il y a, elle est plutôt dans la volonté qu’a Zinnemann de proposer au public une histoire ambitieuse, intelligente, complexe. Ainsi, la vision de l’armée évite le manichéisme. Le film n’est pas une charge contre l’institution mais une observation critique de l’intérieur. Le soldat Prewitt, son sergent ou son copain envoyé en camp de redressement, ne sont pas des "hommes contre" (en trouve-t-on beaucoup dans l’armée de métier ?), ce sont juste des individualités assez singulière pour que le spectateur s’y attache et des personnes qui, en cherchant à préserver leur dignité, se retrouvent littéralement coincés dans ce carcan militaire qu'ils ne remettent pas fondamentalement en cause. L’ambiguïté de l’approche peut gêner notre bonne conscience, elle n’en est pas moins crédible et juste. A défaut de génie, Zinnemann fait preuve tout au long de son film d’une réelle sensibilité.
 La Tamara de Stephen Frears étant plus charmante et moins horripilante que la Poppy de Mike Leigh, Tamara Drewe est plus supportable que
La Tamara de Stephen Frears étant plus charmante et moins horripilante que la Poppy de Mike Leigh, Tamara Drewe est plus supportable que 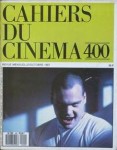
 1987 : Les Cahiers élargissent officiellement leur comité de rédaction (Antoine de Baecque, Joël Magny...), rendent hommage à Andreï Tarkovski, se retournent vers plusieurs classiques (Murnau, Sirk, Keaton, Mizoguchi, Marilyn Monroe, Stroheim, Michel Simon), défendent Le maître de guerre de Clint Eastwood, Un adieu portugais de Joao Botelho, Hotêl de France de Patrice Chéreau, Soigne ta droite de Jean-Luc Godard, Poussière d'ange, Les ailes du désir, Full metal jacket, Intervista, Yeelen. Ici comme en face, le nombre d'entretiens publiés est élevé : Nanni Moretti, Eric Rohmer, David Cronenberg (La mouche), Oliver Stone, Maurice Pialat, Jean-Pierre Mocky (Le miraculé et Agent trouble), Barbet Schroeder (Barfly), Jacques Doillon (Comédie !), Louis Malle (Au revoir les enfants), Alain Tanner (La vallée fantôme), Bernardo Bertolucci, Michael Cimino (Le Sicilien), Shohei Imamura (Zegen), Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni.
1987 : Les Cahiers élargissent officiellement leur comité de rédaction (Antoine de Baecque, Joël Magny...), rendent hommage à Andreï Tarkovski, se retournent vers plusieurs classiques (Murnau, Sirk, Keaton, Mizoguchi, Marilyn Monroe, Stroheim, Michel Simon), défendent Le maître de guerre de Clint Eastwood, Un adieu portugais de Joao Botelho, Hotêl de France de Patrice Chéreau, Soigne ta droite de Jean-Luc Godard, Poussière d'ange, Les ailes du désir, Full metal jacket, Intervista, Yeelen. Ici comme en face, le nombre d'entretiens publiés est élevé : Nanni Moretti, Eric Rohmer, David Cronenberg (La mouche), Oliver Stone, Maurice Pialat, Jean-Pierre Mocky (Le miraculé et Agent trouble), Barbet Schroeder (Barfly), Jacques Doillon (Comédie !), Louis Malle (Au revoir les enfants), Alain Tanner (La vallée fantôme), Bernardo Bertolucci, Michael Cimino (Le Sicilien), Shohei Imamura (Zegen), Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni.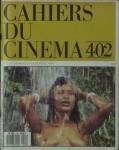
 Quitte à choisir : Seuls le Capra et les deux films de janvier m'ont jusque là échappé. Beaucoup de grands noms à l'affiche pour une année... plutôt moyenne, car je ferai personnellement la fine bouche à propos de La couleur de l'argent, d'Intervista, de Sous le soleil de Satan, du Ventre de l'architecte, du Dernier empereur. Les Arcand, Niermans, Stone, Rosi sont à mon avis des films estimables mais pas bouleversants. Au-delà de l'évidence Wenders et Kubrick (Full metal jacket restant toutefois le seul des six derniers films du cinéaste à ne pas avoir été mis en couverture de Positif), je suis attaché à Reinette et Mirabelle, à Good morning Babilonia, à Yeelen et à Hope and glory. Allez, pour 1987 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Seuls le Capra et les deux films de janvier m'ont jusque là échappé. Beaucoup de grands noms à l'affiche pour une année... plutôt moyenne, car je ferai personnellement la fine bouche à propos de La couleur de l'argent, d'Intervista, de Sous le soleil de Satan, du Ventre de l'architecte, du Dernier empereur. Les Arcand, Niermans, Stone, Rosi sont à mon avis des films estimables mais pas bouleversants. Au-delà de l'évidence Wenders et Kubrick (Full metal jacket restant toutefois le seul des six derniers films du cinéaste à ne pas avoir été mis en couverture de Positif), je suis attaché à Reinette et Mirabelle, à Good morning Babilonia, à Yeelen et à Hope and glory. Allez, pour 1987 : Avantage Cahiers. Partant d'une histoire digne du mélo le plus lacrymogène, Maborosi (Maboroshi no hikari) est un film conduit sur une note basse, d'une manière très sûre et très sensible, particulièrement remarquable pour un premier long métrage (de fiction, s'entend, puisque Hirokazu Kore-eda, le futur auteur de Nobody knows et Still walking, avait à l'époque une expérience de documentariste, information qui n'étonne guère et qui explique en partie l'acuité du regard s'exerçant ici).
Partant d'une histoire digne du mélo le plus lacrymogène, Maborosi (Maboroshi no hikari) est un film conduit sur une note basse, d'une manière très sûre et très sensible, particulièrement remarquable pour un premier long métrage (de fiction, s'entend, puisque Hirokazu Kore-eda, le futur auteur de Nobody knows et Still walking, avait à l'époque une expérience de documentariste, information qui n'étonne guère et qui explique en partie l'acuité du regard s'exerçant ici). Il est étrange de constater à quel point After life (Wandâfuru raifu) peut être considéré comme l'envers exact de Maborosi, les deux semblant séparés par un miroir sans teint. Le point de vue a changé, nous sommes passés de celui des vivants à celui des morts. Le titre ne ment pas : tout se déroule ici après la vie, dans des limbes à l'organisation bureaucratique. Inversant les données par rapport au premier film, l'argument est ici fantastique mais il subit un traitement parfaitement réaliste. La caméra est le plus souvent portée pour suivre les déplacements des personnages, les échanges entre les nouveaux arrivants et ceux qui les accueillent sont soumis à la frontalité du recueil de témoignages dans les reportages, la lumière naturelle éclaire sans apprêt des décors fonctionnels et rudimentaires.
Il est étrange de constater à quel point After life (Wandâfuru raifu) peut être considéré comme l'envers exact de Maborosi, les deux semblant séparés par un miroir sans teint. Le point de vue a changé, nous sommes passés de celui des vivants à celui des morts. Le titre ne ment pas : tout se déroule ici après la vie, dans des limbes à l'organisation bureaucratique. Inversant les données par rapport au premier film, l'argument est ici fantastique mais il subit un traitement parfaitement réaliste. La caméra est le plus souvent portée pour suivre les déplacements des personnages, les échanges entre les nouveaux arrivants et ceux qui les accueillent sont soumis à la frontalité du recueil de témoignages dans les reportages, la lumière naturelle éclaire sans apprêt des décors fonctionnels et rudimentaires.
 Me voilà rassuré.
Me voilà rassuré.