(Woody Allen / Etats-Unis - Grande-Bretagne - Espagne / 2010)
■■■□
 Une douceur après le désagréable Whatever works. Travaillant à nouveau une partition à plusieurs voix, les recouvrant de temps à autre par une autre, en off, indéfinie et plus détachée que d'ordinaire, Woody Allen dans Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu (You will meet a tall dark stranger) abandonne son idée précédente de faire la leçon à son spectateur. Le nouvel opus n'adopte pas de ton sentencieux, évite les formules percutantes et baisse d'un cran le registre des dialogues, sans doute moins brillants mais servant remarquablement la circulation des émotions et facilitant notre attachement aux personnages. Tous ont ici leur chance, à un moment ou à un autre (y compris le plus chargé de stéréotypes, celui de Charmaine, l'ex-prostituée blonde peu futée et attirée par tout ce qui brille, qui sera "rattrapé" in-extremis dans une dernière scène désarmante). Et si le pessimisme foncier du cinéaste tend à imprégner de toutes parts un récit bâti sur des bases plutôt comiques, Allen a le bon goût de ne pas laisser tomber systématiquement les épées de Damoclès suspendues au-dessus de ces têtes tourmentées. Au moment de les quitter, les fortunes seront donc diverses et tout ne sera pas figé.
Une douceur après le désagréable Whatever works. Travaillant à nouveau une partition à plusieurs voix, les recouvrant de temps à autre par une autre, en off, indéfinie et plus détachée que d'ordinaire, Woody Allen dans Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu (You will meet a tall dark stranger) abandonne son idée précédente de faire la leçon à son spectateur. Le nouvel opus n'adopte pas de ton sentencieux, évite les formules percutantes et baisse d'un cran le registre des dialogues, sans doute moins brillants mais servant remarquablement la circulation des émotions et facilitant notre attachement aux personnages. Tous ont ici leur chance, à un moment ou à un autre (y compris le plus chargé de stéréotypes, celui de Charmaine, l'ex-prostituée blonde peu futée et attirée par tout ce qui brille, qui sera "rattrapé" in-extremis dans une dernière scène désarmante). Et si le pessimisme foncier du cinéaste tend à imprégner de toutes parts un récit bâti sur des bases plutôt comiques, Allen a le bon goût de ne pas laisser tomber systématiquement les épées de Damoclès suspendues au-dessus de ces têtes tourmentées. Au moment de les quitter, les fortunes seront donc diverses et tout ne sera pas figé.
S'il est possible, au sein de cette œuvre doucement chorale, de faire endosser à Anthony Hopkins le rôle d'alter ego de Woody Allen que l'on cherche dans tous les films où ce dernier n'apparaît pas, il faut avant tout saluer la performance de l'acteur britannique qui apporte quelque chose de neuf, une certaine opacité, là où trop de prédécesseurs ayant eu à supporter le même poids s'essoufflaient dans l'imitation du modèle (je pense surtout à Kenneth Branagh dans Celebrity et à Larry David dans le Whatever works déjà cité). L'alchimie se crée entre stars et visages inconnus, acteurs aux origines diverses se calant tous sur le bon tempo. Cette justesse de jeu accompagne la discrète élégance de la mise en scène d'un Woody Allen visant à l'essentiel. Les plans-séquences accentuent l'aspect "petit théâtre" des va-et-vient dans l'appartement de Naomi Watts mais une succession de champs-contrechamps butés peut soutenir le dernier échange de cette dernière avec sa mère, provoquant ce qui ressemble à une rupture. Plusieurs détails d'une grande délicatesse attestent ainsi de la sensibilité du cinéaste comme le silence soudain et les esquisses de mouvement de Watts et Antonio Banderas dans la voiture au retour de l'opéra, ou l'emménagement de Josh Brolin chez la voisine d'en face qui doit nous mener à un plan de fenêtre symétrique par rapport à un précédent, qui nous y mène effectivement mais qui nous fait partager une vision inattendue et pourtant logique, avant un baisser de rideau... Brolin (lui aussi remarquable), ombrageux et massif, détone physiquement dans l'univers allénien. Il semble occuper tout l'espace de son décor exigu, jusqu'à ce que, sur la fin, il s'abaisse à une escroquerie qui provoque son expulsion. Au pub, alors que l'on devrait guetter ses réactions, la caméra ne quitte pratiquement pas ses deux amis à ses côtés et ne va le rattraper que brièvement, à deux ou trois reprises, dans la conversation. Puis, à l'hôpital, il s'écarte du petit groupe pour sortir du cadre, sans espoir de retour.
Ces petites touches passionnent et permettent d'admirer le mécanisme d'un film épuré. Ce ne sont pas de gros rouages que l'on voit activés, l'observation se fait à une autre échelle, à la loupe. Nous sommes dans l'horlogerie. Et ce travail d'entraînement opéré par des pièces reliées les unes aux autres convient pour décrire l'un des mérites principaux de l'ouvrage. Woody Allen n'est certes pas le cinéaste de l'amour physique, s'évertuant à ne jamais filmer vraiment de scène sexuelle, mais il est un grand cinéaste du désir. Ici, plus précisément, il excelle à éclairer son déclenchement, qui peut prendre la forme d'une phrase, d'une musique, d'un accent étranger, d'une vision érotique fortuite. Mais tout aussi subtilement représentées sont les conséquences, les bifurcations, les trahisons, les désillusions qu'entraînent ce désir, élément moteur de cette ronde angoissée mais vitale. Oui, décidément, Woody Allen - qui l'eût cru il y a seulement dix ans de cela - a bien fait de s'éloigner de New York...
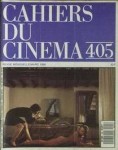
 1988 : Cinq couvertures en commun (Erice, Kaufman, Polanski, Eastwood, Scorsese) et six autres qui auraient pu l'être (Huston, Depardon, Varda, Brisseau, Kieslowski, Angelopoulos) : ce ne sont pas vraiment les différences entre les deux revues que l'on retiendra de cette année-là (d'autant moins qu'elle résident dans des prises de position bien connues, autour de Godard, Truffaut, Sautet ou Demy). Les sommaires s'accordent également sur bien des sujets : le cinéma soviétique "libéré" (dont celui de Kira Muratova), le cinéma du réel (en plus de Varda, Depardon, et Ophuls pour son Hôtel Terminus, Positif rencontre Les Blank et Juris Podnieks et les Cahiers Frederick Wiseman), les muets de Dreyer et Lang, Chen Kaige, Chris Menges (Un monde à part), Robert Zemeckis (Qui veut la peau de Roger Rabbit) et même Rossellini !
1988 : Cinq couvertures en commun (Erice, Kaufman, Polanski, Eastwood, Scorsese) et six autres qui auraient pu l'être (Huston, Depardon, Varda, Brisseau, Kieslowski, Angelopoulos) : ce ne sont pas vraiment les différences entre les deux revues que l'on retiendra de cette année-là (d'autant moins qu'elle résident dans des prises de position bien connues, autour de Godard, Truffaut, Sautet ou Demy). Les sommaires s'accordent également sur bien des sujets : le cinéma soviétique "libéré" (dont celui de Kira Muratova), le cinéma du réel (en plus de Varda, Depardon, et Ophuls pour son Hôtel Terminus, Positif rencontre Les Blank et Juris Podnieks et les Cahiers Frederick Wiseman), les muets de Dreyer et Lang, Chen Kaige, Chris Menges (Un monde à part), Robert Zemeckis (Qui veut la peau de Roger Rabbit) et même Rossellini !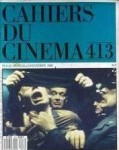
 Quitte à choisir : Cherchons donc parmi les différences...
Quitte à choisir : Cherchons donc parmi les différences...

 Revoir sur grand écran Les Vikings (The Vikings) c'est apprécier le savoir-faire technique de Richard Fleischer et son emploi efficace du Scope (des panoramiques sur les fjords aux gros plans sur les visages), c'est baigner dans les belles images de Jack Cardiff (en particulier lors des remarquables scènes de navigation dans la brume), c'est relever par endroits un louable souci d'authenticité (et un tournage en décors réels), c'est être saisi par quelques fulgurances stylistiques (les vigoureuses entrées dans le champ, les contre-plongées du duel final) et plusieurs pointes de sauvagerie (l'attaque du faucon, le jeu de la hache, la fosse aux loups, la main tranchée), c'est profiter des bonnes interprétations de Tony Curtis, d'Ernest Borgnine, de Janet Leigh et de Kirk Douglas, star et producteur, dont le personnage d'Einar, nous dit-on, refuse de se laisser pousser la barbe, à l'inverse de tous ses camarades vikings, mais se voit dans la foulée à moitié défiguré...
Revoir sur grand écran Les Vikings (The Vikings) c'est apprécier le savoir-faire technique de Richard Fleischer et son emploi efficace du Scope (des panoramiques sur les fjords aux gros plans sur les visages), c'est baigner dans les belles images de Jack Cardiff (en particulier lors des remarquables scènes de navigation dans la brume), c'est relever par endroits un louable souci d'authenticité (et un tournage en décors réels), c'est être saisi par quelques fulgurances stylistiques (les vigoureuses entrées dans le champ, les contre-plongées du duel final) et plusieurs pointes de sauvagerie (l'attaque du faucon, le jeu de la hache, la fosse aux loups, la main tranchée), c'est profiter des bonnes interprétations de Tony Curtis, d'Ernest Borgnine, de Janet Leigh et de Kirk Douglas, star et producteur, dont le personnage d'Einar, nous dit-on, refuse de se laisser pousser la barbe, à l'inverse de tous ses camarades vikings, mais se voit dans la foulée à moitié défiguré...