Il y a entre Les Sept Samouraïs et Les Sept Mercenaires un océan, une culture et six ans d'écart. Il y a aussi, entre le jidai-geki d'Akira Kurosawa et le western de John Sturges, l'espace qui sépare un chef d'œuvre du cinéma d'aventures historiques et un honnête film populaire. Sur l'écran, les samouraïs s'activent une bonne heure de plus que les mercenaires. Cette différence de durée est-elle la conséquence logique de l'opposition entre contemplation orientale et concision hollywoodienne ? Assurément non, le rythme étant aussi rapide d'un côté que de l'autre. Le défaut du film américain, plus visible encore lorsqu'il est placé juste à côté de son modèle, est de rendre au spectateur les choses, les actions, les caractères et les décisions trop évidentes. Il suffit à Kurosawa d'un trait lorsque Sturges s'acharne à nous faire tout le dessin.
Si l'on peut qualifier le premier film de grande fresque historique, c'est que la matière y est d'une richesse incroyable. Mais celle-ci nous est offerte avec une vigueur et une simplicité éblouissantes. Et cela tout le long du film. Prenons par exemple, à la fin, l'expression du choix du plus jeune du groupe (Katsushiro le samouraï ou Chico le mercenaire), pris entre son désir de poursuivre sa route avec les deux autres survivants et celui de rester au village auprès de la paysanne qu'il aime. Kurosawa fait se succéder quelques plans emplis de dignité, laisse sortir son jeune personnage du cadre dans lequel reste ses deux amis, le reprend un peu plus loin, droit, observant la jeune femme, et s'arrête là. La mise en scène est claire sans être insistante. Sturges, lui, ne signale pas esthétiquement la séparation et, accompagnant Chico jusqu'à sa bien aimée, le montrant en train de se retrousser les manches et de détacher son ceinturon, joue uniquement sur la corde émotionnelle.


Chez Kurosawa : une vivacité du trait qui n'empêche jamais la préservation de zones de flou. Chez Sturges : la tentation de l'efficacité qui entraîne plus d'une fois vers la facilité dramaturgique. On peut également évoquer la différence d'approche du monde des paysans. Dans le western, la méfiance que peuvent inspirer ces derniers est essentiellement nourrie par des retournements de situation, comme lorsque quelques pleutres font entrer le tyran Calvera dans le village en l'absence provisoire des mercenaires. Kurosawa, de son côté, ne cherche pas à trancher de manière aussi simpliste mais préfère avancer dans sa description par notations successives. L'évolution du rapport de confiance entre les victimes et leurs défenseurs se fait par petites découvertes mettant la volonté d'engagement de ces derniers à l'épreuve : vieilles armures de samouraïs tués, nourriture et saké la veille du combat décisif...
Le cinéaste japonais s'intéresse-t-il moins à ces paysans ? Sans doute. Mais la caractérisation peu poussée, en regard de celle qui à cours dans le Sturges, peut être aussi considérée comme une moins grande concession au goût du public. On trouve en effet moins de rires d'enfants (le rapport entre ceux-ci et Kikuchiyo/Mifune est beaucoup moins développé dramatiquement que celui concernant Bernardo/Bronson) et moins de héros révélés. Dans Les Sept Samouraïs, les combats ressemblent souvent à des mêlées et, vu sous cet angle, le film se révèle déjà moins individualiste (sans même que l'on s'étende sur le discours autour de la solidarité en temps de guerre proféré par Kambei ou sur la réalisation de l'étendard représentant les sept samouraïs au-dessus du village). La grande violence qui se dégage de ces séquences, accentuée bien sûr par le déchaînement des éléments et l'utilisation des lances et des sabres, est aussi celle de la lutte d'un corps social tout entier contre chaque bandit piégé. Si certains personnages de ce corps prennent plus d'épaisseur que d'autres, ils ne s'en détachent pas par un basculement arbitraire qui les ferait passer du retrait prudent à l'héroïsme guerrier. L'extrême violence dont fait preuve le jeune paysan Rikichi au fil de la bataille est contenue déjà dans la blessure béante causée par la perte de sa femme, dans la nervosité dont il fait preuve à chaque question innocente posée à ce sujet. L'affrontement est une catharsis et les plans que le cinéaste consacre à son regard halluciné, s'ils ne vont pas jusqu'à condamner cette violence, traduisent au moins l'effroi qu'elle suscite.
Mais repassons par la dernière séquence évoquée plus haut. La sortie du cadre de Katsushiro laissait deviner un choix sans avoir à l'illustrer. Cette sortie signale aussi une recherche visuelle, impose un sens plastique. De fait, Les Sept Samouraïs est un festival de formes et de figures qui rend bien pâle l'effort westernien qui le suit. On en retient notamment l'opposition entre le haut et le bas (bandits et samouraïs viennent du sommet de la colline et surplombent le village dans sa cuvette, les tombes des sauveurs sont sur un monticule...), les images que rayent les trombes d'eau tombant du ciel comme les lances et les flèches s'abattant sur les hommes, l'omniprésence, lors du dernier affrontement, d'une boue qui ne permet plus de différencier les combattants et qui ramène, en quelque sorte, les samouraïs à la terre des paysans (en ce sens, effectivement, comme l'assène le chef, ce sont bien ces derniers qui ont gagné). Kurosawa excelle par ailleurs dans sa gestion du terrain, sa caméra embrassant le décor pour mieux relayer l'importance de la notion d'espace et aider à saisir la stratégie de défense de ses personnages, comme dans celle de la météorologie. A ce propos, il convient de rappeler que le film n'est, sur sa durée, pas si pluvieux que cela et qu'il est même assez souvent ensoleillé. Ceci est clairement un prolongement du travail de modulation des émotions effectué par le cinéaste au sein même des séquences. L'humeur y est changeante et le mélange le plus explosif est tout entier concentré dans le personnage endossé par un Toshiro Mifune semblant jouer au-delà de toute contrainte, en liberté absolue. Il faut bien l'ampleur et l'aisance des cadrages de Kurosawa pour capter toute l'énergie de cet homme en fusion, ce caractère éruptif.

Chez les samouraïs, la mort frappe comme la foudre, sans discernement moral, au hasard (l'un des sept disparaît bien avant le combat final). Elle n'est donnée par personne en particulier, les bandits étant chez Kurosawa encore moins caractérisés que les paysans. Elle signale bien, cependant, la fin d'une époque (ce que l'on ressentait déjà lors du recrutement, en voyant ces samouraïs réduits à s'engager pour de si modestes causes) puisque elle est à chaque fois, pour les vaillants sabreurs, donnée par balles. Le film japonais apparaît donc beaucoup plus sombre et dur que son homologue trans-Pacifique. Il privilégie l'éclair tragique plutôt que le coup de force dramatique. Kurosawa saisit le spectateur avec la révélation du sort réservé à la femme de Rikichi quand Sturges distille à peine quelques sensations liées au danger. De même, il étudie les rapports sociaux avec beaucoup plus d'attention, traçant des frontières impossibles à franchir sans une grande douleur, et, n'en restant nullement à une chaste amourette comme le fera Hollywood, évoque une véritable passion sexuelle butant sur la rigidité de la société.
Après tout cela, que reste-t-il aux Mercenaires ? Une histoire prenante, une musique entêtante, une certaine force iconique (mais tenant bien plus au métier et au casting qu'à l'inspiration, assez faible, de Sturges).



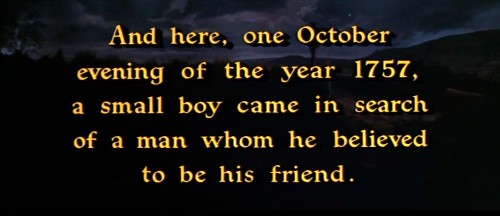










 LES TROIS MOUSQUETAIRES (The three musketeers)
LES TROIS MOUSQUETAIRES (The three musketeers)
 CARTOUCHE
CARTOUCHE
 LE CAPITAINE FRACASSE
LE CAPITAINE FRACASSE
 BARBE-NOIRE LE PIRATE (Blackbeard, the pirate)
BARBE-NOIRE LE PIRATE (Blackbeard, the pirate)


 INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL (Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull)
INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL (Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull)
 DETECTIVE DEE : LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME (Die Renjie)
DETECTIVE DEE : LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME (Die Renjie)