
****
Je reconnais volontiers ne pas être très compétent en wu xia pan (le film de sabre chinois) et dès que je vois des gens se battre dans les airs en voltigeant de bambous en bambous, j'ai tendance à souffler en gonflant les joues, ce qui suffira certainement à disqualifier d'entrée cette note aux yeux des connaisseurs. Parmi les quelques noms associés au genre que j'ai pu croisé jusque là, je ne vois guère que deux exceptions à la règle qui veut que je m'ennuie profondément devant ce type de spectacle : King Hu (A touch of zen, Raining in the mountain) et Tsui Hark (essentiellement les deux premiers Il était une fois en Chine, ce qui me fait croiser les doigts en attendant l'imminente sortie de son Detective Dee). Le secret des poignards volants (le titre international, plus adéquat, est House of flying daggers, ce qui me fait dire que, maison pour maison, je préfère la House of jealous lovers, même si cela n'a absolument rien à voir) est la deuxième incursion de Zhang Yimou sur ce terrain après un Hero (2002) qui partagea beaucoup plus la critique et avant une Cité interdite (2007) qui ne se rattachera au wu xia pan que par intermittences. Ce dernier film m'avait laissé plutôt... interdit et, même si Hero me reste inconnu, la découverte de ce Secret... consolide mes deux sentiments : le genre ne m'est pas très souvent agréable et le cinéma de Zhang Yimou est à circonscrire strictement aux années 90.
Si, concernant cette période, ma préférence va à ses œuvres les plus réalistes (Qiu Ju, une femme chinoise, Vivre, Pas un de moins), je ne fus pas forcément insensibles aux charmes formalistes de certaines autres (Epouses et concubines, Shanghai triad). A ce formalisme, Le secret des poignards volants est totalement assujetti. Assurément, Zhang Yimou est un décorateur hors pair et un coloriste éblouissant, mais sur cette surface brillante, tout glisse et tout paraît vain, à l'image des dernières séquences durant lesquelles se succèdent des tonalités chromatiques différentes (du vert au blanc, bientôt taché de rouge). Le film est idéal pour l'exercice de la capture d'écran (celle-ci est d'autant plus facile que les ralentis numériques abondent), mais rendu à son mouvement, il redevient cet objet lisse et sans réel intérêt.
Les séquences agitées contiennent tout d'abord, mal contemporain, trop de plans. Pourtant, nous dirions que parfois, il en manque... lorsque le montage escamote le mouvement pour rendre possible à l'image les actions qui ne seraient guère réalisables dans la réalité. Les combats alternent de façon bien monotone avec des moments plus calmes. Le tempo est ralenti par les intermèdes romantiques, la plupart du temps organisés en simples champs-contrechamps (et dans les séquences "érotiques", malheureusement, Zhang Ziyi ne cesse de se contorsionner pour ne rien montrer à la caméra).
Dans l'histoire qui nous est contée, tous les personnages sont doubles. Cette duplicité est d'abord un enjeu "policier" (Le secret des poignards volants est en quelque sorte un Infernal affairs en kimono, Andy Lau faisant d'ailleurs le lien entre les deux films) avant de devenir un enjeu amoureux. La question de la sincérité de chacun est ainsi le seul moteur de l'intrigue alors que le film semble annoncer en introduction de tortueuses manigances à l'échelle d'un empire. Au sein de celui-ci, un pouvoir corrompu lutte contre un clan rebelle et insaisissable, dont on nous dit au début et sans jamais y revenir par la suite qu'il dépouille les riches pour donner aux pauvres. Sur la durée de deux heures, seuls quatre personnages seront en fait distingués, les autres étant réduits à des silhouettes virevoltantes ou expirantes sous les lames. De plus, les vraies/fausses trahisons qui se succèdent ne font jamais l'effet du coup de tonnerre : elles laissent indifférent puisque dès les premières scènes nous est laissé le temps d'imaginer à l'avance tous les revirements dont chaque personnage semble capable, les attitudes paraissant vite trop loyales pour être honnêtes et l'intrigue étant si simple. Les acteurs, débitant des dialogues conventionnels au possible et filmés avec le plus grand sérieux, ne parviennent jamais à transcender leur statut de figure désincarnée au service du genre. L'esthétisme du cinéaste, poussé à l'extrême, et l'évolution mécanique du récit achèvent de rendre l'ensemble inutile à mes yeux.
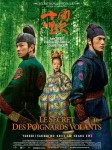 LE SECRET DES POIGNARDS VOLANTS (Shi mian mai fu)
LE SECRET DES POIGNARDS VOLANTS (Shi mian mai fu)
de Zhang Yimou
(Chine - Hong-Kong / 119 mn / 2004)

 SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies)
SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the flies) Revoir sur grand écran Les Vikings (The Vikings) c'est apprécier le savoir-faire technique de Richard Fleischer et son emploi efficace du Scope (des panoramiques sur les fjords aux gros plans sur les visages), c'est baigner dans les belles images de Jack Cardiff (en particulier lors des remarquables scènes de navigation dans la brume), c'est relever par endroits un louable souci d'authenticité (et un tournage en décors réels), c'est être saisi par quelques fulgurances stylistiques (les vigoureuses entrées dans le champ, les contre-plongées du duel final) et plusieurs pointes de sauvagerie (l'attaque du faucon, le jeu de la hache, la fosse aux loups, la main tranchée), c'est profiter des bonnes interprétations de Tony Curtis, d'Ernest Borgnine, de Janet Leigh et de Kirk Douglas, star et producteur, dont le personnage d'Einar, nous dit-on, refuse de se laisser pousser la barbe, à l'inverse de tous ses camarades vikings, mais se voit dans la foulée à moitié défiguré...
Revoir sur grand écran Les Vikings (The Vikings) c'est apprécier le savoir-faire technique de Richard Fleischer et son emploi efficace du Scope (des panoramiques sur les fjords aux gros plans sur les visages), c'est baigner dans les belles images de Jack Cardiff (en particulier lors des remarquables scènes de navigation dans la brume), c'est relever par endroits un louable souci d'authenticité (et un tournage en décors réels), c'est être saisi par quelques fulgurances stylistiques (les vigoureuses entrées dans le champ, les contre-plongées du duel final) et plusieurs pointes de sauvagerie (l'attaque du faucon, le jeu de la hache, la fosse aux loups, la main tranchée), c'est profiter des bonnes interprétations de Tony Curtis, d'Ernest Borgnine, de Janet Leigh et de Kirk Douglas, star et producteur, dont le personnage d'Einar, nous dit-on, refuse de se laisser pousser la barbe, à l'inverse de tous ses camarades vikings, mais se voit dans la foulée à moitié défiguré... En chantant derrière les paravents (Cantando dietro i paraventi en italien) : le titre poétique et mélodieux de ce film, ainsi que la signature qui y est apposée, celle d'Ermanno Olmi, préviennent le spectateur. S'il sera question d'aventures maritimes, la mise en scène ne ressemblera guère à celles ayant donné naissance aux épopées flibustières du cinéma à grand spectacle, qu'il provienne d'Hollywood ou de Cinecitta, qu'il mobilise les foules de figurants du début du siècle dernier ou qu'il court aujourd'hui vers le tout numérique. Olmi nous conte bel et bien une histoire de pirates mais il ne cesse d'en questionner le mode de représentation, proposant un jeu théâtral, un dialogue entre la scène et l'écran, le réel et son imitation, le comédien et le personnage, le conteur et le spectateur.
En chantant derrière les paravents (Cantando dietro i paraventi en italien) : le titre poétique et mélodieux de ce film, ainsi que la signature qui y est apposée, celle d'Ermanno Olmi, préviennent le spectateur. S'il sera question d'aventures maritimes, la mise en scène ne ressemblera guère à celles ayant donné naissance aux épopées flibustières du cinéma à grand spectacle, qu'il provienne d'Hollywood ou de Cinecitta, qu'il mobilise les foules de figurants du début du siècle dernier ou qu'il court aujourd'hui vers le tout numérique. Olmi nous conte bel et bien une histoire de pirates mais il ne cesse d'en questionner le mode de représentation, proposant un jeu théâtral, un dialogue entre la scène et l'écran, le réel et son imitation, le comédien et le personnage, le conteur et le spectateur.
 Bon, je n'aime pas beaucoup ça...
Bon, je n'aime pas beaucoup ça... Devant les abus des autorités et l'intolérance de la bonne société de Portsmouth, Langdon Towne, fraîchement viré de Harvard, et son ami Hunk Marriner partent à l'aventure vers l'Ouest. Ils croisent alors la route du Major Rogers et de son bataillon de Rangers, soutenu par les Anglais. Le militaire a besoin d'un cartographe et prenant connaissance des talents de dessinateur de Towne, les invite à se joindre à eux pour une expédition périlleuse destinée à anéantir une tribu d'indiens alliés aux Français.
Devant les abus des autorités et l'intolérance de la bonne société de Portsmouth, Langdon Towne, fraîchement viré de Harvard, et son ami Hunk Marriner partent à l'aventure vers l'Ouest. Ils croisent alors la route du Major Rogers et de son bataillon de Rangers, soutenu par les Anglais. Le militaire a besoin d'un cartographe et prenant connaissance des talents de dessinateur de Towne, les invite à se joindre à eux pour une expédition périlleuse destinée à anéantir une tribu d'indiens alliés aux Français. La télévision permet de temps à autre de juger sur pièces quelques titres émergents de filmographies de cinéastes hollywoodiens consciencieux mais sans style particulier, tel Richard Thorpe.
La télévision permet de temps à autre de juger sur pièces quelques titres émergents de filmographies de cinéastes hollywoodiens consciencieux mais sans style particulier, tel Richard Thorpe. Troisième temps de mon périple chez Masahiro Shinoda. Si Assassinat ployait quelque peu sous le poids de la politique, La guerre des espions (Ibun Sarutobi Sasuke) doit sa réussite au fait qu'il soit d'abord une enthousiasmante variation sur un genre avant de distiller ses réflexions.
Troisième temps de mon périple chez Masahiro Shinoda. Si Assassinat ployait quelque peu sous le poids de la politique, La guerre des espions (Ibun Sarutobi Sasuke) doit sa réussite au fait qu'il soit d'abord une enthousiasmante variation sur un genre avant de distiller ses réflexions. Philippe Ramos, ambitieux, a donné à Moby Dick un prologue. En laissant courir son imagination autant qu'en s'inspirant de la biographie d'Herman Melville et de la sienne, il a inventé une enfance au Capitaine Achab. Cinq chapitres égrènent des épisodes de la vie du chasseur de baleine. Seul le dernier recoupe le roman. Capitaine Achab est un film singulier, fragile et rageant.
Philippe Ramos, ambitieux, a donné à Moby Dick un prologue. En laissant courir son imagination autant qu'en s'inspirant de la biographie d'Herman Melville et de la sienne, il a inventé une enfance au Capitaine Achab. Cinq chapitres égrènent des épisodes de la vie du chasseur de baleine. Seul le dernier recoupe le roman. Capitaine Achab est un film singulier, fragile et rageant. Séance télé familiale pour finir ce week-end pascal, avec le "sommet" du divertissement de cape et d'épée à la française : Le bossu, très mauvais film d'André Hunebelle. Inutile d'en appeller à la nostalgie de l'enfance et au plaisir de retrouvailles avec des acteurs populaires, l'ensemble est aussi plat que le dos de Lagardère est bombé. La trame du roman de Paul Féval en vaut bien d'autres. Encore faut-il donner du rythme, une forme ou une profondeur, toutes choses dont est incapable Hunebelle. Le cinéma français ne parvient pratiquement jamais à filmer correctement l'action et la vitesse nécessaires au genre, cela crève les yeux ici, encore une fois. Le choix des angles, des cadrages et des coupes donne des chevauchées à deux à l'heure. Les séquences de combat trichent grossièrement avec les distances physiques et la vitesse d'exécution. Bourvil doit se charger de gags paresseux et Jean Marais ne s'en sort pas mieux, lui qui est censé vieillir de vingt ans et qui ne change pas d'un cheveu. Les méchants sont empâtés et transparents. Au contraire des productions hollywoodiennes équivalentes, celle-ci a pu bénéficier de décors réels, mais rien n'accroche l'oeil. La comparaison avec, au hasard, l'agréable Trois mousquetaires de George Sidney (on ne veut même pas parler de Scaramouche) est écrasante. Je suis persuadé que le remake de Philippe de Broca avec Daniel Auteuil, sorti en 97, est meilleur que la version de Hunebelle, contrairement à ce qui a été dit à l'époque. C'est pas possible autrement.
Séance télé familiale pour finir ce week-end pascal, avec le "sommet" du divertissement de cape et d'épée à la française : Le bossu, très mauvais film d'André Hunebelle. Inutile d'en appeller à la nostalgie de l'enfance et au plaisir de retrouvailles avec des acteurs populaires, l'ensemble est aussi plat que le dos de Lagardère est bombé. La trame du roman de Paul Féval en vaut bien d'autres. Encore faut-il donner du rythme, une forme ou une profondeur, toutes choses dont est incapable Hunebelle. Le cinéma français ne parvient pratiquement jamais à filmer correctement l'action et la vitesse nécessaires au genre, cela crève les yeux ici, encore une fois. Le choix des angles, des cadrages et des coupes donne des chevauchées à deux à l'heure. Les séquences de combat trichent grossièrement avec les distances physiques et la vitesse d'exécution. Bourvil doit se charger de gags paresseux et Jean Marais ne s'en sort pas mieux, lui qui est censé vieillir de vingt ans et qui ne change pas d'un cheveu. Les méchants sont empâtés et transparents. Au contraire des productions hollywoodiennes équivalentes, celle-ci a pu bénéficier de décors réels, mais rien n'accroche l'oeil. La comparaison avec, au hasard, l'agréable Trois mousquetaires de George Sidney (on ne veut même pas parler de Scaramouche) est écrasante. Je suis persuadé que le remake de Philippe de Broca avec Daniel Auteuil, sorti en 97, est meilleur que la version de Hunebelle, contrairement à ce qui a été dit à l'époque. C'est pas possible autrement.