L'été passé, et notre emploi du temps n'allant pas en s'allégeant, il s'agissait de prendre une décision quant à la continuation de notre série mensuelle. Après mûre réflexion, devant la masse de courriers inquiets émanant de lecteurs fanatiques, nous avons décidé de ne pas saborder cette rubrique qui, en deux ans seulement, est devenue incontournable dans la blogosphère cinéphile internationale et de nous engager dans une Saison 3. Ainsi soulagés, nous pouvons tranquillement nous poser la question rituelle : Mais, Diable, que trouvions-nous donc dans les salles françaises en Septembre 1985 ?
 Une ligne de force inattendue se dégage de ce mois-ci : la célébration des noces du cinéma et de la musique pop-rock. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, troisième volet de la saga de George Miller créait l'événement. Mel Gibson en partageait l'affiche avec la tigresse soul Tina Turner. Le film fut, dans notre souvenir, reçu de manière assez tranchée, les uns affichant une déception tenant à la débauche spectaculaire et à l'humanisme messianique dont l'auteur chargeait son personnage principal, les autres saluant l'originalité de sa vision et son dépassement formel. Du haut de nos 13 ans et quelques, nous nous étions ralliés alors au deuxième groupe. Y resterions-nous aujourd'hui ?
Une ligne de force inattendue se dégage de ce mois-ci : la célébration des noces du cinéma et de la musique pop-rock. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, troisième volet de la saga de George Miller créait l'événement. Mel Gibson en partageait l'affiche avec la tigresse soul Tina Turner. Le film fut, dans notre souvenir, reçu de manière assez tranchée, les uns affichant une déception tenant à la débauche spectaculaire et à l'humanisme messianique dont l'auteur chargeait son personnage principal, les autres saluant l'originalité de sa vision et son dépassement formel. Du haut de nos 13 ans et quelques, nous nous étions ralliés alors au deuxième groupe. Y resterions-nous aujourd'hui ?
En 85, le chanteur Sting, ayant déjà trouvé le groupe Police trop contraignant à l'endroit de son ego démesuré, misait autant sur la musique en solo que sur le cinéma. Dans La promise de Frank Roddam, il endossait les habits du Baron Frankenstein pour une variation romantique du mythe (en compagnie, charmante, de Jennifer Beals). Ai-je vu ce film ? Plus aucune idée... Plus fraîchement starisée (Like a virgin, 1984), Madonna jouait de façon plus modeste mais avec finalement un retentissement plus grand devant la caméra de Susan Seidelman pour la comédie urbaine Recherche Susan désespérément. Faute de l'avoir revu depuis, nous qualifierons prudemment le film d'agréablement mode et retiendrons surtout qu'il révéla une actrice particulièrement attachante, Rosanna Arquette (en attendant sa sœur...).
 Il n'est pas jusqu'à James Bond qui n'ait succombé à cette vague. Dangereusement vôtre de John Glen, avec un Roger Moore dangereusement vieillissant (ce serait son dernier effort dans le costume de 007), bénéficiait non seulement d'un titre, bientôt hit mondial (A view to a kill), signé des garçons coiffeurs de Duran Duran, mais aussi de la présence singulière de Grace Jones en bras droit du méchant Christopher Walken. Plus sincèrement et plus profondément lié à la culture musicale contemporaine, porté également par un succès discographique renversant (qui m'est devenu aujourd'hui, pour de multiples raisons, quasiment inécoutable), (Don't you) Forget about me de Simple Minds, Breakfast Club de John Hughes a marqué durablement de nombreux cinéphiles de ma génération (bien qu'assez "secrètement", la plupart d'entre nous, et moi le premier, hésitant à jeter à nouveau un œil sur cette histoire de lycéens astreints à une journée de "colle" dans leur établissement désert).
Il n'est pas jusqu'à James Bond qui n'ait succombé à cette vague. Dangereusement vôtre de John Glen, avec un Roger Moore dangereusement vieillissant (ce serait son dernier effort dans le costume de 007), bénéficiait non seulement d'un titre, bientôt hit mondial (A view to a kill), signé des garçons coiffeurs de Duran Duran, mais aussi de la présence singulière de Grace Jones en bras droit du méchant Christopher Walken. Plus sincèrement et plus profondément lié à la culture musicale contemporaine, porté également par un succès discographique renversant (qui m'est devenu aujourd'hui, pour de multiples raisons, quasiment inécoutable), (Don't you) Forget about me de Simple Minds, Breakfast Club de John Hughes a marqué durablement de nombreux cinéphiles de ma génération (bien qu'assez "secrètement", la plupart d'entre nous, et moi le premier, hésitant à jeter à nouveau un œil sur cette histoire de lycéens astreints à une journée de "colle" dans leur établissement désert).
Pour évoquer les rapports entre pop-rock et cinéma, nous nous arrêterons-là et nous garderons bien de gonfler ce corpus de films en y ajoutant P.R.O.F.S. de Patrick Schulmann au prétexte qu'il met en vedette Patrick Bruel. Si cette suite de sketchs en milieu scolaire n'est peut-être finalement pas si indigne que cela, la carrière musicale de son interprète principal l'est en tous points. Tant que nous sommes au rayon rigolade, passons sans regret sur Double zéro de conduite (italien, de Giuliano Carnimeo) et sur Le gaffeur (de Serge Pénard, avec Jean Lefebvre), mais rappelons le surprenant et historique succès public obtenu par Coline Serreau avec son aimable comédie sociologique Trois hommes et un couffin.
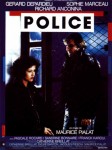 Deux grands auteurs étaient au rendez-vous de septembre : Maurice Pialat et Akira Kurosawa. Si nous reconnaissons que Police et Ran tiennent la dragée haute à presque tous les autres films de ce mois-là, nous avouons qu'ils ne font ni l'un ni l'autre partie de nos opus préférés au sein des belles filmographies des deux cinéastes. Venant après les superbes A nos amours et Kagemusha, et malgré leurs beautés respectives, ils peinent légèrement, selon nous, à réussir le grand écart entre un univers singulier et un genre bien défini (le polar) pour le Français et à faire oublier plusieurs longueurs (sur 2h45) et un hiératisme un peu pesant pour le Japonais. A l'inverse, Louis Malle en réalisant Alamo Bay effectuait sans doute son meilleur travail aux Etats-Unis. Très solidement charpenté, son film traitait avec une certaine force du racisme anti-vietnamien gangrénant une petite communauté de pêcheurs américains (emmenés par Ed Harris).
Deux grands auteurs étaient au rendez-vous de septembre : Maurice Pialat et Akira Kurosawa. Si nous reconnaissons que Police et Ran tiennent la dragée haute à presque tous les autres films de ce mois-là, nous avouons qu'ils ne font ni l'un ni l'autre partie de nos opus préférés au sein des belles filmographies des deux cinéastes. Venant après les superbes A nos amours et Kagemusha, et malgré leurs beautés respectives, ils peinent légèrement, selon nous, à réussir le grand écart entre un univers singulier et un genre bien défini (le polar) pour le Français et à faire oublier plusieurs longueurs (sur 2h45) et un hiératisme un peu pesant pour le Japonais. A l'inverse, Louis Malle en réalisant Alamo Bay effectuait sans doute son meilleur travail aux Etats-Unis. Très solidement charpenté, son film traitait avec une certaine force du racisme anti-vietnamien gangrénant une petite communauté de pêcheurs américains (emmenés par Ed Harris).
Dans cette liste mensuelle, d'autres œuvres sont certainement à découvrir : Dance with a stranger de Mike Newell, drame britannique de bonne réputation, situé dans les années 50 ; Dust de Marion Hänsel avec Jane Birkin et Trevor Howard ; Mystère Alexina de René Féret ; Notre mariage, mélodrame forcément distancié puisque signé par Valéria Sarmiento, épouse et collaboratrice de Raoul Ruiz ; Le pouvoir du mal réflexion philosophique de Krzysztof Zanussi ; Orinoko, essai poétique et historique du vénézuélien Diego Risquez. Avec plus de précautions, nous avançons les titres des films de Gérard Vergez (Bras de fer, Giraudeau et Malavoy bataillent sous l'Occupation), de Tobe Hooper (Life force, mélange d'horreur et de SF qui ne semble guère prisé, y compris par les connaisseurs), de Paul Morrissey (Le neveu de Beethoven, biopic franco-allemand), de James Bridges (Perfect, mêlant journalisme et aerobic, avec John Travolta et Jamie Lee Curtis), de Jeff Kanew (Touché, film d'espionnage) et de Yaky Yosha (Le vautour, drame israélien). Et ce n'est que poussé par notre volonté d'exhaustivité que nous mentionnons Les guerriers de la jungle (Ernst Ritter von Theumer), Les huit guerriers de Shaolin (Chou Ming), L'implacable défi (Bruce Le), Ninja III (Sam Firtsbenberg), Les 36 poings vengeurs de Shaolin (Chen Chih Hua), La femme pervertie (Joe D'Amato) ou Les confidences pornographiques de Lady Winter (de José Benazeraf avec Olinka, également à l'affiche de Je t'offre mon corps de Michel Leblanc).
Enfin, n'oublions pas L'homme au chapeau de soie, remarquable film de montage réalisé par Maud Linder en hommage à son père Max, figure aujourd'hui malheureusement bien oubliée du burlesque "primitif".
 Dans les kiosques, du côté des mensuels (Cinéma devenant, pour quelques temps, hebdomadaire), les couvertures se faisaient sur le film de Pialat (Cahiers du Cinéma (375), Cinématographe (113)), celui de Miller (Starfix (28), L'Ecran Fantastique (60), Premiere (102), qui publia par ailleurs un numéro en août avec Alain Delon en vedette (101)), et celui de Roddam (enfin, surtout pour afficher Sting, comme le fit L'Ecran Fantastique pendant l'été (59) et parler du genre, comme La Revue du Cinéma (408)). A Positif (295), on attendait impatiemment la sortie du Ginger et Fred de Federico Fellini (prévue alors seulement pour janvier 86) et chez Jeune Cinéma (169) on célébrait le cinéma indien.
Dans les kiosques, du côté des mensuels (Cinéma devenant, pour quelques temps, hebdomadaire), les couvertures se faisaient sur le film de Pialat (Cahiers du Cinéma (375), Cinématographe (113)), celui de Miller (Starfix (28), L'Ecran Fantastique (60), Premiere (102), qui publia par ailleurs un numéro en août avec Alain Delon en vedette (101)), et celui de Roddam (enfin, surtout pour afficher Sting, comme le fit L'Ecran Fantastique pendant l'été (59) et parler du genre, comme La Revue du Cinéma (408)). A Positif (295), on attendait impatiemment la sortie du Ginger et Fred de Federico Fellini (prévue alors seulement pour janvier 86) et chez Jeune Cinéma (169) on célébrait le cinéma indien.
Voilà pour septembre 1985. La suite le mois prochain...




 Une ligne de force inattendue se dégage de ce mois-ci : la célébration des noces du cinéma et de la musique pop-rock. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, troisième volet de la saga de George Miller créait l'événement. Mel Gibson en partageait l'affiche avec la tigresse soul Tina Turner. Le film fut, dans notre souvenir, reçu de manière assez tranchée, les uns affichant une déception tenant à la débauche spectaculaire et à l'humanisme messianique dont l'auteur chargeait son personnage principal, les autres saluant l'originalité de sa vision et son dépassement formel. Du haut de nos 13 ans et quelques, nous nous étions ralliés alors au deuxième groupe. Y resterions-nous aujourd'hui ?
Une ligne de force inattendue se dégage de ce mois-ci : la célébration des noces du cinéma et de la musique pop-rock. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, troisième volet de la saga de George Miller créait l'événement. Mel Gibson en partageait l'affiche avec la tigresse soul Tina Turner. Le film fut, dans notre souvenir, reçu de manière assez tranchée, les uns affichant une déception tenant à la débauche spectaculaire et à l'humanisme messianique dont l'auteur chargeait son personnage principal, les autres saluant l'originalité de sa vision et son dépassement formel. Du haut de nos 13 ans et quelques, nous nous étions ralliés alors au deuxième groupe. Y resterions-nous aujourd'hui ? Il n'est pas jusqu'à James Bond qui n'ait succombé à cette vague. Dangereusement vôtre de John Glen, avec un Roger Moore dangereusement vieillissant (ce serait son dernier effort dans le costume de 007), bénéficiait non seulement d'un titre, bientôt hit mondial (A view to a kill), signé des garçons coiffeurs de Duran Duran, mais aussi de la présence singulière de Grace Jones en bras droit du méchant Christopher Walken. Plus sincèrement et plus profondément lié à la culture musicale contemporaine, porté également par un succès discographique renversant (qui m'est devenu aujourd'hui, pour de multiples raisons, quasiment inécoutable), (Don't you) Forget about me de Simple Minds, Breakfast Club de John Hughes a marqué durablement de nombreux cinéphiles de ma génération (bien qu'assez "secrètement", la plupart d'entre nous, et moi le premier, hésitant à jeter à nouveau un œil sur cette histoire de lycéens astreints à une journée de "colle" dans leur établissement désert).
Il n'est pas jusqu'à James Bond qui n'ait succombé à cette vague. Dangereusement vôtre de John Glen, avec un Roger Moore dangereusement vieillissant (ce serait son dernier effort dans le costume de 007), bénéficiait non seulement d'un titre, bientôt hit mondial (A view to a kill), signé des garçons coiffeurs de Duran Duran, mais aussi de la présence singulière de Grace Jones en bras droit du méchant Christopher Walken. Plus sincèrement et plus profondément lié à la culture musicale contemporaine, porté également par un succès discographique renversant (qui m'est devenu aujourd'hui, pour de multiples raisons, quasiment inécoutable), (Don't you) Forget about me de Simple Minds, Breakfast Club de John Hughes a marqué durablement de nombreux cinéphiles de ma génération (bien qu'assez "secrètement", la plupart d'entre nous, et moi le premier, hésitant à jeter à nouveau un œil sur cette histoire de lycéens astreints à une journée de "colle" dans leur établissement désert).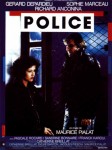 Deux grands auteurs étaient au rendez-vous de septembre : Maurice Pialat et Akira Kurosawa. Si nous reconnaissons que Police et Ran tiennent la dragée haute à presque tous les autres films de ce mois-là, nous avouons qu'ils ne font ni l'un ni l'autre partie de nos opus préférés au sein des belles filmographies des deux cinéastes. Venant après les superbes A nos amours et Kagemusha, et malgré leurs beautés respectives, ils peinent légèrement, selon nous, à réussir le grand écart entre un univers singulier et un genre bien défini (le polar) pour le Français et à faire oublier plusieurs longueurs (sur 2h45) et un hiératisme un peu pesant pour le Japonais. A l'inverse, Louis Malle en réalisant Alamo Bay effectuait sans doute son meilleur travail aux Etats-Unis. Très solidement charpenté, son film traitait avec une certaine force du racisme anti-vietnamien gangrénant une petite communauté de pêcheurs américains (emmenés par Ed Harris).
Deux grands auteurs étaient au rendez-vous de septembre : Maurice Pialat et Akira Kurosawa. Si nous reconnaissons que Police et Ran tiennent la dragée haute à presque tous les autres films de ce mois-là, nous avouons qu'ils ne font ni l'un ni l'autre partie de nos opus préférés au sein des belles filmographies des deux cinéastes. Venant après les superbes A nos amours et Kagemusha, et malgré leurs beautés respectives, ils peinent légèrement, selon nous, à réussir le grand écart entre un univers singulier et un genre bien défini (le polar) pour le Français et à faire oublier plusieurs longueurs (sur 2h45) et un hiératisme un peu pesant pour le Japonais. A l'inverse, Louis Malle en réalisant Alamo Bay effectuait sans doute son meilleur travail aux Etats-Unis. Très solidement charpenté, son film traitait avec une certaine force du racisme anti-vietnamien gangrénant une petite communauté de pêcheurs américains (emmenés par Ed Harris). Dans les kiosques, du côté des mensuels (Cinéma devenant, pour quelques temps, hebdomadaire), les couvertures se faisaient sur le film de Pialat (Cahiers du Cinéma (375), Cinématographe (113)), celui de Miller (Starfix (28), L'Ecran Fantastique (60), Premiere (102), qui publia par ailleurs un numéro en août avec Alain Delon en vedette (101)
Dans les kiosques, du côté des mensuels (Cinéma devenant, pour quelques temps, hebdomadaire), les couvertures se faisaient sur le film de Pialat (Cahiers du Cinéma (375), Cinématographe (113)), celui de Miller (Starfix (28), L'Ecran Fantastique (60), Premiere (102), qui publia par ailleurs un numéro en août avec Alain Delon en vedette (101) Après dix ans de rendez-vous manqués, je rencontre enfin Kiyoshi Kurosawa. Il me plaît.
Après dix ans de rendez-vous manqués, je rencontre enfin Kiyoshi Kurosawa. Il me plaît.