miller
-
Mortelle Randonnée (Claude Miller, 1983)
***Pas revu depuis trois décennies ce polar français parmi les plus insolites, parvenant à homogénéiser des éléments très disparates, des changements de registre et de décor. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs exemples de transposition réussie d'un univers américain à notre environnement, le voyage à travers l'Europe remplaçant sans problème une déambulation états-unienne.Deux imaginaires croissent en parallèle, celui de L’œil et celui de Catherine, avec cette remarquable utilisation de la voix off, dont on n'est pas toujours sûr qu'elle le soit vraiment (certains personnages finissent par dire à L’œil : "Vous parlez tout seul ?").Bizarrement, j'ai parfois pensé au Gould du Privé devant Serrault, qui grille beaucoup de cigarettes et qui a tendance à quitter ses interlocuteurs en marmonnant, en se parlant à lui-même, comme le Marlowe d'Altman. Serrault qui était, même entre deux conneries, dans une sacrée période (Garde à vue, Les Fantômes du chapelier, et peut-être, à revoir, Malevil), qui parvenait à créer des personnages incroyables tout en lâchant des petites gestes, des petites expressions, des petits rires, n'appartenant qu'à lui. Ici, quand il "entre" enfin dans la photo, il sort du cadre, c'est très simple et émouvant. -
Garde à vue (Claude Miller, 1981) & Le Paltoquet (Michel Deville, 1986)
***/**
J'étais curieux de revoir "Garde à vue" et "Le Paltoquet", deux films qui m'avaient impressionné, ado des années 80 (télévision ou vidéo pour le premier, au cinéma pour le second), deux films aux partis-pris comparables, s'appuyant sur un décor unique (ou presque), cherchant à "faire du cinéma" sur des bases théâtrales, racontant une enquête criminelle, convoquant des stars...Le Deville est un peu décevant à la revoyure, son originalité forcenée se retournant contre lui. C'est encore assez plaisant à suivre mais la façon qu'à le cinéaste de placer toutes les trente secondes une "idée" pour amuser, étonner, désarçonner ou mettre à distance devient lassante. Ça finit par n'être qu'une série de trucs de mise en scène, pas désagréable mais trop calculée, à l'image de ces plans qui ne semblent enchaînés que pour mettre en valeur tel mot ou telle expression.A l'opposé, la permanence de la force du Miller tient justement à la belle intégration de son parti-pris dans une coulée plus fluide et moins tape-à-l’œil (Miller en assumait, revendiquait même, le côté "commande"). Ainsi les dialogues d'Audiard se succèdent parfaitement, jamais soulignés pour les élever au rang de bon mot mais toujours déroulés dans le naturel des échanges. Le traitement des thèmes abordés (pédophilie, délitement du couple, rapport à la police, différences sociales, doutes sur la culpabilité...) est net tout en préservant les ambiguïtés. Grande interprétation de Serrault et Ventura (et Marchand). Les 4 premiers Miller, c'est pas rien... -
C'était mieux avant... (Décembre 1985)
Novembre s'étant éloigné à une vitesse faramineuse, il est grand temps de reprendre le cours de notre chronique (faussement) nostalgique. Voyons donc ce qui se tramait dans les salles obscures françaises pendant le mois de Décembre 1985 :
 Fêtes de fin d'année obligent, honneur aux enfants. Deux dessins animés leur étaient destinés : La dernière licorne d'Arthur Rankin Jr. et Jules Bass, et une nouvelle adaptation des BD d'Uderzo et Goscinny, Astérix et la surprise de César, réalisée par Paul et Gaëtan Brizzi. L'arroseuse orange, chronique du Hongrois Zsolt Kezdi-Kovacs datant de 1973 (comme nous le verrons, cette fin d'année fut propice aux rattrapages), pouvait également séduire les plus (ou moins) jeunes, tout comme le conte de Noël de Jeannot Szwarc Santa Claus (avec Dudley Moore et John Lithgow).
Fêtes de fin d'année obligent, honneur aux enfants. Deux dessins animés leur étaient destinés : La dernière licorne d'Arthur Rankin Jr. et Jules Bass, et une nouvelle adaptation des BD d'Uderzo et Goscinny, Astérix et la surprise de César, réalisée par Paul et Gaëtan Brizzi. L'arroseuse orange, chronique du Hongrois Zsolt Kezdi-Kovacs datant de 1973 (comme nous le verrons, cette fin d'année fut propice aux rattrapages), pouvait également séduire les plus (ou moins) jeunes, tout comme le conte de Noël de Jeannot Szwarc Santa Claus (avec Dudley Moore et John Lithgow).Les grands frères (et les grandes sœurs) friands de SF et d'heroic fantasy pouvaient, eux, profiter du savoir faire US grâce aux sorties conjointes des Goonies, aventure spielbergienne signée par Richard Donner, d'Explorers de Joe Dante, gérant l'après Gremlins, et de Kalidor de Richard Fleischer, capitalisant sur Conan le Barbare.
Les ados trouvèrent-ils leur bonheur dans le branché Moi vouloir toi de Patrick Dewolf (avec Gérard Lanvin en animateur de NRJ), dans le fantastico-musical Night magic de Lewis Furey (avec Carole Laure), dans le James-bondien Adieu canaille de Lindsay Shonteff (vieillerie anglaise de 79), dans la farce Maccionesque Pizzaiolo et Mozzarel de Christian Gion (sur un scénario de Wolinski), dans la série B philippine Vendicator de Willie Milan ? Il est permis d'en douter.
Billy-Ze-Kick, la comédie de Gérard Mordillat, Les Féroces, polar transalpin de 76 réalisé par Romolo Guerrieri et Les loups entre eux de José Giovanni (film d'action sur fond de terrorisme international, d'après son propre roman), sans doute destinés à un public plus adulte, ne semblent guère plus enthousiasmants. Baton Rouge, premier long métrage de Rachid Bouchareb, chronique sociale entre la France et les Etats-Unis, doit receler de plus évidentes qualités.
Enfin, pour clore cette première recension par tranches d'âges, n'oublions pas le film pour les vieux : La partie de chasse d'Alan Bridges, un drame britannique à l'allure bien académique mais bénéficiant tout de même de la présence de James Mason dans ce qui restera son dernier rôle.
 Dans cette livraison de décembre, je ne peux cocher que trois titres. En 88, je fus plus que séduit par La petite voleuse de Claude Miller, que je vis alors au moins deux ou trois fois d'affilée. Ensuite seulement je découvris L'effrontée, première collaboration entre le cinéaste et la jeune Charlotte Gainsbourg, qu'il révéla à cette occasion. Cette sensible variation sur les affres de adolescence me paru plaisante sans pour autant me contenter entièrement. Le second événement du mois, du point de vue du cinéma français, était alors l'arrivée sur les écrans du Lion d'or vénitien Sans toit ni loi. Agnès Varda y décrivait de manière elliptique la dérive de Mona, jeune femme sans domicile fixe, incarnée par Sandrine Bonnaire. Beau succès public, le film me laissa personnellement quelque peu insatisfait et distant lorsque je le vis à l'occasion d'une diffusion télévisée, lui préférant d'autres Varda plus "chaleureux". Plus lointain mais plus agréable est le souvenir laissé par Silverado, tentative de revitalisation d'un genre, le western, alors maintenu presque uniquement sous une lumière crépusculaire (celle de Clint Eastwood). Son réalisateur, Lawrence Kasdan, faisait en ce temps figure d'outsider prometteur. La distribution qu'il réunit à cette occasion pourrait presque suffire à évoquer, à elle seule, les petits plaisirs distillés par le cinéma (anglo-)américain de l'époque : Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover, Brian Dennehy, Linda Hunt, Jeff Goldblum, Rosanna Arquette, John Cleese...
Dans cette livraison de décembre, je ne peux cocher que trois titres. En 88, je fus plus que séduit par La petite voleuse de Claude Miller, que je vis alors au moins deux ou trois fois d'affilée. Ensuite seulement je découvris L'effrontée, première collaboration entre le cinéaste et la jeune Charlotte Gainsbourg, qu'il révéla à cette occasion. Cette sensible variation sur les affres de adolescence me paru plaisante sans pour autant me contenter entièrement. Le second événement du mois, du point de vue du cinéma français, était alors l'arrivée sur les écrans du Lion d'or vénitien Sans toit ni loi. Agnès Varda y décrivait de manière elliptique la dérive de Mona, jeune femme sans domicile fixe, incarnée par Sandrine Bonnaire. Beau succès public, le film me laissa personnellement quelque peu insatisfait et distant lorsque je le vis à l'occasion d'une diffusion télévisée, lui préférant d'autres Varda plus "chaleureux". Plus lointain mais plus agréable est le souvenir laissé par Silverado, tentative de revitalisation d'un genre, le western, alors maintenu presque uniquement sous une lumière crépusculaire (celle de Clint Eastwood). Son réalisateur, Lawrence Kasdan, faisait en ce temps figure d'outsider prometteur. La distribution qu'il réunit à cette occasion pourrait presque suffire à évoquer, à elle seule, les petits plaisirs distillés par le cinéma (anglo-)américain de l'époque : Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover, Brian Dennehy, Linda Hunt, Jeff Goldblum, Rosanna Arquette, John Cleese... Il me reste à lister les titres éveillant en moi quelque curiosité, à commencer par deux italiens, Cuore, nouvelle projection, historique, dans le monde de l'enfance par Luigi Comencini (et version cinéma d'une série télé), et Une saison italienne, de Pupi Avati, relatant un épisode de la vie du jeune Mozart. Tonnerres lointains est généralement reconnu comme l'une des œuvres majeures de Satyajit Ray. Le fait que ce film social et historique de 1973 ait mis douze ans à être distribué en France n'en est que plus surprenant. The way it is or Eurydice in the avenues d'Eric Mitchell est un film indépendant américain entre théâtre et réalité dont l'intérêt ne doit sûrement pas se limiter aux premières apparitions de Vincent Gallo et Steve Buscemi dans des seconds rôles. Drôle de missionnaire de Richard Loncraine est une comédie écrite et interprétée par Michael Palin, ce qui suffit à nous attirer.
Il me reste à lister les titres éveillant en moi quelque curiosité, à commencer par deux italiens, Cuore, nouvelle projection, historique, dans le monde de l'enfance par Luigi Comencini (et version cinéma d'une série télé), et Une saison italienne, de Pupi Avati, relatant un épisode de la vie du jeune Mozart. Tonnerres lointains est généralement reconnu comme l'une des œuvres majeures de Satyajit Ray. Le fait que ce film social et historique de 1973 ait mis douze ans à être distribué en France n'en est que plus surprenant. The way it is or Eurydice in the avenues d'Eric Mitchell est un film indépendant américain entre théâtre et réalité dont l'intérêt ne doit sûrement pas se limiter aux premières apparitions de Vincent Gallo et Steve Buscemi dans des seconds rôles. Drôle de missionnaire de Richard Loncraine est une comédie écrite et interprétée par Michael Palin, ce qui suffit à nous attirer.Notons pour terminer ce panorama que parmi les produits pornographiques diffusés alors, nous trouvons deux classiques américains du genre (millésimés 1981) qui doivent se distinguer aisément du tout-venant : d'une part, Nightdreams, baptisé ici Journal intime d'une nymphomane, hard expérimental inspiré notamment du Eraserhead de David Lynch et signé par F. X. Pope (auteur de Café Flesh, autre fameux X), et d'autre part, Pandora's mirror, aventure fantastique filmée par Warren Evans et affublée, en guise de titre français, d'un subtil Sodomise-moi jusqu'à la garde.
 Nous ne savons si Nightdreams ou Pandora's mirror fit en décembre 85 la couverture de l'un de ces magazines spécialisés qui, placés sur la rangée du haut de notre marchand de journaux, nous étaient alors encore interdits, mais nous sommes certains que Sans toit ni loi et son actrice principale étaient à l'honneur sur bien des supports, à en juger par les couvertures des Cahiers du Cinéma (378), de Cinématographe (114), de Premiere (105) et de Jeune Cinéma (171). Bernard Giraudeau faisait, lui, la une de Starfix (31), alors que Silverado plaisait à La Revue du Cinéma (411), que L'Ecran Fantastique (63) effectuait un tir groupé avec Explorers, Santa Claus et Les Goonies et que Positif (298) anticipait sur la sortie de L'honneur des Prizzi de John Huston.
Nous ne savons si Nightdreams ou Pandora's mirror fit en décembre 85 la couverture de l'un de ces magazines spécialisés qui, placés sur la rangée du haut de notre marchand de journaux, nous étaient alors encore interdits, mais nous sommes certains que Sans toit ni loi et son actrice principale étaient à l'honneur sur bien des supports, à en juger par les couvertures des Cahiers du Cinéma (378), de Cinématographe (114), de Premiere (105) et de Jeune Cinéma (171). Bernard Giraudeau faisait, lui, la une de Starfix (31), alors que Silverado plaisait à La Revue du Cinéma (411), que L'Ecran Fantastique (63) effectuait un tir groupé avec Explorers, Santa Claus et Les Goonies et que Positif (298) anticipait sur la sortie de L'honneur des Prizzi de John Huston.Voilà pour décembre 1985. La suite le mois prochain...
Pour en savoir plus : Silverado, Les Goonies, Kalidor, Pizzaiolo et Mozzarel et Explorers vus par le consciencieux (et courageux) Mariaque.
-
C'était mieux avant... (Septembre 1985)
L'été passé, et notre emploi du temps n'allant pas en s'allégeant, il s'agissait de prendre une décision quant à la continuation de notre série mensuelle. Après mûre réflexion, devant la masse de courriers inquiets émanant de lecteurs fanatiques, nous avons décidé de ne pas saborder cette rubrique qui, en deux ans seulement, est devenue incontournable dans la blogosphère cinéphile internationale et de nous engager dans une Saison 3. Ainsi soulagés, nous pouvons tranquillement nous poser la question rituelle : Mais, Diable, que trouvions-nous donc dans les salles françaises en Septembre 1985 ?
 Une ligne de force inattendue se dégage de ce mois-ci : la célébration des noces du cinéma et de la musique pop-rock. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, troisième volet de la saga de George Miller créait l'événement. Mel Gibson en partageait l'affiche avec la tigresse soul Tina Turner. Le film fut, dans notre souvenir, reçu de manière assez tranchée, les uns affichant une déception tenant à la débauche spectaculaire et à l'humanisme messianique dont l'auteur chargeait son personnage principal, les autres saluant l'originalité de sa vision et son dépassement formel. Du haut de nos 13 ans et quelques, nous nous étions ralliés alors au deuxième groupe. Y resterions-nous aujourd'hui ?
Une ligne de force inattendue se dégage de ce mois-ci : la célébration des noces du cinéma et de la musique pop-rock. Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, troisième volet de la saga de George Miller créait l'événement. Mel Gibson en partageait l'affiche avec la tigresse soul Tina Turner. Le film fut, dans notre souvenir, reçu de manière assez tranchée, les uns affichant une déception tenant à la débauche spectaculaire et à l'humanisme messianique dont l'auteur chargeait son personnage principal, les autres saluant l'originalité de sa vision et son dépassement formel. Du haut de nos 13 ans et quelques, nous nous étions ralliés alors au deuxième groupe. Y resterions-nous aujourd'hui ?En 85, le chanteur Sting, ayant déjà trouvé le groupe Police trop contraignant à l'endroit de son ego démesuré, misait autant sur la musique en solo que sur le cinéma. Dans La promise de Frank Roddam, il endossait les habits du Baron Frankenstein pour une variation romantique du mythe (en compagnie, charmante, de Jennifer Beals). Ai-je vu ce film ? Plus aucune idée... Plus fraîchement starisée (Like a virgin, 1984), Madonna jouait de façon plus modeste mais avec finalement un retentissement plus grand devant la caméra de Susan Seidelman pour la comédie urbaine Recherche Susan désespérément. Faute de l'avoir revu depuis, nous qualifierons prudemment le film d'agréablement mode et retiendrons surtout qu'il révéla une actrice particulièrement attachante, Rosanna Arquette (en attendant sa sœur...).
 Il n'est pas jusqu'à James Bond qui n'ait succombé à cette vague. Dangereusement vôtre de John Glen, avec un Roger Moore dangereusement vieillissant (ce serait son dernier effort dans le costume de 007), bénéficiait non seulement d'un titre, bientôt hit mondial (A view to a kill), signé des garçons coiffeurs de Duran Duran, mais aussi de la présence singulière de Grace Jones en bras droit du méchant Christopher Walken. Plus sincèrement et plus profondément lié à la culture musicale contemporaine, porté également par un succès discographique renversant (qui m'est devenu aujourd'hui, pour de multiples raisons, quasiment inécoutable), (Don't you) Forget about me de Simple Minds, Breakfast Club de John Hughes a marqué durablement de nombreux cinéphiles de ma génération (bien qu'assez "secrètement", la plupart d'entre nous, et moi le premier, hésitant à jeter à nouveau un œil sur cette histoire de lycéens astreints à une journée de "colle" dans leur établissement désert).
Il n'est pas jusqu'à James Bond qui n'ait succombé à cette vague. Dangereusement vôtre de John Glen, avec un Roger Moore dangereusement vieillissant (ce serait son dernier effort dans le costume de 007), bénéficiait non seulement d'un titre, bientôt hit mondial (A view to a kill), signé des garçons coiffeurs de Duran Duran, mais aussi de la présence singulière de Grace Jones en bras droit du méchant Christopher Walken. Plus sincèrement et plus profondément lié à la culture musicale contemporaine, porté également par un succès discographique renversant (qui m'est devenu aujourd'hui, pour de multiples raisons, quasiment inécoutable), (Don't you) Forget about me de Simple Minds, Breakfast Club de John Hughes a marqué durablement de nombreux cinéphiles de ma génération (bien qu'assez "secrètement", la plupart d'entre nous, et moi le premier, hésitant à jeter à nouveau un œil sur cette histoire de lycéens astreints à une journée de "colle" dans leur établissement désert).Pour évoquer les rapports entre pop-rock et cinéma, nous nous arrêterons-là et nous garderons bien de gonfler ce corpus de films en y ajoutant P.R.O.F.S. de Patrick Schulmann au prétexte qu'il met en vedette Patrick Bruel. Si cette suite de sketchs en milieu scolaire n'est peut-être finalement pas si indigne que cela, la carrière musicale de son interprète principal l'est en tous points. Tant que nous sommes au rayon rigolade, passons sans regret sur Double zéro de conduite (italien, de Giuliano Carnimeo) et sur Le gaffeur (de Serge Pénard, avec Jean Lefebvre), mais rappelons le surprenant et historique succès public obtenu par Coline Serreau avec son aimable comédie sociologique Trois hommes et un couffin.
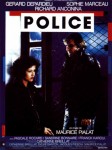 Deux grands auteurs étaient au rendez-vous de septembre : Maurice Pialat et Akira Kurosawa. Si nous reconnaissons que Police et Ran tiennent la dragée haute à presque tous les autres films de ce mois-là, nous avouons qu'ils ne font ni l'un ni l'autre partie de nos opus préférés au sein des belles filmographies des deux cinéastes. Venant après les superbes A nos amours et Kagemusha, et malgré leurs beautés respectives, ils peinent légèrement, selon nous, à réussir le grand écart entre un univers singulier et un genre bien défini (le polar) pour le Français et à faire oublier plusieurs longueurs (sur 2h45) et un hiératisme un peu pesant pour le Japonais. A l'inverse, Louis Malle en réalisant Alamo Bay effectuait sans doute son meilleur travail aux Etats-Unis. Très solidement charpenté, son film traitait avec une certaine force du racisme anti-vietnamien gangrénant une petite communauté de pêcheurs américains (emmenés par Ed Harris).
Deux grands auteurs étaient au rendez-vous de septembre : Maurice Pialat et Akira Kurosawa. Si nous reconnaissons que Police et Ran tiennent la dragée haute à presque tous les autres films de ce mois-là, nous avouons qu'ils ne font ni l'un ni l'autre partie de nos opus préférés au sein des belles filmographies des deux cinéastes. Venant après les superbes A nos amours et Kagemusha, et malgré leurs beautés respectives, ils peinent légèrement, selon nous, à réussir le grand écart entre un univers singulier et un genre bien défini (le polar) pour le Français et à faire oublier plusieurs longueurs (sur 2h45) et un hiératisme un peu pesant pour le Japonais. A l'inverse, Louis Malle en réalisant Alamo Bay effectuait sans doute son meilleur travail aux Etats-Unis. Très solidement charpenté, son film traitait avec une certaine force du racisme anti-vietnamien gangrénant une petite communauté de pêcheurs américains (emmenés par Ed Harris).Dans cette liste mensuelle, d'autres œuvres sont certainement à découvrir : Dance with a stranger de Mike Newell, drame britannique de bonne réputation, situé dans les années 50 ; Dust de Marion Hänsel avec Jane Birkin et Trevor Howard ; Mystère Alexina de René Féret ; Notre mariage, mélodrame forcément distancié puisque signé par Valéria Sarmiento, épouse et collaboratrice de Raoul Ruiz ; Le pouvoir du mal réflexion philosophique de Krzysztof Zanussi ; Orinoko, essai poétique et historique du vénézuélien Diego Risquez. Avec plus de précautions, nous avançons les titres des films de Gérard Vergez (Bras de fer, Giraudeau et Malavoy bataillent sous l'Occupation), de Tobe Hooper (Life force, mélange d'horreur et de SF qui ne semble guère prisé, y compris par les connaisseurs), de Paul Morrissey (Le neveu de Beethoven, biopic franco-allemand), de James Bridges (Perfect, mêlant journalisme et aerobic, avec John Travolta et Jamie Lee Curtis), de Jeff Kanew (Touché, film d'espionnage) et de Yaky Yosha (Le vautour, drame israélien). Et ce n'est que poussé par notre volonté d'exhaustivité que nous mentionnons Les guerriers de la jungle (Ernst Ritter von Theumer), Les huit guerriers de Shaolin (Chou Ming), L'implacable défi (Bruce Le), Ninja III (Sam Firtsbenberg), Les 36 poings vengeurs de Shaolin (Chen Chih Hua), La femme pervertie (Joe D'Amato) ou Les confidences pornographiques de Lady Winter (de José Benazeraf avec Olinka, également à l'affiche de Je t'offre mon corps de Michel Leblanc).
Enfin, n'oublions pas L'homme au chapeau de soie, remarquable film de montage réalisé par Maud Linder en hommage à son père Max, figure aujourd'hui malheureusement bien oubliée du burlesque "primitif".
 Dans les kiosques, du côté des mensuels (Cinéma devenant, pour quelques temps, hebdomadaire), les couvertures se faisaient sur le film de Pialat (Cahiers du Cinéma (375), Cinématographe (113)), celui de Miller (Starfix (28), L'Ecran Fantastique (60), Premiere (102), qui publia par ailleurs un numéro en août avec Alain Delon en vedette (101)), et celui de Roddam (enfin, surtout pour afficher Sting, comme le fit L'Ecran Fantastique pendant l'été (59) et parler du genre, comme La Revue du Cinéma (408)). A Positif (295), on attendait impatiemment la sortie du Ginger et Fred de Federico Fellini (prévue alors seulement pour janvier 86) et chez Jeune Cinéma (169) on célébrait le cinéma indien.
Dans les kiosques, du côté des mensuels (Cinéma devenant, pour quelques temps, hebdomadaire), les couvertures se faisaient sur le film de Pialat (Cahiers du Cinéma (375), Cinématographe (113)), celui de Miller (Starfix (28), L'Ecran Fantastique (60), Premiere (102), qui publia par ailleurs un numéro en août avec Alain Delon en vedette (101)), et celui de Roddam (enfin, surtout pour afficher Sting, comme le fit L'Ecran Fantastique pendant l'été (59) et parler du genre, comme La Revue du Cinéma (408)). A Positif (295), on attendait impatiemment la sortie du Ginger et Fred de Federico Fellini (prévue alors seulement pour janvier 86) et chez Jeune Cinéma (169) on célébrait le cinéma indien.Voilà pour septembre 1985. La suite le mois prochain...
-
Je suis heureux que ma mère soit vivante
(Claude et Nathan Miller / France / 2009)
□□□□
 Misère du cinéma français du milieu, rentrée 2009, épisode 2 (*)
Misère du cinéma français du milieu, rentrée 2009, épisode 2 (*)Décrire de façon troublante les retrouvailles d'un jeune homme avec sa mère, quinze ans après son abandon, comme une passion amoureuse est plutôt une bonne idée. C'est la seule à se détacher de Je suis heureux que ma mère soit vivante, film qui n'a pour lui que sa relative brièveté (90 minutes).
Nous sommes dans un drame PSYCHOLOGIQUE, au sens Stabilo du terme. C'est à dire que dès la première séquence, celle de la baignade estivale entre père et fils (adoptif), tout concourt à nous faire sentir qu'il y a du lourd en train de se jouer là : de l'étrangeté dans le quotidien, du secret familial pesant, du traumatisme qui affleure, des regards intenses, des dialogues appuyés. Pas une scène, pas un plan dans ce film qui ne soient écrasés par du sur-signifiant. Le seul moment qui échappe à cette fatalité est celui où la violence éclate, de manière totalement inattendue. Pour un instant, l'étude psychologique se suspend enfin... avant de reprendre son cours.
A l'inscription sociale des personnages, on ne croit pas un instant (à côté, le Rickyde François Ozon passerait pour du Ken Loach). Bien évidemment, les auteurs clament qu'il était hors de question de porter un jugement. Or, dans la façon de la regarder, de la faire bouger ou parler, il n'est laissé aucune chance à la mère "indigne", qui ne peut que provoquer l'apitoiement du spectateur (comparez avec le personnage similaire interprété par Kierston Warreing dans le récent Fish tank). De toute manière, tous les acteurs sont affreusement dirigés et la mise en scène n'a aucune grâce.
Auteur passionnant pendant ses quinze premières années d'activité, Claude Miller ne cesse de s'enliser depuis quelques temps dans un cinéma de papa où l'âpreté des sujets est relayée par une réalisation pachydermique et déprimante. L'association avec son fils Nathan n'a rien changé à l'affaire : après La petite Lili et Un secret, il réalise une troisième horreur d'affilée.
(*) : Pour l'épisode 1, voir ici.
Un avis voisin : Rob Gordon
Un avis opposé : Goin' to the movies
-
Un secret
(Claude Miller / France / 2007)
□□□□
 Embarrassant. En sortant de la projection je me suis dit que je traiterais le film de façon ironique en tirant en particulier sur Bruel. Puis, j'ai eu envie de l'expédier en deux-trois phrases. Mais bon, je vais tout de même me forcer à expliquer un minimum pourquoi j'ai vécu l'heure et demie la plus pénible depuis le début de cette année cinématographique.
Embarrassant. En sortant de la projection je me suis dit que je traiterais le film de façon ironique en tirant en particulier sur Bruel. Puis, j'ai eu envie de l'expédier en deux-trois phrases. Mais bon, je vais tout de même me forcer à expliquer un minimum pourquoi j'ai vécu l'heure et demie la plus pénible depuis le début de cette année cinématographique.Claude Miller est un cinéaste attiré par les sentiments troubles, par les corps, par les terreurs de l'enfance. C'est aussi l'un des représentants de ce cinéma français du milieu, si malmené ces dernières années, un cinéma populaire de qualité et ambitieux. Mais, vraiment là, c'est pas possible. Premier handicap de taille : l'interprétation du "couple star". En me remémorant le très bon Toutes peines confondues (Michel Deville, 1991), j'espérais au mieux une surprise ou au pire ne pas être dérangé par ce pauvre Patrick Bruel. Peine perdue. Si j'ajoute que je suis assez peu sensible au charme de Cécile de France, la cause est déjà pratiquement entendue. Toute la presse s'est déjà moquée des scènes où les deux apparaissent vieillis, je n'en rajouterai pas. Pour les autres, Julie Depardieu, Nathalie Boutefeu, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric, c'est la routine (Michel Ciment au dernier Masque et la plume : "C'est le meilleur rôle d'Amalric cette année"; je t'aime bien Michel, mais je te jure, des fois, t'en fais trop....).
Pour ce qui est du sujet, apparemment si cher à Miller, le fait qu'il ne soit pas porté par les acteurs de façon satisfaisante pour moi me le rend peu passionnant. La reconstitution d'époque est totalement empesée et la restitution de l'ambiance passe par des procédés d'une subtilité éléphantesque. Il semblerait que cette famille ne voit au cinéma que des actualités sur Hitler, tombe sur un discours chaque fois qu'elle allume la radio et ne laisse traîner dans sa maison que des journaux aux titres alarmistes. Un plan anodin traduit bien cette impression : un panoramique amorcé par un employé changeant la plaque portant le nom de la rue où habite la famille, baptisée maintenant "Rue du Maréchal Pétain". En plus de situer ainsi grossièrement son sujet dans l'Histoire pour-que-les-plus-jeunes-spectateurs-comprennent-bien et de multiplier les allers-retours temporels sans résultat, Claude Miller rate toutes les scènes clés. Car il a plein d'idées visuelles. Sauf que depuis quelques films (La classe de neige, précisément), il abuse d'effets balourds, notamment pour les moments les plus violents (ralentis, lumières inquiétantes, plans oniriques...). Un seul passage nous sort de la torpeur ambiante : le brusque accès de sauvagerie de François pendant la projection du film (Nuit et brouillard, peut-être) et ses explications à Louise.
J'avais bien aimé Betty Fisher et autres histoires, mais trois ans après, je m'étais demandé si Claude Miller n'avait pas réalisé avec La petite Lili son plus mauvais film. La réponse était non.