Cinéaste de l’effleurement, Wong Kar-wai s’efforce de mettre autant en valeur le choc des coups que la grâce des esquives. Dans ce Grandmaster où sont mises sur un pied d’égalité scènes de combat et scènes d’intimité (jusqu’à ce que l’on puisse parler parfois de "l’intimité d’un combat"), même les caresses semblent suspendues, laissant ainsi constamment un espace, minime mais infranchissable, entre deux corps, entre deux épidermes.
Si le protecteur de Gong Er se bat au sabre, sa lame n’ouvre que des plaies de coton dans les épais habits de ses adversaires. L’arme ne perfore pas. De même, le mobilier, curieux souci des combattants, est brisé bien plus souvent que les os.

Pénétrer, toucher même, semblant impossible, il faut trouver des intermédiaires, des substituts, des palliatifs. Une lettre, un bouton, font le lien entre les corps distants et un combat vaut une étreinte. Seul le rêve permet l’entremêlement. En dehors, les êtres ou les objets ne s’attirent que pour mieux se repousser en de somptueuses chorégraphies. Wong Kar-wai est un cinéaste de la surface des choses (mais ses films ne sont superficiels que lorsqu’ils échouent à offrir autre chose qu’un catalogue de jolis détails, lorsqu’ils n’en restent qu’aux idées, sans les relier entre elles ni aux personnages supposés leur donner chair, cf My Blueberry Nights)
Wong Kar-wai est aussi un cinéaste de la fragmentation. Il escamote la continuité du mouvement et fait sienne la rapidité moderne du montage des films d’action. Que les combats manquent de lisibilité n’est pas un problème : se focaliser sur un détail, le couper du reste, ou ne l’y faire tenir que par la musicalité du rythme ou la texture de l’image, il y a longtemps que le cinéaste est passé maître dans cet exercice. Dès lors, il ne faut pas s’étonner non plus de le voir faire le pari d’une fresque historique à la vision (au sens strict) délibérément limitée. Comme il suffit que l’on sente la vibration qui habite les êtres sous la surface, la simple notation historique laisse deviner tout l’ancrage.

Le film, qui se termine dans les fumées d’opium, est, de manière assez évidente, "léonien". Le rapport des personnages à l’espace diffère cependant d’Il était une fois en Amérique au Grandmaster. Chez Leone, nous sommes saisis par les sauts du proche au lointain, du gros plan au plan large, comme par la brutalité du ratage de l’amour. A l’opposé, chez Wong Kar-wai, la fragmentation rend les personnages insituables, dans des décors qui, pourtant, ne semble jamais vraiment changer. De plus, si ces êtres passent à côté de l’amour, ce ratage se fait en glissades gracieuses. Toutefois, entre les deux œuvres, la mélancolie alliée à l’ampleur du geste romanesque, le souffle historique et intime qui traverse, sont (presque) comparables.
Et comme chez Leone, la question du temps et de son glissement est essentielle. Dans The Grandmaster, les différents temps semblent coulisser comme des panneaux (ou glisser comme les pieds sur le sol, mouillé ou enneigé, pendant les combats). Et sur une échelle moins grande, le film provoque une étrange sensation avec ces ralentis s’étirant en des plans pourtant très courts. Une sorte de double flux se crée, quelque chose qui s’enroule sur lui-même à force de poser la question du regard vers l’arrière ou vers l’avant.


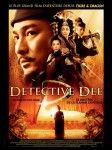 DETECTIVE DEE : LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME (Die Renjie)
DETECTIVE DEE : LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME (Die Renjie)
 LE FOSSÉ (Jiabiangou)
LE FOSSÉ (Jiabiangou) Impossible pour moi, à le découvrir aujourd'hui, de ne pas juger Infernal affairs (Mou gaan dou) à l'aune de son remake de 2006, Les infiltrés (à mon sens le meilleur Scorsese de la série Di Caprio en cours). Une simple donnée explique à elle seule la plupart des différences que l'on observe entre les deux œuvres : la durée des métrages. L'original, ramassé sur ses cent minutes, affiche à son compteur quasiment une heure de moins.
Impossible pour moi, à le découvrir aujourd'hui, de ne pas juger Infernal affairs (Mou gaan dou) à l'aune de son remake de 2006, Les infiltrés (à mon sens le meilleur Scorsese de la série Di Caprio en cours). Une simple donnée explique à elle seule la plupart des différences que l'on observe entre les deux œuvres : la durée des métrages. L'original, ramassé sur ses cent minutes, affiche à son compteur quasiment une heure de moins. "Seules deux scènes retiennent l'attention, et encore... la première est un flash : la mort du chevalier, écartelé par quatre cordes et coupé en deux d'un coup de sabre. La deuxième est l'ultime duel sur le pont, déjà jonché de plusieurs dizaines de cadavres, combattants zigouillés par le héros manchot. Le coup final porté grâce à l'usage de trois sabres (pour un seul bras) est assez beau car il explique d'autres scènes de jonglerie avec des oeufs ou des ustensiles de cuisine qui paraissaient ridicules.
"Seules deux scènes retiennent l'attention, et encore... la première est un flash : la mort du chevalier, écartelé par quatre cordes et coupé en deux d'un coup de sabre. La deuxième est l'ultime duel sur le pont, déjà jonché de plusieurs dizaines de cadavres, combattants zigouillés par le héros manchot. Le coup final porté grâce à l'usage de trois sabres (pour un seul bras) est assez beau car il explique d'autres scènes de jonglerie avec des oeufs ou des ustensiles de cuisine qui paraissaient ridicules. PTU, c'est l'espace, la durée (le temps), la surprise (le contretemps).
PTU, c'est l'espace, la durée (le temps), la surprise (le contretemps). Avec les deux Election (vus en salles au printemps), To creuse son sillon et tente son Parrain à lui à travers l'histoire d'une lutte pour le pouvoir au sein d'un clan de la pègre hong-kongaise. Dans le premier volet, tout est enrobé d'obscurité, et ce dès les premières scènes de tractations entre les "oncles" en vue de l'élection du nouveau parrain, où les visages sont volontairement sous-éclairés. Un des règlements de comptes se fera l'après-midi dans un restaurant, mais le store sera tiré pour prendre au piège et pour faire le noir. L'exception arrive au dénouement, au cours de la partie de pêche. Ce brutal éclairage se fait alors aussi sur la personnalité de Lok, jusque là le personnage qui attirait la sympathie du spectateur face au chien fou Big D, mais dont on sentait bien qu'il était, lui aussi, capable des pires horreurs. Johnnie To connaît sa grammaire et montre donc, bien sûr, l'ambiguïté inhérente à ces récits de gangsters. Roi des scènes d'action, il innove constamment, sans en faire trop, d'où l'impression grisante de voir celles-ci filmées exactement comme il le faut. Dense et sec, Election 1 ne dévie pas de son propos : la lutte pour acquérir un pouvoir absolu et le néant qui en découle.
Avec les deux Election (vus en salles au printemps), To creuse son sillon et tente son Parrain à lui à travers l'histoire d'une lutte pour le pouvoir au sein d'un clan de la pègre hong-kongaise. Dans le premier volet, tout est enrobé d'obscurité, et ce dès les premières scènes de tractations entre les "oncles" en vue de l'élection du nouveau parrain, où les visages sont volontairement sous-éclairés. Un des règlements de comptes se fera l'après-midi dans un restaurant, mais le store sera tiré pour prendre au piège et pour faire le noir. L'exception arrive au dénouement, au cours de la partie de pêche. Ce brutal éclairage se fait alors aussi sur la personnalité de Lok, jusque là le personnage qui attirait la sympathie du spectateur face au chien fou Big D, mais dont on sentait bien qu'il était, lui aussi, capable des pires horreurs. Johnnie To connaît sa grammaire et montre donc, bien sûr, l'ambiguïté inhérente à ces récits de gangsters. Roi des scènes d'action, il innove constamment, sans en faire trop, d'où l'impression grisante de voir celles-ci filmées exactement comme il le faut. Dense et sec, Election 1 ne dévie pas de son propos : la lutte pour acquérir un pouvoir absolu et le néant qui en découle. Si Election 2 me déçoit quelque peu, c'est que le style ne varie guère et que les personnages ne sont pas spécialement approfondis (alors que de ce côté-là, la deuxième partie du Parrain, c'est quand même quelque chose...). Passant sur les deux ans du mandat de Lok, qui nous auraient bien intéressés, Johnnie To concentre son récit sur la nouvelle élection et reproduit son schéma des règlements de comptes entre candidats. Les ramifications du scénario sont moins complexes (moins de protagonistes entrent en jeu) et les affrontements sont plus systématiques (mais on n'oublie pas la scène dans le chenil). Une dimension politique est ajoutée en traitant des rapports avec la Chine, qui semble in fine tirer toutes les ficelles. Le diptyque (provisoire ?) se clôt toujours plus sombre (nous sommes passé d'une partition plutôt pop à une musique lancinante) et plus violent.
Si Election 2 me déçoit quelque peu, c'est que le style ne varie guère et que les personnages ne sont pas spécialement approfondis (alors que de ce côté-là, la deuxième partie du Parrain, c'est quand même quelque chose...). Passant sur les deux ans du mandat de Lok, qui nous auraient bien intéressés, Johnnie To concentre son récit sur la nouvelle élection et reproduit son schéma des règlements de comptes entre candidats. Les ramifications du scénario sont moins complexes (moins de protagonistes entrent en jeu) et les affrontements sont plus systématiques (mais on n'oublie pas la scène dans le chenil). Une dimension politique est ajoutée en traitant des rapports avec la Chine, qui semble in fine tirer toutes les ficelles. Le diptyque (provisoire ?) se clôt toujours plus sombre (nous sommes passé d'une partition plutôt pop à une musique lancinante) et plus violent.