
****
Valérie est une jolie fille de treize ans. Elle vit avec sa grand mère dans un village où arrivent, en même temps, une troupe de comédiens et une procession de moines. Autour de sa maison rôde un être maléfique surnommé "le Putois" et un jeune homme bienveillant, "l'Aiglon", qui se révèle être le fils du précédent. Le garçon va se charger de protéger Valérie contre tous les hommes ou créatures qui l'entourent et qui ne pensent qu'à abuser d'elle.
Valérie au pays des merveilles, film d'un Jaromil Jires responsable quelques mois plus tôt d'une belle Plaisanterie, est difficile à décrire tant il suit la logique des rêves et leur emprunte le caractère aventureux de leurs articulations. A aucun moment, et pas plus au début qu'à la fin du récit, nous ne nous sentons arrimés à une quelconque réalité. Nous restons dans le rêve de Valérie. Par conséquent, tout peut advenir et le cinéaste ne se prive pas d'assembler des séries de plans dont la nature est totalement imprévisible.
Cette esthétique de la surprise incessante est agréable mais peut aussi paraître quelque peu vaine. Le travail sur la forme est constant, chaque plan se voulant puissamment expressif. Les cadrages improbables abondent, comme les jeux de lumière et de caches (le traitement de l'espace est très particulier, l'architecture de la maison de Valérie, par exemple, se faisant presque "mouvante"). Une impression de trop plein se fait jour car les références semblent innombrables (partant des deux plus évidentes, Lewis Carroll et Bram Stoker), les pistes qui s'ouvrent sont mutliples et l'apparence des personnages eux-mêmes peut changer en un instant. La mise en scène de Jires impressionne mais prend le risque de lâcher le spectateur et de le mettre à distance.
Pour autant, malgré l'onirisme absolu impregnant l'objet, c'est un véritable récit qui se met en place. Si des bifurcations désarçonnent, si des symboles échappent, si des images restent difficiles à définir, une histoire nous est bien contée. C'est celle d'une innocence en péril, d'une virginité menacée. Une lutte est engagée entre le blanc qui caractérise le monde de Valérie et le noir du tentateur maléfique, entre la lumière solaire et la pénombre des caves.
La beauté virginale est aussi celle de certaines images irisantes que compose le cinéaste. Cependant elle est très loin de ressembler à une quelconque pudibonderie. Valérie est une jeune fille en danger ayant ses propres troubles, ses émois, ses curiosités. Le surgissement de la monstruosité de l'empêche pas d'aller de l'avant et elle ne détourne pas le regard si elle surprend un couple faisant l'amour. L'aventure, qui laisse une large part à l'érotisme, s'apparente au passage vers la sexualité. La dernière séquence illustre d'ailleurs l'accession à un autre état, harmonieux pour tous, y compris ceux que l'on croyait repoussés.
Dans ce film riche de prolongements, le ballet des nombreux personnages convoqués finit par prendre la forme d'un nœud de vipère familial, ce qui ouvre plus encore à une profonde dimension psychanalytique et donne, sur la durée, une certaine épaisseur à des figures au départ schématiques. Malgré les thèmes périlleux, comme celui de l'inceste, qui apparaissent alors, malgré les agissements sanguinaires des vampires qui le peuplent, ce déroutant Valérie au pays des merveilles reste jusqu'au bout d'une grande douceur. Encore une chose étonnante.
A lire : une chronique DVD enthousiaste signée par un praticien bien connu.
 VALÉRIE AU PAYS DES MERVEILLES (Valerie a tyden divu)
VALÉRIE AU PAYS DES MERVEILLES (Valerie a tyden divu)
de Jaromil Jires
(Tchécoslovaquie / 73 min / 1970)


 CARLOS
CARLOS

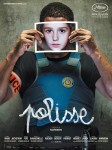
 POLISSE
POLISSE
 2008 : Cette année-là, les Cahiers vont saluer et écouter Brian De Palma, Arnaud Desplechin, Ari Folman, Laurent Cantet, Raymond Depardon, Werner Herzog, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Sean Penn (Into the wild), Hou Hsiao-hsien et Juliette Binoche (Le voyage du ballon rouge), Sandrine Bonnaire (Elle s'appelle Sabine), Garin Nugroho (Opera Jawa), Jerzy Skolimowski (Quatre nuits avec Anna), Bertrand Bonello (De la guerre), Jean-Pierre et Luc Dardenne (Le silence de Lorna), Béla Tarr (L'homme de Londres), Ramin Bahrani (Chop shop), Steve McQueen (Hunger), James Gray (Two lovers), Jeanne Moreau et Louis Garrel. Ils publient des textes sur le cinéma américain contemporain, l'état du cinéma français (le Club des 13, les Etats Généraux), le cinéma muet, les fictions documentaires, la représentation de la guerre, Johan van der Keuken, Shirley Clarke, Jim McBride, Kiju Yoshida, Chris Marker, Mario Monicelli, Howard Hawks, Werner Schroeter, Youssef Chahine, Manny Farber, Shinji Aoyama, Jia Zhangke et Dino Risi (par Luc Moullet).
2008 : Cette année-là, les Cahiers vont saluer et écouter Brian De Palma, Arnaud Desplechin, Ari Folman, Laurent Cantet, Raymond Depardon, Werner Herzog, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Sean Penn (Into the wild), Hou Hsiao-hsien et Juliette Binoche (Le voyage du ballon rouge), Sandrine Bonnaire (Elle s'appelle Sabine), Garin Nugroho (Opera Jawa), Jerzy Skolimowski (Quatre nuits avec Anna), Bertrand Bonello (De la guerre), Jean-Pierre et Luc Dardenne (Le silence de Lorna), Béla Tarr (L'homme de Londres), Ramin Bahrani (Chop shop), Steve McQueen (Hunger), James Gray (Two lovers), Jeanne Moreau et Louis Garrel. Ils publient des textes sur le cinéma américain contemporain, l'état du cinéma français (le Club des 13, les Etats Généraux), le cinéma muet, les fictions documentaires, la représentation de la guerre, Johan van der Keuken, Shirley Clarke, Jim McBride, Kiju Yoshida, Chris Marker, Mario Monicelli, Howard Hawks, Werner Schroeter, Youssef Chahine, Manny Farber, Shinji Aoyama, Jia Zhangke et Dino Risi (par Luc Moullet).
 Quitte à choisir : Si je cherche la trace de mes dix favoris de l'année, j'en trouve six chez les Cahiers (Coen, Anderson, Desplechin, Folman, Cantet, Depardon) et seulement trois chez Positif (Allen en plus des Coen et d'Anderson). En mettant côte à côte Demy et Antonioni, en avouant que le Doillon m'est inconnu, comme les deux films de décembre choisis par les Cahiers, et même en réaffirmant mon rejet total de Redacted, je vois la revue de Frodon-Burdeau assurer et celle de Ciment marquer le pas, ses choix se portant essentiellement sur des habitués de la maison en petite (Eastwood, Scorsese) ou en très mauvaise (Burton, Romero, Leigh, Varda) forme. Allez, pour 2008 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Si je cherche la trace de mes dix favoris de l'année, j'en trouve six chez les Cahiers (Coen, Anderson, Desplechin, Folman, Cantet, Depardon) et seulement trois chez Positif (Allen en plus des Coen et d'Anderson). En mettant côte à côte Demy et Antonioni, en avouant que le Doillon m'est inconnu, comme les deux films de décembre choisis par les Cahiers, et même en réaffirmant mon rejet total de Redacted, je vois la revue de Frodon-Burdeau assurer et celle de Ciment marquer le pas, ses choix se portant essentiellement sur des habitués de la maison en petite (Eastwood, Scorsese) ou en très mauvaise (Burton, Romero, Leigh, Varda) forme. Allez, pour 2008 : Avantage Cahiers.
 WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN