(Miklos Jancso / Hongrie / 1965 & 1972)
■■■□ / ■■■□
Ma dernière rencontre renversante avec l'oeuvre passée d'un cinéaste jusque là inconnu remonte à 2006, lorsque j'ai découvert coup sur coup Les sans-espoir (1965) et Rouges et blancs (1967) de Miklos Jancso (le second, proprement sublime, film de guerre à cheval gorgé de plans étourdissants, s'imposant à moi comme l'un des plus grands de la décennie 60). L'année suivante, la vision de Mon chemin et de Psaume rouge confirmait mon emballement initial. Il me reste maintenant à me procurer les dvd de Silence et cri (1967) et de Cantate (1963) et j'ai bien peur que l'aventure s'arrête ici, malgré les 30 ou 40 films signés par le cinéaste (qui est toujours en activité). Car si Jancso prenait place auprès des plus grands auteurs dans les années 60/70, célébré qu'il était par la critique et les festivals, il n'a vu depuis 1979 aucun de ses films distribués en France. C'est que notre homme est hongrois et comme tous les cinéastes de l'Est n'ayant pu ou voulu travailler aux Etats-Unis ou en Europe occidentale, comme l'ont fait Polanski ou Forman, son oeuvre est de plus en plus reléguée aux oubliettes, faute de diffusion correcte (saluons donc comme il se doit le travail de Clavis films qui a édité les 6 titres disponibles). Revenons sur les deux oeuvres les plus "fraîches" dans ma mémoire :
 Mon chemin, troisième film de Jancso, pose les fondements de son esthétique. La technique commence à s'appuyer sur d'amples plans séquences, figure qui prendra au fil du temps de plus en plus d'importance dans le cinéma du hongrois. Que ceux qui ont déjà souffert devant un film de Bela Tarr ne soient pas effrayés en trouvant dans une même phrase les expressions "plan séquence" et "hongrois". Ici, la sensation du temps est complexifiée, magnifiée par des mouvements d'appareils extraordinaires, par les déplacements des groupes dans le cadre, par la simultanéité d'actions à l'avant et l'arrière-plan. Pas de solennité, ni de confusion. Le terme est parfois utilisé abusivement, mais pas pour Jancso : c'est bien une merveilleuse chorégraphie qui s'offre à nos yeux.
Mon chemin, troisième film de Jancso, pose les fondements de son esthétique. La technique commence à s'appuyer sur d'amples plans séquences, figure qui prendra au fil du temps de plus en plus d'importance dans le cinéma du hongrois. Que ceux qui ont déjà souffert devant un film de Bela Tarr ne soient pas effrayés en trouvant dans une même phrase les expressions "plan séquence" et "hongrois". Ici, la sensation du temps est complexifiée, magnifiée par des mouvements d'appareils extraordinaires, par les déplacements des groupes dans le cadre, par la simultanéité d'actions à l'avant et l'arrière-plan. Pas de solennité, ni de confusion. Le terme est parfois utilisé abusivement, mais pas pour Jancso : c'est bien une merveilleuse chorégraphie qui s'offre à nos yeux.
Le cinéaste plonge son spectateur directement dans le chaos, dès les premiers plans, sans repères, rendant ainsi parfaitement l'indécision d'un temps de guerre. Car nous sommes à la fin de la seconde guerre mondiale. L'invasion russe de la Hongrie succède petit à petit à l'occupation allemande. Après un premier tiers consacré à l'errance du personnage principal, Joseph, jeune homme plongé dans l'absurdité concentrationnaire et la confusion des troupes militaires (hongroises, russes, allemandes), le récit se stabilise autour d'un refuge agricole et développe une relation particulière, celle du héros et de son ami-geôlier russe, du même âge. Dans les oeuvres suivantes, une telle focalisation sur des personnages précis disparaîtra. Cette caractérisation inhabituelle se fait cependant avec une grande subtilité (seuls leurs rapports et leurs activités quotidiennes sont montrés, ni leur passé ni leur psychologie ne sont développés). Découpage encore relativement classique, récit laissant passer un espoir naissant lié à une compréhension mutuelle entre individus de nationalités différentes, richesse émotionnelle : Mon chemin est la porte d'entrée idéale pour découvrir Jancso.
 D'un film à l'autre, quelques éléments sont invariables : volonté de traiter une période historique marquante, tournage dans la grande plaine hongroise, goût prononcé pour les nus féminins en mouvement, opposés aux uniformes militaires des hommes. Psaume rouge (prix de la mise en scène à Cannes en 1972) est composé exclusivement de plans séquences (une vingtaine pour une durée totale de 1h20). Sinueux, ils créent sans cesse des figures circulaires, plus précisément d'encerclement, puisqu'il s'agit d'étouffer un mouvement révolutionnaire. Le procédé pourrait être rigide, mais loin de contraindre, l'art de Jancso permet l'éblouissement. Dans ces plans incroyables, la vie entre par n'importe quel côté (chevaux ou individus, que l'on perd et retrouve un instant plus tard) et le mouvement est constant (celui de la caméra est redoublé par celui des personnages, constamment en train de marcher).
D'un film à l'autre, quelques éléments sont invariables : volonté de traiter une période historique marquante, tournage dans la grande plaine hongroise, goût prononcé pour les nus féminins en mouvement, opposés aux uniformes militaires des hommes. Psaume rouge (prix de la mise en scène à Cannes en 1972) est composé exclusivement de plans séquences (une vingtaine pour une durée totale de 1h20). Sinueux, ils créent sans cesse des figures circulaires, plus précisément d'encerclement, puisqu'il s'agit d'étouffer un mouvement révolutionnaire. Le procédé pourrait être rigide, mais loin de contraindre, l'art de Jancso permet l'éblouissement. Dans ces plans incroyables, la vie entre par n'importe quel côté (chevaux ou individus, que l'on perd et retrouve un instant plus tard) et le mouvement est constant (celui de la caméra est redoublé par celui des personnages, constamment en train de marcher).
Cette révolte d'un groupe de paysans à la fin du XIXe siècle est une allégorie, filmée comme telle. Les dialogues sont rares et sont remplacés par des chants populaires entonnés par les révoltés. La bande-son mélange de très belle manière airs traditionnels, adaptation de La Marseillaise et ballade folk américaine. A part pour les costumes et les décors, les événements constitutifs de tout mouvement de ce type (revirements, traîtrises, compréhension envers l'un des "ennemis") et le discours sur le socialisme sont abordés de manière non réaliste, proche d'un opéra. Des morts ressuscitent, du sang est représenté par un oeillet rouge. Le massacre est décrit par un travelling sur des corps nus, puis des habits jonchant le sol, tâchés et troués à la baillonnette (quel plan !). Enfin, tout cela pourrait laisser penser que l'acteur a peu d'importance dans le cinéma de Jancso. Au contraire, les corps, très beaux, sont au coeur du dispositif. Et il faut noter, pour finir que dans Psaume rouge, la nudité féminine n'est, pour une fois, pas signe d'oppression mais de choix et de liberté.
 Cela faisait quelque temps que je n'étais pas tombé sur un petit film indépendant américain (j'entends ici le qualificatif au sens musical et culturel du terme, plutôt qu'économique). Le dernier se trouvait être Ghost world de Terry Zwigoff, datant de 2001 mais vu seulement quatre ans plus tard. Sous forme de vignettes ironiques, on y parlait de la culture indé, du refus du conformisme, de l'amour de la musique et de l'importance des pratiques artistiques de chacun, pour aboutir à une réflexion touchante sur ce qui nous paraît cool ou ringard. Steve Buscemi et l'ado Thora Birch formaient un savoureux duo dépareillé, sous les yeux d'une jeune fille qui gagnait déjà à être connue, Scarlett Johansson.
Cela faisait quelque temps que je n'étais pas tombé sur un petit film indépendant américain (j'entends ici le qualificatif au sens musical et culturel du terme, plutôt qu'économique). Le dernier se trouvait être Ghost world de Terry Zwigoff, datant de 2001 mais vu seulement quatre ans plus tard. Sous forme de vignettes ironiques, on y parlait de la culture indé, du refus du conformisme, de l'amour de la musique et de l'importance des pratiques artistiques de chacun, pour aboutir à une réflexion touchante sur ce qui nous paraît cool ou ringard. Steve Buscemi et l'ado Thora Birch formaient un savoureux duo dépareillé, sous les yeux d'une jeune fille qui gagnait déjà à être connue, Scarlett Johansson. Les trois âges (Three ages) est le premier long-métrage que Buster Keaton a pu réaliser, après avoir fait ses armes dans de nombreux courts. Il décida de proposer une parodie d'Intolérance de Griffith. Si le choix paraît culotté, les risques sont tout de même très calculés. D'une part, l'original est suffisamment connu pour que le détournement marche pleinement chez les spectateurs de l'époque. D'autre part, en traitant un même sujet à trois époques différentes de l'humanité (la préhistoire, l'antiquité romaine et l'Amérique contemporaine), Keaton garde finalement le rythme des courts et moyens métrages burlesques précédents, repoussant à plus tard la construction d'une intrigue plus étoffée. Ce premier effort long est tout à fait plaisant mais on n'y trouve que par intermittences le génie comique de l'auteur, qui sera en place de manière plus évidente l'année suivante avec Sherlock Jr (début d'une période dorée qui ne dura, rappelons-le, que 6 années).
Les trois âges (Three ages) est le premier long-métrage que Buster Keaton a pu réaliser, après avoir fait ses armes dans de nombreux courts. Il décida de proposer une parodie d'Intolérance de Griffith. Si le choix paraît culotté, les risques sont tout de même très calculés. D'une part, l'original est suffisamment connu pour que le détournement marche pleinement chez les spectateurs de l'époque. D'autre part, en traitant un même sujet à trois époques différentes de l'humanité (la préhistoire, l'antiquité romaine et l'Amérique contemporaine), Keaton garde finalement le rythme des courts et moyens métrages burlesques précédents, repoussant à plus tard la construction d'une intrigue plus étoffée. Ce premier effort long est tout à fait plaisant mais on n'y trouve que par intermittences le génie comique de l'auteur, qui sera en place de manière plus évidente l'année suivante avec Sherlock Jr (début d'une période dorée qui ne dura, rappelons-le, que 6 années).

 Un crime dans la tête (The Manchurian candidate) est un thriller politique, un étonnant film d'espionnage réalisé avec un regard assez acide. En Corée, des soldats américains sont faits prisonniers. Ils sont manipulés psychologiquement, puis renvoyés chez eux sans souvenirs de l'expérience imposée mais prêts à être à tout moment "dirigés" à leur insu. Le but de l'opération est l'assassinat d'un candidat à la Maison Blanche et son remplacement par un politicien fantoche. Ce film de Frankenheimer est ouvertement anti-communiste. Il ne se résume pas cependant à cette position, car il est tout aussi clairement anti-fasciste. Ce sont bien les deux extrêmes qui sont renvoyés dos à dos. Les allusions au McCarthysme et à ses dérives insupportables sont évidentes. Finalement, c'est au sein même de la bonne société américaine que sont nichés les plus grands ennemis de la démocratie, plus que chez les Rouges à l'étranger.
Un crime dans la tête (The Manchurian candidate) est un thriller politique, un étonnant film d'espionnage réalisé avec un regard assez acide. En Corée, des soldats américains sont faits prisonniers. Ils sont manipulés psychologiquement, puis renvoyés chez eux sans souvenirs de l'expérience imposée mais prêts à être à tout moment "dirigés" à leur insu. Le but de l'opération est l'assassinat d'un candidat à la Maison Blanche et son remplacement par un politicien fantoche. Ce film de Frankenheimer est ouvertement anti-communiste. Il ne se résume pas cependant à cette position, car il est tout aussi clairement anti-fasciste. Ce sont bien les deux extrêmes qui sont renvoyés dos à dos. Les allusions au McCarthysme et à ses dérives insupportables sont évidentes. Finalement, c'est au sein même de la bonne société américaine que sont nichés les plus grands ennemis de la démocratie, plus que chez les Rouges à l'étranger. 7 ans et 6 films plus tard (dont 7 jours en mai et Grand prix), Les parachutistes arrivent (The gypsy moths) s'éloigne considérablement du registre virulent d'Un crime dans la tête, car Frankenheimer entamait là un virage esthétique certain. Les parachutistes en question ne sont pas des militaires mais trois sportifs casse-cous proposant un spectacle itinérant de voltige. Le trio pose ses valises dans un petite ville du Kansas et plus précisément dans la maison de la tante du plus jeune, Malcolm, qui revient ainsi, plus de dix ans après, au pays. Ainsi se fait la chronique de quelques journées pas si tranquilles, tout étant réuni pour que l'arrivée de ces trois saltimbanques mélancoliques perturbent la petite vie de famille bourgeoise bien rangée.
7 ans et 6 films plus tard (dont 7 jours en mai et Grand prix), Les parachutistes arrivent (The gypsy moths) s'éloigne considérablement du registre virulent d'Un crime dans la tête, car Frankenheimer entamait là un virage esthétique certain. Les parachutistes en question ne sont pas des militaires mais trois sportifs casse-cous proposant un spectacle itinérant de voltige. Le trio pose ses valises dans un petite ville du Kansas et plus précisément dans la maison de la tante du plus jeune, Malcolm, qui revient ainsi, plus de dix ans après, au pays. Ainsi se fait la chronique de quelques journées pas si tranquilles, tout étant réuni pour que l'arrivée de ces trois saltimbanques mélancoliques perturbent la petite vie de famille bourgeoise bien rangée.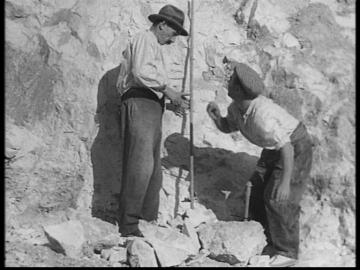

 Assez réputé dans les années 70, Gros plan (Inserts) a, depuis, bien sombré dans l'oubli, certainement à cause des difficultés qu'a rencontré son auteur pour enchaîner d'autres films intéressants à la suite de ce premier effort. Son statut et son sujet faisaient espérer beaucoup. Le résultat n'est pas désagréable mais un tantinet décevant.
Assez réputé dans les années 70, Gros plan (Inserts) a, depuis, bien sombré dans l'oubli, certainement à cause des difficultés qu'a rencontré son auteur pour enchaîner d'autres films intéressants à la suite de ce premier effort. Son statut et son sujet faisaient espérer beaucoup. Le résultat n'est pas désagréable mais un tantinet décevant.

 Est-ce que l'éloignement (pour ne pas dire l'exotisme) rend plus indulgent ? Sûrement qu'une scène de rue tournée à Alger se charge pour nous d'une autre dimension par rapport à la même qui nous montrerait n'importe quelle ville française. Je précise tout de suite : Viva Laldjérie est bien plus qu'un film informant sur une société. C'est une oeuvre ambitieuse et maîtrisée, un petit bijou.
Est-ce que l'éloignement (pour ne pas dire l'exotisme) rend plus indulgent ? Sûrement qu'une scène de rue tournée à Alger se charge pour nous d'une autre dimension par rapport à la même qui nous montrerait n'importe quelle ville française. Je précise tout de suite : Viva Laldjérie est bien plus qu'un film informant sur une société. C'est une oeuvre ambitieuse et maîtrisée, un petit bijou. Le temps des gitans, découvert à sa sortie alors que j'avais 17 ans, est l'un des trois films les plus importants pour moi dans cette époque de la fin des années 90, où se forgeait ma cinéphilie (les deux autres, puisque vous mourez d'envie de le savoir, sont Mauvais sang et Les ailes du désir). Je garde donc pour Kusturica une certaine affection, jusque dans ses ouvrages mineurs (de plus en plus ?). La lévitation du héros du Temps des gitans et l'envol de la mariée d'Underground sont en bonne place dans mon musée imaginaire.
Le temps des gitans, découvert à sa sortie alors que j'avais 17 ans, est l'un des trois films les plus importants pour moi dans cette époque de la fin des années 90, où se forgeait ma cinéphilie (les deux autres, puisque vous mourez d'envie de le savoir, sont Mauvais sang et Les ailes du désir). Je garde donc pour Kusturica une certaine affection, jusque dans ses ouvrages mineurs (de plus en plus ?). La lévitation du héros du Temps des gitans et l'envol de la mariée d'Underground sont en bonne place dans mon musée imaginaire.