Mars ? Déjà de l'histoire ancienne... Hâtons-nous donc de reprendre le cours de notre exercice mémoriel et rappelons-nous des sorties en salles françaises du mois d'Avril 1985 :
 Bien que ces aveux soient aujourd'hui un brin douloureux, commençons par ce qui nous attirait réellement en ce temps-là. Pensant tomber sur un Outsiders à la Française, nous nous étions précipités à la projection de Hors-la-loi, de Robin Davis. Une dizaine de jeunes rebelles sans cause, parmi lesquels Clovis Cornillac, Wadeck Stanczak et Isabelle Pasco, s'y trouvaient pourchassés par la police et quelques paysans de Lozère. Sans encore y connaître grand chose, il nous était tout de même apparu que l'ensemble n'était pas vraiment du niveau de Coppola. En revanche, à l'âge de 13 ans, coincé au stade cinéphile débutant et uniquement informé par Première, il était difficile de ne pas succomber à l'épate de Luc Besson et de son Subway, de ne pas trouver ça génial, de ne pas y revenir plusieurs fois et de ne pas en retenir toutes les répliques. Ayant par la suite opéré une volte-face par rapport au cinéma du nounours barbu, étant passé à un rejet total, à la violence proportionnelle à l'amour porté auparavant (devrai-je porter plainte pour avoir été ainsi abusé en ces années d'innocence ?), il m'est impossible aujourd'hui de juger cet objet sereinement.
Bien que ces aveux soient aujourd'hui un brin douloureux, commençons par ce qui nous attirait réellement en ce temps-là. Pensant tomber sur un Outsiders à la Française, nous nous étions précipités à la projection de Hors-la-loi, de Robin Davis. Une dizaine de jeunes rebelles sans cause, parmi lesquels Clovis Cornillac, Wadeck Stanczak et Isabelle Pasco, s'y trouvaient pourchassés par la police et quelques paysans de Lozère. Sans encore y connaître grand chose, il nous était tout de même apparu que l'ensemble n'était pas vraiment du niveau de Coppola. En revanche, à l'âge de 13 ans, coincé au stade cinéphile débutant et uniquement informé par Première, il était difficile de ne pas succomber à l'épate de Luc Besson et de son Subway, de ne pas trouver ça génial, de ne pas y revenir plusieurs fois et de ne pas en retenir toutes les répliques. Ayant par la suite opéré une volte-face par rapport au cinéma du nounours barbu, étant passé à un rejet total, à la violence proportionnelle à l'amour porté auparavant (devrai-je porter plainte pour avoir été ainsi abusé en ces années d'innocence ?), il m'est impossible aujourd'hui de juger cet objet sereinement.
Tout aussi barbu, James Cameron proposait un film bientôt tout aussi culte. Terminator fit bien sûr son effet sur nous aussi, essentiellement en raison de sa violence (le poing de Schwarzie qui traverse le corps du pauvre biker : succès assuré dans la cour du collège). Pas revue depuis, pas même au moment de la sortie d'un deuxième volet que nous ne goûtâmes guère, cette série B carrée propulsa le cinéaste dans une autre dimension, sur le plan économique en tout cas. Quatrième titre coché à l'époque : Le jeu du faucon de John Schlesinger avec les vedettes pour ados qu'étaient Timothy Hutton et Sean Penn en apprentis-espions. Je n'en ai plus aucun souvenir.
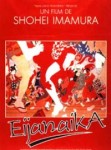 Plus marquants sont trois autres films de ce mois, découverts plus tardivement. Les 613 minutes de Shoah représentent une expérience physique unique, vertigineuse et étouffante. Le documentaire de Claude Lanzmann sur l'extermination des Juifs d'Europe dans les camps nazis est d'une grande importance historique et provoque quantité de réflexions sur l'esthétique et la morale. Un fois que ceci a été rappelé, on peut regretter que cette œuvre monumentale ait été à l'origine de l'établissement d'un dogme et de la formulation d'un interdit, celui de la représentation, interdit constamment réaffirmé depuis par l'auteur et ses admirateurs inconditionnels.
Plus marquants sont trois autres films de ce mois, découverts plus tardivement. Les 613 minutes de Shoah représentent une expérience physique unique, vertigineuse et étouffante. Le documentaire de Claude Lanzmann sur l'extermination des Juifs d'Europe dans les camps nazis est d'une grande importance historique et provoque quantité de réflexions sur l'esthétique et la morale. Un fois que ceci a été rappelé, on peut regretter que cette œuvre monumentale ait été à l'origine de l'établissement d'un dogme et de la formulation d'un interdit, celui de la représentation, interdit constamment réaffirmé depuis par l'auteur et ses admirateurs inconditionnels.
Dans un registre bien plus léger, avec Poulet au vinaigre, Claude Chabrol et son acteur Jean Poiret donnaient vie sur l'écran à l'Inspecteur Lavardin, dont un second volet cinématographique et une mini-série télévisée allaient ensuite continuer de nous conter les aventures. Réjouissant et caustique, l'opus, s'il n'est pas le plus admirable de la longue carrière du cinéaste, est savoureux. Plus enthousiasmant encore, selon moi, est l'incroyable film du grand Shohei Imamura, Eijanaïka. En plein XIXe, se déroule un récit ébouriffant, complexe et vivifiant, un conte historique ballottant les maîtres et la populace pour déboucher sur une réflexion politique limpide.
Il me semble être tombé une fois à la télévision sur Faster Pussycat, Kill ! Kill ! de Russ Meyer, tourné en 1966 mais seulement exploité dans les salles françaises en ce mois d'avril 85. Je me souviens d'un beau noir et blanc, de cadrages étonnants et de poitrines généreuses. Rien de plus. De même, il n'est pas impossible que se soient trouvés sous mes yeux, un soir de désœuvrement télévisuel, Blanche et Marie de Jacques Renard (Miou-Miou et Sandrine Bonnaire en résistantes), 2010 de Peter Hyams (suite du 2001, de Kubrick, toujours d'après Arthur C. Clarke et pari forcément insensé), La nuit porte-jaretelles de Virginie Thévenet (film-mode autour de Pigalle), Le kid de la plage de Garry Marshall (comédie anodine au service de la star Matt Dillon) ou Liberté, égalité, choucroute de Jean Yanne (dont il est difficile de trouver un défenseur).
 Une fois ces titres énoncés, il en reste, parmi ceux qui me sont inconnus, de très tentants : en premier lieu, Micki et Maude de Blake Edwards (Dudley Moore, coincé entre Amy Irving et Ann Reinking, y devient bigame), puis La balade inoubliable du discret mais sensible Pupi Avati, Brother de John Sayles (l'histoire d'un esclave noir échappé d'une autre planète et aterrissant à New York, poursuivi par deux chasseurs de primes), La maison et le monde, l'un des derniers longs-métrages de Satyajit Ray (encore une fois adapté de Rabindranath Tagore et traitant de la confrontation entre valeurs indiennes et occidentales), Marlene, un documentaire de Maximilian Schell sur Dietrich (présente sur la bande son mais ayant refusé de se laisser filmer), La route des Indes du revenant David Lean (nouvelle fresque historique d'après E.M. Forster) et enfin Le pactole, énième fable immorale de Jean-Pierre Mocky.
Une fois ces titres énoncés, il en reste, parmi ceux qui me sont inconnus, de très tentants : en premier lieu, Micki et Maude de Blake Edwards (Dudley Moore, coincé entre Amy Irving et Ann Reinking, y devient bigame), puis La balade inoubliable du discret mais sensible Pupi Avati, Brother de John Sayles (l'histoire d'un esclave noir échappé d'une autre planète et aterrissant à New York, poursuivi par deux chasseurs de primes), La maison et le monde, l'un des derniers longs-métrages de Satyajit Ray (encore une fois adapté de Rabindranath Tagore et traitant de la confrontation entre valeurs indiennes et occidentales), Marlene, un documentaire de Maximilian Schell sur Dietrich (présente sur la bande son mais ayant refusé de se laisser filmer), La route des Indes du revenant David Lean (nouvelle fresque historique d'après E.M. Forster) et enfin Le pactole, énième fable immorale de Jean-Pierre Mocky.
Plus risquées me semblent les découvertes d'Adieu blaireau, polar sophistiqué de Bob Decourt avec Philippe Léotard, d'Au-delà des murs de l'Israélien Uri Barbash (un film de prison appelant à la réconciliation entre Juifs et Palestiniens), des Bostoniennes, drame de faible réputation de James Ivory (avec Christopher Reeve et Vanessa Redgrave), du Combat des maîtres (un "Shaw Brothers" de Liu Chia Liang), de Country - Les moissons du cœur de Richard Pearce (un nouveau regard sur la campagne américaine, avec Jessica Lange et Sam Shepard), du Déclic de Jean-Louis Richard, d'après la BD érotique de Milo Manara, d'Electric dreams du clippeur Steve Barron (l'ordinateur d'une jeune femme devient humain), de Mata-Hari de Curtis Harrington (avec Sylvia Kristel), de Mojado power de et avec le Mexicain Alfonso Arau (l'immigration clandestine vers les USA vue de manière humoristique), de Monsieur de Pourceaugnac de Michel Mitrani, d'après Molière avec Michel Galabru, d'Un printemps sous la neige (film franco-canadien de Daniel Petrie avec Liv Ullmann et le jeune Kiefer Sutherland, un mélo social sur les années 30), des Plaisirs interdits de Salvatore Samperi (la passion incestueuse entre un frère et une sœur), d'Onde de choc de Nico Mastorakis (film de serial killer avec un héros aveugle) et de Vidas (film-choc sur la société portugaise par Antonio da Cunha Telles). Mais, on le voit, même dans ce lot, une bonne surprise n'est pas à exclure, ce qui donne finalement à ce mois-là une couleur très intéressante.
Il nous reste toutefois à lister les produits venant de Hong-Kong (Les jeunes bonzes du temple de Shaolin de Tang Cheng Da, Le tigre de Shaolin d'Au Yeung Chuen, Le karatéka au poing d'or de Pasan) et à mentionner l'étonnante prééminence de la thématique du vice dans les pornos du mois (Apprenties vicieuses de Youri Berko, Ballets roses pour couples vicieux de Johana Morgan et Le vice de Madame, non signé).
 Pour les revues et magazines de cinéma, c'est surtout 2010 qui crée l'évènement en avril de cette année. Le film de Peter Hyams se retrouve en effet en couverture de Cinéma 85 (316), de Starfix (25) et de L'Ecran Fantastique (55). Les Cahiers du Cinéma (370) choisissent de poursuivre le dialogue avec Chabrol (Poulet au vinaigre est à la une) et Positif (290) avec Blake Edwards (Micki et Maude). La Revue du Cinéma (404) élit La petite fille au tambour de George Roy Hill et Jeune Cinéma (166), Louise l'insoumise de Charlotte Silvera, tous deux sortis en mars. Cinématographe (109) illustre son numéro sur les "Chocs de cultures" par une photo du Fleuve de Jean Renoir. Enfin, Premiere (97) rencontre Yves Montand, bientôt à l'affiche dans le Jean de Florette de Claude Berri.
Pour les revues et magazines de cinéma, c'est surtout 2010 qui crée l'évènement en avril de cette année. Le film de Peter Hyams se retrouve en effet en couverture de Cinéma 85 (316), de Starfix (25) et de L'Ecran Fantastique (55). Les Cahiers du Cinéma (370) choisissent de poursuivre le dialogue avec Chabrol (Poulet au vinaigre est à la une) et Positif (290) avec Blake Edwards (Micki et Maude). La Revue du Cinéma (404) élit La petite fille au tambour de George Roy Hill et Jeune Cinéma (166), Louise l'insoumise de Charlotte Silvera, tous deux sortis en mars. Cinématographe (109) illustre son numéro sur les "Chocs de cultures" par une photo du Fleuve de Jean Renoir. Enfin, Premiere (97) rencontre Yves Montand, bientôt à l'affiche dans le Jean de Florette de Claude Berri.
Voilà pour avril 1985. La suite le mois prochain...
Pour en savoir plus : Electric dreams, Poulet au vinaigre, Terminator et 2010 vus par Mariaque.
 Bien que ces aveux soient aujourd'hui un brin douloureux, commençons par ce qui nous attirait réellement en ce temps-là. Pensant tomber sur un Outsiders à la Française, nous nous étions précipités à la projection de Hors-la-loi, de Robin Davis. Une dizaine de jeunes rebelles sans cause, parmi lesquels Clovis Cornillac, Wadeck Stanczak et Isabelle Pasco, s'y trouvaient pourchassés par la police et quelques paysans de Lozère. Sans encore y connaître grand chose, il nous était tout de même apparu que l'ensemble n'était pas vraiment du niveau de Coppola. En revanche, à l'âge de 13 ans, coincé au stade cinéphile débutant et uniquement informé par Première, il était difficile de ne pas succomber à l'épate de Luc Besson et de son Subway, de ne pas trouver ça génial, de ne pas y revenir plusieurs fois et de ne pas en retenir toutes les répliques. Ayant par la suite opéré une volte-face par rapport au cinéma du nounours barbu, étant passé à un rejet total, à la violence proportionnelle à l'amour porté auparavant (devrai-je porter plainte pour avoir été ainsi abusé en ces années d'innocence ?), il m'est impossible aujourd'hui de juger cet objet sereinement.
Bien que ces aveux soient aujourd'hui un brin douloureux, commençons par ce qui nous attirait réellement en ce temps-là. Pensant tomber sur un Outsiders à la Française, nous nous étions précipités à la projection de Hors-la-loi, de Robin Davis. Une dizaine de jeunes rebelles sans cause, parmi lesquels Clovis Cornillac, Wadeck Stanczak et Isabelle Pasco, s'y trouvaient pourchassés par la police et quelques paysans de Lozère. Sans encore y connaître grand chose, il nous était tout de même apparu que l'ensemble n'était pas vraiment du niveau de Coppola. En revanche, à l'âge de 13 ans, coincé au stade cinéphile débutant et uniquement informé par Première, il était difficile de ne pas succomber à l'épate de Luc Besson et de son Subway, de ne pas trouver ça génial, de ne pas y revenir plusieurs fois et de ne pas en retenir toutes les répliques. Ayant par la suite opéré une volte-face par rapport au cinéma du nounours barbu, étant passé à un rejet total, à la violence proportionnelle à l'amour porté auparavant (devrai-je porter plainte pour avoir été ainsi abusé en ces années d'innocence ?), il m'est impossible aujourd'hui de juger cet objet sereinement.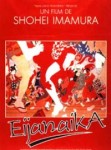 Plus marquants sont trois autres films de ce mois, découverts plus tardivement. Les 613 minutes de Shoah représentent une expérience physique unique, vertigineuse et étouffante. Le documentaire de Claude Lanzmann sur l'extermination des Juifs d'Europe dans les camps nazis est d'une grande importance historique et provoque quantité de réflexions sur l'esthétique et la morale. Un fois que ceci a été rappelé, on peut regretter que cette œuvre monumentale ait été à l'origine de l'établissement d'un dogme et de la formulation d'un interdit, celui de la représentation, interdit constamment réaffirmé depuis par l'auteur et ses admirateurs inconditionnels.
Plus marquants sont trois autres films de ce mois, découverts plus tardivement. Les 613 minutes de Shoah représentent une expérience physique unique, vertigineuse et étouffante. Le documentaire de Claude Lanzmann sur l'extermination des Juifs d'Europe dans les camps nazis est d'une grande importance historique et provoque quantité de réflexions sur l'esthétique et la morale. Un fois que ceci a été rappelé, on peut regretter que cette œuvre monumentale ait été à l'origine de l'établissement d'un dogme et de la formulation d'un interdit, celui de la représentation, interdit constamment réaffirmé depuis par l'auteur et ses admirateurs inconditionnels. Une fois ces titres énoncés, il en reste, parmi ceux qui me sont inconnus, de très tentants : en premier lieu, Micki et Maude de Blake Edwards (Dudley Moore, coincé entre Amy Irving et Ann Reinking, y devient bigame), puis La balade inoubliable du discret mais sensible Pupi Avati, Brother de John Sayles (l'histoire d'un esclave noir échappé d'une autre planète et aterrissant à New York, poursuivi par deux chasseurs de primes), La maison et le monde, l'un des derniers longs-métrages de Satyajit Ray (encore une fois adapté de Rabindranath Tagore et traitant de la confrontation entre valeurs indiennes et occidentales), Marlene, un documentaire de Maximilian Schell sur Dietrich (présente sur la bande son mais ayant refusé de se laisser filmer), La route des Indes du revenant David Lean (nouvelle fresque historique d'après E.M. Forster) et enfin Le pactole, énième fable immorale de Jean-Pierre Mocky.
Une fois ces titres énoncés, il en reste, parmi ceux qui me sont inconnus, de très tentants : en premier lieu, Micki et Maude de Blake Edwards (Dudley Moore, coincé entre Amy Irving et Ann Reinking, y devient bigame), puis La balade inoubliable du discret mais sensible Pupi Avati, Brother de John Sayles (l'histoire d'un esclave noir échappé d'une autre planète et aterrissant à New York, poursuivi par deux chasseurs de primes), La maison et le monde, l'un des derniers longs-métrages de Satyajit Ray (encore une fois adapté de Rabindranath Tagore et traitant de la confrontation entre valeurs indiennes et occidentales), Marlene, un documentaire de Maximilian Schell sur Dietrich (présente sur la bande son mais ayant refusé de se laisser filmer), La route des Indes du revenant David Lean (nouvelle fresque historique d'après E.M. Forster) et enfin Le pactole, énième fable immorale de Jean-Pierre Mocky. Pour les revues et magazines de cinéma, c'est surtout 2010 qui crée l'évènement en avril de cette année. Le film de Peter Hyams se retrouve en effet en couverture de Cinéma 85 (316), de Starfix (25) et de L'Ecran Fantastique (55). Les Cahiers du Cinéma (370) choisissent de poursuivre le dialogue avec Chabrol (Poulet au vinaigre est à la une) et Positif (290) avec Blake Edwards (Micki et Maude). La Revue du Cinéma (404) élit La petite fille au tambour de George Roy Hill et Jeune Cinéma (166), Louise l'insoumise de Charlotte Silvera, tous deux sortis en mars. Cinématographe (109) illustre son numéro sur les "Chocs de cultures" par une photo du Fleuve de Jean Renoir. Enfin, Premiere (97) rencontre Yves Montand, bientôt à l'affiche dans le Jean de Florette de Claude Berri.
Pour les revues et magazines de cinéma, c'est surtout 2010 qui crée l'évènement en avril de cette année. Le film de Peter Hyams se retrouve en effet en couverture de Cinéma 85 (316), de Starfix (25) et de L'Ecran Fantastique (55). Les Cahiers du Cinéma (370) choisissent de poursuivre le dialogue avec Chabrol (Poulet au vinaigre est à la une) et Positif (290) avec Blake Edwards (Micki et Maude). La Revue du Cinéma (404) élit La petite fille au tambour de George Roy Hill et Jeune Cinéma (166), Louise l'insoumise de Charlotte Silvera, tous deux sortis en mars. Cinématographe (109) illustre son numéro sur les "Chocs de cultures" par une photo du Fleuve de Jean Renoir. Enfin, Premiere (97) rencontre Yves Montand, bientôt à l'affiche dans le Jean de Florette de Claude Berri. Tout est disjoint, rien ne raccorde. Cinéma de poésie m'objectera-t-on. Mais encore faudrait-il parvenir à créer un choc ou un flux. Or il ne subsiste ici qu'un déséquilibre entre chaque chose et finalement, une faille, un vide, un ennui. En premier lieu, le montage ne fait qu'heurter les plans les uns aux autres dans le sens où, même lorsqu'est posé un simple champ-contrechamp, même lorsqu'est organisé un échange de regards, jamais les personnages ne semblent se situer dans le même espace, dans le même temps. Le film débute dans une cour, au milieu du peuple, et dès la première séquence, le découpage échoue à établir une continuité spatiale et à décrire visuellement les liens qui unissent les personnages.
Tout est disjoint, rien ne raccorde. Cinéma de poésie m'objectera-t-on. Mais encore faudrait-il parvenir à créer un choc ou un flux. Or il ne subsiste ici qu'un déséquilibre entre chaque chose et finalement, une faille, un vide, un ennui. En premier lieu, le montage ne fait qu'heurter les plans les uns aux autres dans le sens où, même lorsqu'est posé un simple champ-contrechamp, même lorsqu'est organisé un échange de regards, jamais les personnages ne semblent se situer dans le même espace, dans le même temps. Le film débute dans une cour, au milieu du peuple, et dès la première séquence, le découpage échoue à établir une continuité spatiale et à décrire visuellement les liens qui unissent les personnages. Avec Le samouraï du crépuscule (Tasogare Seibei), il ne faut pas s'attendre à un film de genre plein de bruits de lames qui s'entrechoquent, de giclées de sang ou de sauts périlleux arrière. Yoji Yamada, vénérable artisan du cinéma japonais qui s'est lancé dans une trilogie historique consacrée aux samouraïs après avoir œuvré essentiellement dans la comédie sociale, tourne ostensiblement le dos à toute notion d'épopée et à tout effet spectaculaire. Situé dans la deuxième moitié du XIXe, au moment où cette caste particulière se voit sur le déclin, le récit s'attache à décrire un épisode de la vie de l'un de ses membres, l'atypique Seibei Iguchi, homme simple et pauvre, s'occupant seul de ses deux petites filles et sentant son âme devenir plus paysanne que guerrière. C'est donc avant tout à l'étude minutieuse d'un quotidien peu éclairé d'ordinaire que nous convie Yamada.
Avec Le samouraï du crépuscule (Tasogare Seibei), il ne faut pas s'attendre à un film de genre plein de bruits de lames qui s'entrechoquent, de giclées de sang ou de sauts périlleux arrière. Yoji Yamada, vénérable artisan du cinéma japonais qui s'est lancé dans une trilogie historique consacrée aux samouraïs après avoir œuvré essentiellement dans la comédie sociale, tourne ostensiblement le dos à toute notion d'épopée et à tout effet spectaculaire. Situé dans la deuxième moitié du XIXe, au moment où cette caste particulière se voit sur le déclin, le récit s'attache à décrire un épisode de la vie de l'un de ses membres, l'atypique Seibei Iguchi, homme simple et pauvre, s'occupant seul de ses deux petites filles et sentant son âme devenir plus paysanne que guerrière. C'est donc avant tout à l'étude minutieuse d'un quotidien peu éclairé d'ordinaire que nous convie Yamada.