Le pli étant pris, autant poursuivre en cette nouvelle année l'entreprise entamée en septembre dernier qui consiste à voir si, vraiment, c'était mieux avant. Continuons donc à avancer mois par mois en gardant ce décalage symbolique, bien que totalement arbitraire, de 25 ans. Passée une année 1983 relativement faste (surtout en comparaison du millésime 2008), braquons donc les projecteurs sur les films distribués en France au mois de Janvier 1984.
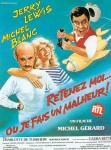 J'ai alors douze ans, je commence à aller assez régulièrement au cinéma de Nontron, situé à une quinzaine de kilomètres du domicile familial périgourdin, j'aime beaucoup Terence Hill et Bud Spencer. Je connais les films de Michel Blanc mais pas ceux de Jerry Lewis. Les deux sont bizarrement réunis à l'affiche de Retenez-moi ou je fais un malheur, de Michel Gérard. Pourtant bon public en ce temps-là, je ne trouve pas ça terrible, déjà. Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur le fait que c'est une daube sans nom.
J'ai alors douze ans, je commence à aller assez régulièrement au cinéma de Nontron, situé à une quinzaine de kilomètres du domicile familial périgourdin, j'aime beaucoup Terence Hill et Bud Spencer. Je connais les films de Michel Blanc mais pas ceux de Jerry Lewis. Les deux sont bizarrement réunis à l'affiche de Retenez-moi ou je fais un malheur, de Michel Gérard. Pourtant bon public en ce temps-là, je ne trouve pas ça terrible, déjà. Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur le fait que c'est une daube sans nom.
J'ai de vagues souvenirs de deux autres films sortis ce mois-là. Dans La nuit des juges (Peter Yams), Michael Douglas intégrait une organisation secrète qui se chargeait de liquider les criminels ayant échappé à la justice. Je ne saurai dire si ce sujet pour le moins suspect donnait lieu à un film honnête ou pas... De ce côté-ci de l'Atlantique, Gilles Béhat (réalisateur, pour mémoire, de l'impayable Dancing machine en 1990) filmait les coups de tatanes et de poing américain que donnait Bernard Giraudeau à Bernard-Pierre Donnadieu (et réciproquement), dans le fameux Rue Barbare.
 Mes connaissances se limitent à ces trois titres (sans compter celui que j'évoquerai plus bas). Pour le reste, on remarquera que l'époque était aux récits bien musclés : Jean-Claude Missiaen proposait avec Ronde de nuit un polar à la Française relativement bien accueilli par la presse (avec Gérard Lanvin et Eddy Mitchell) et Yves Boisset s'offrait Lee Marvin pour Canicule, une oeuvre qui, depuis la cour du collège, sentait autant la poudre que le souffre (comme toutes celles où l'on trouvait Miou-Miou d'ailleurs). Je ne sais toujours pas, à ce jour, ce qu'il en est réellement. Sûrement dans le même registre, nous trouvons une Cité du crime italienne (par un certain Stelvio Massi). Et les femmes s'y mettent aussi : Les anges du mal, de Paul Nicholas, se déroule dans une prison qui leur est réservée.
Mes connaissances se limitent à ces trois titres (sans compter celui que j'évoquerai plus bas). Pour le reste, on remarquera que l'époque était aux récits bien musclés : Jean-Claude Missiaen proposait avec Ronde de nuit un polar à la Française relativement bien accueilli par la presse (avec Gérard Lanvin et Eddy Mitchell) et Yves Boisset s'offrait Lee Marvin pour Canicule, une oeuvre qui, depuis la cour du collège, sentait autant la poudre que le souffre (comme toutes celles où l'on trouvait Miou-Miou d'ailleurs). Je ne sais toujours pas, à ce jour, ce qu'il en est réellement. Sûrement dans le même registre, nous trouvons une Cité du crime italienne (par un certain Stelvio Massi). Et les femmes s'y mettent aussi : Les anges du mal, de Paul Nicholas, se déroule dans une prison qui leur est réservée.
 Au rayon comédie, le menu ne faisait guère envie : en plus du Michel Gérard déjà cité, nous étaient proposés P'tit con (Gérard Lauzier) et Le joli coeur (Francis Perrin). Mieux valait donc tenter sa chance dans un autre genre, du côté du Choix des seigneurs (Giacomo Battiato), de Trahisons conjugales (de David Hughes Jones, d'après Pinter, avec Jeremy Irons et Ben Kingsley), du Train s'est arrêté (Abdrachinov Vadim), de L'éducation de Rita (Lewis Gilbert, avec Michael Caine), voire, pour les plus téméraires, de 2019 après la chute de New York (Sergio Martino).
Au rayon comédie, le menu ne faisait guère envie : en plus du Michel Gérard déjà cité, nous étaient proposés P'tit con (Gérard Lauzier) et Le joli coeur (Francis Perrin). Mieux valait donc tenter sa chance dans un autre genre, du côté du Choix des seigneurs (Giacomo Battiato), de Trahisons conjugales (de David Hughes Jones, d'après Pinter, avec Jeremy Irons et Ben Kingsley), du Train s'est arrêté (Abdrachinov Vadim), de L'éducation de Rita (Lewis Gilbert, avec Michael Caine), voire, pour les plus téméraires, de 2019 après la chute de New York (Sergio Martino).
Sortaient également ce mois-là Le bon plaisir de Francis Girod (porté par le trio Deneuve-Serrault-Trintignant) et trois films fantastiques signés de spécialistes, méritant certainement le détour : La foire des ténèbres de Jack Clayton, Le jour d'après de Nicholas Meyer et Christine, l'un des classiques de John Carpenter, que je n'ai donc toujours pas vu.
 Il manque à l'appel deux noms et non des moindres, deux super-auteurs affolant la critique et les cinéphiles, tant sur l'écran que derrière un micro : Godard et Fellini. Le premier faisait mine de suivre la mode de l'époque, offrant à la renversante Maruschka Detmers son Prénom Carmen (au moins trois autres adaptations de Carmen furent proposées, en l'espace de quelques mois, au public : celle de Carlos Saura, celle de Peter Brook et celle de Francesco Rosi; quelqu'un se rappelle-t-il, d'ailleurs, la raison de cet engouement soudain ?). Le second prenait la mer. Et vogue le navire : celui-là, je le connais et c'est peu de dire qu'il m'a marqué. Découvert bien après sa sortie, il reste pour moi le dernier grand Fellini, avant trois ultimes films mi-figue mi-raisin. Comme souvent chez l'Italien, ce sont des images de rêves qui restent en tête longtemps après : un rhinocéros sur un bateau, une salle des machines infernale, des intermèdes musicaux aussi improbables que magiques.
Il manque à l'appel deux noms et non des moindres, deux super-auteurs affolant la critique et les cinéphiles, tant sur l'écran que derrière un micro : Godard et Fellini. Le premier faisait mine de suivre la mode de l'époque, offrant à la renversante Maruschka Detmers son Prénom Carmen (au moins trois autres adaptations de Carmen furent proposées, en l'espace de quelques mois, au public : celle de Carlos Saura, celle de Peter Brook et celle de Francesco Rosi; quelqu'un se rappelle-t-il, d'ailleurs, la raison de cet engouement soudain ?). Le second prenait la mer. Et vogue le navire : celui-là, je le connais et c'est peu de dire qu'il m'a marqué. Découvert bien après sa sortie, il reste pour moi le dernier grand Fellini, avant trois ultimes films mi-figue mi-raisin. Comme souvent chez l'Italien, ce sont des images de rêves qui restent en tête longtemps après : un rhinocéros sur un bateau, une salle des machines infernale, des intermèdes musicaux aussi improbables que magiques.
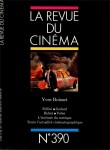 En s'intéressant aux revues de l'époque, on ne s'étonnera pas de tomber sur la tête de Jean-Luc Godard. Le cinéaste est à la une de Cinéma 84 (301), qui propose parallèlement un dossier sur la critique, et, bien évidemment, en couverture des Cahiers du Cinéma (355), où Prénom Carmen laisse cependant une place à A nos amours, astucieuse manière de signifier le changement d'année 1983/1984. Cinématographe (96) sort un numéro consacré à Fellini et La revue du cinéma (390) choisit quant à elle de mettre en vedette Boisset et son Canicule. Wargames, sorti en décembre, est en couverture de Starfix (11) et Bernard Giraudeau sur celle de Première (82). De son côté, Positif (275) fête comme il se doit la sortie française, vingt-neuf ans après sa réalisation, du magnifique Nuages flottants de Mikio Naruse.
En s'intéressant aux revues de l'époque, on ne s'étonnera pas de tomber sur la tête de Jean-Luc Godard. Le cinéaste est à la une de Cinéma 84 (301), qui propose parallèlement un dossier sur la critique, et, bien évidemment, en couverture des Cahiers du Cinéma (355), où Prénom Carmen laisse cependant une place à A nos amours, astucieuse manière de signifier le changement d'année 1983/1984. Cinématographe (96) sort un numéro consacré à Fellini et La revue du cinéma (390) choisit quant à elle de mettre en vedette Boisset et son Canicule. Wargames, sorti en décembre, est en couverture de Starfix (11) et Bernard Giraudeau sur celle de Première (82). De son côté, Positif (275) fête comme il se doit la sortie française, vingt-neuf ans après sa réalisation, du magnifique Nuages flottants de Mikio Naruse.
Voilà pour janvier 1984. La suite le mois prochain...
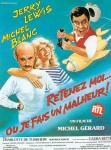 J'ai alors douze ans, je commence à aller assez régulièrement au cinéma de Nontron, situé à une quinzaine de kilomètres du domicile familial périgourdin, j'aime beaucoup Terence Hill et Bud Spencer. Je connais les films de Michel Blanc mais pas ceux de Jerry Lewis. Les deux sont bizarrement réunis à l'affiche de Retenez-moi ou je fais un malheur, de Michel Gérard. Pourtant bon public en ce temps-là, je ne trouve pas ça terrible, déjà. Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur le fait que c'est une daube sans nom.
J'ai alors douze ans, je commence à aller assez régulièrement au cinéma de Nontron, situé à une quinzaine de kilomètres du domicile familial périgourdin, j'aime beaucoup Terence Hill et Bud Spencer. Je connais les films de Michel Blanc mais pas ceux de Jerry Lewis. Les deux sont bizarrement réunis à l'affiche de Retenez-moi ou je fais un malheur, de Michel Gérard. Pourtant bon public en ce temps-là, je ne trouve pas ça terrible, déjà. Aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur le fait que c'est une daube sans nom. Mes connaissances se limitent à ces trois titres (sans compter celui que j'évoquerai plus bas). Pour le reste, on remarquera que l'époque était aux récits bien musclés : Jean-Claude Missiaen proposait avec Ronde de nuit un polar à la Française relativement bien accueilli par la presse (avec Gérard Lanvin et Eddy Mitchell) et Yves Boisset s'offrait Lee Marvin pour Canicule, une oeuvre qui, depuis la cour du collège, sentait autant la poudre que le souffre (comme toutes celles où l'on trouvait Miou-Miou d'ailleurs). Je ne sais toujours pas, à ce jour, ce qu'il en est réellement. Sûrement dans le même registre, nous trouvons une Cité du crime italienne (par un certain Stelvio Massi). Et les femmes s'y mettent aussi : Les anges du mal, de Paul Nicholas, se déroule dans une prison qui leur est réservée.
Mes connaissances se limitent à ces trois titres (sans compter celui que j'évoquerai plus bas). Pour le reste, on remarquera que l'époque était aux récits bien musclés : Jean-Claude Missiaen proposait avec Ronde de nuit un polar à la Française relativement bien accueilli par la presse (avec Gérard Lanvin et Eddy Mitchell) et Yves Boisset s'offrait Lee Marvin pour Canicule, une oeuvre qui, depuis la cour du collège, sentait autant la poudre que le souffre (comme toutes celles où l'on trouvait Miou-Miou d'ailleurs). Je ne sais toujours pas, à ce jour, ce qu'il en est réellement. Sûrement dans le même registre, nous trouvons une Cité du crime italienne (par un certain Stelvio Massi). Et les femmes s'y mettent aussi : Les anges du mal, de Paul Nicholas, se déroule dans une prison qui leur est réservée. Au rayon comédie, le menu ne faisait guère envie : en plus du Michel Gérard déjà cité, nous étaient proposés P'tit con (Gérard Lauzier) et Le joli coeur (Francis Perrin). Mieux valait donc tenter sa chance dans un autre genre, du côté du Choix des seigneurs (Giacomo Battiato), de Trahisons conjugales (de David Hughes Jones, d'après Pinter, avec Jeremy Irons et Ben Kingsley), du Train s'est arrêté (Abdrachinov Vadim), de L'éducation de Rita (Lewis Gilbert, avec Michael Caine), voire, pour les plus téméraires, de 2019 après la chute de New York (Sergio Martino).
Au rayon comédie, le menu ne faisait guère envie : en plus du Michel Gérard déjà cité, nous étaient proposés P'tit con (Gérard Lauzier) et Le joli coeur (Francis Perrin). Mieux valait donc tenter sa chance dans un autre genre, du côté du Choix des seigneurs (Giacomo Battiato), de Trahisons conjugales (de David Hughes Jones, d'après Pinter, avec Jeremy Irons et Ben Kingsley), du Train s'est arrêté (Abdrachinov Vadim), de L'éducation de Rita (Lewis Gilbert, avec Michael Caine), voire, pour les plus téméraires, de 2019 après la chute de New York (Sergio Martino). Il manque à l'appel deux noms et non des moindres, deux super-auteurs affolant la critique et les cinéphiles, tant sur l'écran que derrière un micro : Godard et Fellini. Le premier faisait mine de suivre la mode de l'époque, offrant à la renversante Maruschka Detmers son Prénom Carmen (au moins trois autres adaptations de Carmen furent proposées, en l'espace de quelques mois, au public : celle de Carlos Saura, celle de Peter Brook et celle de Francesco Rosi; quelqu'un se rappelle-t-il, d'ailleurs, la raison de cet engouement soudain ?). Le second prenait la mer. Et vogue le navire : celui-là, je le connais et c'est peu de dire qu'il m'a marqué. Découvert bien après sa sortie, il reste pour moi le dernier grand Fellini, avant trois ultimes films mi-figue mi-raisin. Comme souvent chez l'Italien, ce sont des images de rêves qui restent en tête longtemps après : un rhinocéros sur un bateau, une salle des machines infernale, des intermèdes musicaux aussi improbables que magiques.
Il manque à l'appel deux noms et non des moindres, deux super-auteurs affolant la critique et les cinéphiles, tant sur l'écran que derrière un micro : Godard et Fellini. Le premier faisait mine de suivre la mode de l'époque, offrant à la renversante Maruschka Detmers son Prénom Carmen (au moins trois autres adaptations de Carmen furent proposées, en l'espace de quelques mois, au public : celle de Carlos Saura, celle de Peter Brook et celle de Francesco Rosi; quelqu'un se rappelle-t-il, d'ailleurs, la raison de cet engouement soudain ?). Le second prenait la mer. Et vogue le navire : celui-là, je le connais et c'est peu de dire qu'il m'a marqué. Découvert bien après sa sortie, il reste pour moi le dernier grand Fellini, avant trois ultimes films mi-figue mi-raisin. Comme souvent chez l'Italien, ce sont des images de rêves qui restent en tête longtemps après : un rhinocéros sur un bateau, une salle des machines infernale, des intermèdes musicaux aussi improbables que magiques.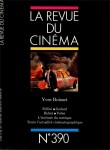 En s'intéressant aux revues de l'époque, on ne s'étonnera pas de tomber sur la tête de Jean-Luc Godard. Le cinéaste est à la une de Cinéma 84 (301), qui propose parallèlement un dossier sur la critique, et, bien évidemment, en couverture des Cahiers du Cinéma (355), où Prénom Carmen laisse cependant une place à A nos amours, astucieuse manière de signifier le changement d'année 1983/1984. Cinématographe (96) sort un numéro consacré à Fellini et La revue du cinéma (390) choisit quant à elle de mettre en vedette Boisset et son Canicule. Wargames, sorti en décembre, est en couverture de Starfix (11) et Bernard Giraudeau sur celle de Première (82). De son côté, Positif (275) fête comme il se doit la sortie française, vingt-neuf ans après sa réalisation, du magnifique Nuages flottants de Mikio Naruse.
En s'intéressant aux revues de l'époque, on ne s'étonnera pas de tomber sur la tête de Jean-Luc Godard. Le cinéaste est à la une de Cinéma 84 (301), qui propose parallèlement un dossier sur la critique, et, bien évidemment, en couverture des Cahiers du Cinéma (355), où Prénom Carmen laisse cependant une place à A nos amours, astucieuse manière de signifier le changement d'année 1983/1984. Cinématographe (96) sort un numéro consacré à Fellini et La revue du cinéma (390) choisit quant à elle de mettre en vedette Boisset et son Canicule. Wargames, sorti en décembre, est en couverture de Starfix (11) et Bernard Giraudeau sur celle de Première (82). De son côté, Positif (275) fête comme il se doit la sortie française, vingt-neuf ans après sa réalisation, du magnifique Nuages flottants de Mikio Naruse.
