(Alain Jessua / France / 1979)
■■□□
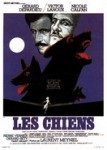 Le docteur Ferret (Victor Lanoux, plutôt bon) s'installe dans une ville de banlieue et s'étonne d'y soigner essentiellement des morsures et de croiser continuellement les habitants accompagnés de leurs chiens de défense. Dans un climat de violence croissante, il rencontre le "fournisseur" de la population en molosses, l'éleveur et maître-chien Morel (Depardieu), qui semble étendre son influence sur toute la cité. Voici donc un film de dénonciation : Jessua montre l'engrenage qui, partant d'un racisme au quotidien et d'une suspicion envers les jeunes, mène un groupe de "bons citoyens" au lynchage de tous ceux qui n'adhèrent pas à leur vision fasciste. Les actes d'un violeur non identifié provoquent la recherche de boucs émissaires, l'obsession sécuritaire est entretenue par celui qui lorgne sur la mairie. La trame est démonstrative et le film n'est pas dépourvu de défauts : les différents groupes sociaux sont schématiquement représentés (les notables, les jeunes, les immigrés), Elisabeth, le personnage féminin principal évolue d'une façon qui rend peu crédible son revirement final en comparaison à la droiture morale que garde de bout en bout le médecin, la résolution de l'affaire de viol est peu convaincante.
Le docteur Ferret (Victor Lanoux, plutôt bon) s'installe dans une ville de banlieue et s'étonne d'y soigner essentiellement des morsures et de croiser continuellement les habitants accompagnés de leurs chiens de défense. Dans un climat de violence croissante, il rencontre le "fournisseur" de la population en molosses, l'éleveur et maître-chien Morel (Depardieu), qui semble étendre son influence sur toute la cité. Voici donc un film de dénonciation : Jessua montre l'engrenage qui, partant d'un racisme au quotidien et d'une suspicion envers les jeunes, mène un groupe de "bons citoyens" au lynchage de tous ceux qui n'adhèrent pas à leur vision fasciste. Les actes d'un violeur non identifié provoquent la recherche de boucs émissaires, l'obsession sécuritaire est entretenue par celui qui lorgne sur la mairie. La trame est démonstrative et le film n'est pas dépourvu de défauts : les différents groupes sociaux sont schématiquement représentés (les notables, les jeunes, les immigrés), Elisabeth, le personnage féminin principal évolue d'une façon qui rend peu crédible son revirement final en comparaison à la droiture morale que garde de bout en bout le médecin, la résolution de l'affaire de viol est peu convaincante.
En revanche, une chose fait tenir le film et le rend plutôt réussi : la volonté de Jessua de tirer son histoire vers le fantastique, en utilisant plusieurs leviers mais toujours sur des données réalistes. Comme Buffet froid, Les chiens est un documentaire sur ces villes nouvelles apparues dans les années 70 et comme Blier, Jessua insiste sur la froideur des architectures (pour une action qui semble plutôt avoir lieu en été) et filme beaucoup de nuit. La plus grande étrangeté ne vient pas cependant de ces images de grands ensembles mais de cette omniprésence des chiens. Ici, les gens dînent au restaurant avec leur berger allemand au pied de la table, ne sortent pas sans eux dans la rue, les emmènent dans leur voiture pour chaque déplacement. Toutes ces scènes sont filmées sans effet particulier et en sont d'autant plus étonnantes. Jessua pousse son propos jusqu'au bout : les habitants de la cité deviennent de plus en plus agressifs, semblent se transformer eux-mêmes en animaux (réflexion explicitée inutilement par une remarque de Ferret à Elisabeth). Une séquence aussi excessive que troublante voit Morel pousser Elisabeth vers une libération totale de ses pulsions au cours d'un simple exercice d'attaque pour son chien. L'aspect fantastique devient de plus en plus prégnant sur la fin : le compte réglé de bel façon à Morel, ces voitures en poursuite des fugitifs qui s'arrêtent net comme empêchées de franchir une barrière invisible entourant la ville et un épilogue offrant un cadre en rupture complète par rapport à tout ce qui a précédé. Film à vedettes, message d'alerte politique, description sociologique (l'importance dans ces années-là du terrain de moto-cross) et conte fantastique : curieux mélange pour un résultat imparfait (contrairement à l'excellent Jeu de massacre que Jessua réalisa en 67) mais toujours intéressant.


 Rex Ingram, bien oublié aujourd'hui, était l'un des plus prestigieux réalisateurs du temps du muet. Balayé par l'arrivée du parlant, il ne signa comme film sonore que ce Baroud (prononcer baroude, "guerre" en arabe), en tandem avec sa femme Alice Terry. Comme cela arrivait souvent à l'époque, cette coproduction fut tournée en deux versions, l'une française, l'autre en anglais, avec pour cette dernière l'interprétation du premier rôle par Ingram lui-même. C'est la version française que Patrick Brion diffusa en 2007 au Cinéma de minuit.
Rex Ingram, bien oublié aujourd'hui, était l'un des plus prestigieux réalisateurs du temps du muet. Balayé par l'arrivée du parlant, il ne signa comme film sonore que ce Baroud (prononcer baroude, "guerre" en arabe), en tandem avec sa femme Alice Terry. Comme cela arrivait souvent à l'époque, cette coproduction fut tournée en deux versions, l'une française, l'autre en anglais, avec pour cette dernière l'interprétation du premier rôle par Ingram lui-même. C'est la version française que Patrick Brion diffusa en 2007 au Cinéma de minuit. On ne redira jamais assez l'importance de revenir de temps en temps vers les travaux des grands documentaristes, afin de laver nos yeux fatigués par les mensonges des reportages télévisés consacrés aux vrais gens. Tout à coup, nous redécouvrons les notions de distance, de montage, de hors-champ.
On ne redira jamais assez l'importance de revenir de temps en temps vers les travaux des grands documentaristes, afin de laver nos yeux fatigués par les mensonges des reportages télévisés consacrés aux vrais gens. Tout à coup, nous redécouvrons les notions de distance, de montage, de hors-champ. Avant-dernier film de l'auteur de Freaks, Les poupées du diable (The devil-doll) est un ouvrage relativement mineur dans la belle carrière de Tod Browning. Lionel Barrymore y incarne Paul Lavond, ancien banquier ayant été accusé à tort de meurtre, suite à un complot organisé par trois de ses associés. Évadé du bagne en compagnie d'un scientifique, il trouve le moyen d'accomplir sa vengeance en s'appropriant la découverte de ce dernier : la possibilité de transformer tout être vivant en petite créature obéissante de la taille d'une poupée.
Avant-dernier film de l'auteur de Freaks, Les poupées du diable (The devil-doll) est un ouvrage relativement mineur dans la belle carrière de Tod Browning. Lionel Barrymore y incarne Paul Lavond, ancien banquier ayant été accusé à tort de meurtre, suite à un complot organisé par trois de ses associés. Évadé du bagne en compagnie d'un scientifique, il trouve le moyen d'accomplir sa vengeance en s'appropriant la découverte de ce dernier : la possibilité de transformer tout être vivant en petite créature obéissante de la taille d'une poupée. Je saisis l'occasion de la vision de ce film de Browning pour évoquer un classique du genre : Les chasses du comte Zaroff (The most dangerous game). Zaroff est un aristocrate russe, installé sur une île déserte des Caraïbes. Son jeu favori est de recueillir des naufragés pour s'en servir de gibier lors de chasses à l'homme organisées avec ses domestiques et ses chiens. C'est ce qu'apprend à ses dépens Bob Rainsford, célèbre chasseur de fauves et seul survivant du dernier naufrage provoqué par Zaroff. Aux côtés des Frankenstein et autres Dracula, voici l'un des prototypes participant de l'établissement, dans les années 30, des figures et des formes propres au cinéma d'horreur.
Je saisis l'occasion de la vision de ce film de Browning pour évoquer un classique du genre : Les chasses du comte Zaroff (The most dangerous game). Zaroff est un aristocrate russe, installé sur une île déserte des Caraïbes. Son jeu favori est de recueillir des naufragés pour s'en servir de gibier lors de chasses à l'homme organisées avec ses domestiques et ses chiens. C'est ce qu'apprend à ses dépens Bob Rainsford, célèbre chasseur de fauves et seul survivant du dernier naufrage provoqué par Zaroff. Aux côtés des Frankenstein et autres Dracula, voici l'un des prototypes participant de l'établissement, dans les années 30, des figures et des formes propres au cinéma d'horreur. Le film de Mamoulian, qui n'est pas la première version cinématographique du roman de Stevenson (au moins deux adaptations avaient déjà été faîtes auparavant), date de 1931, soit avant le code Hays, établi en 1930 mais appliqué 4 ans après. L'oeuvre est donc ouvertement érotique. L'aguicheuse Myriam Hopkins, dans le rôle de Ivy, peut s'en donner à coeur joie : quand Jekyll la raccompagne jusqu'à sa chambre après l'avoir sauvée d'une agression dans la rue, elle finit nue sous les draps et laisse tomber sa jambe, qui se balance le long du lit. Ce mouvement de pendule, restant en surimpression sur le plan suivant de promenade, obsède incidemment Jekyll, qui tente de ne rien laisser paraître de son trouble face à son ami le Dr Lanyon. La volonté toujours ré-affirmée du héros d'avancer la date du mariage avec Muriel résonne comme une évidence : il veut coucher avec elle le plus tôt possible. C'est bien l'empêchement de ce désir qui provoque ses transformations et ses retours vers la prostituée. Une date d'union enfin fixée, et Jekyll se retrouve soulagé, pensant pouvoir mieux lutter contre ses démons intérieurs.
Le film de Mamoulian, qui n'est pas la première version cinématographique du roman de Stevenson (au moins deux adaptations avaient déjà été faîtes auparavant), date de 1931, soit avant le code Hays, établi en 1930 mais appliqué 4 ans après. L'oeuvre est donc ouvertement érotique. L'aguicheuse Myriam Hopkins, dans le rôle de Ivy, peut s'en donner à coeur joie : quand Jekyll la raccompagne jusqu'à sa chambre après l'avoir sauvée d'une agression dans la rue, elle finit nue sous les draps et laisse tomber sa jambe, qui se balance le long du lit. Ce mouvement de pendule, restant en surimpression sur le plan suivant de promenade, obsède incidemment Jekyll, qui tente de ne rien laisser paraître de son trouble face à son ami le Dr Lanyon. La volonté toujours ré-affirmée du héros d'avancer la date du mariage avec Muriel résonne comme une évidence : il veut coucher avec elle le plus tôt possible. C'est bien l'empêchement de ce désir qui provoque ses transformations et ses retours vers la prostituée. Une date d'union enfin fixée, et Jekyll se retrouve soulagé, pensant pouvoir mieux lutter contre ses démons intérieurs. Vue à la suite, la version de Victor Fleming en ressort bien affadie. Le film est pourtant plus réputé, essentiellement grâce à la présence au générique de Spencer Tracy et de Ingrid Bergman. La réflexion se veut plus subtile et les transformations physiques plus réalistes et moins spectaculaires. On y perd toutefois beaucoup en force. L'érotisme est réduit au minimum, Bergman/Ivy n'étant plus prostituée mais serveuse de bar. Tracy est plus sobre que March mais moins intéressant, trop sympathique et profondément bon. Ses accès de folie semblent passer pour des accidents et ne pas appartenir à sa personnalité propre. Jamais attiré par le mal, ses motivations sont alors bien floues. Hyde n'est plus un animal mais est proche de ces personnages de maris harcelant leurs femmes jusqu'à la folie dans les mélodrames criminels, très courants à l'époque, de type Gaslight ou Rebecca. Le remake est fidèle à la version précédente, reprenant parfois des plans exacts.
Vue à la suite, la version de Victor Fleming en ressort bien affadie. Le film est pourtant plus réputé, essentiellement grâce à la présence au générique de Spencer Tracy et de Ingrid Bergman. La réflexion se veut plus subtile et les transformations physiques plus réalistes et moins spectaculaires. On y perd toutefois beaucoup en force. L'érotisme est réduit au minimum, Bergman/Ivy n'étant plus prostituée mais serveuse de bar. Tracy est plus sobre que March mais moins intéressant, trop sympathique et profondément bon. Ses accès de folie semblent passer pour des accidents et ne pas appartenir à sa personnalité propre. Jamais attiré par le mal, ses motivations sont alors bien floues. Hyde n'est plus un animal mais est proche de ces personnages de maris harcelant leurs femmes jusqu'à la folie dans les mélodrames criminels, très courants à l'époque, de type Gaslight ou Rebecca. Le remake est fidèle à la version précédente, reprenant parfois des plans exacts. Pour certains, Dupontel cinéaste c'est, sur le fond, l'anti-conformisme, la rébellion, la trash attitude, et dans la forme, un délire visuel sous le patronage de Terry Gilliam. Voilà pour la légende. Ne connaissant ni Bernie, ni Le créateur, j'ai découvert dernièrement Enfermés dehors et j'ai pu ainsi me faire une idée du phénomène. Quel résultat pour cet histoire de SDF qui enfile par hasard un uniforme de policier ? Une idéologie simpliste, les signes banals de la révolte contre l'ordre établi et au final, un message des plus consensuels. La charge contre la police est soit trop légère et attendue pour une oeuvre de combat, soit trop superficielle pour atteindre à la réflexion. Le port de l'uniforme donne l'impression d'accéder au pouvoir et à la puissance, donc le cinéaste utilise un effet de zoom violent sur son personnage transformé et plutôt trois fois qu'une, pour bien nous faire comprendre. L'appel fait à Noir Désir (groupe remarquable, mais là n'est pas la question) pour la bande-son est une autre preuve de la "subtilité" de l'ensemble. Le retournement d'une situation habituelle (le flic prend ici la défense des faibles voleurs) ne produit que du conformisme et du bien-pensant ironique. Et tout cela ne s'arrange pas avec la leçon donnée au PDG corrompu, prise de position très courageuse. Ne pas oublier aussi que la société de consommation, elle nous bouffe. Il y aura donc une séquence idiote avec des panneaux publicitaires qui s'animent. Les gags visuels ne sont pas, il est vrai, tous aussi malheureux et on est vraiment peiné de voir échouer cette tentative de dynamisation du cinéma comique à la française. Dans le genre, on pense parfois, à regrets, à la grande comédie italienne des années 70, là où les personnages étaient mille fois plus travaillés et où les scénarios ne se terminaient pas de façon aussi cul-cul avec la famille reconstituée. Le PDG a pris conscience, les SDF ont mangé, le néo-flic a sauvé la petite fille. Et malgré tout ça, on a donné l'impression d'avoir donné un grand coup de pied dans le système et dans le cinéma français. Chapeau...
Pour certains, Dupontel cinéaste c'est, sur le fond, l'anti-conformisme, la rébellion, la trash attitude, et dans la forme, un délire visuel sous le patronage de Terry Gilliam. Voilà pour la légende. Ne connaissant ni Bernie, ni Le créateur, j'ai découvert dernièrement Enfermés dehors et j'ai pu ainsi me faire une idée du phénomène. Quel résultat pour cet histoire de SDF qui enfile par hasard un uniforme de policier ? Une idéologie simpliste, les signes banals de la révolte contre l'ordre établi et au final, un message des plus consensuels. La charge contre la police est soit trop légère et attendue pour une oeuvre de combat, soit trop superficielle pour atteindre à la réflexion. Le port de l'uniforme donne l'impression d'accéder au pouvoir et à la puissance, donc le cinéaste utilise un effet de zoom violent sur son personnage transformé et plutôt trois fois qu'une, pour bien nous faire comprendre. L'appel fait à Noir Désir (groupe remarquable, mais là n'est pas la question) pour la bande-son est une autre preuve de la "subtilité" de l'ensemble. Le retournement d'une situation habituelle (le flic prend ici la défense des faibles voleurs) ne produit que du conformisme et du bien-pensant ironique. Et tout cela ne s'arrange pas avec la leçon donnée au PDG corrompu, prise de position très courageuse. Ne pas oublier aussi que la société de consommation, elle nous bouffe. Il y aura donc une séquence idiote avec des panneaux publicitaires qui s'animent. Les gags visuels ne sont pas, il est vrai, tous aussi malheureux et on est vraiment peiné de voir échouer cette tentative de dynamisation du cinéma comique à la française. Dans le genre, on pense parfois, à regrets, à la grande comédie italienne des années 70, là où les personnages étaient mille fois plus travaillés et où les scénarios ne se terminaient pas de façon aussi cul-cul avec la famille reconstituée. Le PDG a pris conscience, les SDF ont mangé, le néo-flic a sauvé la petite fille. Et malgré tout ça, on a donné l'impression d'avoir donné un grand coup de pied dans le système et dans le cinéma français. Chapeau...

 En 1913, un journaliste anglais, correspondant en Russie, est menacé d'expulsion par le régime tsariste, se fait embaucher par l'Intelligence Service afin d'infiltrer les mouvements révolutionnaires, est déporté en Sibérie à la suite d'un attentat dont il n'est pas l'auteur, est libéré par la Révolution de 1917, devient adjoint d'un commissaire du peuple, sauve de la fusillade une comtesse et l'entraîne dans un périple au coeur de la guerre civile. Et là, les péripéties commencent vraiment...
En 1913, un journaliste anglais, correspondant en Russie, est menacé d'expulsion par le régime tsariste, se fait embaucher par l'Intelligence Service afin d'infiltrer les mouvements révolutionnaires, est déporté en Sibérie à la suite d'un attentat dont il n'est pas l'auteur, est libéré par la Révolution de 1917, devient adjoint d'un commissaire du peuple, sauve de la fusillade une comtesse et l'entraîne dans un périple au coeur de la guerre civile. Et là, les péripéties commencent vraiment...
