(John Frankenheimer / Etats-Unis / 1962 & 1969)
■■■□ / ■■■□
 Un crime dans la tête (The Manchurian candidate) est un thriller politique, un étonnant film d'espionnage réalisé avec un regard assez acide. En Corée, des soldats américains sont faits prisonniers. Ils sont manipulés psychologiquement, puis renvoyés chez eux sans souvenirs de l'expérience imposée mais prêts à être à tout moment "dirigés" à leur insu. Le but de l'opération est l'assassinat d'un candidat à la Maison Blanche et son remplacement par un politicien fantoche. Ce film de Frankenheimer est ouvertement anti-communiste. Il ne se résume pas cependant à cette position, car il est tout aussi clairement anti-fasciste. Ce sont bien les deux extrêmes qui sont renvoyés dos à dos. Les allusions au McCarthysme et à ses dérives insupportables sont évidentes. Finalement, c'est au sein même de la bonne société américaine que sont nichés les plus grands ennemis de la démocratie, plus que chez les Rouges à l'étranger.
Un crime dans la tête (The Manchurian candidate) est un thriller politique, un étonnant film d'espionnage réalisé avec un regard assez acide. En Corée, des soldats américains sont faits prisonniers. Ils sont manipulés psychologiquement, puis renvoyés chez eux sans souvenirs de l'expérience imposée mais prêts à être à tout moment "dirigés" à leur insu. Le but de l'opération est l'assassinat d'un candidat à la Maison Blanche et son remplacement par un politicien fantoche. Ce film de Frankenheimer est ouvertement anti-communiste. Il ne se résume pas cependant à cette position, car il est tout aussi clairement anti-fasciste. Ce sont bien les deux extrêmes qui sont renvoyés dos à dos. Les allusions au McCarthysme et à ses dérives insupportables sont évidentes. Finalement, c'est au sein même de la bonne société américaine que sont nichés les plus grands ennemis de la démocratie, plus que chez les Rouges à l'étranger.
Un crime dans la tête se singularise également par son aspect science-fiction. La technologie est omniprésente, notamment les écrans de télévision. On peut penser au Dr Mabuse pour cela et pour la manipulation des esprits et l'utilisation de techniques paranormales. Plus que dans un film politique, on se retrouve dans une sorte de conte où l'on nous montre des cauchemars, un bal masqué, des cartes à jouer. Même les scènes les plus anodines, comme la rencontre dans le train entre Frank Sinatra et Janet Leigh sont traitées comme si elles faisaient partie de la manipulation, laissant planer le doute. Frankenheimer s'en donne à coeur-joie visuellement, rajoutant à un scénario et à un positionnement moral déjà intrigants, une esthétique pleine d'effets très maîtrisés, à base de grands angles déformants, proposant en particulier un catalogue de la figure favorite du cinéaste : un cadrage en profondeur avec la tête d'un des personnage envahissant toute une partie du premier plan.
Le film a fait l'objet d'un remake signé par Jonathan Demme en 2004.
 7 ans et 6 films plus tard (dont 7 jours en mai et Grand prix), Les parachutistes arrivent (The gypsy moths) s'éloigne considérablement du registre virulent d'Un crime dans la tête, car Frankenheimer entamait là un virage esthétique certain. Les parachutistes en question ne sont pas des militaires mais trois sportifs casse-cous proposant un spectacle itinérant de voltige. Le trio pose ses valises dans un petite ville du Kansas et plus précisément dans la maison de la tante du plus jeune, Malcolm, qui revient ainsi, plus de dix ans après, au pays. Ainsi se fait la chronique de quelques journées pas si tranquilles, tout étant réuni pour que l'arrivée de ces trois saltimbanques mélancoliques perturbent la petite vie de famille bourgeoise bien rangée.
7 ans et 6 films plus tard (dont 7 jours en mai et Grand prix), Les parachutistes arrivent (The gypsy moths) s'éloigne considérablement du registre virulent d'Un crime dans la tête, car Frankenheimer entamait là un virage esthétique certain. Les parachutistes en question ne sont pas des militaires mais trois sportifs casse-cous proposant un spectacle itinérant de voltige. Le trio pose ses valises dans un petite ville du Kansas et plus précisément dans la maison de la tante du plus jeune, Malcolm, qui revient ainsi, plus de dix ans après, au pays. Ainsi se fait la chronique de quelques journées pas si tranquilles, tout étant réuni pour que l'arrivée de ces trois saltimbanques mélancoliques perturbent la petite vie de famille bourgeoise bien rangée.
Frankenheimer calme son jeu et se cale merveilleusement entre cinéma moderne et classicisme du mélodrame sirkien ou minnellien. Rien que le sujet des Gypsy moths fait penser à La ronde de l'aube de Douglas Sirk. La confrontation des deux oeuvres devrait être riche en reflexions. Le fantôme de Minnelli flotte lui notamment grâce à Deborah Kerr. Dix ans après Thé et sympathie, elle laisse toujours autant sentir le feu sous la glace. Entre les deux périodes, bien des choses ont changé. Alors que le trouble affleurait à peine sous la surface, la gêne est maintenant palpable dès la première rencontre. Alors que le désir était contrarié ou repoussé, l'adultère s'étale pratiquement au grand jour. Mike Rettig, le solitaire qui les fait toutes frissonner sans dire un mot, n'a pas longtemps à attendre pour coucher avec la maîtresse de maison dès que le mari s'endort à l'étage. Les existences sont vides. Il ne s'agit même pas de révélation par une confrontation, car tous en sont déjà conscients. Le malaise touche chacun. Seule différence : certains l'acceptent, d'autres non.
La description sociétale s'appuie donc sur des figures archetypales mais poussées à un point de tristesse extrême. La formation des trois couples éphémères est directe. Une séquence de bar à strip-tease ne dépareillerait pas dans un Tarantino. La construction du film rattache plus, elle aussi, l'ensemble à la modernité : après une introduction présentant le show, deux grands segments s'articulent de part et d'autre de la longue séquence centrale du spectacle aérien. Pendant plusieurs minutes, les sauts se succèdent, le plus souvent sans musique. Pas évidente sur le papier, cette partie est remarquable. Évitant au maximum les gros plans de visages qui induisent l'utilisation de transparences, Frankenheimer privilégie les plans larges sur les cascadeurs. Le spectacle s'avère assez beau, techniquement impeccable, parfois drôle même grâce aux pitreries de Browdy faisant croire à l'assistance, par micro interposé, qu'il a oublié son parachute alors qu'il a déjà sauté dans le vide. Sans élément dramatisant autre que cette tristesse diffuse envahissant les personnages, on craint tout de même, forcément, le drame. Il arrive. Ce sera un drame de la mélancolie.
Il faudrait dire encore bien des choses sur ce film aux riches prolongements : la caractérisation sans faille (Gene Hackman en Browdy, grande gueule obsédée par l'argent, Burt Lancaster en Rettig, retrouvant le temps d'un exposé sur le parachutisme devant une assistance de braves dames le ton vif et charmeur et le sourire ô combien carnassier d'Elmer Gantry le charlatan), le regard sur la foule qui se masse de la même manière autour d'un cadavre qu'autour d'un parachutiste ayant réussi un saut fabuleux, ou le rôle de la météo (la chaleur de la première journée, la fausse piste de la pluie et du terrain trempé...). Bref, tout cela incite à découvrir bien d'autres oeuvres de John Frankenheimer (décédé en 2002), dont le nom est loin de ne s'associer qu'à French Connection n°2.
A lire : Cinétudes (un passage en revue très détaillé de la carrière de Frankenheimer).
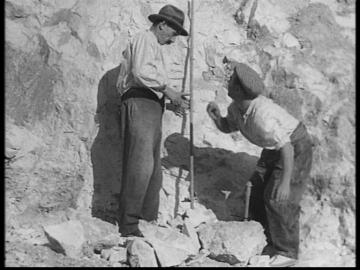

 Assez réputé dans les années 70, Gros plan (Inserts) a, depuis, bien sombré dans l'oubli, certainement à cause des difficultés qu'a rencontré son auteur pour enchaîner d'autres films intéressants à la suite de ce premier effort. Son statut et son sujet faisaient espérer beaucoup. Le résultat n'est pas désagréable mais un tantinet décevant.
Assez réputé dans les années 70, Gros plan (Inserts) a, depuis, bien sombré dans l'oubli, certainement à cause des difficultés qu'a rencontré son auteur pour enchaîner d'autres films intéressants à la suite de ce premier effort. Son statut et son sujet faisaient espérer beaucoup. Le résultat n'est pas désagréable mais un tantinet décevant.

 Est-ce que l'éloignement (pour ne pas dire l'exotisme) rend plus indulgent ? Sûrement qu'une scène de rue tournée à Alger se charge pour nous d'une autre dimension par rapport à la même qui nous montrerait n'importe quelle ville française. Je précise tout de suite : Viva Laldjérie est bien plus qu'un film informant sur une société. C'est une oeuvre ambitieuse et maîtrisée, un petit bijou.
Est-ce que l'éloignement (pour ne pas dire l'exotisme) rend plus indulgent ? Sûrement qu'une scène de rue tournée à Alger se charge pour nous d'une autre dimension par rapport à la même qui nous montrerait n'importe quelle ville française. Je précise tout de suite : Viva Laldjérie est bien plus qu'un film informant sur une société. C'est une oeuvre ambitieuse et maîtrisée, un petit bijou. Mis de bonne humeur par le Kusturica, je me suis laissé tenter par la ressortie post-César de La Môme. Je vous jure que je voulais bien l'aimer ce film, que j'étais prêt à passer par dessus bien des contraintes imposées par le genre. Mais pour ce faire, il aurait fallu que le cinéaste me fasse un peu plus confiance en temps que spectateur et qu'il ne se base pas uniquement sur son cahier des charges pour conduire son récit. Je ne connais pas les précédents travaux d'Olivier Dahan mais il m'a l'air d'être un jeune cinéaste (40 ans) "moderne et ambitieux". Alors pourquoi diable nous fait-il un biopic aussi conventionnel ? C'est sûr, tout était calibré dès le départ pour que ça marche, ici et de l'autre côté de l'Atlantique. Tous les rôles principaux sont tenus par des vedettes, au point qu'on s'étonne de ne pas voir débarquer Clovis Cornillac en Marcel Cerdan. A ce jeu de reconstitution historique avec l'accent, ce sont les plus aguerris (Depardieu et Greggory) qui sont le moins insupportables. On a droit en passant à l'incarnation de Marlene Dietrich par Caroline Sihol, et ça, ça fait très mal. Quant à Marion Cotillard, c'est vrai que ça a dû être dur pour elle toutes ces heures passées au maquillage (mais elle est en fait meilleure en vieille dame qu'en femme de son âge).
Mis de bonne humeur par le Kusturica, je me suis laissé tenter par la ressortie post-César de La Môme. Je vous jure que je voulais bien l'aimer ce film, que j'étais prêt à passer par dessus bien des contraintes imposées par le genre. Mais pour ce faire, il aurait fallu que le cinéaste me fasse un peu plus confiance en temps que spectateur et qu'il ne se base pas uniquement sur son cahier des charges pour conduire son récit. Je ne connais pas les précédents travaux d'Olivier Dahan mais il m'a l'air d'être un jeune cinéaste (40 ans) "moderne et ambitieux". Alors pourquoi diable nous fait-il un biopic aussi conventionnel ? C'est sûr, tout était calibré dès le départ pour que ça marche, ici et de l'autre côté de l'Atlantique. Tous les rôles principaux sont tenus par des vedettes, au point qu'on s'étonne de ne pas voir débarquer Clovis Cornillac en Marcel Cerdan. A ce jeu de reconstitution historique avec l'accent, ce sont les plus aguerris (Depardieu et Greggory) qui sont le moins insupportables. On a droit en passant à l'incarnation de Marlene Dietrich par Caroline Sihol, et ça, ça fait très mal. Quant à Marion Cotillard, c'est vrai que ça a dû être dur pour elle toutes ces heures passées au maquillage (mais elle est en fait meilleure en vieille dame qu'en femme de son âge). Un petit film de Renoir, par sa durée (une trentaine de minutes), par son importance au sein de la filmographie et par le peu de moyens dont le cinéaste a disposé. Bien qu'ayant déjà réalisé le prestigieux Nana (1926), il en est encore à se chercher et à expérimenter. Ici, tout tient du bricolage, souvent ingénieux, avec ces maquettes de la ville sous la neige, ces surimpressions et autres effets visuels.
Un petit film de Renoir, par sa durée (une trentaine de minutes), par son importance au sein de la filmographie et par le peu de moyens dont le cinéaste a disposé. Bien qu'ayant déjà réalisé le prestigieux Nana (1926), il en est encore à se chercher et à expérimenter. Ici, tout tient du bricolage, souvent ingénieux, avec ces maquettes de la ville sous la neige, ces surimpressions et autres effets visuels. Les quelques extraits entr'aperçus au moment de Cannes n'étaient pas très engageants, la rumeur s'est faîte très négative et la sortie du film fin janvier a été accompagnée par un déluge de mauvaises critiques. Ainsi redoutée, la catastrophe n'a finalement... pas lieu. Kusturica avec Promets-moi, livre une farce, réalisée dans son coin. A la suite de Underground, il est évident que le cinéaste n'a plus souhaité se frotter aux grands sujets. Il a ainsi signé des oeuvres de plus en plus simples et lumineuses. On peut regretter qu'au cours des dix dernières années, chaque rendez-vous soit un peu moins marquant que le précédent, mais pour l'instant, l'énergie suffit encore à emporter le morceau. Kusturica semble finalement vouloir faire du cinéma comme il fait de la musique, sans se prendre la tête. Et effectivement, ses films ressemblent de plus en plus aux concerts du No Smoking Orchestra (voir le formidable documentaire tourné par Kusturica lui-même sur son groupe : Super-8 stories), soit du rock balkanique qui ne se singularise pas par sa subtilité mais qui est tout simplement une belle machine à danser et transpirer.
Les quelques extraits entr'aperçus au moment de Cannes n'étaient pas très engageants, la rumeur s'est faîte très négative et la sortie du film fin janvier a été accompagnée par un déluge de mauvaises critiques. Ainsi redoutée, la catastrophe n'a finalement... pas lieu. Kusturica avec Promets-moi, livre une farce, réalisée dans son coin. A la suite de Underground, il est évident que le cinéaste n'a plus souhaité se frotter aux grands sujets. Il a ainsi signé des oeuvres de plus en plus simples et lumineuses. On peut regretter qu'au cours des dix dernières années, chaque rendez-vous soit un peu moins marquant que le précédent, mais pour l'instant, l'énergie suffit encore à emporter le morceau. Kusturica semble finalement vouloir faire du cinéma comme il fait de la musique, sans se prendre la tête. Et effectivement, ses films ressemblent de plus en plus aux concerts du No Smoking Orchestra (voir le formidable documentaire tourné par Kusturica lui-même sur son groupe : Super-8 stories), soit du rock balkanique qui ne se singularise pas par sa subtilité mais qui est tout simplement une belle machine à danser et transpirer. Réalisé entre Klute (1971) et Les hommes du président (1976), ensemble d'oeuvres qui forme a posteriori une fameuse trilogie paranoïaque, A cause d'un assassinat (The Parallax view) est un modèle de thriller politique. L'assassinat en question est celui d'un sénateur américain, abattu, d'après la version officielle, par un individu isolé. Pourtant, trois ans après les faits, Joe Frady, journaliste, s'inquiète de voir disparaître un a un tous les témoins de la scène. Son enquête périlleuse lui fait découvrir les agissements de la Parallax, entreprise recrutant déséquilibrés ou autres asociaux pour en faire les instruments d'assassinats politiques.
Réalisé entre Klute (1971) et Les hommes du président (1976), ensemble d'oeuvres qui forme a posteriori une fameuse trilogie paranoïaque, A cause d'un assassinat (The Parallax view) est un modèle de thriller politique. L'assassinat en question est celui d'un sénateur américain, abattu, d'après la version officielle, par un individu isolé. Pourtant, trois ans après les faits, Joe Frady, journaliste, s'inquiète de voir disparaître un a un tous les témoins de la scène. Son enquête périlleuse lui fait découvrir les agissements de la Parallax, entreprise recrutant déséquilibrés ou autres asociaux pour en faire les instruments d'assassinats politiques. Ah, le cinéma d'Abel Gance... Sa grandiloquence, son premier degré, ses interprètes qui écarquillent les yeux, ses arabesques... Pour exécuter la commande de Lucrèce Borgia, Gance n'a disposé ni des moyens financiers souhaités ni d'un scénario à son goût. Mais on se demande si le manque de conviction du cinéaste et l'absence de l'intensité habituelle ne sauvent pas ce petit film, pas très bon mais pas désagréable pour autant. Tout le sérieux mis dans J'accuse ! (1922) ou La dixième symphonie (1918) rend ces oeuvres difficilement supportables aujourd'hui (je ne connais pas ses deux films les plus célèbres : La roue (1922) et Napoléon(1927)). Si Lucrèce Borgia se laisse regarder, c'est notamment pour son aspect fantaisie historique qui s'oppose pourtant à la volonté de Gance de traiter cette intrigue à rebondissements mélodramatiques avec le plus grand respect possible envers la réalité. Nous suivons donc la famille Borgia en train de secouer la vie romaine de ce XVe siècle : le père (et pape) Alexandre VI observe sans trop sourciller César, son fils cadet qui, sous l'influence de Machiavel, fait assassiner son frère aîné et les amants et maris successifs de sa soeur Lucrèce, complote à tous les niveaux, se livre à des orgies et décide de conquérir toute l'Italie. Ainsi les péripéties s'enchaînent, assemblées avec du métier et parfois de l'invention dans le montage (devant ces meurtres qui s'accomplissent pendant que leurs commanditaires président des assemblées ou devant cette montée de la révolte populaire entremêlée à l'aide d'un son de cloche avec les réactions d'inquiétudes des membres de la famille réfugiés dans le palais, il serait un peu gonflé de parler du Parrain de Coppola mais bon...). La composition de certains plans lors des cérémonies autour du pape ou quelques beaux mouvements de caméra retiennent l'attention.
Ah, le cinéma d'Abel Gance... Sa grandiloquence, son premier degré, ses interprètes qui écarquillent les yeux, ses arabesques... Pour exécuter la commande de Lucrèce Borgia, Gance n'a disposé ni des moyens financiers souhaités ni d'un scénario à son goût. Mais on se demande si le manque de conviction du cinéaste et l'absence de l'intensité habituelle ne sauvent pas ce petit film, pas très bon mais pas désagréable pour autant. Tout le sérieux mis dans J'accuse ! (1922) ou La dixième symphonie (1918) rend ces oeuvres difficilement supportables aujourd'hui (je ne connais pas ses deux films les plus célèbres : La roue (1922) et Napoléon(1927)). Si Lucrèce Borgia se laisse regarder, c'est notamment pour son aspect fantaisie historique qui s'oppose pourtant à la volonté de Gance de traiter cette intrigue à rebondissements mélodramatiques avec le plus grand respect possible envers la réalité. Nous suivons donc la famille Borgia en train de secouer la vie romaine de ce XVe siècle : le père (et pape) Alexandre VI observe sans trop sourciller César, son fils cadet qui, sous l'influence de Machiavel, fait assassiner son frère aîné et les amants et maris successifs de sa soeur Lucrèce, complote à tous les niveaux, se livre à des orgies et décide de conquérir toute l'Italie. Ainsi les péripéties s'enchaînent, assemblées avec du métier et parfois de l'invention dans le montage (devant ces meurtres qui s'accomplissent pendant que leurs commanditaires président des assemblées ou devant cette montée de la révolte populaire entremêlée à l'aide d'un son de cloche avec les réactions d'inquiétudes des membres de la famille réfugiés dans le palais, il serait un peu gonflé de parler du Parrain de Coppola mais bon...). La composition de certains plans lors des cérémonies autour du pape ou quelques beaux mouvements de caméra retiennent l'attention.