Pour tenter de rassurer sa principale collaboratrice qui s'inquiète du potentiel de scandale se nichant dans certaines réflexions d'Hannah Arendt sur les conseils juifs, le patron du New Yorker, s'apprêtant à publier le travail de la philosophe sur le procès Eichmann, dit : "Mais cela ne représente que dix pages sur trois cents !" Et Margarethe von Trotta de réduire ces dix pages à quatre ou cinq lignes et de passer une heure sur leur retentissement...

A partir de mots pesés pour provoquer et ayant donné lieu finalement à des interprétations multiples, dont certaines, certes pas les moins nombreuses, furent excessives et erronées, la cinéaste ne construit son récit, platement pédagogique, que sur un principe d'opposition, sans ambiguïté ni doute. D'un côté, Arendt et ses courageux défenseurs. De l'autre, ceux qui l'attaquent depuis son propre camp, les Juifs bornés qui ne comprennent rien. Entre les deux, rien ni personne.
Pour faire sentir la force d'une opposition au spectateur lambda, qui demande à être informé et ému mais pas plus, il n'est rien de mieux que le bon vieux champ-contrechamp.
Un champ-contrechamp, cela peut servir à situer. Dans Hannah Arendt, le procédé sert surtout à nous assigner une place, à nous dire où l'on doit se tenir. Ainsi, nous sommes forcément à côté de Mary, l'amie d'Hannah, lorsqu'elle rabat le caquet des intellectuels de salon dénigrant Arendt. Von Trotta dispose de part et d'autre regards mauvais de la meute et posture féminine fière. La victoire verbale de la femme libre ne tarde pas, et peu importe que les arguments soient aussi bassement personnels des deux côtés. Pour que cette scène soit parfaite, il aurait fallu sans doute la ponctuer d'un coup de pied entre les jambes du salaud.
Un champ-contrechamp, cela peut servir à montrer quelqu'un en train de réfléchir à l'objet de son étude. Dans Hannah Arendt, la représentation du procès Eichmann, ce sont les images du nazi dans sa cage de verre diffusées sur un moniteur et la philosophe assise en salle de presse qui réagit à ces images. Elle y réagit discrètement. Enfin, discrètement... Il faut quand même que l'on comprenne bien ce qui lui passe par la tête à ces moments-là. On lit donc sur son visage, successivement (et musique à l'appui), la désapprobation devant une faible attaque du procureur, l'intensité de la réflexion naissante à partir d'une réponse déterminante de l'accusé, le sourire ironique face à une défense aberrante de celui-ci...
Un champ-contrechamp, cela peut servir à émouvoir. Dans Hannah Arendt, le grand final a lieu dans un petit amphithéâtre. Arendt y brise enfin le silence qu'elle s'est imposé jusque là, dans la tempête provoquée par la publication de son texte. Ce sont ses premières paroles publiques, sa première défense. Elle se tient, pugnace, sur l'estrade. Face à elle, se trouvent ses étudiants, jeunes, beaux, silencieux, pénétrés. Est-ce vraiment nécessaire de les convaincre ? On en doute. Dès les premières secondes de la scène, on sait comment elle va finir : tous vont applaudir vivement et seuls les fâcheux, les vieux universitaires qui ont voulu mettre leur brillante collègue à la porte quelques minutes avant, vont quitter piteusement la salle.

L'usage simpliste du champ-contrechamp est souvent pointé comme preuve d'académisme ou d'absence de mise en scène. C'est une sorte de cliché critique. Et c'est donc, souvent, une vérité. Que cet usage ait, dans Hannah Arendt, des buts variés ne change rien à l'affaire. Il est un signe, parmi d'autres, de la médiocrité stylistique et narrative d'un banal film de vulgarisation historique, un de plus.

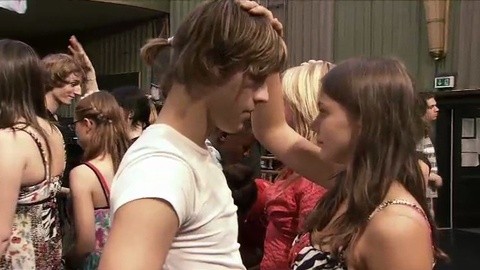
 LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA BAUSCH (Tanzträume)
LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA BAUSCH (Tanzträume)
 DU JOUR AU LENDEMAIN (Von heute auf morgen)
DU JOUR AU LENDEMAIN (Von heute auf morgen)
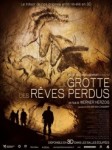 LA GROTTE DES RÊVES PERDUS (Cave of forgotten dreams)
LA GROTTE DES RÊVES PERDUS (Cave of forgotten dreams)
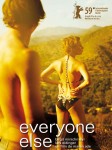 EVERYONE ELSE (Alle anderen)
EVERYONE ELSE (Alle anderen)
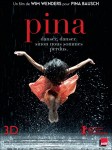 PINA
PINA

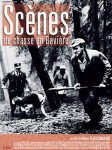 SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE (Jagdszenen aus Niederbayern)
SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE (Jagdszenen aus Niederbayern) Avec La révélation, titre français passe-partout remplaçant le Storm original mais pas forcément plus approprié, Hans-Christian Schmid a eu le mérite de se frotter à un sujet politique actuel et complexe. Développer une fiction à partir de l'activité d'une institution comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'est pas chose aisée. Le cinéaste allemand le fait sans complaisance vis à vis des magistrats y exerçant leur métier, n'hésitant pas à évoquer leur lassitude, la tentation des petits arrangements et, plus généralement, la difficulté à résister au pragmatisme politique international qu'impose, entre autres choses, la construction européenne. Tourné en 2008, le film entre en résonance avec le procès Slobodan Milosevic et l'arrestation de Radovan Karadzic et tente d'accompagner les réflexions autour de la place à donner à la Serbie dans l'U.E. Pour étoffer sa base documentaire, que l'on sent très travaillée en amont, Schmid brosse le portrait de deux femmes, l'une, véritable héroïne de cette histoire, procureure à La Haye, l'autre, victime de la guerre de Bosnie, et donne à son film l'apparence d'une enquête policière dont l'aboutissement est censé interroger les notions de responsabilité individuelle et de droiture morale.
Avec La révélation, titre français passe-partout remplaçant le Storm original mais pas forcément plus approprié, Hans-Christian Schmid a eu le mérite de se frotter à un sujet politique actuel et complexe. Développer une fiction à partir de l'activité d'une institution comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'est pas chose aisée. Le cinéaste allemand le fait sans complaisance vis à vis des magistrats y exerçant leur métier, n'hésitant pas à évoquer leur lassitude, la tentation des petits arrangements et, plus généralement, la difficulté à résister au pragmatisme politique international qu'impose, entre autres choses, la construction européenne. Tourné en 2008, le film entre en résonance avec le procès Slobodan Milosevic et l'arrestation de Radovan Karadzic et tente d'accompagner les réflexions autour de la place à donner à la Serbie dans l'U.E. Pour étoffer sa base documentaire, que l'on sent très travaillée en amont, Schmid brosse le portrait de deux femmes, l'une, véritable héroïne de cette histoire, procureure à La Haye, l'autre, victime de la guerre de Bosnie, et donne à son film l'apparence d'une enquête policière dont l'aboutissement est censé interroger les notions de responsabilité individuelle et de droiture morale.
 Moïse et Aaron (Moses und Aron) est l'adaptation d'un opéra inachevé d'Arnold Schönberg. La première réflexion que l'on se fait devant ce film, c'est que les Straub n'ont pas cherché à tirer l'opéra vers le spectacle cinématographique, contrairement aux autres cinéastes ayant tenté ce genre d'expérience comme Losey ou Rosi (le premier y parvenant, dans mon souvenir, mieux avec Don Giovanni que le second avec Carmen). Le plan long, la caméra fixe et les acteurs immobiles sont la règle, souffrant de peu d'exceptions. Les cinéastes inventent le cadrage de "trois-quart dos". L'écran peut rester noir deux ou trois minutes.
Moïse et Aaron (Moses und Aron) est l'adaptation d'un opéra inachevé d'Arnold Schönberg. La première réflexion que l'on se fait devant ce film, c'est que les Straub n'ont pas cherché à tirer l'opéra vers le spectacle cinématographique, contrairement aux autres cinéastes ayant tenté ce genre d'expérience comme Losey ou Rosi (le premier y parvenant, dans mon souvenir, mieux avec Don Giovanni que le second avec Carmen). Le plan long, la caméra fixe et les acteurs immobiles sont la règle, souffrant de peu d'exceptions. Les cinéastes inventent le cadrage de "trois-quart dos". L'écran peut rester noir deux ou trois minutes.