***
wenders
-
Perfect Days (Wim Wenders, 2023)
Scènes de la vie quotidienne d'un agent d'entretien des toilettes publiques de Tokyo, grand-petit film. Petit au sens modeste, comme le cadre de vie du personnage et le cadre serré du film, comme les lieux qu'il habite et nettoie, comme les plaisirs qu'il s'autorise. Avec calme, simplicité et bienveillance, Wenders nous parle du lien social, du rapport avec les autres mais aussi de la nécessité à être en accord avec soi-même. Un beau film-hommage à un pays, une ville, un quartier, un acteur, le magnifique Koji Yakusho. -
Les Ailes du désir (Wim Wenders, 1987)
****

- L'odeur et le goût du café dans un gobelet qui réchauffe aussi les mains.
- La façon qu'a Bruno Ganz de pencher légèrement la tête d'un côté en écoutant et en regardant les autres, image même de la compassion.
- La fillette brune assise à côté de Damiel et qui n'arrête pas de lui parler pendant les numéros de cirque.
- Cassiel qui, les yeux clos et la tête posée contre celle de la statue, couvre son oreille de la paume de sa main droite pour ne plus entendre la musique.
- Le travelling latéral accompagnant la marche de Marion, le soir, sur le trottoir. Le travelling avant suivant la marche de Damiel, le jour, au milieu de la rue.
- L'enchaînement The Carny/From Her To Eternity.
(Comment faire la différence entre un cinéaste qui ne fait que se servir du rock et un cinéaste qui l'aime vraiment ? Le premier place un morceau, un extrait de concert, au milieu des autres scènes, publicitairement. Le second, lui, filme dans la continuité l'enchaînement de deux morceaux - voir aussi Jonathan Demme et les Feelies dans Dangereuse sous tous rapports.)- L'Histoire et la Guerre qui s'invitent derrière les vitres de la voiture et dans la mémoire de Cassiel assis à l'arrière.
- Le suicidaire qui saute deux fois de suite.
- Je ne me rappelais pas que Peter Falk était lui aussi un ex-ange.
- Wenders réinvente la figure de l'ange au cinéma, ainsi que la notion d'invisibilité (modulée par la magnifique idée des visions des enfants), par des moyens très simples : des têtes qui se tournent pour porter le regard au loin, "à travers" l'ange tout proche, des mains qui n'attrapent ni ne touchent vraiment... Par cette nouvelle approche de la présence/absence, il réinvente même, en passant, le nu (de dos) féminin.
- Le film brasse toutes les histoires. La grande, articulée autour de la Seconde Guerre mondiale, avec Berlin au centre de celle-ci, qui taraudait Wenders, comme elle taraudait encore tout le monde à l'époque. Et celle du cinéma évidemment, avec le tournage de film dans le film et surtout le noir et blanc, qui renvoie au muet, à l'expressionnisme, à Cocteau-Alekan (le rêve de Marion), au cirque chaplinien, à l'avant-garde des années 20 (séquence des tourments de Cassiel), puis, avec le renfort de la couleur, au documentaire, au film d'errance...
- Il y a deux plans qui saisissent tout à coup. Ils sont tous les deux consacrés à Solveig Dommartin. Après de longues minutes en noir et blanc, c'est le premier plan en couleurs, très bref, la montrant sur son trapèze et vue d'en bas. La justification de ces 3 ou 4 secondes colorées n'est, à ce moment-là, pas encore accessible au spectateur. Et à la fin, en plein milieu de sa déclaration amoureuse en forme de long monologue, alors que la caméra la fixe depuis longtemps déjà de profil, face à Bruno Ganz, c'est le plan soudain très rapproché sur son visage, plan qui intensifie encore la séquence, qui fait la décision et qui engage pour de bon, qui provoque le contrechamp sur le partenaire et qui lie les deux êtres.
- Il n'y a pas film plus aérien. Pas seulement céleste, puisque la caméra a justement pour rôle de lier ciel et terre. Ces plans en mouvement sont d'une beauté encore impensable, donnant des images d'avant les drones qui rendent maintenant tout visible et tout possible. Et ces mouvements verticaux de liaison ne sont pas gratuits, qu'ils soient amples pour signaler la présence des anges dans les hauteurs ou plus modestes, à niveau d'acteur, pour traduire la tentation de Damiel de se rapprocher du sol en suivant la ligne imaginaire tracée par celle qui fait l'ange sur son trapèze, l'humaine qu'il peut regarder d'en bas.
- Elle reste extraordinaire cette segmentation des pensées, attrapées au vol. Leur collage crée le rythme poétique. Ainsi peut cheminer la langue de Peter Handke et se faire sans gêne le saut qualitatif de la parole pour chacun (un cran au-dessus pour tout le monde). Et si cela ne suffit pas à le justifier, il faut se dire que nous entendons ce que veulent bien entendre cette armée des anges.
- Lorsque la caméra passe de la salle de concert au bar et inversement, l'intensité du son varie ("logiquement", et pourtant on le remarque aussitôt). Ces allers-retours entre deux pièces, à travers une large porte ouverte, me fait penser au bar de l'hôtel Overlook de Shining. Le passage se fait sans rupture entre deux lumières, deux décors, deux ambiances différentes, et presque deux temps (Marion, dans son monologue, prend le temps de parler de toute sa vie et de son futur). Bien sûr, l'un des deux bars est plus sain que l'autre. Mais de toute façon, Nicholson était déjà fou avant d'y entrer, comme Ganz est déjà un homme amoureux. Dans les deux cas, il ne s'agit que de la cristallisation d'un état.
- Les anges voient le monde en noir et blanc, les humains en couleurs. Wenders a eu tout juste. Le noir et blanc, avec ses échelles de gris, est intemporel. L'image en couleurs vieillit, devient tout de suite datable. Elle donne immédiatement une idée de l'âge de l'objet, du corps, du vêtement (la veste bariolée choisie par Damiel devenu homme, mais pas encore "de goût"). C'est quand le film passe à la couleur que l'on sait qu'il est de 1987. De plus, le noir et blanc permet plus aisément le rapprochement d'époques différentes. Une image de désastre guerrier passé peut être collée sans hiatus à une autre, pacifiée et actuelle. Ainsi coule le fleuve de pensées des anges. En revanche, le temps présent des humains, lui, ne peut être qu'en couleurs périssables (l'archive en couleurs de 1945 est d'ailleurs la seule désignant quelqu'un avec précision : la femme qui secoue ses couettes de lit dans l'immeuble éventré).
- Il y a bien marqué au dernier plan : "À suivre". Wenders avait donc le droit de réaliser en 1993 Si loin, si proche !. Mais cette "suite" n'est rien, elle n'existe pas, elle a disparu de la mémoire. Les Ailes du désir se tiennent seules, film unique, le (l'un des) plus beau(x) du monde.
-
Pina

****
Dire tout d'abord que les images de la représentation du Sacre du printemps, telle qu'elle est filmée par Wim Wenders, ont constitué la plus stimulante expérience cinématographique qu'il m'ait été donné de vivre ces derniers mois.
C'est ainsi que débute Pina, le film hommage du cinéaste à la célèbre chorégraphe du Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch, décédée en 2009. Et déjà, d'une part, nous sommes plongés au cœur de l'art de la danse tel que l'a conçu cette femme, d'autre part, la pertinence du choix de la 3D éclate sous nos yeux. Le travail sur la profondeur et la netteté des contours des corps, des vêtements et des objets que permettent cette technique la rende particulièrement appropriée à la mise en scène d'un ballet, l'œil passant en effet du groupe au soliste, de l'arrière plan au devant, sans heurt, en captant la même intensité, en bénéficiant de la même définition. Nous pensons alors appréhender le mieux qu'il est possible ce qui se joue sur scène, en chaque endroit et à chaque moment.
Pina est organisé comme une succession de représentations au théâtre, de séquences dansées en extérieurs et de témoignages de danseurs (ainsi que de quelques images d'archives). A mon sens, la 3D selon Wenders n'est jamais aussi convaincante que lorsqu'elle investit un espace artificiel, celui de la scène, donc, avec son fond dépouillé, monochrome ou sans couleur. La 3D ne génère pas un surcroît de réalité, comme veut nous le faire avaler la publicité. Elle n'incite pas au toucher : s'il y avait caresse, le contact ne se ferait que sur une surface plane et lisse, une strate. Cette image est en effet constituée de couches successives, propriété qui renvoie au passé du cinéma et de la vidéo, aux superpositions diaboliques de Méliès, aux tentatives de films en relief, aux transparences hollywoodiennes classiques ou aux expériences d'un Zbigniew Rybczynzki. Wenders sait prendre en compte cette idée de trucage et s'en amuse au détour d'une séquence montrant une danseuse aux bras exagérément musclés ou d'une saynète autour d'une "maison de poupée".
Dans son art, Pina Bausch faisait bouger les lignes et tomber les frontières. Elle faisait, aussi, tomber les lignes : chez elle, les corps ne cessent de chuter, tout en continuant, même à terre, à danser. Wenders lui emboîte le pas. Ne se limitant pas à faire danser aux carrefours, dans le métro aérien ou près des cours d'eau, il cherche à travailler la géométrie des plans. Des cadrages se font au ras du sol, des plongées donnent le vertige, des images s'emboîtent les unes dans les autres, et toujours, grâce à la 3D, la profondeur est sondée. Les éléments du plan sont découpés si nettement, la séparation entre les couches est si visible, qu'il semble impossible de passer de l'une à l'autre. Et pourtant, avec fluidité, les corps voyagent dans cet espace sans effort, les points de références pour l'œil ne cessent de changer, provoquant parfois une étonnante perception des proportions. Les envols eux-mêmes s'en trouvent suspendus plus longuement, plus facilement. En extérieur, ces effets se ressentent avec moins d'évidence. Toutefois, voir danser la troupe hors les murs, ce n'est pas une manière de se frotter plus vigoureusement au réel. Quoi de plus irréel, en effet, que ces séquences là ? La danse, comme tout art, n'est qu'une image, une représentation, un reflet du réel.
Avec Pina, le cinéma s'occupe donc de la danse, avec les moyens qu'il faut mais sans se départir d'une agréable simplicité. Un écran de cinéma apparaît au fond de la scène, un projecteur, un chariot, des rails évoquent la machinerie du 7ème art. Des effets de montage, fusionnant plusieurs personnes en une seule lors de la pièce Kontakthof, permettent de visualiser ce qui ne pouvait l'être sur scène. Des lieux, des compositions, des gestes, font écho à d'anciens films de Wenders. Réjouissons-nous que tout cela soit débarrassé, miraculeusement, de la dimension moralisatrice accompagnant souvent les réflexions habituelles du cinéaste sur les images.
La lourdeur d'une chape, il est certes possible de la ressentir à un autre niveau. Les propos tenus par les danseurs, dans des inserts brisant parfois de façon gênante l'élan des séquences de ballet, paraissent dans un premier temps trop exclusivement flatteurs envers la disparue. Ces interventions ne semblent guère permettre de mettre en valeur autre chose que le regard perçant de la chorégraphe et sa capacité à révéler ses danseurs à eux-même, deux qualités rappelées ici à l'envi. Mais on peut voir ces séquences d'un autre œil et les entendre d'une autre oreille. Tout d'abord, Wenders ne s'en sert pas dans un but didactique. Son film n'est pas une leçon d'histoire de l'art, il donne simplement à voir la singularité de l'œuvre de Pina Bausch. Les bouleversements qu'elle a provoqué sont sur l'écran et il n'est pas utile qu'un commentaire vienne nous rappeler le travail radical sur le corps, les vêtements et le décor. Les phrases que prononcent les danseurs ne sonnent donc pas comme des explications, mais comme des messages. Pina est un tombeau, au sens du poème écrit pour un défunt. Il y a un côté fiction dans ces intermèdes, ces mots étant visiblement mûrement choisis et écrits. De plus, ces femmes et ces hommes sont présentés de la même manière, en train de prendre la pose, leur parole ne venant qu'en off, comme en pensée. Filmés ainsi, ils ressemblent aux anges des Ailes du désir. Non nommés, ils forment une sorte d'armée ailée au service de la déesse Pina.
Depuis vingt ans, Wim Wenders traversait le cinéma en fantôme. En disparaissant, Pina Bausch l'a fait renaître.
 PINA
PINAde Wim Wenders
(Allemagne - France - Grande-Bretagne / 106 mn / 2011)
-
C'était mieux avant... (Septembre 1984)
Fini l'été. Il est grand temps de reprendre notre voyage mensuel dans le temps. Et hop, direction les salles de cinéma françaises au mois de Septembre 1984 :
Après s'être débarassés de leurs fonds de tiroir, la période estivale étant encore, à cette époque, jugée trop risquée pour sortir les titres les plus ambitieux, les distributeurs lâchent enfin les chevaux.
 Jugez-en plutôt : en cette rentrée 84, débarquent sur les écrans L'affamée du plaisir (Sam Corey), Assistantes sexuelles (Philip Drexler Jr.), Commando spécial pour sodomisations (Jacques Courtenay), Les cuisses en l'air (Tony Reed), Demoiselles à prendre par derrière (Jeremy Silver), Initiation pour une pucelle (Oliver Mato), Journal intime d'une nymphomane (Gérard Kikoine), Les orgies du Comte Porno (Joanna Morgan), Partouzes spéciales pour lesbiennes (Jacques Courtenay), Petites mains à tout faire (Léon Gucci), Sensual progression (Joanna Morgan encore) et Rosalie ou la débauche d'une adolescence (Michel Leblanc, avec, humm..., Olinka).
Jugez-en plutôt : en cette rentrée 84, débarquent sur les écrans L'affamée du plaisir (Sam Corey), Assistantes sexuelles (Philip Drexler Jr.), Commando spécial pour sodomisations (Jacques Courtenay), Les cuisses en l'air (Tony Reed), Demoiselles à prendre par derrière (Jeremy Silver), Initiation pour une pucelle (Oliver Mato), Journal intime d'une nymphomane (Gérard Kikoine), Les orgies du Comte Porno (Joanna Morgan), Partouzes spéciales pour lesbiennes (Jacques Courtenay), Petites mains à tout faire (Léon Gucci), Sensual progression (Joanna Morgan encore) et Rosalie ou la débauche d'une adolescence (Michel Leblanc, avec, humm..., Olinka).A part ça, quelques films d'auteurs :
La sortie de Paris, Texas marque la première apothéose publique (700 000 entrées sur Paris, à peine moins que Les Morfalous), critique (voir plus bas) et corporatiste (Palme d'or à Cannes) de Wim Wenders, en attendant Les ailes du désir. Appâté par la majesté des images de Robby Müller magnifiant la marche d'Harry Dean Stanton sous l'oeil des vautours et par la guitare de Ry Cooder, l'apprenti-cinéphile se trouvait quelque peu désarçonné par la suite, série de longues scènes où le cadre se rétrécissait à la mesure d'une cabine de peep-show et où la musique cédait la place à la confession. Désarçonné mais bouleversé au point de vouloir ensuite remonter le cours du temps pour mieux connaître ce nouvel ami allemand (qui ne l'était déjà plus beaucoup).
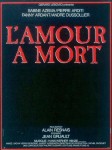 Quelques mois seulement après La vie est un roman (l'un des deux seuls films du réalisateur de Marienbad qui me laisse de marbre), un nouveau Resnais s'offrait à nous : L'amour à mort. Souvenir d'un beau film de chambre douloureux, intense et cependant moins ancré dans la mémoire que Mon oncle d'amérique ou Mélo. Autre grand nom au programme, celui de John Huston. Au-dessous du volcan, découvert quelques années après sa sortie, m'avait plutôt secoué avant qu'une récente révision me le fasse reculer d'un petit cran. Toujours au rayon "Auteurs", nous trouvions Le futur est femme, nouvelle fable signée Marco Ferreri, avec Ornella Mutti et Hanna Schygulla et Hotel New Hampshire du vigoureux Tony Richardson, avec Jodie Foster, Beau Bridges, Rob Lowe et la même Nastassja Kinski que chez Wenders. Ils m'ont échappé l'un comme l'autre.
Quelques mois seulement après La vie est un roman (l'un des deux seuls films du réalisateur de Marienbad qui me laisse de marbre), un nouveau Resnais s'offrait à nous : L'amour à mort. Souvenir d'un beau film de chambre douloureux, intense et cependant moins ancré dans la mémoire que Mon oncle d'amérique ou Mélo. Autre grand nom au programme, celui de John Huston. Au-dessous du volcan, découvert quelques années après sa sortie, m'avait plutôt secoué avant qu'une récente révision me le fasse reculer d'un petit cran. Toujours au rayon "Auteurs", nous trouvions Le futur est femme, nouvelle fable signée Marco Ferreri, avec Ornella Mutti et Hanna Schygulla et Hotel New Hampshire du vigoureux Tony Richardson, avec Jodie Foster, Beau Bridges, Rob Lowe et la même Nastassja Kinski que chez Wenders. Ils m'ont échappé l'un comme l'autre.Bien, mais qu'ai-je donc réellement vu en salles à cette époque-là, du haut de mes presque treize ans ? Tout d'abord des comédies. Police Academy (premier volet, par Hugh Wilson) nous avait beaucoup fait rigoler. Il y a peu de chances pour que cela se reproduise. En revanche, le Top secret ! des ZAZ (Zucker/Abrahams/Zucker), parodie d'espionnage délirante, avec le sémillant Val Kilmer et un Omar Sharif qui finit concassé, doit bien faire marrer aujourd'hui encore (avouez-le, vous n'avez pas pu vous empêcher de jeter un oeil sur Arte l'autre soir, à l'occasion de sa rediffusion... moi, j'avais ciné).
 La grande affaire du mois, c'était le retour de l'homme au fouet et au chapeau. Indiana Jones et le temple maudit (Steven Spielberg) comblait l'ado peu regardant, tout en lui faisant sentir que quelque chose clochait (un peu long ce rituel sanglant, non ?). Peu de temps après, ce petit quelque chose se transformait dans notre esprit en gros ratage et renvoyait cet épisode six pieds sous terre en comparaison des volets 1 et 3. Avec Les Ripoux, Claude Zidi, qui sortait quand même, il faut le rappeler, des Sous-doués en vacances et de Banzaï, surprenait tout son monde en filmant avec une verve inattendue les magouilles de flics de Noiret et Lhermitte. Résultat : un triomphe au box-office. Vus également : Le meilleur de Barry Levinson, ou Robert Redford au pays du baseball, et Le moment de vérité (The Karaté Kid en VO) d'un John G. Avildsen en manque de Rocky, avec Ralph Macchio et Noriyuki "Pat" Morita (comment qu't'as la chair de poule à la fin quand Ralph y'fait le coup d'la cigogne avec sa jambe cassée !).
La grande affaire du mois, c'était le retour de l'homme au fouet et au chapeau. Indiana Jones et le temple maudit (Steven Spielberg) comblait l'ado peu regardant, tout en lui faisant sentir que quelque chose clochait (un peu long ce rituel sanglant, non ?). Peu de temps après, ce petit quelque chose se transformait dans notre esprit en gros ratage et renvoyait cet épisode six pieds sous terre en comparaison des volets 1 et 3. Avec Les Ripoux, Claude Zidi, qui sortait quand même, il faut le rappeler, des Sous-doués en vacances et de Banzaï, surprenait tout son monde en filmant avec une verve inattendue les magouilles de flics de Noiret et Lhermitte. Résultat : un triomphe au box-office. Vus également : Le meilleur de Barry Levinson, ou Robert Redford au pays du baseball, et Le moment de vérité (The Karaté Kid en VO) d'un John G. Avildsen en manque de Rocky, avec Ralph Macchio et Noriyuki "Pat" Morita (comment qu't'as la chair de poule à la fin quand Ralph y'fait le coup d'la cigogne avec sa jambe cassée !).Étrangement, l'heure était aux remakes américains de films européens. Avec Besoin d'amour, Jerry Schatzberg refaisait, en compagnie de Gene Hackman, L'incompris de Luigi Comencini (on nous dit que c'est moins bon que l'original). Avec La fille en rouge, Gene Wilder refaisait, en compagnie de lui-même, Un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert (on nous dit que c'est kif-kif). Et avec C'est la faute à Rio, Stanley Donen refaisait, en compagnie de Michael Caine, Un moment d'égarement de Claude Berri (on nous dit que c'est meilleur).
 Autres titres du mois, plus ou moins attirants : Le Tartuffe première réalisation de Gérard Depardieu, Souvenirs souvenirs d'Ariel Zeïtoun avec les yéyés Christophe Malavoy et Pierre-Loup Rajot, Journal intime, film politique hongrois de la réputée Marta Meszaros, Jazz band de Karen Chakhnazarov (du jazz dans la Russie des années 20), La garce, étrange projet de Christine Pascal, avec Isabelle Huppert et Richard Berry, L'intrus d'Irène Jouannet avec Marie Dubois et Richard Anconina, Le voyage (de l'espionnage exotique par Michel Andrieu), Anou Banou, les filles de l'utopie (d'Edna Politi, documentaire sur l'histoire d'Israël vue par les femmes). Notons également que Carole Laure Stress (Jean-Louis Bertuccelli), que Sandrine Bonnaire Tir à vue (Marc Angelo) et que Miou-Miou et Souchon prennent Le vol du Sphinx (Laurent Ferrier). Enfin, n'oublions pas, outre les hong-kongueries habituelles (Ceinture rouge contre dragon blanc de Chen Hung Min, Les cinq foudroyants de Shaolin de Godfrey Ho, Les deux cavaliers de Shaolin de Yang Ching Chen et Les vengeurs du kung fu de Philip Chan), les improbables 2020 Texas gladiators (italien de Kevin Mancuso), L'homme coriace (blaxplotation de Cliff Roquemore), Pris au piège (de l'aventure dans la jungle, par Gus Trikonis), et l'alléchant Rock Zombies (ou plus précisément Hard Rock Zombies, titre original de ce film de Krishna Shah, qui semble basé sur une histoire pleine... de rock et de zombies).
Autres titres du mois, plus ou moins attirants : Le Tartuffe première réalisation de Gérard Depardieu, Souvenirs souvenirs d'Ariel Zeïtoun avec les yéyés Christophe Malavoy et Pierre-Loup Rajot, Journal intime, film politique hongrois de la réputée Marta Meszaros, Jazz band de Karen Chakhnazarov (du jazz dans la Russie des années 20), La garce, étrange projet de Christine Pascal, avec Isabelle Huppert et Richard Berry, L'intrus d'Irène Jouannet avec Marie Dubois et Richard Anconina, Le voyage (de l'espionnage exotique par Michel Andrieu), Anou Banou, les filles de l'utopie (d'Edna Politi, documentaire sur l'histoire d'Israël vue par les femmes). Notons également que Carole Laure Stress (Jean-Louis Bertuccelli), que Sandrine Bonnaire Tir à vue (Marc Angelo) et que Miou-Miou et Souchon prennent Le vol du Sphinx (Laurent Ferrier). Enfin, n'oublions pas, outre les hong-kongueries habituelles (Ceinture rouge contre dragon blanc de Chen Hung Min, Les cinq foudroyants de Shaolin de Godfrey Ho, Les deux cavaliers de Shaolin de Yang Ching Chen et Les vengeurs du kung fu de Philip Chan), les improbables 2020 Texas gladiators (italien de Kevin Mancuso), L'homme coriace (blaxplotation de Cliff Roquemore), Pris au piège (de l'aventure dans la jungle, par Gus Trikonis), et l'alléchant Rock Zombies (ou plus précisément Hard Rock Zombies, titre original de ce film de Krishna Shah, qui semble basé sur une histoire pleine... de rock et de zombies).Du côté de la presse spécialisée, on tend vers l'unanimité. Compte tenu du fait que Starfix (18) et L'Écran Fantastique (48) peuvent difficilement mettre en couverture la Palme d'or (on y trouve plutôt, respectivement, Sting, dans l'attente de la sortie de Dune, et Harrison Ford en Indiana Jones) et que Première (90) reste fidèle à sa politique des stars, en gratifiant ses lecteurs d'un portrait de Richard Berry en débardeur, seul Cinématographe (103) se distingue vraiment en fêtant Alain Delon. Car en effet, de Positif (283) à Cinéma 84 (309), en passant par La Revue du Cinéma (397), tous choisissent Paris, Texas. Et si vous me dîtes : "Comme par hasard, tu oublies de signaler que les Cahiers du Cinéma (363) prennent le risque de publier un numéro spécial Cinéma de Hong-Kong", je vous répondrai : "Evidemment puisque le Wenders, ils l'avaient déjà choisi pour leur numéro de juin. Faudrait suivre un peu !".
Voilà pour septembre 1984. La suite le mois prochain...
-
Mets donc un disque, qu'on se repose
Nightswimming is on Pause...
...pour une dizaine de jours.
Puisque, cette année, je vous entraîne mensuellement vers les lointains rivages temporels de 1984, je vous propose, pour meubler agréablement la parenthèse, de jeter une oreille sur cette playlist concoctée par mes soins et estampillée nineteen eighty-four :
Découvrez Cocteau Twins!Et comme en septembre prochain, pour évoquer la rentrée 84, il faudra forcément parler du film ayant mêlé le mieux, en ce temps-là, images et musique, pourquoi ne pas s'y replonger un peu :
-
Don't come knocking
(Wim Wenders / Etats-Unis / 2005)
□□□□
 La semaine dernière, je posais la question "Êtes-vous Wendersien ?". Or il se trouve que Arte a diffusé ce jeudi soir Don't come knockingqui, présenté à Cannes en 2005 était passé chez pas mal de gens pour le film du grand retour du cinéaste. Cependant, j'ai du mal à écrire que le hasard fait bien les choses tant ces deux heures de chromos furent pénibles pour moi. Je n'en appellerai pas cruellement au passé de Wenders. Je n'utiliserai pas non plus l'ironie pour le démonter (bien que ce Ne viens pas faire toc-toc le mériterait). Je me bornerai à dire calmement quel mauvais film nous avons là.
La semaine dernière, je posais la question "Êtes-vous Wendersien ?". Or il se trouve que Arte a diffusé ce jeudi soir Don't come knockingqui, présenté à Cannes en 2005 était passé chez pas mal de gens pour le film du grand retour du cinéaste. Cependant, j'ai du mal à écrire que le hasard fait bien les choses tant ces deux heures de chromos furent pénibles pour moi. Je n'en appellerai pas cruellement au passé de Wenders. Je n'utiliserai pas non plus l'ironie pour le démonter (bien que ce Ne viens pas faire toc-toc le mériterait). Je me bornerai à dire calmement quel mauvais film nous avons là.Dès le départ, avec ce cow-boy qui s'échappe à cheval d'un tournage en plein désert, on sent que ça ne va pas aller : ces images léchées, ce portait rabattu d'une équipe de cinéma au travail, ces silhouettes stéréotypées, cet humour qui se force à paraître incongru... Le premier quart d'heure est une catastrophe et les choses ne s'arrangent guère par la suite. La faute en incombe autant à Wenders qu'à Sam Shepard qui signe un scénario sans intérêt particulier et qui joue sur une seule note son rôle d'acteur vieillissant. Ce Howard Spence, ancienne gloire revenue de tous les excès, décide de tout plaquer, de se délester de son attirail de cow boy de pacotille et de ses cartes de crédit. Et tout ça pour quoi ? Pour aller voir sa mère, laquelle était restée sans nouvelle de lui depuis trente ans. Celle-ci en profite pour lui annoncer qu'il est père depuis longtemps. Il se dirige donc vers le Montana à la rencontre de son fils et de la femme qu'il a aimé brièvement, des années auparavant.
Si cette quête relance un tantinet la machine, l'émotion qu'elle est censée provoquer, grâce aux retrouvailles à l'écran de Sam Shepard et Jessica Lange, n'advient jamais. Certaines scènes sont d'ailleurs assez pathétiques puisque Wenders cherche à jouer sur plusieurs tableaux (voir la crise que pique Jessica Lange dans la rue, en disant à Shepard ses quatre vérités... le tout sous les yeux de deux culturistes en train de faire leur gym). C'est que le cinéaste veut faire un film décalé. Mais si Wenders était le roi de la rigolade, ça se saurait. Toutes ses tentatives tombent à plat et les seules qui marchent un petit peu (comme le personnage mono-maniaque de détective pour assurances, joué par Tim Roth) semblent copiées sur l'absurde de Lynch ou des frères Coen.
Tout est enrobé de nostalgie, rien n'a de prise sur une quelconque réalité. Nous n'avons qu'une série de vignettes décalées, où la mise en scène se réduit à des touches bariolées, humoristico-poético-gnan-gnan, dénuées de toute rigueur dans la narration ou les dialogues, du niveau disons d'un Klapisch ou d'un Besson période Subway. Le regard porté sur les plus jeunes a la couleur de la guimauve (passant par exemple totalement à côté du potentiel émotionnel et énigmatique que portait le personnage angélique interprété par Sarah Polley).
D'accord, Wim Wenders sait encore comment bien placer deux ou trois accords de guitare pour amorcer une séquence, filmer un batiment dans un cadrage-hommage à Hopper ou faire ressentir l'agressivité lumineuse d'un casino, mais cela s'arrête là. Ah si, Don't come knocking a pour moi un avantage : me rappeler combien était agréable la balade sur le même thème paternel du Broken flowersde Jarmusch (héritier officiel de Wenders) et me faire dire que finalement le récent voyage au pays des néons proposé par Wong Kar-wai (héritier officieux) dans My blueberry nights n'était pas si mal.
-
Êtes-vous Wendersien(ne) ?
 Wim Wenders est présent cette année encore au Festival de Cannes, en sélection officielle. L'arrivée d'un nouveau film du cinéaste suscite à peu près autant d'espoir et d'enthousiasme qu'un congrès du PS ou la participation d'une équipe française au deuxième tour de la Champions League. Pendant une quinzaine d'années pourtant, Wenders y était, lui, sur le toit de l'Europe.
Wim Wenders est présent cette année encore au Festival de Cannes, en sélection officielle. L'arrivée d'un nouveau film du cinéaste suscite à peu près autant d'espoir et d'enthousiasme qu'un congrès du PS ou la participation d'une équipe française au deuxième tour de la Champions League. Pendant une quinzaine d'années pourtant, Wenders y était, lui, sur le toit de l'Europe.Découvrir à 15 ans Les ailes du désiralors que l'on ne connaît que la ligne Besson/Parker prônée par Studio et Premièreprovoque une sacrée remise en question. Les anges de Wenders me poussèrent alors à remonter le temps, vers ce nouveau cinéma allemand de l'époque. De cette période, pendant laquelle le regard du cinéaste, bien avant Paris, texas, était déjà tourné vers les Etats-Unis, je mets au plus haut L'ami américain. En 67, Boorman avec Le point de non retourfaisait un grand polar américain à l'européenne. Dix ans plus tard, Wenders fit un grand polar européen à l'américaine.
Malheureusement, en allant dans l'autre sens, passé le projet mégalo de Jusqu'au bout du monde, mené à terme tant bien que mal, les choses se sont vite gâtées jusqu'à me laisser indifférent. Parallèlement, le discours posé et pertinent du cinéaste devenait barbant et aigri. Exceptées quelques révisions, je n'ai donc pas vu de film de Wenders depuis 8 ou 9 ans.
Voici mes préférences :
**** : L'ami américain (1977), Paris, Texas (1984), Les ailes du désir (1987)
*** : Alice dans les villes (1973), Au fil du temps (1976), L'état des choses (1982), Jusqu'au bout du monde (1991)
** : Hammett (1982), Lisbonne Story (1994), Buena Vista Social Club (1999)
* : Si loin, si proche (1993)
o : Million Dollar Hotel (2000)
Vus il y a trop longtemps : L'angoisse du gardien de but au moment du penalty (1971), Faux mouvement (1975)
Pas vus : Summer in the city (1971), La lettre écarlate (1972), Nick's movie (1979), Arisha (1994), The end of violence (1997), Land of plenty (2004), Don't come knocking (2006) et ses autres documentaires
N'hésitez pas à apporter vos commentaires (et à me dire si je dois m'y remettre)...