(un programme diffusé en son temps par Le Cinéma de Minuit)
The battle (1911, 19 min) ****

Une des méthodes qu'utilise Griffith pour s'affranchir de la contraignante présentation en tableaux indépendants qui caractérise le cinéma des premiers temps, c'est le prolongement, grâce au découpage (et à un cadrage très précis), de ces tableaux par les bords. Par un bord, plus exactement. Les plans s'assemblent ainsi les uns aux autres. C'est flagrant, presque schématique, ici. Dans la pièce principale de la maison de The battle se trouve l'héroïne et y entrent des soldats blessés cherchant un abri. A droite, une porte s'ouvre sur l'extérieur. De l'autre côté, on passe sur la terrasse en bois qui délimite à la fois l'entrée de la maison et le début du champ de bataille. Les axes et les échelles de plans sont toujours les mêmes et nous avons donc bien à gauche de la collure du plan l'intérieur et à droite l'extérieur. L'organisation de l'espace est claire, visant à la compréhension immédiate du spectateur.
Le découpage fait penser à la pliure d'un livre ou mieux, d'un dépliant, car Griffith propose plus que deux volets. L'espace se prolonge en effet au-delà du mur servant de charnière aux plans (charnière très visible, mécanique, grinçante : peu à peu, au fil des films, Griffith va huiler tout ça). "Sur la droite", le champ de bataille s'étend assez loin. La ligne de front où combattent sudistes et nordistes est vue sous deux ou trois angles différents et même quelques coups d'éclats sont décrits à proximité du lieu.
Cependant, la vision reste plutôt étroite, pas assez étendue en tout cas pour, à nos yeux d'aujourd'hui, englober la guerre. Le dispositif filmique est trop simple, comme l'est l'interprétation d'ensemble. Les acteurs principaux et les figurants montrent bien qu'ils sont tourmentés, qu'ils meurent ou qu'ils sont blessés, se tournant par exemple face à la caméra lorsqu'ils sont atteints par les balles de l'ennemi. De plus, le scénario est convenu : le jeune soldat couard, pris de panique lors de son baptême du feu, se ridiculise aux yeux de sa belle avant d'effectuer un acte de bravoure qui décidera du sort de la bataille. Tout de même, le rythme est des plus vifs, réglé comme du papier à musique.
One is business, the other crime (1912, 15 min) ****

Le fonctionnement par "volets", qui atténue sérieusement la force de The battle, constitue l'attrait, le principe même, très réfléchi, de One is business, the other crime. Deux couples nous sont présentés : l'un riche, l'autre pauvre. S'opposent misère et bonne société, et, bientôt, vol et... corruption. Car l'ouvrier ne vaut pas moins que le grand bourgeois, il n'est pas plus condamnable, au contraire dira-t-on. Griffith traite de la réconciliation possible, de la tolérance, de l'entraide, l'homme riche donnant finalement du travail au pauvre qui a tenté de le voler.
Le découpage tient ici de l'effet de miroir. Les pauvres sont montrés dans leur petit appartement avec fenêtre à rideaux sur la droite. Les riches le sont dans leur vaste salon avec de grandes ouvertures sur la gauche. Et nous passons sans cesse d'un lieu à l'autre. Le dispositif garde son évidence mais apparaît moins rigide, l'éloignement entre les deux habitations permettant l'insertion de plans de rues intermédiaires. Ceci va de pair évidemment avec l'usage du montage parallèle qui montre deux actions simultanées et qui précisément ici permet de faire tenir ensemble dans l'espace du film deux pièces de la belle demeure : le salon où s'introduit le voleur et la chambre à coucher depuis laquelle la femme seule entend ce dernier, s'empare d'un revolver et s'en va le surprendre.
Death's marathon (1913, 17 min) ****

On sait que chez Griffith, le montage parallèle est souvent associé au "sauvetage de dernière minute". L'usage du procédé est déjà assez complexe dans Death's marathon, au cours d'un final qui relève l'intérêt un peu faible de la première partie de ce film. L'histoire est celle d'une rivalité amoureuse entre collègues qui restent loyaux, et de la dérive du "gagnant" jusqu'au suicide que l'autre essaye d'éviter. La dernière séquence (avant l'épilogue) distribue trois espaces : le bureau où s'est retranché le désespéré, sa maison où sa femme le retient par téléphone interposé, et, entre les deux, les lieux traversés à toute allure par son ami décidé à le sauver.
Le téléphone est un véritable objet dramatique et "suspensif", ici admirablement utilisé. Y passe toute l'émotion, intense, de la scène (on fait s'exprimer le bébé pour que le père, au bout de fil, n'appuie pas sur la gâchette) et c'est à travers lui que la femme entendra le coup de feu si redouté. Car non, en effet, chez Griffith, le sauvetage ne réussit pas toujours ! Cela, on ne le sait pas forcément et la surprise est grande devant ce dénouement dramatique, à peine atténué par la formation d'un nouveau couple. C'est que, ayant établi ce modèle de figure cinématographique, Griffith veut en jouer à loisir pour mieux surprendre son spectateur.
The miser's heart (1911, 18 min) ****

Lorsque le temps est ainsi étiré par la mise en scène, la cruauté peut s'installer d'autant mieux. Il faut voir celle dont font preuve les malfrats de Miser's heart pour obtenir le code du coffre fort où un vieil avare garde ses pièces. Ils n'hésitent aucunement à suspendre dans le vide une fillette venant de sympathiser avec ce dernier et, pire encore, à placer une bougie sous la corde retenant la gamine afin qu'elle se consume progressivement sous les yeux de leur prisonnier. Ce qui est très fort ici, et efficace narrativement, c'est que Griffith montre l'émergence de l'idée dans la tête du gangster, les étapes de sa réflexion.
Esthétiquement, les "volets" se dépliant et se rabattant dominent encore dans The miser's heart, mais l'échelle semble plus grande, laissant observer, vraiment, un quartier. Partant d'un plus petit sujet, de l'écriture d'une chronique sociale passant par le fait divers, on aboutit, par rapport à la guerre de sécession de The Battle, à une œuvre paradoxalement plus ample. L'espace y est mieux parcouru, les caractères y sont mieux dessinés, la palette comportementale y est plus riche, le regard y est plus proche. Tout paraît plus spontané, moins appuyé.
The musketeers of Pig Alley (1912, 17 min) ****

Mais, notamment en termes de jeu d'acteurs, dans cet ensemble de courts métrages griffithiens, voici venu le pic, l'éclair, la brûlure. The musketeers of Pig Alley est seulement le quatrième film de Lillian Gish (les trois premiers étant aussi des Griffith, réalisés cette même année 1912). Pourtant, dès sa première apparition, elle irradie par son extraordinaire capacité à préserver son naturel, à vivre la scène quand tant d'autres à l'époque, y compris chez Griffith, miment et jouent la comédie. Chaque geste et chaque regard de Mademoiselle Gish sonne juste et émeut par sa précision, sa vérité, sa grâce. Pour autant, la fameuse thématique de l'innocence en danger n'a que faire ici et on se rend compte que l'œuvre du cinéaste ne se réduit pas à cela non plus. Dans The musketeers, Lillian Gish épate par sa façon de tenir tête au gangster qui la courtise. Douce et attentionnée avec son homme, musicien les poches vides, elle devient sèche et inflexible face au mauvais garçon jusqu'à lui décocher une fulgurante et jolie baffe dans la poire. Elle figure finalement le rempart du couple.
Ce court est l'un des Griffith les plus célèbres. Plusieurs atouts ont contribué à sa pérennité, en plus de la présence de la géniale actrice. La légende le présente comme le premier film policier ou criminel. Si c'est certainement abusif d'un point de vue strictement historique, ça ne l'est plus si l'on parle esthétique et naissance du mythe. Griffith présente une histoire de gangsters dans un quartier chaud de New York. Suivant avec autant de plaisir le bad guy que le couple positif, il montre une véritable jungle urbaine, un pullulement de pauvres gens et de voleurs dans des rues étroites. Le format de l'image et le retour à l'écran de certains lieux toujours cadrés de la même façon rendent ce monde étouffant et les trajectoires qui s'y dessinent pré-déterminées. Cependant, ce n'est plus une contrainte subie, c'est une organisation, un dispositif très pensé, destiné à diriger les protagonistes avec la précision d'un maître de ballet.
Cet arpentage donne naissance à une formidable séquence au cours de laquelle deux gangs se suivent l'un l'autre à travers les ruelles, rasant avec précaution les murs de briques. C'est une poursuite au ralenti, une approche quasi-animale, pendant laquelle le temps se dilate avant l'explosion, l'échange de tirs en une poignée de secondes et quelques nuages de fumée. Ce double rythme, on le retrouvera ensuite partout jusque dans les plus modernes de nos polars.
La séquence contient un plan iconique ayant lui aussi beaucoup fait pour la réputation du film. Celui de Snapper Kid (personnage excellemment "typé" par Elmer Booth), devançant deux acolytes, remontant vers nous le long d'un mur depuis le fond de l'image jusqu'au gros plan. Griffith a fait une nouvelle conquête : la profondeur, la transversalité. L'espace ne se parcourt plus uniquement dans deux dimensions, les gangsters, le plus souvent, s'avancent, s'enfoncent dans la foule. L'espace s'élargit encore.
Ce gros plan sur le visage d'Elmer Booth n'est pas une invention cinématographique. Griffith n'a pas tout trouvé tout seul. Mais il est sans doute celui qui parvient alors à rendre ces trouvailles visuelles plus efficaces, à les insérer au mieux dans le récit, à s'en servir pour enrichir et exacerber l'expression. De là vient le sentiment d'assister à la naissance d'un langage, à une articulation nouvelle.
The massacre (1914, 30 min) ****

L'image forte s'élevant au symbolique tout en restant parfaitement maintenue par la narration, on la trouve à nouveau dans The massacre, fresque westernienne réalisée trois ans après The battle, avec quel souffle supplémentaire ! Dans la dernière partie, les membres d'un convoi sont attaqués et encerclés par des indiens. Parmi eux, l'héroïne tient fiévreusement son bébé dans les bras. Des coups de feu sont tirés en tous sens, les corps tombent un à un. Au cœur de la séquence, un plan se signale effrontément : on y voit le visage apeuré de la jeune femme, à droite un pistolet qui vise le hors-champ, à gauche une main tenant une bible et, derrière, l'agitation.
Le groupe est donc encerclé. La conquête de l'espace par Griffith se poursuit : ici, le cercle. Certes, la caméra ne tourne pas sur des rails mais elle s'éloigne et peut alors embrasser les vastes paysages, observer les courbes et les lignes droites que les chevauchées provoquent. On est définitivement débarrassé de l'exiguïté et de la frontalité de The battle.
Après un prologue classique dans son alternance entre intérieur et extérieur et dans sa présentation d'un triangle amoureux, le film prend son envol avec l'attaque sauvage d'un campement indien. Et oui, l'ultime massacre évoqué plus haut est une vengeance... Le premier agresseur est l'armée et la description de son action est ponctuée par un plan saisissant, jeté avec une insistance inhabituelle. Inhabituelle parce qu'il ne s'y passe rien. On y voit "seulement" des braises volantes et un chien errant autour du corps d'une jeune indienne et de celui de son bébé resté sur elle. "Massacre" serait donc à mettre au pluriel, le second répondant au premier.
Sur le plan de la morale griffithienne, la vision de ces courts métrages confirme une chose : Naissance d'une nation fut bel et bien une étonnante aberration. La façon dont sont traités les Noirs dans ce célèbre film devient effectivement incompréhensible en voyant comment apparaissent les nobles indiens dans The massacre, comment l'union des bonnes volontés se réalise dans One is business, comment la rédemption de l'avare ou de l'ancien voleur devient possible dans The miser's heart et comment le système est le premier responsable du pourrissement des valeurs dans The Musketeers.


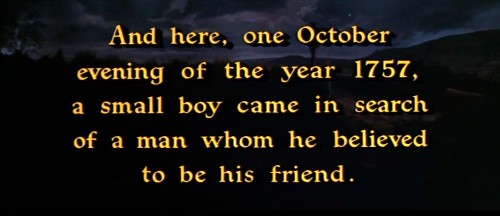



















 DES MONSTRES ATTAQUENT LA VILLE (Them !)
DES MONSTRES ATTAQUENT LA VILLE (Them !)