


****/****/****
Le génie de Kelly, la maîtrise de Donen, la pertinence de Comden et Green (au scénario)... Inutile d'insister sur tout cela. Mais en revoyant Chantons sous la pluie pour là énième fois, je me suis surtout dit que ce qui le rendait décidément inaltérable, c'était son double statut d'œuvre divertissante et réflexive. Le rêve hollywoodien est ici réalisé dans le sens où le spectateur, quelque soit son âge, sa culture, son humeur et son niveau de lecture, est accueilli avec la même grâce. Car ce film porte en lui son propre commentaire, tout en nous laissant libres de le lire ou pas. Gene Kelly cherche d'emblée la connivence, entrant dans le champ avec un sourire ostensiblement affiché et nous réservant, à nous seul, la vérité sur le parcours de son personnage, grâce à l'insertion d'images contredisant les propos tenus face à ses fans. Comme ils le font de l'opposition entre bons et mauvais acteurs, les auteurs s'amusent de celle existant entre "culture de masse" et "haute culture", l'intégrant à une écriture du comique qui repose notamment sur la gêne (ressort classique dans la comédie hollywoodienne, qui, ici, n'est jamais activé contre les personnages puisque le dépassement de cette gêne est aussi donné à voir, comme le montre la séquence de la fête dans laquelle Debbie Reynolds sort du gâteau et découvre dans l'assistance Gene Kelly, qu'elle vient de rencontrer et de rabrouer pour la vulgarité de son art : désarçonnée, elle se donne pourtant à fond jusqu'au terme de son numéro de music hall un peu nunuche).
Quand nous pouvons savourer la réflexion sur le genre et l'approche historique précise, d'autres, les plus jeunes par exemple, peuvent profiter du caractère instructif du spectacle. Derrière les frasques des stars, se discerne l'hommage aux artistes et techniciens de l'ombre (dans le duo Don Lockwood - Cosmo Brown, soit Gene Kelly - Donald O'Connor, c'est bien le moins célèbre des deux, le compositeur, qui trouve généralement les solutions aux problèmes artistiques). De même, toute la machinerie du septième art est exposée, à l'occasion bien sûr de la déclaration d'amour chantée dans le studio désert mais figurant bientôt un extérieur au clair de lune magique ou encore de la balade des deux amis qui les fait passer devant plusieurs plateaux où se tournent des films de série. Par conséquent, un peu plus tard, lorsque se fait le numéro Good morning dans la maison de Don Lockwood, celle-ci apparaît comme un pur décor, avec ce faux mur de cuisine à travers lequel passe la caméra et une chute finale sur un canapé, accessoire utilisé peu de temps auparavant pour le Make 'em laugh d'O'Connor dans le studio de cinéma.
La dernière partie du film est toujours aussi éblouissante. Peu après le fameux numéro-titre (quelles admirables variations de rythme !), vient le morceau de bravoure Broadway melody, merveilleusement détaché du reste du récit, illustration d'une idée que Don Lockwood explique à son producteur (celui-ci ayant du mal à la "visualiser" et décidant probablement de ne pas en tenir compte pour le film en cours de réalisation). La (seconde) première du film dans le film est l'occasion de dénouer l'intrigue. Kelly et Donen tirent alors un parti admirable du lieu tout en rendant un nouvel hommage au music hall. Et enfin, Don Lockwood rattrape Kathy Selden, le chant et la musique reviennent, le spectacle descend dans la salle, le cinéma est partout. Debbie Reynolds se retourne brusquement vers Gene Kelly et son visage en larmes bouleverse, que l'on soit n'importe quel type de spectateur...
De Donen à Oury et de Kelly à Montand, la chute s'annonçait rude, mais elle fut quelque peu amortie. Le corniaud était, dans mon souvenir, meilleur que ce qu'il est réellement. Avec La folie des grandeurs, la modification de mon jugement se fait dans le sens inverse. Alors que je m'attendais à revoir une œuvre médiocre, je me suis retrouvé devant une comédie assez agréable, pas loin d'être une vraie réussite.
Inspiré du Ruy Blas de Victor Hugo, le scénario fait preuve de consistance et ménage de plaisants rebondissements. Ainsi, bien campés sur leurs jambes, les auteurs du film peuvent glisser des anachronismes de langage ou de comportement, des pointes d'absurde, du comique plus distancié que d'ordinaire (les apartés que nous réserve Montand, la lecture de la lettre qui se transforme en dialogue avec une voix off, les clins d'œil au western italien). Les gags sont nombreux et atteignent souvent leur but.
Le film a, de plus, une vivacité certaine. Le soin apporté à l'ensemble (décors, costumes, photographie, interprétation de qualité égale) fait que le rythme est tenu sans réel fléchissement. Les scènes d'action, souvent pathétiques dans ce genre de production, sont réalisées avec vigueur (la capture de César par Salluste, l'évasion du bagne dans le désert) et même lorsqu'elles gardent un pied dans le pastiche, elles ne tombent pas dans le ridicule. Il y a certes quelques facilités ici ou là et une musique bien faible, signée de Polnareff, mais le refuge dans un passé lointain et le relatif éloignement géographique autorise mieux les fantaisies. La mise en scène d'Oury n'a rien d'exceptionnel, les différents mouvements s'effectuant de manière assez rigide, mais tel raccord ou telle plongée ont leur efficacité.
Le dynamisme provient de l'histoire, de l'équipe de réalisation, mais aussi et surtout, du remplacement de Bourvil par Montand. Alors que le premier restait toujours en-dessous de De Funès, encombrait parfois ses avancées, le second lui tient parfaitement tête et parvient à se caler sur son rythme effréné. Montand apporte sa verve et, par rapport à son prédécesseur, rend infiniment moins gnan-gnan les épisodes romantiques (qui sont de plus, ici, accompagnés d'une légère ironie, via le décorum ou le regard de De Funès).
De Montand à Hallyday, la chute s'annonçait encore plus tragique que la précédente, mais elle fut en fait, elle aussi, assez peu douloureuse. D'ailleurs, j'exagère un peu. La présence de Johnny Hallyday dans Titeuf, le film est limitée, en terme de durée et bien sûr parce que nous nous retrouvons ici uniquement face à son "avatar" dessiné. Toutefois, il faut dire que ces quelques minutes du film de Zep constituent sans aucun doute le meilleur clip vidéo que nous ait jamais offert l'ex-idole des jeunes. La chose a échappé au journaliste de Télérama en charge de la critique de ce Titeuf. Dans l'hebdo, le film est descendu sous le prétexte qu'il marcherait à l'esbroufe. Trois éléments prouveraient, selon l'auteur du texte, la réalité de l'arnaque : la bande originale, l'inadéquation entre le coût du projet et son résultat et enfin le choix de la 3D. La musique est effectivement inégale (le fond étant touché avec un morceau réunissant quatre tocards de la chanson française) mais... relativement en accord avec le sujet et les personnages. Et Zep réussit quand même à placer ces vieux punks des Toy Dolls (pas n'importe où de surcroît). Le fric dépensé et la publicité accompagnant la sortie, à vrai dire, je m'en tape. Reste le problème de la 3D, à propos duquel... je ne peux me prononcer, ayant vu le film en 2D. Cela reste le seul point sur lequel je pourrai m'accorder avec Télérama car je ne vois en effet pas très bien ce que la technique peut apporter dans ce cas précis.
Ceci étant précisé, je dois dire que, de mon côté, c'est au contraire la modestie du film qui m'a plu. Pas de voix people pour de nouveaux personnages (les aficionados, dont je ne suis pas, peuvent éventuellement se plaindre de ce manque de nouveauté), pas de translation spectaculaire du monde de Titeuf (l'amusante introduction préhistorique est une fausse piste) : on reste au ras de la rue, au niveau de la cour de récré. Le fait que Zep ait obtenu le contrôle total de sa création était sans doute, déjà, un gage de fidélité sinon de qualité. L'esprit cracra et bébête de la série et de la BD est heureusement préservé, ce qui nous vaut un festival de gros mots, de blagues pipi-caca et de pensées sexuelles idiotes. L'histoire est toute simple, ancrée dans le quotidien, juste réhaussée visuellement par les illustrations des délires de Titeuf et de ses copains. L'esthétique du film n'est pas transcendante mais quelques idées se remarquent, ainsi que plusieurs micro-gags à l'arrière-plan. La thématique abordée est celle d'un passage d'un âge à l'autre draînant ses inquiétudes. Si l'issue ne fait guère de doute (happy end pour les parents, plus en demie-teinte pour Titeuf qui doit encore avancer...), cette structure classique donne l'assise nécessaire pour un passage réussi au format long.

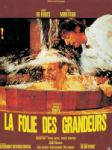
 CHANTONS SOUS LA PLUIE (Singin' in the rain)
CHANTONS SOUS LA PLUIE (Singin' in the rain)
de Gene Kelly et Stanley Donen
(Etats-Unis / 103 mn / 1952)
LA FOLIE DES GRANDEURS
de Gérard Oury
(France / 108 mn / 1971)
TITEUF, LE FILM
de Zep
(France / 87 mn / 2011)
 Le Corniaud n'est pas désagréable dans sa première heure y compris sous son aspect touristique (la séquence documentaire de la cadillac avançant au pas au milieu de la foule des ruelles napolitaines, les vues de Rome...), du moins jusqu'à ce qu'il se rapproche des personnages italiens, aussitôt traînés dans les pires clichés. Reconnaissons aussi que quelques gags portent.
Le Corniaud n'est pas désagréable dans sa première heure y compris sous son aspect touristique (la séquence documentaire de la cadillac avançant au pas au milieu de la foule des ruelles napolitaines, les vues de Rome...), du moins jusqu'à ce qu'il se rapproche des personnages italiens, aussitôt traînés dans les pires clichés. Reconnaissons aussi que quelques gags portent. Comme on me le fit remarquer à son terme, La chevauchée fantastique ne propose finalement "pas beaucoup d'aventures", seule l'anthologique attaque de la diligence par les Indiens pouvant être décrite comme telle. Le classique de Ford dispose une série de figures comme autant d'archétypes : la façon dont chaque voyageur est présenté au début de l'histoire, en le caractérisant avec beaucoup de vigueur et de netteté, est en cela très significative, sans même parler du cadre (la petite ville puis le désert), de la simplicité de l'argument, des différents évènements parsemant le périple.
Comme on me le fit remarquer à son terme, La chevauchée fantastique ne propose finalement "pas beaucoup d'aventures", seule l'anthologique attaque de la diligence par les Indiens pouvant être décrite comme telle. Le classique de Ford dispose une série de figures comme autant d'archétypes : la façon dont chaque voyageur est présenté au début de l'histoire, en le caractérisant avec beaucoup de vigueur et de netteté, est en cela très significative, sans même parler du cadre (la petite ville puis le désert), de la simplicité de l'argument, des différents évènements parsemant le périple. Toy story 3 est une source de plaisir continu. Il s'agit d'abord d'un film d'évasion mené à un rythme époustouflant (tout en gardant une lisibilité totale de l'action et l'espace nécessaire à l'approfondissement des personnages). Ensuite, il propose quelques images stupéfiantes, notamment lors de la longue séquence de la décharge avec ses sublimes visions de l'Enfer. La projection en 3D ne donne pas exactement le vertige mais la technique se révèle tout à fait appropriée pour ce film jouant sur l'animation de jouets et donc sur les changements d'échelle. Cette différence de perception autorise à trouver de la beauté et de l'étrangeté à un décor à priori banal ou criard comme le sont les salles de la garderie Sunnyside. Une machine vulgaire, telle un distributeur de friandises, peut de la même façon devenir un fantastique refuge à explorer.
Toy story 3 est une source de plaisir continu. Il s'agit d'abord d'un film d'évasion mené à un rythme époustouflant (tout en gardant une lisibilité totale de l'action et l'espace nécessaire à l'approfondissement des personnages). Ensuite, il propose quelques images stupéfiantes, notamment lors de la longue séquence de la décharge avec ses sublimes visions de l'Enfer. La projection en 3D ne donne pas exactement le vertige mais la technique se révèle tout à fait appropriée pour ce film jouant sur l'animation de jouets et donc sur les changements d'échelle. Cette différence de perception autorise à trouver de la beauté et de l'étrangeté à un décor à priori banal ou criard comme le sont les salles de la garderie Sunnyside. Une machine vulgaire, telle un distributeur de friandises, peut de la même façon devenir un fantastique refuge à explorer. Une révision de la première trilogie Star Wars confirme entièrement l'impression laissée des années auparavant : les deux premiers épisodes sont bons, le troisième beaucoup moins. Jouant à la fois sur une trame classique et sur des nouveautés techniques et rythmiques, La guerre des étoiles, tient bien le coup, notamment dans la conduite du récit. Sans doute meilleur encore, L'Empire contre-attaque suit très habilement deux lignes narratives (l'apprentissage de Luke et les aventures de Leia et Solo) se croisant en peu d'endroits mais liées par un montage parallèle aux transitions soignées (le passage d'une scène à l'autre se fait harmonieusement en s'appuyant sur des postures, des situations ou des ambiances comparables). Se concluant par une série d'échecs, ce volet est de loin le plus sombre et le moins superficiel de la trilogie. En revanche, Le retour du Jedi, en ciblant un plus jeune public, s'enlise plus d'une fois dans la niaiserie, non seulement en multipliant les gentils gags autour des Ewoks mais aussi en faisant évoluer les rapports du trio Leia/Skywalker/Solo de manière angélique. La violence, y compris morale, est totalement absente. Ce troisième épisode, appliquant conventionnellement son programme, n'a pour lui que ses compétences techniques, indéniables et toujours grisantes. L'insertion postérieure, par George Lucas, dans les trois films, de quelques images de synthèse est une aberration esthétique brisant la cohérence parfaite de ces objets. Cette bêtise annonce le naufrage de la trilogie suivante, un sommet de laideur.
Une révision de la première trilogie Star Wars confirme entièrement l'impression laissée des années auparavant : les deux premiers épisodes sont bons, le troisième beaucoup moins. Jouant à la fois sur une trame classique et sur des nouveautés techniques et rythmiques, La guerre des étoiles, tient bien le coup, notamment dans la conduite du récit. Sans doute meilleur encore, L'Empire contre-attaque suit très habilement deux lignes narratives (l'apprentissage de Luke et les aventures de Leia et Solo) se croisant en peu d'endroits mais liées par un montage parallèle aux transitions soignées (le passage d'une scène à l'autre se fait harmonieusement en s'appuyant sur des postures, des situations ou des ambiances comparables). Se concluant par une série d'échecs, ce volet est de loin le plus sombre et le moins superficiel de la trilogie. En revanche, Le retour du Jedi, en ciblant un plus jeune public, s'enlise plus d'une fois dans la niaiserie, non seulement en multipliant les gentils gags autour des Ewoks mais aussi en faisant évoluer les rapports du trio Leia/Skywalker/Solo de manière angélique. La violence, y compris morale, est totalement absente. Ce troisième épisode, appliquant conventionnellement son programme, n'a pour lui que ses compétences techniques, indéniables et toujours grisantes. L'insertion postérieure, par George Lucas, dans les trois films, de quelques images de synthèse est une aberration esthétique brisant la cohérence parfaite de ces objets. Cette bêtise annonce le naufrage de la trilogie suivante, un sommet de laideur. La première partie de La grande vadrouille (l'arrivée à Paris des trois parachutistes anglais en trois endroits différents) est vraiment réussie et presque constamment drôle, surtout, bien sûr, les séquences à l'Opéra. Le seul gag vraiment absurde est génial (De Funès cognant sa perruque posée à côté de lui et se faisant mal au crâne) et fait regretter qu'il n'y en ait pas d'autres. Le rythme faiblit sérieusement avec le périple vers l'auberge pour ne repartir qu'avec la tentative de passage en zone libre. Les quiproquos dans la Kommandantur sont sympathiques mais la réussite de la séquence tient plus à l'abattage des comédiens et aux croisements orchestrés par le scénario qu'à la mise en scène. Celle-ci reste assez plate, malgré quelques cadrages plus inventifs que d'habitude, et Oury ne sait absolument pas filmer la vitesse et l'action. Grâce à Marie Dubois, la bluette réservée à Bourvil est un peu plus supportable qu'ailleurs. Bien évidemment, le moindre Français croisé dans l'aventure est prêt à aider tout le monde, au nez et à la barbe des occupants.
La première partie de La grande vadrouille (l'arrivée à Paris des trois parachutistes anglais en trois endroits différents) est vraiment réussie et presque constamment drôle, surtout, bien sûr, les séquences à l'Opéra. Le seul gag vraiment absurde est génial (De Funès cognant sa perruque posée à côté de lui et se faisant mal au crâne) et fait regretter qu'il n'y en ait pas d'autres. Le rythme faiblit sérieusement avec le périple vers l'auberge pour ne repartir qu'avec la tentative de passage en zone libre. Les quiproquos dans la Kommandantur sont sympathiques mais la réussite de la séquence tient plus à l'abattage des comédiens et aux croisements orchestrés par le scénario qu'à la mise en scène. Celle-ci reste assez plate, malgré quelques cadrages plus inventifs que d'habitude, et Oury ne sait absolument pas filmer la vitesse et l'action. Grâce à Marie Dubois, la bluette réservée à Bourvil est un peu plus supportable qu'ailleurs. Bien évidemment, le moindre Français croisé dans l'aventure est prêt à aider tout le monde, au nez et à la barbe des occupants. Océans est un beau documentaire animalier, aux images parfois impressionnantes. Il ne faut pas en attendre plus. La "scénarisation" des séquences n'est pas excessive et surtout, le discours écologique est simple et direct, heureusement dénué du moralisme culpabilisateur de
Océans est un beau documentaire animalier, aux images parfois impressionnantes. Il ne faut pas en attendre plus. La "scénarisation" des séquences n'est pas excessive et surtout, le discours écologique est simple et direct, heureusement dénué du moralisme culpabilisateur de  La nuit au musée (rien que le titre, on pense déjà aux Marx Brothers) est une amusante comédie. La technique est impeccable, qui s'efforce d'animer toute la collection d'un Museum d'Histoire Naturelle, une fois la nuit tombée. On trouve peu de chutes de rythme, l'alternance du calme de la journée et de la furie nocturne étant bien géré. Le message véhiculé par cette histoire de père de famille paumé et divorcé qui regagne l'estime de son fils n'a certes rien de nouveau et le trio des vieux veilleurs de nuit qui s'avèrent être les méchants du film n'a rien de mémorable. L'intérêt tient plutôt dans l'aspect régressif du personnage de Ben Stiller. Cela ne donne pas toujours un résultat très fin (ni très drôle) mais cela intrigue plutôt, tout comme le font ces ruptures de rythme, assez étonnantes, en pleine folie ambiante (l'irrésistible psychanalyse d'Attila). (*)
La nuit au musée (rien que le titre, on pense déjà aux Marx Brothers) est une amusante comédie. La technique est impeccable, qui s'efforce d'animer toute la collection d'un Museum d'Histoire Naturelle, une fois la nuit tombée. On trouve peu de chutes de rythme, l'alternance du calme de la journée et de la furie nocturne étant bien géré. Le message véhiculé par cette histoire de père de famille paumé et divorcé qui regagne l'estime de son fils n'a certes rien de nouveau et le trio des vieux veilleurs de nuit qui s'avèrent être les méchants du film n'a rien de mémorable. L'intérêt tient plutôt dans l'aspect régressif du personnage de Ben Stiller. Cela ne donne pas toujours un résultat très fin (ni très drôle) mais cela intrigue plutôt, tout comme le font ces ruptures de rythme, assez étonnantes, en pleine folie ambiante (l'irrésistible psychanalyse d'Attila). (*)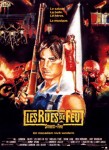 Ouf, j'ai 13 ans ! La première barrière d'interdiction est enfin franchie et je peux tranquillement aller voir par exemple Bernard Giraudeau, Valérie Kaprisky et Caroline Cellier s'entre-déchirer sur les plages de Saint-Tropez pendant L'année des méduses (Christopher Frank). La fable urbaine de Walter Hill, Les rues de feu, contrairement à ce que ma mémoire (et la réputation de son auteur) me soufflait, ne fut pas soumis à la même restriction. Hill était alors considéré comme une nouvelle pointure... A la question du passage du temps, l'ami Mariaque a déjà apporté quelques éléments de réponse
Ouf, j'ai 13 ans ! La première barrière d'interdiction est enfin franchie et je peux tranquillement aller voir par exemple Bernard Giraudeau, Valérie Kaprisky et Caroline Cellier s'entre-déchirer sur les plages de Saint-Tropez pendant L'année des méduses (Christopher Frank). La fable urbaine de Walter Hill, Les rues de feu, contrairement à ce que ma mémoire (et la réputation de son auteur) me soufflait, ne fut pas soumis à la même restriction. Hill était alors considéré comme une nouvelle pointure... A la question du passage du temps, l'ami Mariaque a déjà apporté quelques éléments de réponse 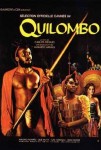 En ce temps-là, Jerry Lewis tentait à nouveau une expérience française mais, après Michel Gérard (Retenez-moi ou je fais un malheur), tombait sur Philippe Clair (Par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir). Les comédies américaines du mois, Le convoi des casseurs (de Charles B. Griffith, une histoire de poursuites en voitures) et Moscou à New York (de Paul Mazursky, sur un émigrant soviétique en Amérique, interprété par Robin Williams), n'éveillent pas plus de désir. Avec Quilombo, Carlos Diegues suscitait moins d'enthousiasme qu'aux grandes heures du Cinema novo brésilien. Autres sorties du mois : Reuben, Reuben, ou la vie d'artiste (de Robert Ellis Miller avec Tom Conti), Rocking silver (d'Erik Clausen, chronique rock danoise), Archie Shepp, Je suis jazz... C'est ma vie (documentaire de Franck Cassenti), Cal (de Pat O'Connor, sur l'Irlande du Nord), Christmas story (de Bob Clark), Matagi, le vieux chasseur d'ours (de Toshio Gotoh), Un amour interdit (drame historique de Jean-Pierre Dougnac), Et la vie... et les larmes... et l'amour (Nikolai Goubenko, chronique d'une maison de retraite soviétique). Une fois n'est pas coutume, peut-être faut-il alors se tourner vers Hong Kong : Mad mission est une parodie d'espionnage concoctée par un Tsui Hark en pleine ascension et Le dernier seigneur de Shaolin, de Woo Ming Hung, est un film de kung-fu à l'honnête réputation (contrairement à La main de fer de Chao de Luk Tang, présenté au même moment).
En ce temps-là, Jerry Lewis tentait à nouveau une expérience française mais, après Michel Gérard (Retenez-moi ou je fais un malheur), tombait sur Philippe Clair (Par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir). Les comédies américaines du mois, Le convoi des casseurs (de Charles B. Griffith, une histoire de poursuites en voitures) et Moscou à New York (de Paul Mazursky, sur un émigrant soviétique en Amérique, interprété par Robin Williams), n'éveillent pas plus de désir. Avec Quilombo, Carlos Diegues suscitait moins d'enthousiasme qu'aux grandes heures du Cinema novo brésilien. Autres sorties du mois : Reuben, Reuben, ou la vie d'artiste (de Robert Ellis Miller avec Tom Conti), Rocking silver (d'Erik Clausen, chronique rock danoise), Archie Shepp, Je suis jazz... C'est ma vie (documentaire de Franck Cassenti), Cal (de Pat O'Connor, sur l'Irlande du Nord), Christmas story (de Bob Clark), Matagi, le vieux chasseur d'ours (de Toshio Gotoh), Un amour interdit (drame historique de Jean-Pierre Dougnac), Et la vie... et les larmes... et l'amour (Nikolai Goubenko, chronique d'une maison de retraite soviétique). Une fois n'est pas coutume, peut-être faut-il alors se tourner vers Hong Kong : Mad mission est une parodie d'espionnage concoctée par un Tsui Hark en pleine ascension et Le dernier seigneur de Shaolin, de Woo Ming Hung, est un film de kung-fu à l'honnête réputation (contrairement à La main de fer de Chao de Luk Tang, présenté au même moment).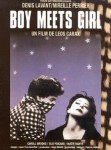 Après un excellent mois d'octobre, novembre flirterait donc avec le néant si trois titres ne relevaient le niveau. La sortie tardive d'un mélodrame de 1959, Fleurs de papier, permettait la découverte de Guru Dutt, grande figure du cinéma indien. L'Anglais Michael Radford s'attaquait courageusement à Orwell en donnant sa version de 1984. De son étonnante réussite, nous vous avons déjà entretenu
Après un excellent mois d'octobre, novembre flirterait donc avec le néant si trois titres ne relevaient le niveau. La sortie tardive d'un mélodrame de 1959, Fleurs de papier, permettait la découverte de Guru Dutt, grande figure du cinéma indien. L'Anglais Michael Radford s'attaquait courageusement à Orwell en donnant sa version de 1984. De son étonnante réussite, nous vous avons déjà entretenu  L'Amadeus de Forman étant sorti le dernier jour du mois d'octobre, plusieurs revues le choisissent pour illustrer leur numéro de novembre : Positif (285), La revue du Cinéma (399) et les Cahiers du Cinéma (365). Cinéma 84 (311) fait de même mais avec L'amour par terre de Rivette. Cinématographe (104) consacre sa livraison mensuelle aux "enfants sauvages" (Le voleur de Bagdad de Berger, Powell et Whelan en couverture) et Jeune Cinéma (162) revient sur l'œuvre de Boris Barnet (La jeune fille au carton à chapeau). La "conquérante" Valérie Kaprisky est à la une de Première (92) et Sophie Marceau sur celle de Starfix (20), en prévision de la sortie de L'amour braque. Finalement, seul L'Écran Fantastique (50) met en avant l'un des films évoqués plus haut, Les rues de feu.
L'Amadeus de Forman étant sorti le dernier jour du mois d'octobre, plusieurs revues le choisissent pour illustrer leur numéro de novembre : Positif (285), La revue du Cinéma (399) et les Cahiers du Cinéma (365). Cinéma 84 (311) fait de même mais avec L'amour par terre de Rivette. Cinématographe (104) consacre sa livraison mensuelle aux "enfants sauvages" (Le voleur de Bagdad de Berger, Powell et Whelan en couverture) et Jeune Cinéma (162) revient sur l'œuvre de Boris Barnet (La jeune fille au carton à chapeau). La "conquérante" Valérie Kaprisky est à la une de Première (92) et Sophie Marceau sur celle de Starfix (20), en prévision de la sortie de L'amour braque. Finalement, seul L'Écran Fantastique (50) met en avant l'un des films évoqués plus haut, Les rues de feu.