90s - Page 3
-
Les Aventures d'un homme invisible (John Carpenter, 1992)
**Cette comédie fantastique de Carpenter est ma foi bien agréable. Elle n'est pas hilarante mais elle est régulièrement drôle, la gamme, de l'humour subtil au gag vulgaire, étant parcourue avec la même tenue. L'invisibilité dans le quotidien produit son lot d'étonnements et d'amusements visuels (jusqu'au cauchemar du personnage qui découvre que son sexe est invisible). Et comme Carpenter s'y connaît en récit, la conduite est sans faille (c'est même mieux huilé que certains autres de ses films, plus sérieux, plus personnels). Enfin, le casting est des plus adaptés : Chevy Chase, Darryl Hannah, Sam Neill. Ce qui fait que ce n'est pas pour autant un grand film (au-delà de la folle scène sexuelle que l'on pourrait imaginer et qui est encore une fois évitée), c'est le choix (l'obligation ?) de montrer si souvent Chase à l'écran, même s'il est tout à fait bon. Carpenter fait le maximum pour justifier les apparitions/disparitions du corps de l'acteur en jouant des points de vue, mais l'alternance n'en paraît pas moins arbitraire dans bien des scènes et empêche celles-ci de basculer dans une véritable folie ou une véritable étrangeté. On en reste donc au niveau du divertissement de qualité. -
Contre-enquête (Sidney Lumet, 1990)
**Le film appartient à ce qui est probablement la meilleure veine de l'œuvre de Lumet, celle qui montre New York avec un scrupuleux réalisme. Timothy Hutton, en jeune juge, y enquête sur Nick Nolte, flic bossant à la dure et venant d'abattre un dealer noir. Le premier est plutôt bon, le second fout vraiment les jetons. La ville, dans un ambiance pluvieuse, monochrome, presque terne, est décrite, à travers sa police, comme gangrénée par la violence et bouffée par les antagonismes communautaires. Le constat n'est pas neuf à cette époque mais intéresse (atterre) toujours. Pétri de qualités de fabrication, Contre-enquête se révèle cependant moins passionnant que prévu, souvent trop bavard, soumis à des chutes de rythme, légèrement répétitif. Son défaut principal tient à la (louable) double obsession qui le guide, la dénonciation de la corruption et du racisme, dans le sens où la moindre scène, le moindre dialogue, se trouvent chargés d'y renvoyer (jusqu'au passé sentimental du petit juge héroïque, rattaché assez artificiellement à l'intrigue). En découle une impression d'efficacité mais aussi de pesanteur didactique. -
Hard Eight (Paul Thomas Anderson, 1996)
Un homme sur le retour prend sous son aile un garçon un peu paumé. Avec cette histoire de joueurs, P.T. Anderson fait ses débuts, forcément prometteurs, et pose les bases thématiques (le maître et l’élève) et esthétiques (précision et musicalité) de son cinéma.
L’impressionnante carrière de P.T. Anderson n’a pas démarré avec Boogie Nights mais avec ce Hard Eight, film, tendant vers le noir, sur le milieu des amateurs de jeux d’argent et qui était étrangement resté inédit malgré une présentation cannoise à Un Certain Regard en 1996. Loin de la vision infernale donnée au même moment par Martin Scorsese dans Casino, le jeune cinéaste de 25 ans filme avec empathie ses personnages déambuler dans les salles de Reno. Prenant le temps d’avancer par longues séquences, faisant preuve d’une grande précision rythmique dans les plans et leur assemblage, peaufinant musicalement son univers, il développe une relation filiale par substitution qui est aussi un échange entre mentor et disciple, thème majeur de sa filmographie à venir. Au genre du néo-polar américain alors en vogue (Coen, Tarantino, Fincher…), il s’intègre surtout par son dernier tiers, qui laisse s’infiltrer la violence et qui rend les choses plus explicites et par là moins originales. Cinéaste aimant prolonger ses fils narratifs jusqu’au vertige ou à l’épuisement, Anderson est ici, malheureusement, poussé à fermement boucler son récit. Au Hard Eight (terme de joueur de dés) imposé par la production, il a toujours préféré son titre de départ, Sidney, prénom du personnage joué par Philip Baker Hall (dans son plus grand rôle). Cela indique assez sa volonté de déplacement du simple polar cool vers une plus ambitieuse peinture de caractères qui laisserait les thèmes émerger progressivement. Le résultat n’est pas tout à fait un coup d’essai - coup de maître, mais la belle entrée en jeu, souple et sinueuse, d’un futur top player.
(Texte paru dans L'Annuel du Cinéma 2019)
-
Une équipe hors du commun (Penny Marshall, 1992)
**Honnête divertissement dans les deux sens du terme. C'est agréable à suivre même si l'on ne possède aucune connaissance ni attirance pour le baseball, grâce au dynamisme de chaque séquence. C'est surtout honnête car bienveillant envers le moindre de ses personnages, tous bien campés (Madonna est tout à fait correcte, Geena Davis impeccable et Tom Hanks, en entraîneur alcoolique forcé de s'occuper d'une équipe de filles, sort une composition savoureuse), tout en ne repoussant pas trop dans l'ombre les difficultés et les douleurs de l'époque (1943). Le récit est classique mais a le bon goût de ne pas virer au triomphalisme, se terminant même par une défaite. Il est encadré par un prologue et un épilogue au présent dans lesquels ce sont bien des actrices âgées qui jouent les rôles et non les stars grimées, ce qui rend la fin, cette réunion de mamies pionnières du baseball féminin professionnel, touchante. -
La Famille Addams (Barry Sonnenfeld, 1991)
°N'ayant jamais été en contact avec l'univers de la Famille Addams, je le découvre avec le film à succès de Sonnenfeld. Tout cela m'échappe. L'humour m'apparaît lourdingue, l'histoire, tournant comme toujours autour de l'appât du gain et de la bonté du cœur, sans intérêt et mal racontée, l'interprétation soit outrancière (Christopher Lloyd) soit juste correcte (Angelica Huston, Raul Julia), la réalisation tout à fait impersonnelle et sans aucune mesure avec la poésie macabre burtonienne se déployant à la même époque. Coincée par la visée familiale de l'affaire, la mise en scène relègue à chaque coup les jeux horrifiques dans le hors-champ, ce qui est désespérant. Enfin, je ne vois absolument pas qui sont ces gens et je ne comprends pas leurs rapports avec les autres, dits "normaux". -
A brighter summer day (Edward Yang, 1991)
***Il faudrait comparer avec la version de 3 heures distribuée à l'époque car dans celle-ci qui monte à 4, la dernière provoque une baisse de l'attention, alors que le récit se fait plus tragique, faisant que l'on est moins sensible aux belles vibrations produites par la mise en scène. Mais c'est très probablement le chef-d'œuvre d'Edward Yang. Il impressionne par son ampleur émotionnelle, historique, sociale et cinématographique alors qu'il est justement concentré sur quelques lieux et quelques mois. S'il est difficile tout d'abord, de se repérer, on admire vite, par la suite, la complexité de la toile et la limpidité de sa présentation. L'une des choses qui frappent est la capacité de Yang à intégrer des éléments de cinéma de genre (notamment à travers la violence qui fait irruption régulièrement alors que tout a l'air si calme) sans faire dévier d'un pouce sa conception de la mise en scène, basée sur le temps, l'observation, l'ellipse, la ramification. La partie centrale du film est ainsi magnifique, donnant à voir des plans superbement composés, discrètement animés (ils sont le plus souvent fixes mais jamais contraignants) et intimement reliés par un découpage des scènes tout sauf classique. Très long mais très beau film. -
Désillusions

On attend tellement du cinéma, on espère tant trouver de quoi nous nourrir même lorsque l'on fait le choix de film le plus incertain, le plus hasardeux et le plus téméraire au regard de nos goûts habituels, que l'attente est parfois mal récompensée, la chute brutale et la désillusion radicale. Ainsi, ayant été hypnotisé, un soir déjà lointain, lors de la diffusion télévisée de ce grand documentaire qu'est En construccion (2000), je suis parti plein d'entrain, l'été dernier, à la découverte du cinéma de son auteur, l'Espagnol José Luis Guerin. L'illusion n'a pas perduré.
Los Motivos de Berta (1983) est la chronique de quelques jours dans la vie d'une petite campagnarde, passée au prisme de son imaginaire. Sous la forte influence, assumée, du Victor Erice de L'Esprit de la ruche, un récit étrange tente de se mettre en place, tout en longs plans ciselés en noir et blanc. Mais il a tôt fait de se déliter et le mystère qui l'accompagne, au lieu de s'épaissir, finit par s'éventer et disparaître au-delà des champs de Castille, rêvés ou bien réels, dans le sillage d'une Arielle Dombasle chevauchant, en robe blanche et perruque.
Innisfree (1990) est une relecture de L'Homme tranquille de John Ford, un documentaire-hommage réalisé sur les terres irlandaises de son tournage en 1951. Alternant rares extraits et prises de vue sur place, l'œuvre a la (non-)forme de la déambulation. Elle n'offre pas plus de progression émotionnelle qu'elle ne dévoile de but particulier. Malgré un découpage plutôt vif, les séquences-blocs semblent ne jamais vouloir se clore. Des scènes de pub flirtent avec l'insupportable, des enfants de l'école racontent les scènes du film, des reconstitutions sont esquissées... A chaque instant, l'articulation entre les deux films, espacés de quarante années, manque cruellement.
Tren de sombras / Le Spectre de Thuit (1997) est l'auscultation, à la Blow up, d'une série d'images. Présentées comme des reliques des années vingt, bobines à usage familial appartenant à un riche amateur de l'époque, quelque chose nous dit qu'elles tiennent de l'aimable supercherie. Guerin les donne d'abord à voir telles quelles, avant de s'en approcher au plus près, de les grossir, de les ralentir. Sur le papier passionnant, le projet s'abîme dans une réalisation tâtonnante, répétitive et imprécise dans la mise à jour des rapports qu'elle est supposée dégager. Conscient de cette opacité, Guerin finit par reconstituer et montrer le contrechamp de ces images, montrer le filmeur : tout cela est donc bien laborieux. Cherchant, en parallèle, le spectre du passé dans le présent, le cinéaste en passe de surcroît par de longs tunnels de plans sur une nature indéchiffrable qui achèvent en nous l'espoir qui subsistait malgré tout, lorsque nous contemplions un beau visage de jeune fille.
Dans la ville de Sylvia (2007) est un film à la teneur en fiction plus prononcée. Il est coupé par trois cartons annonçant autant de nuits (alors que la quasi-totalité du récit se passe de jour), bornes qui n'ont pas d'intérêt particulier. Entre elles, un récit ou plutôt son esquisse, avec ce que cela comporte d'inachevé et d'insatisfaisant. Cette esquisse a, cette fois-ci, il est vrai, le mérite d'épouser parfaitement l'idée originelle. Car Guerin filme ici comme son personnage principal, à longueur de journée, dessine, en reprenant son geste, en l'ajustant, et en laissant même le vent tourner les pages/les plans. Guerin filme aussi comme le jeune homme regarde, captant à distance des bribes de conversations, observant de loin comment peuvent se composer des formes, tentant de saisir un peu de la beauté intérieure de chaque jolie femme croisée en terrasse ou dans les rues. Eloge de la ville, de la marche, de l'observation, de la présence des femmes, le film est léger comme une plume, volatil comme une goutte de parfum.
José Luis Guerin m'a laissé là, dubitatif et presque endolori par la vision de ces œuvres dans lesquelles plusieurs séquences semblent conclusives mais recèlent finalement de nouvelles et timides relances pour aboutir à cette impression de longueur excessive et sans enjeu apparent, cette impression que les quatre-vingt-dix minutes annoncées généralement se sont transformées en trois heures.
-
24 portraits d'Alain Cavalier
Réalisées en 1987 (la première) et en 1991 (la seconde), ces deux séries qui n'en font qu'une se placent donc pour Alain Cavalier entre Thérèse (1986) et Libera me (1993). L'inscription de ces 24 portraits dans l'évolution stylistique du cinéaste, leur importance dans son processus de réflexion sur la fiction et le documentaire, sur le rapport au personnage, au récit et à la technique, sont donc limpides.
L'un des tout premiers plans du premier film de la série montre les mains de "la matelassière" (les portraits sont titrés ainsi par le métier qu'exerce chacune des femmes rencontrées par Cavalier) et il est emblématique. Le cinéaste affectionne en effet ces cadrages sur des parties du corps ou bien sur des objets vus de près, posés sur des tables, des fonds unis qui épurent. Et de manière aussi simple qu'il filme, il parle sur ces images-là pour situer. Pour nommer précisément, aussi. Il a choisi de ne filmer que des femmes, souvent âgées et travaillant "à l'ancienne". L'une de ses motivations est d'enregistrer leur présence, de laisser une trace.
Ces femmes, il les filme à l'ouvrage, expliquant ou leur demandant d'expliquer leurs gestes. Et face à elles, il fait, lui aussi, son métier, il montre que, cinéaste, c'en est un. On remarque, au fil des portraits, la tentation, de moins en moins contenue, de Cavalier d'entrer dans le cadre et d'y faire entrer ses deux accompagnateurs (son et image). Mais même dans la première série, où il ne donne pas à voir de reflets de lui et son équipe restreinte, il rend compte de la fabrication par la voix et les choix de montage. Il peut très bien, par exemple, demander à son opérateur un fondu au noir ou un panoramique (ce qui ne va pas sans quelques hésitations ou erreurs). Il peut demander le clap. Il peut "diriger", en demandant qu'une tête se redresse, qu'une phrase soit redite, qu'une musique soit jouée dans la pièce ou qu'un objet soit montré.
Deux métiers sont donc face à face, rendant encore plus passionnante la présentation. L'un enrichit l'autre : à un moment, Alain Cavalier se demande à voix haute ce qu'il va pouvoir tirer de ces portraits pour réaliser ses films suivants et, en même temps, il espère que l'expérience a plu à ces femmes filmées. Sans attacher moins d'attention à elles, il parle de plus en plus de lui et de son passé.
24 portraits, ce n'est donc pas "Nos beaux métiers d'autrefois". Ce sont des mains et des visages de femmes (Cavalier avoue d'ailleurs que le visage est sa préoccupation première), filmés alternativement. Et par-dessus, se déroule leur parole. Cavalier les fait parler pendant le travail et passe sans cesse des questions sur ce sujet à celles plus personnelles. Ces dernières arrivent comme à l'improviste (sans jamais paraître irrespectueuses) et portent sur les enfants, les maris ou la solitude. Elles sont simples mais peuvent ouvrir des vannes.
24 PORTRAITS D'ALAIN CAVALIER (France, 24 x 13 min, 1987 & 1991) ****

-
Edward aux mains d'argent

Aux couleurs éclatantes des murs, des objets, des véhicules et des vêtements des habitants de cette zone pavillonnaire dans laquelle Tim Burton situe l'histoire d'Edward aux mains d'argent sont opposés la blancheur du teint et le noir de l'accoutrement de son héros qui le rend d'abord invisible au regard lorsqu'il se tient blotti sous le toit de son château avant de s'extraire de ce néant, de renaître. A ce château haut perché, les nuages chargés ont d'ailleurs l'habitude de s'accrocher pour le plonger régulièrement dans la pénombre. A l'intérieur, un gris poussiéreux recouvre les machines abandonnées.
Le noir et blanc, c'est le cinéma des origines. C'est de là que tout part et c'est là-bas qu'il faut revenir, au moins de temps en temps, pour s'extraire du monde de trop de couleurs. Et le lieu le plus accueillant est celui du genre qui marque le plus l'enfance, qui laisse les traces les moins effaçables : le fantastique, le conte, l'horreur.
Ce qui rend beau ce retour nostalgique, c'est qu'il est accompagné par l'idée de transmission, à travers la présence de Vincent Price jouant l'inventeur, le père, le professeur d'Edward (et ici, Burton est à chercher bien sûr dans les deux à la fois : la créature aux ciseaux et son créateur). Remarquons cependant que Price n'est pas déjà mort, qu'il n'est pas embaumé par la grisaille : ses yeux bleus percent, des touches de couleur parsèment son apparence. Avant qu'Edward soit propulsé dans les rues de la riante banlieue, c'est Peg, la mère de famille, qui effectue le premier pas, imposant sa présence incongrue dans la bâtisse suposée hantée sans se départir de son entrain et de sa sincérité désarmante. Grâce à cela, grâce à elle, le récit naît, l'improbable se réalise. Grâce, donc, à la mère de Kim qui elle-même racontera à sa petite fille l'histoire. La transmission remonte à loin.
Des habitants, Kim est celle qui, à la fin, sera vétue de blanc. Un blanc finalement taché de rouge, ce qui rendra la réclusion à nouveau nécessaire. Elle ne devrait pourtant pas être la règle : les couleurs ont leur place là-haut, comme l'échange est possible en bas. Plusieurs points de rencontre sont là pour le prouver. Le plus beau est peut-être cet instant partagé le soir de Noël. Edward, recherché par tout le monde, revient un moment dans la maison de sa famille adoptive. Il entre dans le salon, décoré pour l'occasion mais paraissant soudain épuré, doucement éclairé, irréel, comme si l'aura d'Edward l'avait précédée. Une main s'approche alors dans le but de toucher le dos du jeune homme dans un cadrage très courant dans le genre fantastique. Or le sursaut ne se fait pas. Les gestes sont calmes et tendres. La main se pose légèrement sur l'épaule. Les deux mondes se mêlent dans ce qui est un magnifique prélude à la poignante séquence de l'impossible étreinte.
Le film nous demande d'aller aux delà des apparences. Il nous aide à voir le jardin verdoyant, créatif et harmonieux au-delà des grilles inquiétantes du château. Ce jardin est le cœur d'Edward, c'est le gâteau de cette forme que dirige l'inventeur pris de vertige vers la poitrine de l'un de ses robots rudimentaires. L'autre recommandation est d'être soi-même, afin de ne pas devenir interchangeable comme ces ménagères peuplant la petite ville et posant dans le studio télé des questions bêtes, à leur niveau, bien qu'elles ouvrent malgré tout, involontairement, quelques gouffres ("Si vous deveniez comme tout le monde, vous ne seriez plus différent ?", "Avez-vous une petite amie ?"). Cette banlieue est aussi celle des frères Coen et de Lynch, il suffit d'accentuer légèrement, d'y mettre un peu d'ordre esthétique, d'en grossir des détails, pour qu'en sorte la part monstrueuse.
On l'avait un peu oublié depuis, l'éloignement et les récents échecs de Burton faisant écran, mais Edward aux mains d'argent est un film qui n'est pas surchargé, qui pose les choses simplement. Si les contre-plongées peuvent y être extrêmes, elles ne sont pas là pour épater mais pour exprimer le plus purement possible l'idée du déplacement du personnage sur un fond auquel il n'appartient pas. L'idée des ciseaux à la place des mains est également des plus simples. Le principal est qu'elle soit prolongée dans toutes ses dimensions : ludiques, dangereuses ou sexuelles. Et qu'elle ne débouche pas sur une confortable résolution. Le merveilleux conte de Burton n'élude ni la violence ni la mort, d'où, au-delà de l'émotion qu'il suscite encore, sa tenue, son exemplarité, sa beauté.
****
 EDWARD AUX MAINS D'ARGENT (Edward Scissorhands)
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT (Edward Scissorhands)de Tim Burton
(Etats-Unis / 105 min / 1990)
-
Le bûcher des vanités

Adapté de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités est un film que Brian De Palma a voulu d'un comique noir et grimaçant. On retient avant tout deux choses de la vision de ce qui est sans doute l'un des plus mauvais titres d'un cinéaste très inégal : la vulgarité et la confusion narrative.
Des dialogues scatologiques ou graveleux sont mis dans la bouche d'interprètes n'ôtant jamais leur masque, celui du rictus alcoolisé (Bruce Willis), celui du sourire tétanisé du yuppie pris au piège (Tom Hanks) ou celui de la gourmande nymphomane sans cervelle (Melanie Griffith). Ces marionnettes (les seconds rôles n'ont pas plus d'épaisseur que les premiers) s'agitent dans un monde de luxe monumentalisé par la caméra du cinéaste. Abusant des courtes focales, celui-ci s'amuse à déformer les visages jusqu'au grotesque. Il colle un plan en plongée vertigineuse à un autre en contre-plongée tout aussi extrême de manière totalement gratuite. Faisant ainsi des pieds et des mains à chaque instant, il finit par laisser le sens de ses images s'évanouir.
A la vulgarité du style s'ajoute une conduite particulièrement maladroite du récit, grinçant dans ses articulations et pataud dans ses développements. La faillite apparaît entière lorsque l'on se pose la question du point de vue. L'histoire est supposée nous être contée par le journaliste Peter Fallow (Willis), sa voix intervenant d'ailleurs en off à quatre ou cinq reprises (le plus souvent uniquement pour verbaliser ce que l'on voit sur l'écran). Mais il arrive que la caméra "virtuose" de De Palma nous impose d'habiter quelque temps l'esprit troublé de Sherman McCoy (Hanks). A d'autres reprises encore, le surplomb "objectif" devient la règle.
Pas plus rigoureuse que celles qui la précèdent, la dernière partie du film inflige une réconciliation familiale puis le prêche assommant d'un juge noir (Morgan Freeman assénant à l'assistance : "Be decent people !"). Tout cela après avoir passé le temps à dépeindre les oppositions inter-communautaires new yorkaises (noirs, juifs, wasps) avec la finesse d'un commando de GI lâché dans Bagdad. Après la charge, la leçon de morale (et peu importe de savoir si cette fin a été imposée ou non par les producteurs).
Le hasard m'a fait ainsi découvrir Le bûcher des vanités juste après avoir revu The player, deux films réalisés à quelques mois d'écart et partageant de nombreux points communs : un plan-séquence-générique mémorable en ouverture, la vision acide d'un milieu précis (celui des golden boys de Manhattan ici, des producteurs hollywoodiens là), le récit de la terrible chute d'un homme parvenu au sommet, un dénouement "sauvant" le héros de manière grinçante... Partant de là, la supériorité altmanienne apparaît écrasante, tant au niveau de la fluidité stylistique que de l'efficacité dramatique. Un point les différencie surtout. Altman, à qui on reproche régulièrement (à tort) de se moquer de ses personnages, ne les ridiculise jamais. Sans même parler du principal, il n'y a qu'à comparer les figures féminines de The player (celle, touchante, de Greta Scacchi ou celle, énergique et persévérante, de Whoopi Goldberg) et celles du Bûcher (la bêtise caractérisant à la fois la femme et la maîtresse). On mesure alors parfaitement la distance qui sépare un regard s'autorisant quelques pointes ironiques mais restant honnête et un regard méprisant et moralisateur.
****
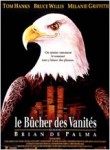 LE BÛCHER DES VANITÉS (The bonfire of vanities)
LE BÛCHER DES VANITÉS (The bonfire of vanities)de Brian De Palma
(Etats-Unis / 125 min / 1990)