
Adapté de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités est un film que Brian De Palma a voulu d'un comique noir et grimaçant. On retient avant tout deux choses de la vision de ce qui est sans doute l'un des plus mauvais titres d'un cinéaste très inégal : la vulgarité et la confusion narrative.
Des dialogues scatologiques ou graveleux sont mis dans la bouche d'interprètes n'ôtant jamais leur masque, celui du rictus alcoolisé (Bruce Willis), celui du sourire tétanisé du yuppie pris au piège (Tom Hanks) ou celui de la gourmande nymphomane sans cervelle (Melanie Griffith). Ces marionnettes (les seconds rôles n'ont pas plus d'épaisseur que les premiers) s'agitent dans un monde de luxe monumentalisé par la caméra du cinéaste. Abusant des courtes focales, celui-ci s'amuse à déformer les visages jusqu'au grotesque. Il colle un plan en plongée vertigineuse à un autre en contre-plongée tout aussi extrême de manière totalement gratuite. Faisant ainsi des pieds et des mains à chaque instant, il finit par laisser le sens de ses images s'évanouir.
A la vulgarité du style s'ajoute une conduite particulièrement maladroite du récit, grinçant dans ses articulations et pataud dans ses développements. La faillite apparaît entière lorsque l'on se pose la question du point de vue. L'histoire est supposée nous être contée par le journaliste Peter Fallow (Willis), sa voix intervenant d'ailleurs en off à quatre ou cinq reprises (le plus souvent uniquement pour verbaliser ce que l'on voit sur l'écran). Mais il arrive que la caméra "virtuose" de De Palma nous impose d'habiter quelque temps l'esprit troublé de Sherman McCoy (Hanks). A d'autres reprises encore, le surplomb "objectif" devient la règle.
Pas plus rigoureuse que celles qui la précèdent, la dernière partie du film inflige une réconciliation familiale puis le prêche assommant d'un juge noir (Morgan Freeman assénant à l'assistance : "Be decent people !"). Tout cela après avoir passé le temps à dépeindre les oppositions inter-communautaires new yorkaises (noirs, juifs, wasps) avec la finesse d'un commando de GI lâché dans Bagdad. Après la charge, la leçon de morale (et peu importe de savoir si cette fin a été imposée ou non par les producteurs).
Le hasard m'a fait ainsi découvrir Le bûcher des vanités juste après avoir revu The player, deux films réalisés à quelques mois d'écart et partageant de nombreux points communs : un plan-séquence-générique mémorable en ouverture, la vision acide d'un milieu précis (celui des golden boys de Manhattan ici, des producteurs hollywoodiens là), le récit de la terrible chute d'un homme parvenu au sommet, un dénouement "sauvant" le héros de manière grinçante... Partant de là, la supériorité altmanienne apparaît écrasante, tant au niveau de la fluidité stylistique que de l'efficacité dramatique. Un point les différencie surtout. Altman, à qui on reproche régulièrement (à tort) de se moquer de ses personnages, ne les ridiculise jamais. Sans même parler du principal, il n'y a qu'à comparer les figures féminines de The player (celle, touchante, de Greta Scacchi ou celle, énergique et persévérante, de Whoopi Goldberg) et celles du Bûcher (la bêtise caractérisant à la fois la femme et la maîtresse). On mesure alors parfaitement la distance qui sépare un regard s'autorisant quelques pointes ironiques mais restant honnête et un regard méprisant et moralisateur.
****
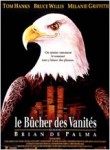 LE BÛCHER DES VANITÉS (The bonfire of vanities)
LE BÛCHER DES VANITÉS (The bonfire of vanities)
de Brian De Palma
(Etats-Unis / 125 min / 1990)
 Le film du mois ? Certains, que l'on qualifiera de De Palmophiles, vous diront à coup sûr qu'il s'agit de Body double. Malgré la craquante Melanie Griffith, ce titre de l'inégal barbu n'a jamais provoqué chez moi autre chose qu'un léger soupir, que ce soit au moment de sa sortie ou à la revoyure, une dizaine d'années plus tard. Bizarrement (ou pas), j'ai fini par le confondre avec le clip de Frankie Goes To Hollywood, Relax. Non, le film du mois, qui l'est resté pour moi de 1985 à aujourd'hui, est bien le Brazil de Terry Gilliam, aventure plus orwellienne encore que le 1984 de Michael Radford (sorti peu de temps
Le film du mois ? Certains, que l'on qualifiera de De Palmophiles, vous diront à coup sûr qu'il s'agit de Body double. Malgré la craquante Melanie Griffith, ce titre de l'inégal barbu n'a jamais provoqué chez moi autre chose qu'un léger soupir, que ce soit au moment de sa sortie ou à la revoyure, une dizaine d'années plus tard. Bizarrement (ou pas), j'ai fini par le confondre avec le clip de Frankie Goes To Hollywood, Relax. Non, le film du mois, qui l'est resté pour moi de 1985 à aujourd'hui, est bien le Brazil de Terry Gilliam, aventure plus orwellienne encore que le 1984 de Michael Radford (sorti peu de temps  On était aussi, en ce temps-là, A la recherche de Garbo. Sans que cela paraisse ajouter à sa gloire, Sidney Lumet filmait Anne Bancroft qui se mourait d'un cancer et rêvait de rencontrer la Divine. Des États-Unis parvenaient également quelques produits plus indépendants comme Alphabet City (Amos Poe) et Variety (Bette Gordon), une sorte de bêtisier hollywoodien titré Hollywood Graffiti (Ron Blackman et Bruce Goldstein) et un retour classique sur la grande dépression avec Les saisons du cœur (de Robert Benton, avec Sally Field et Ed Harris). Mais n'oublions pas Purple rain d'Albert Magnoli, film supposé lancer le chanteur Prince au cinéma. Le but ne fut pas atteint, seule la B.O. restant dans les mémoires.
On était aussi, en ce temps-là, A la recherche de Garbo. Sans que cela paraisse ajouter à sa gloire, Sidney Lumet filmait Anne Bancroft qui se mourait d'un cancer et rêvait de rencontrer la Divine. Des États-Unis parvenaient également quelques produits plus indépendants comme Alphabet City (Amos Poe) et Variety (Bette Gordon), une sorte de bêtisier hollywoodien titré Hollywood Graffiti (Ron Blackman et Bruce Goldstein) et un retour classique sur la grande dépression avec Les saisons du cœur (de Robert Benton, avec Sally Field et Ed Harris). Mais n'oublions pas Purple rain d'Albert Magnoli, film supposé lancer le chanteur Prince au cinéma. Le but ne fut pas atteint, seule la B.O. restant dans les mémoires. Sur notre lancée, abordons les films français. Découvert pour ma part bien après sa sortie, Péril en la demeure, le polar voyeuriste de Michel Deville (avec Christophe Malavoy, Nicole Garcia, Michel Piccoli, Anémone et Richard Bohringer) me séduisit. Il en va de même pour La vie de famille de Jacques Doillon, probablement le premier film de cet auteur que j'ai pu voir et qui me surprit alors totalement devant ma télévision avec ce fragile récit d'une relation père-fille. L'événement national était cependant à chercher plutôt du côté de L'amour braque. Andrzej Zulawski y faisait tournoyer Sophie Marceau entre Francis Huster et Tcheky Karyo, apparemment de manière plus ou moins scandaleuse (je n'ai malheureusement jamais vérifié). Parmi les autres sorties du mois battant pavillon français, on notera L'amour en douce d'Edouard Molinaro (comédie assez bien reçue, avec Jean-Pierre Marielle et Daniel Auteuil, et révélant Emmanuelle Béart), Les Nanas d'Annick Lanoë (avec Marie-France Pisier, Anémone, Dominique Lavanant, Macha Méril, Juliette Binoche... et pas un seul mec), La part des choses de Bernard Dartigues (un documentaire sur une famille d'agriculteurs), Le thé à la menthe d'Abdelkrim Bahloul (comédie dramatique entre France et Algérie), Tranches de vie de François Leterrier (film à sketches d'après Gérard Lauzier, de bien mauvaise réputation). Enfin, une convergence semble se faire entre trois œuvres, trois films-jeu aux trames relâchées et ludiques : Signé Charlotte de Caroline Huppert, Rouge-gorge de Pierre Zucca, et, le plus allêchant du lot, Les favoris de la lune, premier film français du Géorgien Otar Iosseliani.
Sur notre lancée, abordons les films français. Découvert pour ma part bien après sa sortie, Péril en la demeure, le polar voyeuriste de Michel Deville (avec Christophe Malavoy, Nicole Garcia, Michel Piccoli, Anémone et Richard Bohringer) me séduisit. Il en va de même pour La vie de famille de Jacques Doillon, probablement le premier film de cet auteur que j'ai pu voir et qui me surprit alors totalement devant ma télévision avec ce fragile récit d'une relation père-fille. L'événement national était cependant à chercher plutôt du côté de L'amour braque. Andrzej Zulawski y faisait tournoyer Sophie Marceau entre Francis Huster et Tcheky Karyo, apparemment de manière plus ou moins scandaleuse (je n'ai malheureusement jamais vérifié). Parmi les autres sorties du mois battant pavillon français, on notera L'amour en douce d'Edouard Molinaro (comédie assez bien reçue, avec Jean-Pierre Marielle et Daniel Auteuil, et révélant Emmanuelle Béart), Les Nanas d'Annick Lanoë (avec Marie-France Pisier, Anémone, Dominique Lavanant, Macha Méril, Juliette Binoche... et pas un seul mec), La part des choses de Bernard Dartigues (un documentaire sur une famille d'agriculteurs), Le thé à la menthe d'Abdelkrim Bahloul (comédie dramatique entre France et Algérie), Tranches de vie de François Leterrier (film à sketches d'après Gérard Lauzier, de bien mauvaise réputation). Enfin, une convergence semble se faire entre trois œuvres, trois films-jeu aux trames relâchées et ludiques : Signé Charlotte de Caroline Huppert, Rouge-gorge de Pierre Zucca, et, le plus allêchant du lot, Les favoris de la lune, premier film français du Géorgien Otar Iosseliani. Le film de kung-fu mensuel se nommait La conspiration de Shaolin (de Roc Tien), du Brésil, débarquait O amuleto de Ogum, un thriller de 1974 signé par l'ancienne gloire Nelson Perreira dos Santos et deux propositions ouest-allemandes étaient faites : comme son nom l'indique, Out of order... En dérangement (de Carl Schenkel, un huis-clos dans un ascenseur) et, d'un tout autre intérêt, Heimat, la chronique fort réputée d'Edgar Reitz initialement concue pour la télévision (affichant une durée totale de 15h). Enfin, il reste dans cette liste un titre, et non des moindres, vu le succès qu'il obtint à l'époque : La déchirure du Britannique Roland Joffé. Bien qu'elle ne soit probablement pas dépourvue de quelques qualités, je n'ai guère envie de revoir aujourd'hui cette œuvre édifiante sur les atrocités des Khmers Rouges. Il faut dire que son final est susceptible de dégoûter à jamais de la musique de John Lennon, tout le contraire de Gilliam et son Braaaaziiiiil....
Le film de kung-fu mensuel se nommait La conspiration de Shaolin (de Roc Tien), du Brésil, débarquait O amuleto de Ogum, un thriller de 1974 signé par l'ancienne gloire Nelson Perreira dos Santos et deux propositions ouest-allemandes étaient faites : comme son nom l'indique, Out of order... En dérangement (de Carl Schenkel, un huis-clos dans un ascenseur) et, d'un tout autre intérêt, Heimat, la chronique fort réputée d'Edgar Reitz initialement concue pour la télévision (affichant une durée totale de 15h). Enfin, il reste dans cette liste un titre, et non des moindres, vu le succès qu'il obtint à l'époque : La déchirure du Britannique Roland Joffé. Bien qu'elle ne soit probablement pas dépourvue de quelques qualités, je n'ai guère envie de revoir aujourd'hui cette œuvre édifiante sur les atrocités des Khmers Rouges. Il faut dire que son final est susceptible de dégoûter à jamais de la musique de John Lennon, tout le contraire de Gilliam et son Braaaaziiiiil.... En ce qui concerne les couvertures des revues et autres magazines cinéma, les choix étaient variés. Dune apparut "monumental" à L'Ecran Fantastique (53), La vie de famille fut mis en avant par La Revue du Cinéma (402), Les favoris de la lune eurent les honneurs des Cahiers du Cinéma (368), après avoir profité de ceux de Positif un mois plus tôt, lesquels prenaient un peu d'avance en saluant Théo Angelopoulos et son Voyage à Cythère (288). Deux films de janvier se retrouvaient par ailleurs à la une : The element of crime de Lars Von Trier sur celle de Cinéma 85 (314), et le Razorback de Mulcahy sur celle de Starfix (23). Enfin, Cinématographe (107) publiait un dossier sur "Les écrivains et le cinéma" tandis que Première (94) mettait en couverture Isabelle Adjani (pour l'imminent Subway).
En ce qui concerne les couvertures des revues et autres magazines cinéma, les choix étaient variés. Dune apparut "monumental" à L'Ecran Fantastique (53), La vie de famille fut mis en avant par La Revue du Cinéma (402), Les favoris de la lune eurent les honneurs des Cahiers du Cinéma (368), après avoir profité de ceux de Positif un mois plus tôt, lesquels prenaient un peu d'avance en saluant Théo Angelopoulos et son Voyage à Cythère (288). Deux films de janvier se retrouvaient par ailleurs à la une : The element of crime de Lars Von Trier sur celle de Cinéma 85 (314), et le Razorback de Mulcahy sur celle de Starfix (23). Enfin, Cinématographe (107) publiait un dossier sur "Les écrivains et le cinéma" tandis que Première (94) mettait en couverture Isabelle Adjani (pour l'imminent Subway). Redacted se présente comme un assemblage de documents militaires, amateurs ou télévisuels, tous liés, de près ou de loin, au viol d'une Irakienne et à l'assassinat de sa famille par deux soldats américains, faits qui se seraient déroulés courant 2006.
Redacted se présente comme un assemblage de documents militaires, amateurs ou télévisuels, tous liés, de près ou de loin, au viol d'une Irakienne et à l'assassinat de sa famille par deux soldats américains, faits qui se seraient déroulés courant 2006. Les jeunots Sean Penn et Tom Cruise commençaient à faire parler d'eux. Le premier tenait le rôle principal de Bad boys réalisé par Rick Rosenthal, film de prison dont l'affiche, pleine de promesses ultra-violentes, impressionna beaucoup nos yeux de pré-adolescent. Le deuxième plongeait dans le monde plus aisé mais non moins trouble de Risky business (Paul Brickman). Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. En revanche, je me rappelle très vaguement être tombé un jour sur Les copains d'abord, signé par un cinéaste resté estampillé eighties, Lawrence Kasdan. Celui-ci surfait sur la vague du film de groupe : sept amis de lycée (dont Tom Berenger, William Hurt, Kevin Kline, Jeff Goldblum et Glenn Close) se retrouvaient à l'occasion de l'enterrement d'un huitième et faisaient le point sur leur vie.
Les jeunots Sean Penn et Tom Cruise commençaient à faire parler d'eux. Le premier tenait le rôle principal de Bad boys réalisé par Rick Rosenthal, film de prison dont l'affiche, pleine de promesses ultra-violentes, impressionna beaucoup nos yeux de pré-adolescent. Le deuxième plongeait dans le monde plus aisé mais non moins trouble de Risky business (Paul Brickman). Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre. En revanche, je me rappelle très vaguement être tombé un jour sur Les copains d'abord, signé par un cinéaste resté estampillé eighties, Lawrence Kasdan. Celui-ci surfait sur la vague du film de groupe : sept amis de lycée (dont Tom Berenger, William Hurt, Kevin Kline, Jeff Goldblum et Glenn Close) se retrouvaient à l'occasion de l'enterrement d'un huitième et faisaient le point sur leur vie. Autres films sortis ce mois-là et dont je ne sais pas grand chose : Le crime de Cuenca (espagnol, de Pilar Miro et plutôt conseillé par la presse à l'époque), Femmes de personne (de Christopher Frank, apparemment plus recommandable que son film suivant : L'année des méduses), Le léopard (de Jean-Claude Sussfeld avec Brasseur et Lavanant), Laisse béton (Serge Le Péron), Un amour interdit (Jean-Pierre Dougnac). Deux titres sont à découvrir certainement : Sans témoin était le nouveau Nikita Mikhalkov. Le cinéaste était à la veille d'une reconnaissance internationale (à partir des Yeux noirs en 1987) mais avait déjà proposé quelques joyaux dans les années 70 (Quelques jours dans la vie d'Oblomov, Partition inachevée pour piano mécanique, Cinq soirées). Mauvaise conduite est un documentaire du chef opérateur Nestor Almendros et d'Orlando Jimenez Leal, sur la chasse aux homosexuels menée par le régime cubain dans les années 60. D'autre part, il serait bête d'oublier de mentionner Hot dog film de campus olé-olé se déroulant au ski (Peter Markle) et, parmi la bonne demie-douzaine de films d'arts martiaux du mois, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu (titre original Haegyeolsa) de Godfrey Ho et Doo-yong Lee avec Jang Lee Wang et Jim Norris (le frère de Chuck ?).
Autres films sortis ce mois-là et dont je ne sais pas grand chose : Le crime de Cuenca (espagnol, de Pilar Miro et plutôt conseillé par la presse à l'époque), Femmes de personne (de Christopher Frank, apparemment plus recommandable que son film suivant : L'année des méduses), Le léopard (de Jean-Claude Sussfeld avec Brasseur et Lavanant), Laisse béton (Serge Le Péron), Un amour interdit (Jean-Pierre Dougnac). Deux titres sont à découvrir certainement : Sans témoin était le nouveau Nikita Mikhalkov. Le cinéaste était à la veille d'une reconnaissance internationale (à partir des Yeux noirs en 1987) mais avait déjà proposé quelques joyaux dans les années 70 (Quelques jours dans la vie d'Oblomov, Partition inachevée pour piano mécanique, Cinq soirées). Mauvaise conduite est un documentaire du chef opérateur Nestor Almendros et d'Orlando Jimenez Leal, sur la chasse aux homosexuels menée par le régime cubain dans les années 60. D'autre part, il serait bête d'oublier de mentionner Hot dog film de campus olé-olé se déroulant au ski (Peter Markle) et, parmi la bonne demie-douzaine de films d'arts martiaux du mois, L'exécuteur défie l'empire du kung-fu (titre original Haegyeolsa) de Godfrey Ho et Doo-yong Lee avec Jang Lee Wang et Jim Norris (le frère de Chuck ?). J'ai un excellent souvenir du Temps suspendu, chronique adolescente signée Peter Gothar, l'un des premiers films non-anglophone (puisque hongrois) à m'avoir séduit (découvert à la télévision). C'est en mars 1984 qu'a été également distribué en France le premier Jim Jarmusch, Permanent vacation. Peu de choses me restent en tête à son propos, si ce n'est que j'avais plutôt apprécié. Le britannique Local hero (Bill Forsyth) est une agréable fable à la Capra dans laquelle Burt Lancaster, employé d'un grand groupe pétrolier, débarque dans un petit village écossais afin de négocier le rachat de l'ensemble des terres. Francesco Rosi donnait à son tour dans le film-opéra de prestige avec sa version "réaliste" de Carmen. Cela m'avait plongé dans un ennui sans nom. Peu à l'aise face au genre, je préfère à la rigueur les plus stylisés Don Giovanni de Losey et La flûte enchantée de Bergman.
J'ai un excellent souvenir du Temps suspendu, chronique adolescente signée Peter Gothar, l'un des premiers films non-anglophone (puisque hongrois) à m'avoir séduit (découvert à la télévision). C'est en mars 1984 qu'a été également distribué en France le premier Jim Jarmusch, Permanent vacation. Peu de choses me restent en tête à son propos, si ce n'est que j'avais plutôt apprécié. Le britannique Local hero (Bill Forsyth) est une agréable fable à la Capra dans laquelle Burt Lancaster, employé d'un grand groupe pétrolier, débarque dans un petit village écossais afin de négocier le rachat de l'ensemble des terres. Francesco Rosi donnait à son tour dans le film-opéra de prestige avec sa version "réaliste" de Carmen. Cela m'avait plongé dans un ennui sans nom. Peu à l'aise face au genre, je préfère à la rigueur les plus stylisés Don Giovanni de Losey et La flûte enchantée de Bergman. Dead zone n'est pas mon Cronenberg de chevet (les chefs d'oeuvres viendront un peu plus tard), le cinéaste y gagnant en efficacité ce qu'il perd un peu en mystère et en trouble, mais cette adaptation de Stephen King, portée par le grand Christopher Walken reste fichtrement bien en mémoire, et pas seulement pour telle image de paire de ciseaux plantée dans une bouche. En parlant d'images traumatisantes, la sortie du mois était sans aucun doute celle du Scarface de Brian DePalma. Je l'ai découvert assez tardivement (redoutais-je inconsciemment de me frotter à l'ultra-violence dont tout le monde parlait ?) et je ne l'ai pas revu depuis, mais il me passionna bien plus que les thrillers tordus que le cinéaste filmait à l'époque, comme Furie, Pulsions ou Body double (je mets de côté Blow out, plus intéressant). Je termine ce tour d'horizon du mois sur un coup de coeur : Polar de Jacques Bral, adaptation d'un roman de Patrick Manchette (et peut-être la plus réussie, donnant en tout cas, à mon sens, un meilleur film que le Nada de Chabrol). Oeuvre somnanbulique et pessimiste, à la trame tortueuse et bénéficiant d'une extraordinaire interprétation de Jean-François Balmer, Polar est un modèle du genre, à la Française.
Dead zone n'est pas mon Cronenberg de chevet (les chefs d'oeuvres viendront un peu plus tard), le cinéaste y gagnant en efficacité ce qu'il perd un peu en mystère et en trouble, mais cette adaptation de Stephen King, portée par le grand Christopher Walken reste fichtrement bien en mémoire, et pas seulement pour telle image de paire de ciseaux plantée dans une bouche. En parlant d'images traumatisantes, la sortie du mois était sans aucun doute celle du Scarface de Brian DePalma. Je l'ai découvert assez tardivement (redoutais-je inconsciemment de me frotter à l'ultra-violence dont tout le monde parlait ?) et je ne l'ai pas revu depuis, mais il me passionna bien plus que les thrillers tordus que le cinéaste filmait à l'époque, comme Furie, Pulsions ou Body double (je mets de côté Blow out, plus intéressant). Je termine ce tour d'horizon du mois sur un coup de coeur : Polar de Jacques Bral, adaptation d'un roman de Patrick Manchette (et peut-être la plus réussie, donnant en tout cas, à mon sens, un meilleur film que le Nada de Chabrol). Oeuvre somnanbulique et pessimiste, à la trame tortueuse et bénéficiant d'une extraordinaire interprétation de Jean-François Balmer, Polar est un modèle du genre, à la Française. Le film de Bral se retrouvait en couverture de Positif (277) quand Scarface faisait la une de Starfix (13), illustrant un dossier "Spécial violence urbaine". Première (84) s'entretenait avec Claude Brasseur. Cinématographe (98) revenait sur le Hitchcock des années 50 (L'homme qui en savait trop en couve). Enfin, trois films sortis en février étaient mis en avant par les autres revues : La femme flambée (et le cinéma des deux Allemagnes) pour Cinéma 84 (303), Star 80 pour la Revue du Cinéma (392) et A mort l'arbitre ! pour les Cahiers du Cinéma (357).
Le film de Bral se retrouvait en couverture de Positif (277) quand Scarface faisait la une de Starfix (13), illustrant un dossier "Spécial violence urbaine". Première (84) s'entretenait avec Claude Brasseur. Cinématographe (98) revenait sur le Hitchcock des années 50 (L'homme qui en savait trop en couve). Enfin, trois films sortis en février étaient mis en avant par les autres revues : La femme flambée (et le cinéma des deux Allemagnes) pour Cinéma 84 (303), Star 80 pour la Revue du Cinéma (392) et A mort l'arbitre ! pour les Cahiers du Cinéma (357).