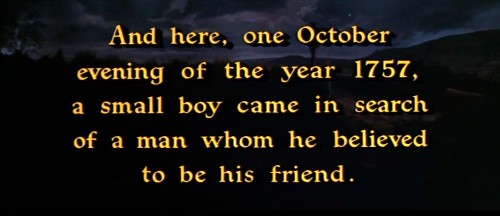Catherine Deneuve a-t-elle jamais été aussi blonde que dans Le Sauvage, l'agréable comédie de Jean-Paul Rappeneau (meilleure que me le laissaient croire de vagues souvenirs) ? Est-ce le bronzage ou la nature luxuriante qui réhausse ici cette blondeur ? Toujours est-il que ses cheveux y sont si blonds qu'ils tirent presque, par moments, vers le blanc (quand ils ne sont pas mouillés, bien sûr : là, ils brunissent par endroits et se chargent de tout leur poids, donnant à voir des changements de forme et de couleur aussi spectaculaires que les revirements émotionnels du personnage).
Cette blondeur/blancheur éclate et éblouit comme une glace reflète soudain le soleil à la faveur d'un mouvement imprévu et nous brûle la rétine. Yves Montand, lui, veut rester seul, ne pas être dérangé sur son île déserte et vivre tranquillement son fantasme de robinsonade. Seulement, ce reflet blond n'arrête pas de surgir et de le faire sursauter, ce reflet ou ce qui signale sa présence : la voix qui résonne tout à coup, un moteur qui démarre... Ne pas porter son regard sur l'emmerdeuse blonde est impossible tant celle-ci attire l'attention, l'exige même. Le problème pour Montand, c'est que, à la regarder, l'aveuglement est assuré, parfois pour des semaines (très joli passage de la révélation de l'ellipse de la construction du radeau, lorsqu'il lui répond qu'il a eu la grippe la semaine passée : on réalise alors par cet échange qu'ils ne se sont ni parlé ni croisé pendant plusieurs jours, bien qu'ils vivent l'un à côté de l'autre !). Il arrive pourtant que l'intensité lumineuse baisse. Lorsque Deneuve sort de l'eau et se hisse, trempée, sur le ponton, elle se trouve plongée dans le rouge orangé du soleil couchant derrière elle, belle image de carte postale. Seulement, Montand refuse alors de la voir. Excédé qu'il est par la perte de son bateau, il se barricade, ferme les yeux en même temps que tous les volets de sa maison.
Le Sauvage, c'est l'histoire d'un couple qui se forme en s'écharpant, histoire que l'on aimerait d'ailleurs délestée de toute autre présence, les récits naturels, inconséquents, lâchés comme en passant, tête blonde en l'air, de ses aventures d'antan par Deneuve se suffisant à eux-mêmes. Le sauvage, c'est surtout cette folle crinière blonde qui ne cesse de s'agiter sur le fond vert des plantes et des arbres exotiques. Moins mince que ne l'était sa sœur onze ans plus tôt quand elle tournait L'homme de Rio avec Philippe De Broca, Catherine Deneuve impose sa présence avec toute l'énergie et la franchise nécessaires. Sur le jaune du sable ou le bleu de l'océan se dessinent ses courbes, silhouette rendue plus nette et attirante encore par les chemises régulièrement mouillées et entrouvertes, qu'elle ne tarde d'ailleurs pas trop, pour notre bonheur, à enlever. L'éblouissement ne tient donc pas seulement au jeu, déjà précieux, de la chevelure.
Peu vraisemblable apparaît le dénouement dans une communauté de campagne mais l'important est ailleurs. Les cheveux de Deneuve sont maintenant recouverts d'un chapeau de papier. Seules quelques boucles s'en échappent sur les côtés, comme un piquant rappel. Montand revient à elle. Nul doute qu'elle saura par la suite l'habituer progressivement à supporter la vue de sa fabuleuse blondeur.