Après juin, vient la torpeur estivale. Mais même un plein cagnard, il nous faut remplir notre mission consistant à revenir sur les sorties en salles françaises de Juillet-Août 1984 :
A cette époque-là, le spectateur n'était pas spécialement à la fête pendant les deux mois les plus chauds de l'année, les distributeurs se gardant bien de lâcher leurs plus alléchants poulains avant la rentrée et s'échinant à refourguer à la sauvette le bas de gamme de leur catalogue.
 Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S.
Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S.
Je ne jurerai pas ne pas avoir vu Les branchés du bahut, grosse comédie de Robert Butler, ni Conan le destructeur (second volet signé par le vieux routier Richard Fleischer, avec Schwarzie et Grace Jones). Je suis sûr, en revanche, d'avoir soigneusement évité Xtro (du britannique Harry B. Davenport) dont les photographies d'alien foutaient vraiment trop les jetons.
 Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation.
Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation.
Frankenstein 90 n'a, depuis sa sortie, guère reçu de soutien autre que celui relatif au passé singulier de son auteur, Alain Jessua, l'un des rares cinéastes français à s'être frotté véritablement au fantastique (ici avec Jean Rochefort, Eddy Mitchell et Fiona Gélin). Réalisé par Jean-Loup Hubert, La smala, est semble-t-il l'un des moins routiniers des films centrés sur quelques ex-Splendid.
Au rayon des curiosités, on trouve Pourquoi l'étrange Mr Zolock s'intéressait-il tant à la bande dessinée (docu-fiction canadienne d'Yves Simoneau sur les grands auteurs de BD de l'époque, de Bilal à Gotlib, Tardi, Peyo...) et une adaptation érotique de Mérimée : Carmen nue (Albert Lopez). Quelques autres titres méritent peut-être le coup d'oeil : Bush Mama (oeuvre engagée de Haile Gerima, tournée dans le ghetto de Watts à Los Angeles), Cannonball 2 (Hal Needham), Tank (Marvin J. Chomsky), Siège (série B canadienne de Paul Donovan et Maura O'Connell), La triche (Yannick Bellon), Pavillons lointains (mélodrame britannique aux colonies de Peter Duffell), Angel (polar de Robert Vincent O'Neil), A coups de crosse (policier de Vicente Aranda avec Bruno Cremer et Fanny Cottençon).
 Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).
Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).
Et un troisième finit d'effrayer totalement : Dent pour dent (polar de Steve Carver avec Chuck Norris), Vendredi 13, chapitre final (vraiment final ?, de Joseph Zito), Hercule (Luigi Cozzi avec Lou "Hulk" Ferrigno dans le rôle-titre), Ultime violence (Sam Firstenberg), Shocking Asia (documentaire à sensations d'Emerson Fox), Liste noire (film de vengeance d'Alain Bonnot avec Annie Girardot en Charles Bronson), Mission finale (un sous-Rambo de Cirio H. Santiago), Les aventuriers de la Sierra Leone (un sous-Indiana Jones de Bob Schulz), Les guerriers du Bronx 2 (un sous-New York 1997 de Enzo G. Castellari), et bien sûr les Mad Maxeries italiennes habituelles telles que Les exterminateurs de l'an 3000 (Jules Harrison) ou Le chevalier du monde perdu (David Worth, avec Donald Pleasance).
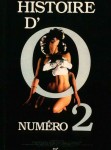 En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend.
En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend.
Rien de palpitant dans tout cela. En 84, il était en fait inutile d'écourter les vacances au bord de la mer, les grands noms n'étant annoncés que pour les derniers jours du mois d'août. Et encore... deux sur trois signaient l'un de leurs plus mauvais films. Dino Risi se fourvoyait totalement en entraînant Coluche dans la sinistre aventure du Bon Roi Dagobert (ici). De son côté, Clint Eastwood se chargeait de filmer lui-même Le retour de l'inspecteur Harry. Je garde le souvenir d'une oeuvre extrèmement déplaisante (contrairement au contemporain La corde raide, non officiellement signé par Eastwood). Finalement, le 29 août, une petite merveille tirait in extremis cette livraison de l'oubli. Eric Rohmer poursuivait sa série des Comédies et proverbes avec Les nuits de la pleine lune, l'un de ses meilleurs opus (là).
 Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.
Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.
Voilà pour l'été 1984. La suite en septembre...
 Le troisième film d'Eric Rohmer intéresse avant tout aujourd'hui d'une part par son inscription dans un mouvement artistique précis, celui de la Nouvelle Vague dont il intègre les principales composantes (tournage dans les rues, jeunesse des protagonistes, goût pour la provocation verbale ou comportementale) et d'autre part par son appartenance à la série des Contes moraux. Deuxième numéro de cette collection, après La boulangère de Monceau, La carrière de Suzanne, comme les autres opus rohmériens, part d'une proposition narrative claire et semble établir un programme tout en s'ingéniant à l'ouvrir au final à l'imprévu. Hâtons-nous de préciser que le film n'égale ni les meilleures oeuvres des jeunes camarades regroupés sous l'étiquette NV, ni les Rohmer suivants (lequel ne donne vraiment la mesure de son immense talent, à mon sens, qu'à partir de Ma nuit chez Maud en 1969).
Le troisième film d'Eric Rohmer intéresse avant tout aujourd'hui d'une part par son inscription dans un mouvement artistique précis, celui de la Nouvelle Vague dont il intègre les principales composantes (tournage dans les rues, jeunesse des protagonistes, goût pour la provocation verbale ou comportementale) et d'autre part par son appartenance à la série des Contes moraux. Deuxième numéro de cette collection, après La boulangère de Monceau, La carrière de Suzanne, comme les autres opus rohmériens, part d'une proposition narrative claire et semble établir un programme tout en s'ingéniant à l'ouvrir au final à l'imprévu. Hâtons-nous de préciser que le film n'égale ni les meilleures oeuvres des jeunes camarades regroupés sous l'étiquette NV, ni les Rohmer suivants (lequel ne donne vraiment la mesure de son immense talent, à mon sens, qu'à partir de Ma nuit chez Maud en 1969). Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S.
Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S. Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation.
Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation. Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).
Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).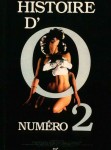 En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend.
En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend. Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.
Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio. "Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison". Voilà le sous-titre du quatième film de la série des Comédies et proverbes d'Eric Rohmer. Quatre chapitres égrennent autant de mois, de novembre à février, le premier posant on ne peut plus clairement la situation (qui, comme souvent dans la série, ne colle pas exactement terme pour terme au proverbe choisi). Deux longues conversations entre Louise et son copain Octave et entre Louise et son ami Rémi détaillent le point de départ du récit et semblent déjà en imaginer toutes les conséquences possibles. Le pour et le contre sont pesés, les risques identifiés. De l'instabilité de Louise naît l'intrigue et ce sont ses trajets incessants entre ses deux maisons qui vont rythmer le film. Le générique de début est porté par un panoramique allant de la rue à l'immeuble de banlieue de l'héroïne et logiquement, quand arrivera celui de la fin, la caméra bougera dans le sens inverse. Ces mouvements qui parsèment Les nuits de la pleine lune ne se limitent pas à accompagner les déplacements des personnages mais font entrer en jeu une problématique sociale en abordant la question des "nouvelles villes" naissant aux abords des grandes agglomérations et provoquant des mutations importantes dans les modes de vie (avec cette attention à l'environnement, nous avons là l'une des composantes du cinéma de Rohmer qui fait que celui-ci peut être qualifié à la fois d'intemporel et de précisemment daté).
"Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison". Voilà le sous-titre du quatième film de la série des Comédies et proverbes d'Eric Rohmer. Quatre chapitres égrennent autant de mois, de novembre à février, le premier posant on ne peut plus clairement la situation (qui, comme souvent dans la série, ne colle pas exactement terme pour terme au proverbe choisi). Deux longues conversations entre Louise et son copain Octave et entre Louise et son ami Rémi détaillent le point de départ du récit et semblent déjà en imaginer toutes les conséquences possibles. Le pour et le contre sont pesés, les risques identifiés. De l'instabilité de Louise naît l'intrigue et ce sont ses trajets incessants entre ses deux maisons qui vont rythmer le film. Le générique de début est porté par un panoramique allant de la rue à l'immeuble de banlieue de l'héroïne et logiquement, quand arrivera celui de la fin, la caméra bougera dans le sens inverse. Ces mouvements qui parsèment Les nuits de la pleine lune ne se limitent pas à accompagner les déplacements des personnages mais font entrer en jeu une problématique sociale en abordant la question des "nouvelles villes" naissant aux abords des grandes agglomérations et provoquant des mutations importantes dans les modes de vie (avec cette attention à l'environnement, nous avons là l'une des composantes du cinéma de Rohmer qui fait que celui-ci peut être qualifié à la fois d'intemporel et de précisemment daté). Expérience inédite pour Eric Rohmer que ce Rayon vert. Après avoir laissé Pascale Ogier décorer les appartements de son personnage des Nuits de la pleine lune, il laisse cette fois-ci Marie Rivière et les acteurs l'entourant collaborer au scénario et aux dialogues, sous forme d'improvisations développées à partir d'une certaine trame. A la mise en scène de suivre. Rohmer délaisse donc quelque peu sa position d'organisateur au regard acéré et sollicite moins son oeil de plasticien. Nous perdons alors en rigueur ce que nous gagnons en naturel et en liberté. Frappent ici la simplicité des gens filmés et de leurs propos, l'abondance des scènes de repas décontractés, un goût pour la déambulation purement documentaire et l'étirement de séquences a priori sans enjeu dramatique. Devant ce cinquième opus de la série Comédies et proverbes, on ne peut que se faire à nouveau la remarque : Eric Rohmer est sans doute, parmi les grands auteurs de la Nouvelle Vague, celui qui est resté le plus fidèle aux principes techniques, esthétiques et narratifs du mouvement.
Expérience inédite pour Eric Rohmer que ce Rayon vert. Après avoir laissé Pascale Ogier décorer les appartements de son personnage des Nuits de la pleine lune, il laisse cette fois-ci Marie Rivière et les acteurs l'entourant collaborer au scénario et aux dialogues, sous forme d'improvisations développées à partir d'une certaine trame. A la mise en scène de suivre. Rohmer délaisse donc quelque peu sa position d'organisateur au regard acéré et sollicite moins son oeil de plasticien. Nous perdons alors en rigueur ce que nous gagnons en naturel et en liberté. Frappent ici la simplicité des gens filmés et de leurs propos, l'abondance des scènes de repas décontractés, un goût pour la déambulation purement documentaire et l'étirement de séquences a priori sans enjeu dramatique. Devant ce cinquième opus de la série Comédies et proverbes, on ne peut que se faire à nouveau la remarque : Eric Rohmer est sans doute, parmi les grands auteurs de la Nouvelle Vague, celui qui est resté le plus fidèle aux principes techniques, esthétiques et narratifs du mouvement. Le résultat n'était pas forcément attendu : le réalisateur le plus cité au terme de la récente consultation lancée par Ludovic Maubreuil sur son blog
Le résultat n'était pas forcément attendu : le réalisateur le plus cité au terme de la récente consultation lancée par Ludovic Maubreuil sur son blog  Un film d'espionnage par Eric Rohmer. Il y aura donc très peu de gunfights.
Un film d'espionnage par Eric Rohmer. Il y aura donc très peu de gunfights.