(Stanley Kubrick / Grande-Bretagne / 1971)
■■■■
Mon (déjà ancien) projet de me procurer tous les films de Kubrick disponibles en dvd pour passer quinze jours à les revisiter un par un étant en veilleuse, je profite qu'Orange mécanique (A clockwork orange) soit encore frais dans ma mémoire après l'avoir revu il y a quelques semaines, pour lâcher diverses remarques sur ce classique par ailleurs mille fois commenté :

- L'introduction est toujours aussi saisissante : les trois premières séquences démarrent de la même façon par un plan fixe de détail en amorce et la vision qui s'élargit grâce à un travelling arrière.
- Trois parties dans le film, mais aussi un renversement en miroir : avant son arrivée à l'hôpital, Alex est confronté tour à tour au clochard, à ses Drougs devenus policiers et à l'homme de la villa. Le bourreau est devenu victime et la violence s'est déplacée.
- Le montage court le dispute aux plans séquences fixes. Souvent, les protagonistes déboulent du fond du décor, façon de mettre en valeur les volumes.
- Orange mécaniqueimpose une heure de représentation de la violence, de sa jouissance et de son absurdité, filmée à l'exacte distance. Cette violence est "chaude" (l'instinct, l'énergie déployée, les sauts aériens dans l'affrontement avec le gang rival) ou "froide" (l'agression préparée du couple, les coups donnés par Alex qui chante a capella). Passée cette première partie, viennent la prison et la politique. Le rythme se calme, dans un ralentissement propice à la réflexion sur la violence et ses différentes formes, en attendant un nouveau déchaînement dont Alex sera cette fois la victime.
- Comme tous les Kubrick, c'est un film-monde, une bulle autonome. Cette société n'est pas très éloignée mais ce n'est pas tout à fait la nôtre (aucun plan de rue réaliste avec figurants). Elle est à la fois futuriste et passée. Le film est-il vraiment une mise en garde ? Pas sûr. C'est en tout cas un constat, une vision politique claire et l'aboutissement d'une pensée pessimiste.

- Le souvenir de la violence atténue dans la mémoire l'importance de l'humour noir, du grotesque, du masque. L'expressivité des visages est poussée jusqu'à la grimace et une étrange absurdité baigne quelques scènes.
- On y voit tous les films suivants se coltinant le thème de la violence, les meilleurs comme les pires. Les traces les plus évidentes se retrouvent dans les recherches esthétiques de Gaspar Noé, dans l'inquiétude et le grotesque chez Lynch, et dans le regard froid de Haneke.
- Film important, fort et clair, passage obligé de nos jeunesses cinéphiles, parmi les nombreux monuments Kubrickiens, celui-ci, en dehors du problème d'un vieillissement esthétique sans doute plus rapide que les autres, serait le chef-d'oeuvre imparfait (la partie centrale à la prison un peu plus faible), en comparaison duquel on préfère quatre ou cinq autres titres plus beaux, plus humains, plus tristes ou plus mystérieux.
Photos : premiere.fr et dvdbeaver.com
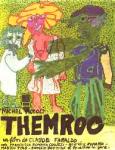 Entre L'an 01 de Gébé et Doillon et les Ferreri de l'époque, voici Themroc, autre fable politique post-68. Un homme refuse un jour l'abrutissant métro-boulot-dodo que la société lui impose. Quittant l'usine, il rejoint son immeuble, se mure dans sa chambre avec sa soeur et détruit à coup de masse la façade donnant sur la cour. De cette caverne, il ne bouge plus que pour partir chasser la nuit un gibier bien particulier : le CRS. Cette révolte animale se propage au voisinage et culmine dans une orgie dont l'ampleur sonore semble faire vaciller la ville entière et donc la société.
Entre L'an 01 de Gébé et Doillon et les Ferreri de l'époque, voici Themroc, autre fable politique post-68. Un homme refuse un jour l'abrutissant métro-boulot-dodo que la société lui impose. Quittant l'usine, il rejoint son immeuble, se mure dans sa chambre avec sa soeur et détruit à coup de masse la façade donnant sur la cour. De cette caverne, il ne bouge plus que pour partir chasser la nuit un gibier bien particulier : le CRS. Cette révolte animale se propage au voisinage et culmine dans une orgie dont l'ampleur sonore semble faire vaciller la ville entière et donc la société. Mon chemin, troisième film de Jancso, pose les fondements de son esthétique. La technique commence à s'appuyer sur d'amples plans séquences, figure qui prendra au fil du temps de plus en plus d'importance dans le cinéma du hongrois. Que ceux qui ont déjà souffert devant un film de Bela Tarr ne soient pas effrayés en trouvant dans une même phrase les expressions "plan séquence" et "hongrois". Ici, la sensation du temps est complexifiée, magnifiée par des mouvements d'appareils extraordinaires, par les déplacements des groupes dans le cadre, par la simultanéité d'actions à l'avant et l'arrière-plan. Pas de solennité, ni de confusion. Le terme est parfois utilisé abusivement, mais pas pour Jancso : c'est bien une merveilleuse chorégraphie qui s'offre à nos yeux.
Mon chemin, troisième film de Jancso, pose les fondements de son esthétique. La technique commence à s'appuyer sur d'amples plans séquences, figure qui prendra au fil du temps de plus en plus d'importance dans le cinéma du hongrois. Que ceux qui ont déjà souffert devant un film de Bela Tarr ne soient pas effrayés en trouvant dans une même phrase les expressions "plan séquence" et "hongrois". Ici, la sensation du temps est complexifiée, magnifiée par des mouvements d'appareils extraordinaires, par les déplacements des groupes dans le cadre, par la simultanéité d'actions à l'avant et l'arrière-plan. Pas de solennité, ni de confusion. Le terme est parfois utilisé abusivement, mais pas pour Jancso : c'est bien une merveilleuse chorégraphie qui s'offre à nos yeux. D'un film à l'autre, quelques éléments sont invariables : volonté de traiter une période historique marquante, tournage dans la grande plaine hongroise, goût prononcé pour les nus féminins en mouvement, opposés aux uniformes militaires des hommes. Psaume rouge (prix de la mise en scène à Cannes en 1972) est composé exclusivement de plans séquences (une vingtaine pour une durée totale de 1h20). Sinueux, ils créent sans cesse des figures circulaires, plus précisément d'encerclement, puisqu'il s'agit d'étouffer un mouvement révolutionnaire. Le procédé pourrait être rigide, mais loin de contraindre, l'art de Jancso permet l'éblouissement. Dans ces plans incroyables, la vie entre par n'importe quel côté (chevaux ou individus, que l'on perd et retrouve un instant plus tard) et le mouvement est constant (celui de la caméra est redoublé par celui des personnages, constamment en train de marcher).
D'un film à l'autre, quelques éléments sont invariables : volonté de traiter une période historique marquante, tournage dans la grande plaine hongroise, goût prononcé pour les nus féminins en mouvement, opposés aux uniformes militaires des hommes. Psaume rouge (prix de la mise en scène à Cannes en 1972) est composé exclusivement de plans séquences (une vingtaine pour une durée totale de 1h20). Sinueux, ils créent sans cesse des figures circulaires, plus précisément d'encerclement, puisqu'il s'agit d'étouffer un mouvement révolutionnaire. Le procédé pourrait être rigide, mais loin de contraindre, l'art de Jancso permet l'éblouissement. Dans ces plans incroyables, la vie entre par n'importe quel côté (chevaux ou individus, que l'on perd et retrouve un instant plus tard) et le mouvement est constant (celui de la caméra est redoublé par celui des personnages, constamment en train de marcher). Assez réputé dans les années 70, Gros plan (Inserts) a, depuis, bien sombré dans l'oubli, certainement à cause des difficultés qu'a rencontré son auteur pour enchaîner d'autres films intéressants à la suite de ce premier effort. Son statut et son sujet faisaient espérer beaucoup. Le résultat n'est pas désagréable mais un tantinet décevant.
Assez réputé dans les années 70, Gros plan (Inserts) a, depuis, bien sombré dans l'oubli, certainement à cause des difficultés qu'a rencontré son auteur pour enchaîner d'autres films intéressants à la suite de ce premier effort. Son statut et son sujet faisaient espérer beaucoup. Le résultat n'est pas désagréable mais un tantinet décevant. Réalisé entre Klute (1971) et Les hommes du président (1976), ensemble d'oeuvres qui forme a posteriori une fameuse trilogie paranoïaque, A cause d'un assassinat (The Parallax view) est un modèle de thriller politique. L'assassinat en question est celui d'un sénateur américain, abattu, d'après la version officielle, par un individu isolé. Pourtant, trois ans après les faits, Joe Frady, journaliste, s'inquiète de voir disparaître un a un tous les témoins de la scène. Son enquête périlleuse lui fait découvrir les agissements de la Parallax, entreprise recrutant déséquilibrés ou autres asociaux pour en faire les instruments d'assassinats politiques.
Réalisé entre Klute (1971) et Les hommes du président (1976), ensemble d'oeuvres qui forme a posteriori une fameuse trilogie paranoïaque, A cause d'un assassinat (The Parallax view) est un modèle de thriller politique. L'assassinat en question est celui d'un sénateur américain, abattu, d'après la version officielle, par un individu isolé. Pourtant, trois ans après les faits, Joe Frady, journaliste, s'inquiète de voir disparaître un a un tous les témoins de la scène. Son enquête périlleuse lui fait découvrir les agissements de la Parallax, entreprise recrutant déséquilibrés ou autres asociaux pour en faire les instruments d'assassinats politiques. Le docteur Ferret (Victor Lanoux, plutôt bon) s'installe dans une ville de banlieue et s'étonne d'y soigner essentiellement des morsures et de croiser continuellement les habitants accompagnés de leurs chiens de défense. Dans un climat de violence croissante, il rencontre le "fournisseur" de la population en molosses, l'éleveur et maître-chien Morel (Depardieu), qui semble étendre son influence sur toute la cité. Voici donc un film de dénonciation : Jessua montre l'engrenage qui, partant d'un racisme au quotidien et d'une suspicion envers les jeunes, mène un groupe de "bons citoyens" au lynchage de tous ceux qui n'adhèrent pas à leur vision fasciste. Les actes d'un violeur non identifié provoquent la recherche de boucs émissaires, l'obsession sécuritaire est entretenue par celui qui lorgne sur la mairie. La trame est démonstrative et le film n'est pas dépourvu de défauts : les différents groupes sociaux sont schématiquement représentés (les notables, les jeunes, les immigrés), Elisabeth, le personnage féminin principal évolue d'une façon qui rend peu crédible son revirement final en comparaison à la droiture morale que garde de bout en bout le médecin, la résolution de l'affaire de viol est peu convaincante.
Le docteur Ferret (Victor Lanoux, plutôt bon) s'installe dans une ville de banlieue et s'étonne d'y soigner essentiellement des morsures et de croiser continuellement les habitants accompagnés de leurs chiens de défense. Dans un climat de violence croissante, il rencontre le "fournisseur" de la population en molosses, l'éleveur et maître-chien Morel (Depardieu), qui semble étendre son influence sur toute la cité. Voici donc un film de dénonciation : Jessua montre l'engrenage qui, partant d'un racisme au quotidien et d'une suspicion envers les jeunes, mène un groupe de "bons citoyens" au lynchage de tous ceux qui n'adhèrent pas à leur vision fasciste. Les actes d'un violeur non identifié provoquent la recherche de boucs émissaires, l'obsession sécuritaire est entretenue par celui qui lorgne sur la mairie. La trame est démonstrative et le film n'est pas dépourvu de défauts : les différents groupes sociaux sont schématiquement représentés (les notables, les jeunes, les immigrés), Elisabeth, le personnage féminin principal évolue d'une façon qui rend peu crédible son revirement final en comparaison à la droiture morale que garde de bout en bout le médecin, la résolution de l'affaire de viol est peu convaincante.

 Arte, dans le cadre de son cycle trash, a diffusé en octobre dernier Sayuri, strip-teaseuse (Ichijo Sayuri : Nureta Yokujo), exemple de "roman porno", genre ayant fait florès au Japon dans les années 70. Précisons que la définition du terme porno varie, dans ce cas, de celle utilisée en France. La censure japonaise interdit depuis toujours l'exposition des pilosités et donc des sexes (la version que nous connaissons de L'empire des sens d'Oshima n'a été distribuée qu'en Occident). Les réalisateurs tournent donc autour de cet interdit en millimétrant leurs cadrages et les postures des comédiens ou en ayant recours à des caches (ce qui arrive à trois reprises ici et qui, paradoxalement, participe assez bien de l'ambiance visuelle recherchée du film). Nous avons là un travail en série, mais les résultats sont aussi loin de la nullité cinématographique des telefilms soft du dimanche soir que des moyens et des buts que se fixent l'industrie du X contemporaine. Car nous sommes bien dans ces années turbulentes où Oshima, Imamura, Suzuki et d'autres, donnent leurs grands coups de boutoirs contre le cinéma traditionnel, par leurs recherches formelles, leurs récits déconstruits, leurs réflexions politiques.
Arte, dans le cadre de son cycle trash, a diffusé en octobre dernier Sayuri, strip-teaseuse (Ichijo Sayuri : Nureta Yokujo), exemple de "roman porno", genre ayant fait florès au Japon dans les années 70. Précisons que la définition du terme porno varie, dans ce cas, de celle utilisée en France. La censure japonaise interdit depuis toujours l'exposition des pilosités et donc des sexes (la version que nous connaissons de L'empire des sens d'Oshima n'a été distribuée qu'en Occident). Les réalisateurs tournent donc autour de cet interdit en millimétrant leurs cadrages et les postures des comédiens ou en ayant recours à des caches (ce qui arrive à trois reprises ici et qui, paradoxalement, participe assez bien de l'ambiance visuelle recherchée du film). Nous avons là un travail en série, mais les résultats sont aussi loin de la nullité cinématographique des telefilms soft du dimanche soir que des moyens et des buts que se fixent l'industrie du X contemporaine. Car nous sommes bien dans ces années turbulentes où Oshima, Imamura, Suzuki et d'autres, donnent leurs grands coups de boutoirs contre le cinéma traditionnel, par leurs recherches formelles, leurs récits déconstruits, leurs réflexions politiques. Oh le beau film que voilà !
Oh le beau film que voilà ! Je le dis d'emblée, Sydney Pollack est pour moi un cinéaste estimable, réalisateur de bons films, mais jamais transcendants. Ce Jeremiah Johnson, après lequel je courrais depuis longtemps, à priori meilleur film de son auteur, ne me fait, malheureusement, pas revoir mon jugement, aussi agréable ce (faux) western soit-il à regarder. Jeremiah Johnson, venant de nulle part, décide de mener la vie rude, dangereuse et solitaire, de trappeur. Son périple montagnard sera l'occasion de rencontres insolites avec d'autres chasseurs et plusieurs tribus indiennes. Un foyer se constitue après son mariage forcé avec une squaw et l'adoption d'un garçon dont la famille de colons, à l'exception de sa mère rendue folle, a été massacrée. L'aspiration idyllique à l'harmonie ainsi réalisée est cependant bientôt brisée. Johnson, entraîné dans un cycle de violences, refait son chemin à l'inverse, croisant une seconde fois les mêmes personnes et disparaissant, auréolé d'une dimension quasi-mythique.
Je le dis d'emblée, Sydney Pollack est pour moi un cinéaste estimable, réalisateur de bons films, mais jamais transcendants. Ce Jeremiah Johnson, après lequel je courrais depuis longtemps, à priori meilleur film de son auteur, ne me fait, malheureusement, pas revoir mon jugement, aussi agréable ce (faux) western soit-il à regarder. Jeremiah Johnson, venant de nulle part, décide de mener la vie rude, dangereuse et solitaire, de trappeur. Son périple montagnard sera l'occasion de rencontres insolites avec d'autres chasseurs et plusieurs tribus indiennes. Un foyer se constitue après son mariage forcé avec une squaw et l'adoption d'un garçon dont la famille de colons, à l'exception de sa mère rendue folle, a été massacrée. L'aspiration idyllique à l'harmonie ainsi réalisée est cependant bientôt brisée. Johnson, entraîné dans un cycle de violences, refait son chemin à l'inverse, croisant une seconde fois les mêmes personnes et disparaissant, auréolé d'une dimension quasi-mythique.