Je suis un autarcique (Io sono un autarchico) (Nanni Moretti / Italie /1976) ■□□□
Ecce Bombo (Nanni Moretti / Italie /1978) ■■□□
Sogni d'oro (Nanni Moretti / Italie /1981) ■■■□
La Cosa (Nanni Moretti / Italie /1990) ■■□□
Le jour de la première de Close-up (Il giorno della prima di Close up) (Nanni Moretti / Italie /1995) ■■□□
Le cri d'angoisse de l'oiseau prédateur (Il grido d'angoscia dell'uccello predatore (20 tagli d'Aprile)) (Nanni Moretti / Italie /2002) ■■□□
Le journal d'un spectateur (Diaro di uno spettatore) (Nanni Moretti / Italie /2007) ■■□□
 Connaissez-vous Michele Apicella ? Vous devez au moins le revoir en jeune député adepte du water-polo (Palombella rossa, 1989)... Avec ce coffret, les Editions Montparnasse ont eu la bonne idée de nous permettre de remonter la piste jusqu'aux premières "vies" de notre homme, qui en connut beaucoup. On le découvre donc ici en comédien de théâtre d'avant-garde, en acteur de cinéma underground puis en cinéaste à la mode. Oui, celui-là même qui sera plus tard professeur de mathématiques (Bianca, 1984) et curé, sous le nom de Don Giulio (La messe est finie, 1985).
Connaissez-vous Michele Apicella ? Vous devez au moins le revoir en jeune député adepte du water-polo (Palombella rossa, 1989)... Avec ce coffret, les Editions Montparnasse ont eu la bonne idée de nous permettre de remonter la piste jusqu'aux premières "vies" de notre homme, qui en connut beaucoup. On le découvre donc ici en comédien de théâtre d'avant-garde, en acteur de cinéma underground puis en cinéaste à la mode. Oui, celui-là même qui sera plus tard professeur de mathématiques (Bianca, 1984) et curé, sous le nom de Don Giulio (La messe est finie, 1985).
Au cours d'une émission de télévision, qui constitue le morceau de bravoure de Sogni d'oro, Michele s'exclame "Je suis le cinéma, je suis le plus grand !". Ils furent nombreux, dès ses premiers essais et surtout dans les années 80 et 90, ceux qui prirent ces propos pour argent comptant, jusqu'à faire de son créateur-interprète-réalisateur, Nanni Moretti, le génial et unique représentant du cinéma italien. Il est vrai que les coups de pied donnés dans la fourmilière transalpine par le jeune cinéaste (23 ans à l'époque du premier long métrage) furent dès le départ très vigoureux et particulièrement surprenants.
Ce qui frappe en effet, de Je suis un autarcique à Sogni d'oro, c'est d'une part la méchanceté dont peut faire preuve à l'occasion Michele-Nanni et d'autre part la nature de ses cibles, peu habituées à recevoir de telles critiques dans un cadre cinématographique. Le héros morettien, qui n'est "jamais doux", comme le lui fait remarquer sa femme, est un être souvent au bord de la dépression, cassant, donneur de leçons, tyrannique avec son entourage. La famille est en première ligne. D'un film à l'autre, on entend son envie d'étrangler son petit garçon, on le voit gifler son père ou violenter sa mère. Dans Sogni d'oro, sur son plateau de cinéma, il frappe continuellement son assistant. A cette violence détonante envers les proches s'ajoute des piques féroces, lancées au détour d'une conversation, à l'encontre d'icônes nationales (Nino Manfredi, Alberto Sordi) ou de collègues (Lina Wertmüller). Si le cinéma de Moretti a tant marqué les esprits en Italie, dès ses débuts, c'est en grande partie parce qu'il se permettait d'aller, sur bien des points, contre les convenances. En un sens, pour ce qui est du regard porté sur le monde culturel, Nanni Moretti a filmé ce qu'il aurait pu écrire ailleurs, déplaçant une démarche critique du papier à la pellicule.
La faible distance qu'a gardé le cinéaste entre lui-même et son double de fiction explique également la répercussion qu'ont eu ses travaux. Sans réaliser encore, à cette époque, de véritable film "à la première personne", il adopte déjà le ton du journal intime ou du moins, fait ressentir fortement l'impression de vécu. En effet, Moretti ne parle que de ce qu'il connaît parfaitement et ses critiques sont formulées de l'intérieur : il est dans la petite bourgeoisie romaine, dans la gauche italienne, dans le monde du cinéma. Ce choix implique que l'auteur lui-même reçoive sa part de reproches et, effectivement, l'auto-ironie de Nanni Moretti est constante, repoussant ainsi le spectre du ressentiment fielleux.
Aussi passionnante soit-elle, la découverte groupée de ses trois premiers films laisse tout de même penser que, vu séparément et de manière totalement détachée des autres, chaque titre ne doit pas avoir la même prestance. En tout cas, une progression qualitative se dessine de façon évidente et le résultat donne raison à Moretti qui aimait à dire, dans les années 80 : "J'espère faire toujours le même film, si possible toujours plus beau".
 Je suis un autarcique laisse ainsi mitigé. Soumis aux contraintes du super-8 (brièveté des plans, fixité du cadre et absence de son direct), il prouve qu'avec peu, on peut arriver à faire sinon beaucoup, du moins quelque chose. Il est certain qu'entre deux blagues de potaches (très cultivés), Moretti parvient à capter un air du temps et, par moments, un mouvement réellement cinématographique mais son film est avant tout une succession de sketchs donnant une (fausse) impression d'improvisation entre amis. Peu séduisante esthétiquement, l'œuvre donne à voir plusieurs tentatives burlesques peu vigoureuses et mal assurées. Si l'on sourit assez souvent devant cette satire du théâtre d'avant-garde, on s'ennuie aussi parfois, comme lors d'un interminable stage en plein air. De plus, Je suis un autarcique est un film qui s'auto-analyse constamment, via l'aventure théâtrale qu'il raconte, qui s'auto-critique et qui finit par épuiser en quelque sorte la capacité personnelle du spectateur à juger par lui-même.
Je suis un autarcique laisse ainsi mitigé. Soumis aux contraintes du super-8 (brièveté des plans, fixité du cadre et absence de son direct), il prouve qu'avec peu, on peut arriver à faire sinon beaucoup, du moins quelque chose. Il est certain qu'entre deux blagues de potaches (très cultivés), Moretti parvient à capter un air du temps et, par moments, un mouvement réellement cinématographique mais son film est avant tout une succession de sketchs donnant une (fausse) impression d'improvisation entre amis. Peu séduisante esthétiquement, l'œuvre donne à voir plusieurs tentatives burlesques peu vigoureuses et mal assurées. Si l'on sourit assez souvent devant cette satire du théâtre d'avant-garde, on s'ennuie aussi parfois, comme lors d'un interminable stage en plein air. De plus, Je suis un autarcique est un film qui s'auto-analyse constamment, via l'aventure théâtrale qu'il raconte, qui s'auto-critique et qui finit par épuiser en quelque sorte la capacité personnelle du spectateur à juger par lui-même.
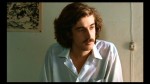 Ecce Bombo, qui pourrait être la suite du précédent, permet de retrouver les mêmes acteurs, regroupés ici en un club d'auto-conscience. L'observation d'un milieu est toujours la principale qualité du film mais la vision s'élargit, se faisant plus générationnelle, moins chargée de références et donc moins soumise à l'incompréhension due à l'éloignement dans le temps. La construction se fait à nouveau par saynètes mais celles-ci sont plus harmonieusement liées et plus fermement mises en scène. La distanciation de certaines est appréciable, Moretti entamant presque un dialogue direct avec le spectateur et utilisant la musique, la télévision et le cinéma comme autant d'éléments médiateurs de sa réflexion. Le désœuvrement et l'apathie de la jeunesse qu'il dépeint sont savoureusement moqués sans toutefois parvenir à éviter totalement un certain affaissement du récit. Le glissement vers la gravité qui s'opère alors donne au film de l'ampleur mais en diminue la vigueur. Le meilleur d'Ecce Bombo est à chercher en fait là où Nanni-Michele est le plus insupportable : en famille, entre les cris et les giffles.
Ecce Bombo, qui pourrait être la suite du précédent, permet de retrouver les mêmes acteurs, regroupés ici en un club d'auto-conscience. L'observation d'un milieu est toujours la principale qualité du film mais la vision s'élargit, se faisant plus générationnelle, moins chargée de références et donc moins soumise à l'incompréhension due à l'éloignement dans le temps. La construction se fait à nouveau par saynètes mais celles-ci sont plus harmonieusement liées et plus fermement mises en scène. La distanciation de certaines est appréciable, Moretti entamant presque un dialogue direct avec le spectateur et utilisant la musique, la télévision et le cinéma comme autant d'éléments médiateurs de sa réflexion. Le désœuvrement et l'apathie de la jeunesse qu'il dépeint sont savoureusement moqués sans toutefois parvenir à éviter totalement un certain affaissement du récit. Le glissement vers la gravité qui s'opère alors donne au film de l'ampleur mais en diminue la vigueur. Le meilleur d'Ecce Bombo est à chercher en fait là où Nanni-Michele est le plus insupportable : en famille, entre les cris et les giffles.
 Moretti a réalisé avec beaucoup plus de moyens Sogni d'oro. A lui Cinecitta, la Dolly et les mouvements d'appareils complexes... Le ton et les thèmes restent pourtant globalement les mêmes : difficultés à communiquer avec les autres autrement que par la violence des mots et des gestes, douleur de filmer, douleur de vivre. Entre les rires diffuse une tristesse certaine qui, alliée à une critique dévastatrice de la télévision, libère un parfum fellinien, le cinéaste des Vitelloni et de Ginger et Fred étant d'ailleurs le seul grand nom cité, explicitement ou pas, dans ces trois films de Moretti, sans aucune méchanceté. Avantageusement, le jeu avec les codes du cinéma remplace souvent, dans Sogni d'oro, les allusions à telle ou telle personnalité culturelle de l'époque. Le propos s'approfondit et la narration se complexifie. Des chutes de tension persistent mais se font moins brutales que par le passé et, gagnant en fluidité, le récit se fait enfin totalement cinématographique. Il reste à Moretti encore un peu de chemin à faire, à éviter notamment que certains gags ne tombent à plat. Avec Sogni d'oro, son cinéma est tout de même, cette fois, bien en place.
Moretti a réalisé avec beaucoup plus de moyens Sogni d'oro. A lui Cinecitta, la Dolly et les mouvements d'appareils complexes... Le ton et les thèmes restent pourtant globalement les mêmes : difficultés à communiquer avec les autres autrement que par la violence des mots et des gestes, douleur de filmer, douleur de vivre. Entre les rires diffuse une tristesse certaine qui, alliée à une critique dévastatrice de la télévision, libère un parfum fellinien, le cinéaste des Vitelloni et de Ginger et Fred étant d'ailleurs le seul grand nom cité, explicitement ou pas, dans ces trois films de Moretti, sans aucune méchanceté. Avantageusement, le jeu avec les codes du cinéma remplace souvent, dans Sogni d'oro, les allusions à telle ou telle personnalité culturelle de l'époque. Le propos s'approfondit et la narration se complexifie. Des chutes de tension persistent mais se font moins brutales que par le passé et, gagnant en fluidité, le récit se fait enfin totalement cinématographique. Il reste à Moretti encore un peu de chemin à faire, à éviter notamment que certains gags ne tombent à plat. Avec Sogni d'oro, son cinéma est tout de même, cette fois, bien en place.
La jaquette du présent coffret, qui annonce les "premiers films de Nanni Moretti", est pour un quart trompeuse. En effet, les courts métrages compilés ne sont pas, comme l'on pouvait s'y attendre, les premières tentatives du cinéaste (La sconfitta, 1973, Pâté de bourgeois, 1973, Comi parli frate ?, 1974) mais un groupe de films réalisés entre 1989 et 2007, soit bien après les "débuts". Si chacun présente un intérêt, cette rupture temporelle met à mal la cohérence éditoriale et il aurait été plus appréciable de disposer sur la quatrième galette de Bianca, dernier long métrage méconnu, avant la reconnaissance internationale apportée par La messe est finie (mais il est vrai que le film est édité par ailleurs).
 Le jour de la première de Close-up est une amusante pastille (déjà présente dans l'édition dvd du film d'Abbas Kiarostami), une poignée de scènes comiques, basées sur le perfectionnisme de Nanni Moretti directeur de salle de cinéma. Ce court souffre tout de même quelque peu d'un tournage en vidéo plutôt "relâché". Les trois minutes du Journal d'un spectateur (l'un des segments du programme collectif Chacun son cinéma) sont plus rigoureuses. Assis au milieu de salles vides, Moretti se rappelle de quelques projections mémorables, de celle du Ciel peut attendre à celle de Rocky Balboa. S'affirment là son sens du cadrage et son don pour la chute. Le cri d'angoisse de l'oiseau prédateur est lui un montage de 25 minutes réalisé à partir de séquences non retenues pour Aprile (1998). Malgré la recherche d'une chronologie, ce bout à bout peine à se muer en récit véritable. Le long métrage était lui-même construit de manière assez libre et son appendice propose une série de scènes et d'allusions pas toujours faciles à saisir. Il faut donc y picorer, souvent avec bonheur, comme lorsque l'on retrouve cette image restée dans les mémoires de Moretti tenant son bébé endormi sur son épaule et qui discoure cette fois sur le nouveau gouvernement de centre-gauche fraîchement installé au pouvoir.
Le jour de la première de Close-up est une amusante pastille (déjà présente dans l'édition dvd du film d'Abbas Kiarostami), une poignée de scènes comiques, basées sur le perfectionnisme de Nanni Moretti directeur de salle de cinéma. Ce court souffre tout de même quelque peu d'un tournage en vidéo plutôt "relâché". Les trois minutes du Journal d'un spectateur (l'un des segments du programme collectif Chacun son cinéma) sont plus rigoureuses. Assis au milieu de salles vides, Moretti se rappelle de quelques projections mémorables, de celle du Ciel peut attendre à celle de Rocky Balboa. S'affirment là son sens du cadrage et son don pour la chute. Le cri d'angoisse de l'oiseau prédateur est lui un montage de 25 minutes réalisé à partir de séquences non retenues pour Aprile (1998). Malgré la recherche d'une chronologie, ce bout à bout peine à se muer en récit véritable. Le long métrage était lui-même construit de manière assez libre et son appendice propose une série de scènes et d'allusions pas toujours faciles à saisir. Il faut donc y picorer, souvent avec bonheur, comme lorsque l'on retrouve cette image restée dans les mémoires de Moretti tenant son bébé endormi sur son épaule et qui discoure cette fois sur le nouveau gouvernement de centre-gauche fraîchement installé au pouvoir.
 Dans le corpus mis en avant ici, La Cosa est un morceau de choix, par sa longueur et sa singularité. Il s'agit d'un "pur" documentaire, sans intervention du cinéaste à l'image ou sur la bande son, qui s'attache à enregistrer la parole des militants du Parti Communiste Italien pendant l'hiver 1989, au moment où ont lieu les secousses que l'on sait du côté de l'Europe de l'Est et où la question se pose d'un changement de nom et d'un glissement vers la sociale-démocratie. Le film, commençant de manière plutôt frustrante (les interventions sont coupées très courtes, au risque du catalogue), trouve peu à peu son rythme, s'appuyant sur les différences d'élocution, de parcours et de ressentis, éclairant le poids du passé et les craintes de l'avenir. Il faut accepter une certaine répétition et un dispositif rudimentaire et attendre les quelques secondes finales pour que Moretti laisse enfin sa patte sur le travail. Ce n'est pas grand chose : un brouhaha soudain après tant de discours posés, des bribes de conversation véhémentes, inaudibles. Cela suffit pour brouiller les pistes, pour glisser du scepticisme, pour garder cette position du poil à gratter de la gauche. Cela suffit aussi, dans notre optique, pour faire le lien avec les débuts du cinéaste, pour boucler la boucle de ce voyage chez Nanni Moretti.
Dans le corpus mis en avant ici, La Cosa est un morceau de choix, par sa longueur et sa singularité. Il s'agit d'un "pur" documentaire, sans intervention du cinéaste à l'image ou sur la bande son, qui s'attache à enregistrer la parole des militants du Parti Communiste Italien pendant l'hiver 1989, au moment où ont lieu les secousses que l'on sait du côté de l'Europe de l'Est et où la question se pose d'un changement de nom et d'un glissement vers la sociale-démocratie. Le film, commençant de manière plutôt frustrante (les interventions sont coupées très courtes, au risque du catalogue), trouve peu à peu son rythme, s'appuyant sur les différences d'élocution, de parcours et de ressentis, éclairant le poids du passé et les craintes de l'avenir. Il faut accepter une certaine répétition et un dispositif rudimentaire et attendre les quelques secondes finales pour que Moretti laisse enfin sa patte sur le travail. Ce n'est pas grand chose : un brouhaha soudain après tant de discours posés, des bribes de conversation véhémentes, inaudibles. Cela suffit pour brouiller les pistes, pour glisser du scepticisme, pour garder cette position du poil à gratter de la gauche. Cela suffit aussi, dans notre optique, pour faire le lien avec les débuts du cinéaste, pour boucler la boucle de ce voyage chez Nanni Moretti.

 Une révision de la première trilogie Star Wars confirme entièrement l'impression laissée des années auparavant : les deux premiers épisodes sont bons, le troisième beaucoup moins. Jouant à la fois sur une trame classique et sur des nouveautés techniques et rythmiques, La guerre des étoiles, tient bien le coup, notamment dans la conduite du récit. Sans doute meilleur encore, L'Empire contre-attaque suit très habilement deux lignes narratives (l'apprentissage de Luke et les aventures de Leia et Solo) se croisant en peu d'endroits mais liées par un montage parallèle aux transitions soignées (le passage d'une scène à l'autre se fait harmonieusement en s'appuyant sur des postures, des situations ou des ambiances comparables). Se concluant par une série d'échecs, ce volet est de loin le plus sombre et le moins superficiel de la trilogie. En revanche, Le retour du Jedi, en ciblant un plus jeune public, s'enlise plus d'une fois dans la niaiserie, non seulement en multipliant les gentils gags autour des Ewoks mais aussi en faisant évoluer les rapports du trio Leia/Skywalker/Solo de manière angélique. La violence, y compris morale, est totalement absente. Ce troisième épisode, appliquant conventionnellement son programme, n'a pour lui que ses compétences techniques, indéniables et toujours grisantes. L'insertion postérieure, par George Lucas, dans les trois films, de quelques images de synthèse est une aberration esthétique brisant la cohérence parfaite de ces objets. Cette bêtise annonce le naufrage de la trilogie suivante, un sommet de laideur.
Une révision de la première trilogie Star Wars confirme entièrement l'impression laissée des années auparavant : les deux premiers épisodes sont bons, le troisième beaucoup moins. Jouant à la fois sur une trame classique et sur des nouveautés techniques et rythmiques, La guerre des étoiles, tient bien le coup, notamment dans la conduite du récit. Sans doute meilleur encore, L'Empire contre-attaque suit très habilement deux lignes narratives (l'apprentissage de Luke et les aventures de Leia et Solo) se croisant en peu d'endroits mais liées par un montage parallèle aux transitions soignées (le passage d'une scène à l'autre se fait harmonieusement en s'appuyant sur des postures, des situations ou des ambiances comparables). Se concluant par une série d'échecs, ce volet est de loin le plus sombre et le moins superficiel de la trilogie. En revanche, Le retour du Jedi, en ciblant un plus jeune public, s'enlise plus d'une fois dans la niaiserie, non seulement en multipliant les gentils gags autour des Ewoks mais aussi en faisant évoluer les rapports du trio Leia/Skywalker/Solo de manière angélique. La violence, y compris morale, est totalement absente. Ce troisième épisode, appliquant conventionnellement son programme, n'a pour lui que ses compétences techniques, indéniables et toujours grisantes. L'insertion postérieure, par George Lucas, dans les trois films, de quelques images de synthèse est une aberration esthétique brisant la cohérence parfaite de ces objets. Cette bêtise annonce le naufrage de la trilogie suivante, un sommet de laideur. La première partie de La grande vadrouille (l'arrivée à Paris des trois parachutistes anglais en trois endroits différents) est vraiment réussie et presque constamment drôle, surtout, bien sûr, les séquences à l'Opéra. Le seul gag vraiment absurde est génial (De Funès cognant sa perruque posée à côté de lui et se faisant mal au crâne) et fait regretter qu'il n'y en ait pas d'autres. Le rythme faiblit sérieusement avec le périple vers l'auberge pour ne repartir qu'avec la tentative de passage en zone libre. Les quiproquos dans la Kommandantur sont sympathiques mais la réussite de la séquence tient plus à l'abattage des comédiens et aux croisements orchestrés par le scénario qu'à la mise en scène. Celle-ci reste assez plate, malgré quelques cadrages plus inventifs que d'habitude, et Oury ne sait absolument pas filmer la vitesse et l'action. Grâce à Marie Dubois, la bluette réservée à Bourvil est un peu plus supportable qu'ailleurs. Bien évidemment, le moindre Français croisé dans l'aventure est prêt à aider tout le monde, au nez et à la barbe des occupants.
La première partie de La grande vadrouille (l'arrivée à Paris des trois parachutistes anglais en trois endroits différents) est vraiment réussie et presque constamment drôle, surtout, bien sûr, les séquences à l'Opéra. Le seul gag vraiment absurde est génial (De Funès cognant sa perruque posée à côté de lui et se faisant mal au crâne) et fait regretter qu'il n'y en ait pas d'autres. Le rythme faiblit sérieusement avec le périple vers l'auberge pour ne repartir qu'avec la tentative de passage en zone libre. Les quiproquos dans la Kommandantur sont sympathiques mais la réussite de la séquence tient plus à l'abattage des comédiens et aux croisements orchestrés par le scénario qu'à la mise en scène. Celle-ci reste assez plate, malgré quelques cadrages plus inventifs que d'habitude, et Oury ne sait absolument pas filmer la vitesse et l'action. Grâce à Marie Dubois, la bluette réservée à Bourvil est un peu plus supportable qu'ailleurs. Bien évidemment, le moindre Français croisé dans l'aventure est prêt à aider tout le monde, au nez et à la barbe des occupants. Océans est un beau documentaire animalier, aux images parfois impressionnantes. Il ne faut pas en attendre plus. La "scénarisation" des séquences n'est pas excessive et surtout, le discours écologique est simple et direct, heureusement dénué du moralisme culpabilisateur de
Océans est un beau documentaire animalier, aux images parfois impressionnantes. Il ne faut pas en attendre plus. La "scénarisation" des séquences n'est pas excessive et surtout, le discours écologique est simple et direct, heureusement dénué du moralisme culpabilisateur de  La nuit au musée (rien que le titre, on pense déjà aux Marx Brothers) est une amusante comédie. La technique est impeccable, qui s'efforce d'animer toute la collection d'un Museum d'Histoire Naturelle, une fois la nuit tombée. On trouve peu de chutes de rythme, l'alternance du calme de la journée et de la furie nocturne étant bien géré. Le message véhiculé par cette histoire de père de famille paumé et divorcé qui regagne l'estime de son fils n'a certes rien de nouveau et le trio des vieux veilleurs de nuit qui s'avèrent être les méchants du film n'a rien de mémorable. L'intérêt tient plutôt dans l'aspect régressif du personnage de Ben Stiller. Cela ne donne pas toujours un résultat très fin (ni très drôle) mais cela intrigue plutôt, tout comme le font ces ruptures de rythme, assez étonnantes, en pleine folie ambiante (l'irrésistible psychanalyse d'Attila). (*)
La nuit au musée (rien que le titre, on pense déjà aux Marx Brothers) est une amusante comédie. La technique est impeccable, qui s'efforce d'animer toute la collection d'un Museum d'Histoire Naturelle, une fois la nuit tombée. On trouve peu de chutes de rythme, l'alternance du calme de la journée et de la furie nocturne étant bien géré. Le message véhiculé par cette histoire de père de famille paumé et divorcé qui regagne l'estime de son fils n'a certes rien de nouveau et le trio des vieux veilleurs de nuit qui s'avèrent être les méchants du film n'a rien de mémorable. L'intérêt tient plutôt dans l'aspect régressif du personnage de Ben Stiller. Cela ne donne pas toujours un résultat très fin (ni très drôle) mais cela intrigue plutôt, tout comme le font ces ruptures de rythme, assez étonnantes, en pleine folie ambiante (l'irrésistible psychanalyse d'Attila). (*) En 76, Andrzej Wajda est, en quelque sorte, le cinéaste "officiel" de la Pologne, ce qui ne veut pas dire qu'il ménage le régime alors en place. Trop brûlant, le projet de L'homme de marbre (Czlowiek z marmuru) fut bloqué pendant treize ans. Avec aplomb, Wajda s'ingénie alors à traduire à l'intérieur-même de son film les difficultés qu'il a rencontré sur son propre chemin, en lui donnant la forme d'une enquête impossible, menée par Agnieszka, une jeune réalisatrice désireuse de se pencher, pour un travail de fin d'études en collaboration avec la télévision, sur la figure de Mateusz Birkut. Ce dernier fut, dans les années 50, l'un des "ouvriers de choc" mis sur un piédestal par le régime stalinien polonais. Du statut de héros populaire immortalisé dans le marbre et sur pellicule, Birkut passa brutalement à celui d'indésirable et finit par disparaître totalement de la circulation. Vingt ans plus tard, Agnieszka ausculte donc les archives filmées, rencontre des témoins toujours réticents, se heurte à sa hiérarchie et ne boucle pas son film... contrairement à Wajda.
En 76, Andrzej Wajda est, en quelque sorte, le cinéaste "officiel" de la Pologne, ce qui ne veut pas dire qu'il ménage le régime alors en place. Trop brûlant, le projet de L'homme de marbre (Czlowiek z marmuru) fut bloqué pendant treize ans. Avec aplomb, Wajda s'ingénie alors à traduire à l'intérieur-même de son film les difficultés qu'il a rencontré sur son propre chemin, en lui donnant la forme d'une enquête impossible, menée par Agnieszka, une jeune réalisatrice désireuse de se pencher, pour un travail de fin d'études en collaboration avec la télévision, sur la figure de Mateusz Birkut. Ce dernier fut, dans les années 50, l'un des "ouvriers de choc" mis sur un piédestal par le régime stalinien polonais. Du statut de héros populaire immortalisé dans le marbre et sur pellicule, Birkut passa brutalement à celui d'indésirable et finit par disparaître totalement de la circulation. Vingt ans plus tard, Agnieszka ausculte donc les archives filmées, rencontre des témoins toujours réticents, se heurte à sa hiérarchie et ne boucle pas son film... contrairement à Wajda. Elizaveta Ouvarova est une ancienne championne de tir au pistolet, mariée et mère de deux enfants. Très impliquée politiquement, elle obtient la place de maire de sa ville. Elle s'investit totalement dans sa mission, décidée notamment à construire un pont et une ville nouvelle sur l'autre rive, cela au risque de négliger sa vie familiale.
Elizaveta Ouvarova est une ancienne championne de tir au pistolet, mariée et mère de deux enfants. Très impliquée politiquement, elle obtient la place de maire de sa ville. Elle s'investit totalement dans sa mission, décidée notamment à construire un pont et une ville nouvelle sur l'autre rive, cela au risque de négliger sa vie familiale. L'œuf du serpent (The serpent's egg) titre mal-aimé de la filmographie bergmanienne, est une œuvre impure, soumise à une étonnante série de tiraillements qui nous retiennent de la placer aux côtés des plus grandes mais qui la rendent dans le même temps absolument captivante. Bien que le scénario fut écrit avant l'exil de Suède d'un Bergman poursuivi par l'administration fiscale et traîté sans ménagement par la presse de son pays, le tournage, effectué en Allemagne, sous les auspices généreux du producteur Dino de Laurentiis, permit au cinéaste de faire passer toute l'inquiétude que lui inspirait son déséquilibre mental de l'époque. Jamais il n'avait bénéficié d'un budget aussi conséquent, d'un temps de tournage aussi long et de moyens techniques aussi importants, notamment en termes de décors. En contrepartie, la limite la plus contraignante fut sans doute pour lui de tourner en anglais (et en allemand dans une moindre mesure).
L'œuf du serpent (The serpent's egg) titre mal-aimé de la filmographie bergmanienne, est une œuvre impure, soumise à une étonnante série de tiraillements qui nous retiennent de la placer aux côtés des plus grandes mais qui la rendent dans le même temps absolument captivante. Bien que le scénario fut écrit avant l'exil de Suède d'un Bergman poursuivi par l'administration fiscale et traîté sans ménagement par la presse de son pays, le tournage, effectué en Allemagne, sous les auspices généreux du producteur Dino de Laurentiis, permit au cinéaste de faire passer toute l'inquiétude que lui inspirait son déséquilibre mental de l'époque. Jamais il n'avait bénéficié d'un budget aussi conséquent, d'un temps de tournage aussi long et de moyens techniques aussi importants, notamment en termes de décors. En contrepartie, la limite la plus contraignante fut sans doute pour lui de tourner en anglais (et en allemand dans une moindre mesure). Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages est la première réalisation de Michel Audiard. Cela démarre sur un monologue de Marlène Jobert, préfigurant les apostrophes au spectateur qu'affectionnera un peu plus tard Bertrand Blier, en plus long et en moins saillant. En fait, pratiquement le quart du métrage est encombré par ce procédé (Jobert laissant parfois la parole à André Pousse, Mario David ou Bernard Blier) faisant ainsi patiner un récit qui n'est déjà pas particulièrement stimulant car ressassant toujours les mêmes histoires de règlements de comptes rigolards entre truands. Pour faire cinéaste, Audiard brise le rythme, façonne des gags cartoonesques (minables), insère des textes décalés en guise de débuts de chapitres. Les dialogues n'offrent aucune progression narrative, Audiard étant trop occupé à coller ses formules les unes aux autres. Même sortant de la bouche de Bernard Blier, ce déluge provoque vite la saturation. Marlène Jobert est supportable à condition de se boucher les oreilles en reluquant son joli corps régulièrement dénudé (et c'est encore la meilleure façon d'illustrer cette note). Au milieu de cette sinistre comédie, nous avons droit à une pitoyable parodie de comédie musicale à la Jacques Demy. On se moque aussi des hippies, du pop-art, de tout ce qui représente la jeunesse et on idolâtre ces vieilles flingueuses et ces vieux gangsters qui savent vivre, eux. Un film de gérontophile. Un film très con, pour parler comme son auteur.
Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages est la première réalisation de Michel Audiard. Cela démarre sur un monologue de Marlène Jobert, préfigurant les apostrophes au spectateur qu'affectionnera un peu plus tard Bertrand Blier, en plus long et en moins saillant. En fait, pratiquement le quart du métrage est encombré par ce procédé (Jobert laissant parfois la parole à André Pousse, Mario David ou Bernard Blier) faisant ainsi patiner un récit qui n'est déjà pas particulièrement stimulant car ressassant toujours les mêmes histoires de règlements de comptes rigolards entre truands. Pour faire cinéaste, Audiard brise le rythme, façonne des gags cartoonesques (minables), insère des textes décalés en guise de débuts de chapitres. Les dialogues n'offrent aucune progression narrative, Audiard étant trop occupé à coller ses formules les unes aux autres. Même sortant de la bouche de Bernard Blier, ce déluge provoque vite la saturation. Marlène Jobert est supportable à condition de se boucher les oreilles en reluquant son joli corps régulièrement dénudé (et c'est encore la meilleure façon d'illustrer cette note). Au milieu de cette sinistre comédie, nous avons droit à une pitoyable parodie de comédie musicale à la Jacques Demy. On se moque aussi des hippies, du pop-art, de tout ce qui représente la jeunesse et on idolâtre ces vieilles flingueuses et ces vieux gangsters qui savent vivre, eux. Un film de gérontophile. Un film très con, pour parler comme son auteur. Par rapport à la connerie, la crétinerie peut apparaître parfois plus sympathique. Le grand bazar est réputé pour être le "meilleur" film des Charlots. C'est peut-être vrai : c'est nul mais pas foncièrement déplaisant. Pendant une demie-heure, on relève quelques gags réussis, disons un sur quatre ou cinq, les autres étant affligeants. Le film bénéficie de l'abattage de Michel Galabru et de Michel Serrault. La sûreté de leur jeu, même dans un registre extrèmement limité comme celui qui leur est imposé, contraste avec l'amateurisme désespérant de celui des Charlots. Contrairement au titre précédemment évoqué, Le grand bazar capte (mal, mais il capte quand même) un certain air du temps avec son scénario anti-consumériste (la bataille que mène un petit commerçant contre un gérant de supermarché) et sa vision d'une banlieue peu attrayante. Comme Audiard avec Demy, Zidi fait lui aussi un renvoi cinéphilique en filmant Galabru partant à l'assaut de son concurrent au son du thème à l'harmonica créé par Morricone pour Il était une fois dans l'Ouest. L'écart, par son gigantisme, provoque un sourire bienveillant, loin du sentiment de mépris que véhicule la parodie d'Audiard. Cela dit, à la mi-parcours (à peu près à la coupure de pub !), ma relative indulgence s'est évaporée devant l'essoufflement du récit, la débilité continue des gags, l'étirement insupportable de certaines séquences comme celles du pillage du magasin et de la virée en boîte et la nullité du dénouement, totalement inoffensif, montrant les Charlots heureux de leur renoncement.
Par rapport à la connerie, la crétinerie peut apparaître parfois plus sympathique. Le grand bazar est réputé pour être le "meilleur" film des Charlots. C'est peut-être vrai : c'est nul mais pas foncièrement déplaisant. Pendant une demie-heure, on relève quelques gags réussis, disons un sur quatre ou cinq, les autres étant affligeants. Le film bénéficie de l'abattage de Michel Galabru et de Michel Serrault. La sûreté de leur jeu, même dans un registre extrèmement limité comme celui qui leur est imposé, contraste avec l'amateurisme désespérant de celui des Charlots. Contrairement au titre précédemment évoqué, Le grand bazar capte (mal, mais il capte quand même) un certain air du temps avec son scénario anti-consumériste (la bataille que mène un petit commerçant contre un gérant de supermarché) et sa vision d'une banlieue peu attrayante. Comme Audiard avec Demy, Zidi fait lui aussi un renvoi cinéphilique en filmant Galabru partant à l'assaut de son concurrent au son du thème à l'harmonica créé par Morricone pour Il était une fois dans l'Ouest. L'écart, par son gigantisme, provoque un sourire bienveillant, loin du sentiment de mépris que véhicule la parodie d'Audiard. Cela dit, à la mi-parcours (à peu près à la coupure de pub !), ma relative indulgence s'est évaporée devant l'essoufflement du récit, la débilité continue des gags, l'étirement insupportable de certaines séquences comme celles du pillage du magasin et de la virée en boîte et la nullité du dénouement, totalement inoffensif, montrant les Charlots heureux de leur renoncement. Un "sang mêlé" nommé Keoma revient dans sa région après avoir servi sous l'uniforme nordiste pendant la guerre de sécession. Son père, grande gâchette, est devenu simple fermier et ses trois demi-frères, qui ne l'ont jamais considéré comme l'un des leurs, sont passés sous les ordres du puissant propriétaire Caldwell. Ce dernier profite d'une épidémie de peste pour maintenir sous sa coupe la population du village.
Un "sang mêlé" nommé Keoma revient dans sa région après avoir servi sous l'uniforme nordiste pendant la guerre de sécession. Son père, grande gâchette, est devenu simple fermier et ses trois demi-frères, qui ne l'ont jamais considéré comme l'un des leurs, sont passés sous les ordres du puissant propriétaire Caldwell. Ce dernier profite d'une épidémie de peste pour maintenir sous sa coupe la population du village.
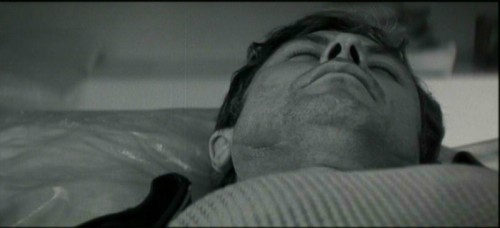
 Chouchouté par
Chouchouté par  Étranges étrangers est au centre de la nouvelle livraison de la collection "Histoire d'un film, mémoire d'une lutte", dirigée par Tangui Perron pour Scope Editions et Périphérie, centre de création cinématographique. Après un premier livre-dvd qui s'appuyait sur le film de Jean-Pierre Thorn, Le dos au mur, ce deuxième numéro confirme que nous tenons là l'une des initiatives éditoriales les plus passionnantes de ces dernières années, redonnant vie à des oeuvres cinématographiques militantes rares et les accompagnant d'une documentation extrèmement riche et instructive.
Étranges étrangers est au centre de la nouvelle livraison de la collection "Histoire d'un film, mémoire d'une lutte", dirigée par Tangui Perron pour Scope Editions et Périphérie, centre de création cinématographique. Après un premier livre-dvd qui s'appuyait sur le film de Jean-Pierre Thorn, Le dos au mur, ce deuxième numéro confirme que nous tenons là l'une des initiatives éditoriales les plus passionnantes de ces dernières années, redonnant vie à des oeuvres cinématographiques militantes rares et les accompagnant d'une documentation extrèmement riche et instructive.