



****/****/****/****
Troisième voyage dans la filmographie de Gérard Courant (le premier ici, le deuxième là), toujours grâce à son aimable concours.
Les deux films les plus anciens de ce lot procurent un sentiment comparable, celui d'assister à une expérience limite bouleversant notre rapport au récit cinématographique et posant une quantité de questions sur la nature même de cet art, l'aspect "ouvert à tous vents" (à toutes les interprétations) caractérisant ces propositions pouvant parfois décourager.
A travers Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier, Gérard Courant semble se (nous) poser la question suivante : A partir de quand une image animée devient du cinéma ? Pour tenter d'y répondre, il part à peu près du même point que pour ses Cinématons. Il convoque cinq modèles (Marie-Noëlle Kaufmann, Gina Lola Benzima, Tessa Volkine, F.J. Ossang et Philippe Garrel) et les laisse improviser ou simplement prendre la pose dans divers endroits, seuls ou en groupe.
L'unité rythmique de la série de séquences obtenues ne semble trouvée qu'à l'aide de la bande son, exclusivement de nature musicale. C'est elle qui donne le mieux le sentiment de la possibilité d'un récit et d'un sens. La musique, entendue sur de très longues plages, est de trois sortes : classique, électronique et punk. Le film démontre toute l'importance qu'elle peut avoir dès qu'elle est plaquée sur des images, toutes les variations qu'elle peut apporter. Plus elle est contemporaine, plus elle tire vers le réel, le document (comme ici lors d'un concert du groupe de F.J. Ossang). A cette actualité et ce côté brut s'oppose le lyrisme de l'opéra. Une distance se crée et ce recul permet l'installation d'un récit d'une part et de l'intemporalité d'autre part. Accompagnant une prise de vue, un portrait en mouvement, la musique apporte un surcroît d’émotion. Ici, elle magnifie en premier lieu les plans consacrés à Marie-Noëlle Kaufmann, figure des plus cinégéniques. Ne rien faire d’autre qu'être là, bouger à peine, mais avec l’assurance de capter le regard…
Comme beaucoup de travaux de Gérard Courant, celui-ci nous renvoie à l’histoire ancienne du cinéma, au muet accompagné de musique, et au temps des mythes Garbo, Dietrich ou Monroe, dont les visages apparaissent plusieurs fois sur l’écran. Toutefois, les liens existant entre les images assemblées restent obscurs et, à mon goût personnel, trop lâches.
Le questionnement se prolonge devant She’s a very nice lady, autre défi narratif. Avant une plus grande ouverture dans son dernier mouvement, ce film "improvisé par Gérard Courant", selon son générique, repose essentiellement sur trois sources d’images : des plans nocturnes de circulation automobile, des portraits filmés de deux femmes (et d’un enfant), toujours dans le style Cinématon, et des images de Gene Tierney dans le très beau Péché mortel de John Stahl (1945), diffusées sur un écran de télévision, enregistrées et retravaillées par des ralentis, des recadrages ou des teintures. Le montage fait alterner ces différentes vues, au rythme de la musique dont le rôle est de déterminer en fait la durée des séquences qui, sans elle, ne pourraient être distinguées les unes des autres. Le spectre musical va de Brian Eno à Richard Wagner. Les morceaux utilisés sont répétitifs et, parfois, répétés. Les images peuvent l’être aussi et comme la captation de celles de Gene Tierney génère un effet stroboscopique, l’hypnose n’est pas loin.
L’idée de récit, elle, s’éloigne encore, malgré la proposition faite par le cinéaste sur la jaquette de son DVD. Courant y raconte une histoire précise, mais qui pourrait tout aussi bien ne pas être prise en considération et être remplacée dans la tête du spectateur du film par une autre. Si celui-ci tient à le faire… Pour ma part, j’ai abandonné rapidement la recherche d’un fil conducteur. Il me restait alors à observer ces instantanés, ces altérations d’images, ces jeux de lumières sur ces visages, et à m’interroger sur le cinéma... Y a-t-il une équivalence entre la star de la fiction et le simple modèle ? Ce qui émane de leur présence à l’écran est-il du même ordre ? Leurs images, mises côte-à-côte, dialoguent-elles ensemble ? Se produit-il un écho à partir du cinéma classique hollywoodien ? Qu’est-ce qui se crée dès qu’une caméra tourne ?
Et encore : Comment garder un moment de cinéma et le faire sien ? Derrière cette question-là se niche sans doute ce qui fait de She’s a very nice lady un film très personnel : la recherche d’une conservation. Celle des plans d’un film (d’une actrice) aimé(e) ou celle des traces de la présence des proches. Le sentiment nostalgique qui découle de cet essai cinématographique vient de là.
Devant ces deux films, trouver sa place n’est pas évident. On peut hésiter longtemps entre l’abandon à la pure sensation et la réflexion permanente. L’équilibre est difficile à tenir sur 90 minutes, l’esprit a tendance à divaguer et à fatiguer, et je pense qu’il vaut mieux faire son choix clairement, dès le départ, pour profiter pleinement de l’expérience, ce que je n’ai pas su (ou pu) faire. Cette veine expérimentale de l’œuvre de Gérard Courant n’est apparemment pas celle à laquelle je suis le plus sensible.
Avec Carnet de Nice, nous nous trouvons dans un registre voisin, toujours assez expérimental mais plus direct, moins réflexif. Nous sommes dans la série des Carnets filmés, là où Gérard Courant donne naissance à l’équivalent d’un journal intime rendant compte de ses voyages. Ici, le prétexte est un séjour niçois durant le temps d’un weekend de novembre 2010.
Débutant avec l’arrivée en train du cinéaste, le film nous montre la promenade des Anglais de manière tout à fait originale : les images enregistrées au rythme du marcheur défilent à l’écran en accéléré. Cette compression produit un drôle d’effet visuel et sonore. Bien qu’encore très longue, la séquence acquiert ainsi une durée supportable, mais c’est surtout la puissance sonore que l’on retient. Le son direct compressé donne un brouhaha assourdissant dès que le moindre roller double le cinéaste-arpenteur. De plus, nous sommes pris en tenaille par les bruits de la circulation sur la voie principale et celui de la mer, régulier et monotone. L’idée est toute simple mais traduit parfaitement la sensation que procure ce genre de ville côtière.
Après la balade, Gérard Courant filme des bribes des Rencontres Cinéma et Vidéo de Nice, festival dont il est l’invité, ainsi que l’envers du décor de quelques Cinématons tournés à l’occasion. Sa mise en scène de la présentation en public de ses propres œuvres, effectuée par l’un de ses meilleurs connaisseurs, Vincent Roussel, est très astucieuse. Il superpose aux images de l’intervenant en train de parler de son cinéma celles du Cinématon que ce dernier avait tourné précédemment. Dans ce Cinématon, Vincent Roussel présente à la caméra divers objets culturels bien choisis (livres, DVD) et donc, en même temps, par transparence, il présente sur scène l’œuvre de Gérard Courant, qui, par ce collage, présente à son tour Vincent Roussel...
La dernière partie de Carnet de Nice est essentiellement consacrée à une autre promenade au bord de la mer. On y voit comme en direct les prises de vue se faire selon l’instinct du cinéaste. Il marche et il filme, il cherche des idées de cadrage, en trouve parfois, pas toujours. Il faut accepter cette règle du jeu, ne pas avoir peur de passer par des moments d’ennui. Dans cette série de plans, on voit les ratures et les traits qui se précisent. Gérard Courant filme les flots inlassablement, tente de jouer sur les échelles de plans, du lointain au détail grossi, sur la lumière et les reflets, et obtient quelques belles images touchant à l’abstraction. Avec ce long final, on s’aperçoit que la mer ne nous a jamais vraiment quitté et qu’elle ne nous a guère laissé de répit au cours de ce séjour à Nice.
Le quatrième film de cette livraison appartient lui aussi à une série, intitulée Mes villes d’habitation, dont il constitue le troisième volet. A travers l’univers est consacré à Saint-Marcellin, ville de l’Isère de 8 000 habitants dans laquelle Gérard Courant a passé une partie de son enfance dans les années cinquante. Le principe est ici de filmer une à une toutes les rues et les places du lieu. Chaque vue est précédée d’un plan sur la plaque nominative et dure une vingtaine de secondes. Pendant 1h18 sont donc listées les 127 rues et les 17 places d’une ville que la majorité d’entre nous n’a jamais traversé ni même, probablement, jamais entendu parler. A priori, ce programme est des plus austères et fait plutôt fuir... A posteriori, l’expérience est particulièrement vivifiante...
Commençons par la question récurrente : Est-ce un film, est-ce du cinéma ? Réponse : Oui. 144 fois oui. Pour chaque prise de vue, Gérard Courant s’impose une fixité du cadre. Le choix de l’endroit où il pose sa caméra pour filmer la voie est donc, déjà, primordial. Ensuite, cette fixité renforce la conscience des limites physiques de l’image et, par extension, du hors-champ. Celui-ci à tout autant d’importance que le champ, que ce soit sur le plan visuel (les entrées et les sorties) ou, surtout, sonore (tous les bruits dont on ne voit pas l’origine, les bribes de conversation de passants invisibles, les pleurs ou les cris d’enfants...).
La durée de chaque vue est la même. Enfin... sensiblement la même, car il m’a semblé qu’elle pouvait varier de quelques secondes. En effet, Courant choisit avec précautions l’endroit de ses coupes, dans le but de créer une véritable dynamique à partir du réel qu’il enregistre. Ce réel est en fait tiré vers des formes de micro-récits et, compte tenu de la courte durée de chaque plan, c’est bien le soin apporté à leur ouverture et leur clôture qui donne ce sentiment. Ainsi, le film est fait de 144 scènes. Un ballet automobile, un coup de klaxon, un salut adressé au caméraman, la trajectoire d’un piéton, l’apparition d’un chat, le reflet d’une vitre, l’attente d’une vieille dame : ces petits riens font l’événement et suffisent. Notre œil et notre oreille s’exercent. Nous sommes en état d’alerte toutes les vingt secondes, à l’affût de quelque chose (et parfois, nous est octroyée, simplement, une pause). Assurément, tout est affaire de regard. Le nôtre, aiguillé par celui du cinéaste. A travers l’univers, malgré la rigueur de son dispositif, n’a vraiment rien à voir avec de la vidéo-surveillance.
Il serait toutefois abusif de vous promettre du rire, de l’action et de l’émotion. Quoi que… L’humour est bien présent. On s’amuse bien sûr en voyant la plaque de la Rue de la Liberté complétée à la bombe par un cinglant "de mon cul", mais également en découvrant qu’un bruit pétaradant de scooter annonce l’arrivée dans le cadre... d’un cycliste. Tel déplacement, telle attitude, peuvent de même prêter à sourire. L’action, elle, est assurée grâce à la position particulière que choisit parfois le cinéaste : en bout de rue, probablement sur un trottoir faisant face à un stop. Dans le cadre, les voitures avancent donc vers nous et la question de savoir si elles vont vraiment tourner au dernier moment se pose… Quant à l’émotion, elle jaillit au générique de fin lorsque Barbara entonne Mon enfance sur des photos de Saint-Marcellin. La chanteuse y a en effet passé une partie de la guerre, réfugiée avec sa famille juive.
Dans les choix du cinéaste, un autre me paraît très important : la succession des rues à l’écran dans l’ordre alphabétique. A l’inverse d’une approche par quartier par exemple, ce déroulement assure un panachage qui ménage les surprises. D'une rue à l'autre, tout peut changer. Les violents contrastes visuels et sonores sont réguliers car nous passons sans transition d'une artère de grande circulation automobile à une rue au calme résidentiel ou à une route menant vers la campagne où chantent les oiseaux.
A nouveau voici un film sous-tendu par l'idée de conservation, de la fixation d'un présent qui pourrait éclairer un futur. A travers l'univers est un travail pour demain. Mais vu aujourd'hui, c'est avant tout un film contemporain qui, malgré la modestie de sa forme, nous fait partager de la manière la plus juste qui soit l'expérience de la vie dans nos villes françaises.
 JE MEURS DE SOIF, J'ÉTOUFFE, JE NE PUIS CRIER
JE MEURS DE SOIF, J'ÉTOUFFE, JE NE PUIS CRIER
SHE'S A VERY NICE LADY
CARNET DE NICE (Carnet filmé : 19 novembre 2010 - 22 novembre 2010)
Á TRAVERS L'UNIVERS
de Gérard Courant
(France / 67 min, 90 min, 81 min, 79 min / 1979, 1982, 2010, 2005)

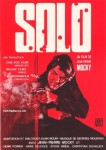 SOLO
SOLO
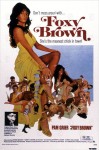 FOXY BROWN
FOXY BROWN


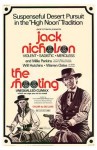
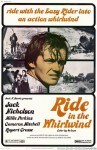
 THE SHOOTING (ou LA MORT TRAGIQUE DE LELAND DRUM)
THE SHOOTING (ou LA MORT TRAGIQUE DE LELAND DRUM)



 JE MEURS DE SOIF, J'ÉTOUFFE, JE NE PUIS CRIER
JE MEURS DE SOIF, J'ÉTOUFFE, JE NE PUIS CRIER

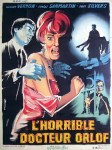
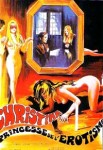 L'HORRIBLE DOCTEUR ORLOF (Gritos en la noche)
L'HORRIBLE DOCTEUR ORLOF (Gritos en la noche)
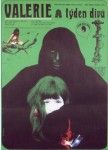 VALÉRIE AU PAYS DES MERVEILLES (Valerie a tyden divu)
VALÉRIE AU PAYS DES MERVEILLES (Valerie a tyden divu)
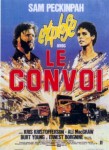 LE CONVOI (Convoy)
LE CONVOI (Convoy)
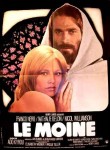 LE MOINE
LE MOINE



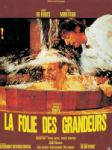
 CHANTONS SOUS LA PLUIE (Singin' in the rain)
CHANTONS SOUS LA PLUIE (Singin' in the rain)
 LES MILLE ET UNE NUITS (Il fiore delle mille e una notte)
LES MILLE ET UNE NUITS (Il fiore delle mille e una notte)