
On attend tellement du cinéma, on espère tant trouver de quoi nous nourrir même lorsque l'on fait le choix de film le plus incertain, le plus hasardeux et le plus téméraire au regard de nos goûts habituels, que l'attente est parfois mal récompensée, la chute brutale et la désillusion radicale. Ainsi, ayant été hypnotisé, un soir déjà lointain, lors de la diffusion télévisée de ce grand documentaire qu'est En construccion (2000), je suis parti plein d'entrain, l'été dernier, à la découverte du cinéma de son auteur, l'Espagnol José Luis Guerin. L'illusion n'a pas perduré.
Los Motivos de Berta (1983) est la chronique de quelques jours dans la vie d'une petite campagnarde, passée au prisme de son imaginaire. Sous la forte influence, assumée, du Victor Erice de L'Esprit de la ruche, un récit étrange tente de se mettre en place, tout en longs plans ciselés en noir et blanc. Mais il a tôt fait de se déliter et le mystère qui l'accompagne, au lieu de s'épaissir, finit par s'éventer et disparaître au-delà des champs de Castille, rêvés ou bien réels, dans le sillage d'une Arielle Dombasle chevauchant, en robe blanche et perruque.
Innisfree (1990) est une relecture de L'Homme tranquille de John Ford, un documentaire-hommage réalisé sur les terres irlandaises de son tournage en 1951. Alternant rares extraits et prises de vue sur place, l'œuvre a la (non-)forme de la déambulation. Elle n'offre pas plus de progression émotionnelle qu'elle ne dévoile de but particulier. Malgré un découpage plutôt vif, les séquences-blocs semblent ne jamais vouloir se clore. Des scènes de pub flirtent avec l'insupportable, des enfants de l'école racontent les scènes du film, des reconstitutions sont esquissées... A chaque instant, l'articulation entre les deux films, espacés de quarante années, manque cruellement.
Tren de sombras / Le Spectre de Thuit (1997) est l'auscultation, à la Blow up, d'une série d'images. Présentées comme des reliques des années vingt, bobines à usage familial appartenant à un riche amateur de l'époque, quelque chose nous dit qu'elles tiennent de l'aimable supercherie. Guerin les donne d'abord à voir telles quelles, avant de s'en approcher au plus près, de les grossir, de les ralentir. Sur le papier passionnant, le projet s'abîme dans une réalisation tâtonnante, répétitive et imprécise dans la mise à jour des rapports qu'elle est supposée dégager. Conscient de cette opacité, Guerin finit par reconstituer et montrer le contrechamp de ces images, montrer le filmeur : tout cela est donc bien laborieux. Cherchant, en parallèle, le spectre du passé dans le présent, le cinéaste en passe de surcroît par de longs tunnels de plans sur une nature indéchiffrable qui achèvent en nous l'espoir qui subsistait malgré tout, lorsque nous contemplions un beau visage de jeune fille.
Dans la ville de Sylvia (2007) est un film à la teneur en fiction plus prononcée. Il est coupé par trois cartons annonçant autant de nuits (alors que la quasi-totalité du récit se passe de jour), bornes qui n'ont pas d'intérêt particulier. Entre elles, un récit ou plutôt son esquisse, avec ce que cela comporte d'inachevé et d'insatisfaisant. Cette esquisse a, cette fois-ci, il est vrai, le mérite d'épouser parfaitement l'idée originelle. Car Guerin filme ici comme son personnage principal, à longueur de journée, dessine, en reprenant son geste, en l'ajustant, et en laissant même le vent tourner les pages/les plans. Guerin filme aussi comme le jeune homme regarde, captant à distance des bribes de conversations, observant de loin comment peuvent se composer des formes, tentant de saisir un peu de la beauté intérieure de chaque jolie femme croisée en terrasse ou dans les rues. Eloge de la ville, de la marche, de l'observation, de la présence des femmes, le film est léger comme une plume, volatil comme une goutte de parfum.
José Luis Guerin m'a laissé là, dubitatif et presque endolori par la vision de ces œuvres dans lesquelles plusieurs séquences semblent conclusives mais recèlent finalement de nouvelles et timides relances pour aboutir à cette impression de longueur excessive et sans enjeu apparent, cette impression que les quatre-vingt-dix minutes annoncées généralement se sont transformées en trois heures.

 [•REC]
[•REC]

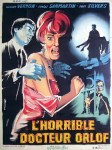
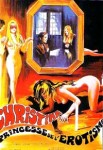 L'HORRIBLE DOCTEUR ORLOF (Gritos en la noche)
L'HORRIBLE DOCTEUR ORLOF (Gritos en la noche)
 LA PIEL QUE HABITO
LA PIEL QUE HABITO Puissant. Sans doute trop. Et aussi trop chargé, trop long, trop large serait-on tenté d'ajouter à la suite. Je me demande toutefois s'il n'est pas un peu vain de se plaindre ainsi car cela revient en fait à regretter qu'Iñarritu n'aille pas assez contre sa nature. Or, il faut bien reconnaître que, sur bien des points, il a mis la pédale douce par rapport à son précédent film, Babel, et que sa décision de se passer dorénavant de son encombrant scénariste Guillermo Arriaga lui a été bénéfique et lui ouvre de nouveaux horizons, cette collaboration, après deux réussites spectaculaires, ayant montré crûment ses limites au troisième essai.
Puissant. Sans doute trop. Et aussi trop chargé, trop long, trop large serait-on tenté d'ajouter à la suite. Je me demande toutefois s'il n'est pas un peu vain de se plaindre ainsi car cela revient en fait à regretter qu'Iñarritu n'aille pas assez contre sa nature. Or, il faut bien reconnaître que, sur bien des points, il a mis la pédale douce par rapport à son précédent film, Babel, et que sa décision de se passer dorénavant de son encombrant scénariste Guillermo Arriaga lui a été bénéfique et lui ouvre de nouveaux horizons, cette collaboration, après deux réussites spectaculaires, ayant montré crûment ses limites au troisième essai. Avec Le Tsar, Pavel Louguine tente un pari ambitieux, celui de dénoncer le despotisme à travers la figure bien connue d'Ivan le Terrible (1530-1584). S'attachant à décrire quelques mois, parmi les plus violents, du règne de ce dernier, il veut à la fois nous plonger dans une ambiance de terreur mystique et proposer une réflexion sur le pouvoir absolu. Ainsi a-t-on connaissance de diverses intrigues de cour, plus ou moins passionnantes, sans grande surprise la plupart du temps, tant le point de départ du récit paraît vérouillé (un grand religieux, ami du tsar, tente d'infléchir la politique destructrice d'Ivan, jusqu'àu sacrifice).
Avec Le Tsar, Pavel Louguine tente un pari ambitieux, celui de dénoncer le despotisme à travers la figure bien connue d'Ivan le Terrible (1530-1584). S'attachant à décrire quelques mois, parmi les plus violents, du règne de ce dernier, il veut à la fois nous plonger dans une ambiance de terreur mystique et proposer une réflexion sur le pouvoir absolu. Ainsi a-t-on connaissance de diverses intrigues de cour, plus ou moins passionnantes, sans grande surprise la plupart du temps, tant le point de départ du récit paraît vérouillé (un grand religieux, ami du tsar, tente d'infléchir la politique destructrice d'Ivan, jusqu'àu sacrifice). Plus navrant encore est l'échec d'Agora. Le présence derrière la caméra d'Alejandro Amenabar, touche-à-tout réputé (
Plus navrant encore est l'échec d'Agora. Le présence derrière la caméra d'Alejandro Amenabar, touche-à-tout réputé ( Seul long-métrage cinéma d'Almodovar qui manquait jusqu'à présent à mon tableau de chasse, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? (Qué he hecho yo para merecer hesto !!) trouve parfaitement sa place en tant qu'oeuvre de transition entre la première période du cinéaste (ses trois premiers films "officiels", provocateurs, foutraques, débraillés et très underground) et la deuxième (celle qui le voit accéder au statut d'auteur européen d'envergure, à partir de la deuxième moitié de la décennie 80).
Seul long-métrage cinéma d'Almodovar qui manquait jusqu'à présent à mon tableau de chasse, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? (Qué he hecho yo para merecer hesto !!) trouve parfaitement sa place en tant qu'oeuvre de transition entre la première période du cinéaste (ses trois premiers films "officiels", provocateurs, foutraques, débraillés et très underground) et la deuxième (celle qui le voit accéder au statut d'auteur européen d'envergure, à partir de la deuxième moitié de la décennie 80). Etreintes brisées (Los abrazos rotos) m'a laissé insatisfait. Je précise tout d'abord que l'une des raisons est indépendante du film lui-même : je ne l'ai pas "entendu" correctement. Problème de copie ou de salle, le son était faible et très mal équilibré. Difficile de se concentrer dans ces conditions. Malheureusement, ma déception n'est pas uniquement dûe aux mésaventures de la technique.
Etreintes brisées (Los abrazos rotos) m'a laissé insatisfait. Je précise tout d'abord que l'une des raisons est indépendante du film lui-même : je ne l'ai pas "entendu" correctement. Problème de copie ou de salle, le son était faible et très mal équilibré. Difficile de se concentrer dans ces conditions. Malheureusement, ma déception n'est pas uniquement dûe aux mésaventures de la technique. Cristina prend un verre à la terrasse d'un café, en compagnie de Vicky et son mari Doug. Elle leur avoue avoir fait l'amour avec Maria Elena, l'ex de son amant Juan Antonio. Un flashback s'amorce pour illustrer la scène en question. Passés les premiers baisers et caresses, nous revenons au présent, à la terrasse, pour continuer le dialogue. Cristina et Vicky sont filmées côte à côte, se détachant d'un fond animé, dissemblables mais complices, parlant avec naturel et sérieux. Suit alors le contrechamp sur Doug, cadré seul, sans rien autour de lui, comme aspiré par le vide de la perspective. Sa défense d'une sexualité "normale" cache bien mal son trouble, suscité par la superposition de cette vision de sa femme et son amie, réunies face à lui, et des propos de cette dernière.
Cristina prend un verre à la terrasse d'un café, en compagnie de Vicky et son mari Doug. Elle leur avoue avoir fait l'amour avec Maria Elena, l'ex de son amant Juan Antonio. Un flashback s'amorce pour illustrer la scène en question. Passés les premiers baisers et caresses, nous revenons au présent, à la terrasse, pour continuer le dialogue. Cristina et Vicky sont filmées côte à côte, se détachant d'un fond animé, dissemblables mais complices, parlant avec naturel et sérieux. Suit alors le contrechamp sur Doug, cadré seul, sans rien autour de lui, comme aspiré par le vide de la perspective. Sa défense d'une sexualité "normale" cache bien mal son trouble, suscité par la superposition de cette vision de sa femme et son amie, réunies face à lui, et des propos de cette dernière. M'étant enfin décidé à aller voir L'orphelinat (El orfanato), repris à l'occasion de la Fête du Cinéma, je me disais que je pourrai débuter ma note sur ce film, qui ne pouvait manquer d'être intéressant, par un parallèle (drôle et pertinent, personne n'en doute je l'espère) entre l'actuelle bonne santé du cinéma espagnol et la victoire méritée de leur équipe nationale à l'Euro de foot. Mais voilà qu'une simple phrase fit voler en éclats ma résolution. Elle fut entendue lors de l'achat de ma place : "Je vous préviens, on vient de m'annoncer que le film est en VF et non en VO comme prévu". Grimace et demande d'un temps de réflexion. Trois possibilités. La première : tenter vaille que vaille de faire abstraction du doublage, en se disant qu'il ne doit rien y avoir de plus ressemblant à un cri de terreur en espagnol qu'un cri de terreur en français. La deuxième : choisir un autre film, sachant que le Desplechin est déjà vu et qu'il ne reste que Sagan et J'ai toujours rêvé d'être gangster(vraiment, mais alors vraiment pas envie du tout, ni de l'un ni de l'autre). La troisième : refaire dans l'autre sens 25 minutes de bagnole en râlant. Je choisis la réponse A. La soirée commençait donc mi-figue mi-raisin et ma réception du film doit se moduler du coefficient correcteur VF.
M'étant enfin décidé à aller voir L'orphelinat (El orfanato), repris à l'occasion de la Fête du Cinéma, je me disais que je pourrai débuter ma note sur ce film, qui ne pouvait manquer d'être intéressant, par un parallèle (drôle et pertinent, personne n'en doute je l'espère) entre l'actuelle bonne santé du cinéma espagnol et la victoire méritée de leur équipe nationale à l'Euro de foot. Mais voilà qu'une simple phrase fit voler en éclats ma résolution. Elle fut entendue lors de l'achat de ma place : "Je vous préviens, on vient de m'annoncer que le film est en VF et non en VO comme prévu". Grimace et demande d'un temps de réflexion. Trois possibilités. La première : tenter vaille que vaille de faire abstraction du doublage, en se disant qu'il ne doit rien y avoir de plus ressemblant à un cri de terreur en espagnol qu'un cri de terreur en français. La deuxième : choisir un autre film, sachant que le Desplechin est déjà vu et qu'il ne reste que Sagan et J'ai toujours rêvé d'être gangster(vraiment, mais alors vraiment pas envie du tout, ni de l'un ni de l'autre). La troisième : refaire dans l'autre sens 25 minutes de bagnole en râlant. Je choisis la réponse A. La soirée commençait donc mi-figue mi-raisin et ma réception du film doit se moduler du coefficient correcteur VF.