(W.S. Van Dyke / Etats-Unis / 1932)
■■□□
 Revoir ce Tarzan, des années après, c'est replonger dans le cinéma hollywoodien des débuts du parlant. A cet égard, le film est passionnant en tant que symbole de cet art-là : simple, populaire, très "premier degré". Au-delà du jugement, une certaine nostalgie affleure : celle que l'on éprouve en se disant que l'on appartient sans doute à la dernière génération qui aura grandit aussi avec ces films-là. La télévision rejetant dorénavant toute diffusion de film ancien, nul doute que pour le jeune public actuel, Tarzan n'a plus les traits de Johnny Weissmuller ni Robin des Bois ceux d'Errol Flynn.
Revoir ce Tarzan, des années après, c'est replonger dans le cinéma hollywoodien des débuts du parlant. A cet égard, le film est passionnant en tant que symbole de cet art-là : simple, populaire, très "premier degré". Au-delà du jugement, une certaine nostalgie affleure : celle que l'on éprouve en se disant que l'on appartient sans doute à la dernière génération qui aura grandit aussi avec ces films-là. La télévision rejetant dorénavant toute diffusion de film ancien, nul doute que pour le jeune public actuel, Tarzan n'a plus les traits de Johnny Weissmuller ni Robin des Bois ceux d'Errol Flynn.
Techniquement, le début est très gênant. Transparences et raccords sont grossiers, telle la promenade de Jane et son père devant des tribus africaines. Cet abus d'écrans pour des scènes manifestement tournées en studio, si déroutant, autant broder dessus : cela matérialiserait donc le refus par les occidentaux du contact avec l'autre. Petit à petit, ils prendront conscience et intégreront le même plan que les animaux et les indigènes. Tarzan, lui, se bat avec de vrais fauves, dans le même cadre, et non à distance de fusil, aidé par les coupures du montage, à la façon des explorateurs repoussant l'attaque de leurs radeaux par les hippopotames.
Signe de l'époque, le racisme sous-jacent apparaît ça et là. Les Noirs sont traités comme des Indiens de western. La charge finale des éléphants sur le village des méchants pygmées, c'est la cavalerie qui arrive. Un dialogue énorme lorsqu'un porteur noir chute dans le vide entre deux explorateurs :
- Que contenait la malle ?
- Des médicaments !
- Pauvre diable...
- On ne peut plus rien pour lui.
Mais il reste, en plus du charme du primitivisme et de l'iconographie, la belle séquence centrale de l'enlèvement de Jane. L'impossibilité de l'échange par la parole et la fascination pour le sauvage sont remarquablement rendus. Ces moments de sensualité cristallisent ce fantasme d'une femme pour un corps fort et non civilisé. Pas d'extrapolation ici, revoyez le film : Jane s'offre et veut clairement se faire un homme-singe.
 Assez différent des films précédents de son auteur, celui-ci s'avère l'un de ses plus réussis. Le changement radical de paysage (le sud du Maroc) s'est avéré particulièrement fécond pour Doillon (mais pour l'instant sans lendemain, celui-ci ayant apparemment de plus en plus de mal à financer ses projets).
Assez différent des films précédents de son auteur, celui-ci s'avère l'un de ses plus réussis. Le changement radical de paysage (le sud du Maroc) s'est avéré particulièrement fécond pour Doillon (mais pour l'instant sans lendemain, celui-ci ayant apparemment de plus en plus de mal à financer ses projets). David Fincher est connu pour ses constructions scénaristiques complexes et pour sa mise en scène virtuose. Pour ma part, je trouvais que ce talent visuel fonctionnait à plein dans Seven, un peu moins dans The game, puis plus du tout dans Fight club (je n'avais rien trouvé de particulier à son volet d'Alien et je n'ai pas vu Panic room). C'est avec plaisir que j'ai donc constaté dans son récent Zodiac la maîtrise d'une mise en scène plus classique. Fincher n'y abuse pas d'effets gratuits, ni de retournements douteux.
David Fincher est connu pour ses constructions scénaristiques complexes et pour sa mise en scène virtuose. Pour ma part, je trouvais que ce talent visuel fonctionnait à plein dans Seven, un peu moins dans The game, puis plus du tout dans Fight club (je n'avais rien trouvé de particulier à son volet d'Alien et je n'ai pas vu Panic room). C'est avec plaisir que j'ai donc constaté dans son récent Zodiac la maîtrise d'une mise en scène plus classique. Fincher n'y abuse pas d'effets gratuits, ni de retournements douteux.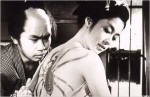 L'argument de Tatouage pourrait donner un petit conte horrifique et érotique de série B. L'amour contrarié d'une jeune femme pour le commis de son père la pousse à s'enfuir. Enlevée, poussée vers la prostitution, elle se fait tatouer de force une gigantesque araignée dans le dos. Dès lors, les cadavres s'accumuleront autour d'elle. Masumura place audacieusement la scène du tatouage en tout début de film avant de revenir en arrière, sans crier gare, et de déployer tout son récit, procédé intriguant et déstabilisant. Autre qualité qui éloigne le film du tout-venant : le soin apporté aux cadrages (et sur-cadrages : d'innombrables plans sont obstrués dans leur partie gauche par un élément du décor).
L'argument de Tatouage pourrait donner un petit conte horrifique et érotique de série B. L'amour contrarié d'une jeune femme pour le commis de son père la pousse à s'enfuir. Enlevée, poussée vers la prostitution, elle se fait tatouer de force une gigantesque araignée dans le dos. Dès lors, les cadavres s'accumuleront autour d'elle. Masumura place audacieusement la scène du tatouage en tout début de film avant de revenir en arrière, sans crier gare, et de déployer tout son récit, procédé intriguant et déstabilisant. Autre qualité qui éloigne le film du tout-venant : le soin apporté aux cadrages (et sur-cadrages : d'innombrables plans sont obstrués dans leur partie gauche par un élément du décor). Moins abouti, La bête aveugle révèle des comportements tout aussi tordus. L'aveugle du titre kidnappe une top model afin de réaliser une sculpture unique dans son atelier-prison. Bien réalisé, la partie séquestration développe des étapes trop classiques (rébellion, duperies pour s'échapper...). La psychologie des personnages n'est pas le point fort du film non plus, l'aveugle vivant par exemple reclus avec sa mère. Ce ménage à trois produit tout de même des moments troublants ou étonnants (la scène de séduction sous le regard de la mère, le retournement de celle-ci pour aider à une évasion).
Moins abouti, La bête aveugle révèle des comportements tout aussi tordus. L'aveugle du titre kidnappe une top model afin de réaliser une sculpture unique dans son atelier-prison. Bien réalisé, la partie séquestration développe des étapes trop classiques (rébellion, duperies pour s'échapper...). La psychologie des personnages n'est pas le point fort du film non plus, l'aveugle vivant par exemple reclus avec sa mère. Ce ménage à trois produit tout de même des moments troublants ou étonnants (la scène de séduction sous le regard de la mère, le retournement de celle-ci pour aider à une évasion). Hasard d'une première note liée à la nouvelle vision du film de Tavernier sur Arte. Que la fête commence donc, mais qu'elle se finisse mieux.
Hasard d'une première note liée à la nouvelle vision du film de Tavernier sur Arte. Que la fête commence donc, mais qu'elle se finisse mieux.