(Claude Chabrol / France / 1970)
■■■■
Présenter de manière publicitaire Le boucher comme étant un "film criminel campagnard" pourrait faire sourire si Claude Chabrol lui-même ne prenait un malin plaisir à y glisser quelques séquences jouant sur cette apparente incongruité. Il en va ainsi des plans décrivant l'arrivée des gendarmes dans le village : la camionnette des fonctionnaires se glisse dans le décor, entre les poules du premier plan et le bâtiment municipal du fond, puis les képis traversent le champ dans le dos des enfants occupés à jouer dans la cour de l'école. Plus tard, de façon moins appuyée, le va-et-vient des véhicules à gyrophares dans la rue donnera son rythme à la scène se déroulant à l'intérieur de la boucherie de Popaul : au premier plan, la comédie villageoise, à l'arrière-plan, le drame criminel.
Cette légère ironie ne retombe pas cependant sur les personnages, quelque soit leur importance. Au cours du bal de mariage, on remarque cet homme dansant si bizarrement, celui que l'on pourrait décrire comme "le simplet du village". Or, sa silhouette reviendra plus tard, lors de l'enterrement de la mariée, pour porter la croix du début de cortège. Chabrol le filme en plan large, ne le désigne pas. C'est assez long pour permettre la reconnaissance mais trop court pour faire afficher un sourire en coin. Nul pittoresque donc, dans ce tableau de la "France profonde" (c'est plutôt l'officier de police dépêché par Bordeaux qui affiche les signes les plus risibles : blouson et chapeau de flic), mais bien le maintien d'une attention réaliste, se déployant à l'intérieur de l'une des plus belles et des plus limpides mises en scène de Claude Chabrol.

A la sortie du bal, un plan-séquence en traveling arrière accompagne Melle Hélène et Popaul de la salle des fêtes jusqu'à la place de l'école (la musique de la fête se laisse entendre tout du long, jusqu'à l'arrivée près de l'église, où les cloches prennent le relais). Ensuite, nous parcourons l'appartement d'Hélène en la suivant dans ses occupations. La séquence, non dramatique, prolonge rythmiquement celle de la promenade et prépare la scénographie des futures visites de Popaul. Chabrol trouve dans Le boucher un équilibre parfait dans ses effets de mise en scène, jamais ostentatoires ni répétés. De très beaux zooms parsèment la séquence du bal, une légère plongée coince un instant Hélène dans son appartement, un écran noir suspend le temps lors de l'ultime visite, une série de magnifiques plans fixes du visage de Stéphane Audran intriguent fortement sur la fin... La fluidité de l'ensemble empêche de ne voir là que des trucs de technicien. Chabrol prend soin de varier les ambiances, dénouant le drame dans la nuit alors que son film était jusque là très solaire. Il boucle également son récit, en écho à la promenade du début, par une course en voiture vers l'hôpital le plus proche. Au pas de deux tranquille dans la rue du village, rendu en plan-séquence, répond cette précipitation, ciselée par un découpage vif et des gros plans déformant le visage de Popaul.
Le temps du film, notre regard évolue : il se fait d'abord surplombant, lointain (les premiers plans balayant la vallée de la Dordogne puis ceux embrassant toute la salle des fêtes...) avant d'épouser progressivement celui d'Hélène. Cette proximité qui nous est accordée nous fait accepter, autant qu'elle, le baiser final. Hélène est un ange (ou tout comme : une institutrice). Gentillesse, blondeur, chasteté... Quoique, ce maquillage, cette cigarette... Ramasser en une fraction de seconde un briquet oublié, l'allumer comme on signe un pacte, s'affoler de son propre comportement, se sentir soulager. La femme est changeante. L'homme aussi : Popaul est délicat et horrible. La folie du Boucher n'est pas brouillage mais coexistence. L'astuce du briquet n'engage pas sur la voie de la dissimulation mais sur celle de la prise de conscience de deux états successifs, dont l'un découle de la permanence du mal dans la nature humaine (depuis la nuit des temps bien sûr).

Ceci étant, il serait vain de tenter de comprendre les raisons profondes des atrocités perpétrées. L'extraordinaire travail d'écriture de Chabrol permet, dans le naturel du dialogue, d'avancer quelques données (la haine du père, la violence militaire) qui ne se transforment jamais en explications suffisantes. Hélène se penche au bord du gouffre et observe. Comme nous, elle ne peut s'empêcher d'éprouver au moins de la sympathie pour Popaul (que l'on ne voit jamais sous un mauvais jour) puis de l'apaiser.
Au final, la voiture d'Hélène éclaire par ses phares les arbres penchés vers la route comme le faisait celle du Dr Mabuse, mais c'est plutôt son M le Maudit que Chabrol a réalisé là.
Ma nouvelle visite au Boucher s'est faite à l'occasion du "Claude Chabrol Blogathon" lancé par le cinéphile américain Flickhead et relayé chez nous par Vincent.
Photos : capture dvd Artedis
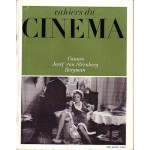
 1965 : Positif, sur trois numéros, prolonge les réflexions autour du Désert rouge entamées fin 1964 par les Cahiers. Robert Benayoun poursuit ses rencontres hollywoodiennes avec Jerry Lewis, Frank Tashlin, Sam Peckinpah, John Huston et Don Siegel. En mai, la maquette change et un nouvel auteur, Franceso Rosi, est adoubé par la revue. Bernard Cohn et Freddy Buache entrent au comité de rédaction.
1965 : Positif, sur trois numéros, prolonge les réflexions autour du Désert rouge entamées fin 1964 par les Cahiers. Robert Benayoun poursuit ses rencontres hollywoodiennes avec Jerry Lewis, Frank Tashlin, Sam Peckinpah, John Huston et Don Siegel. En mai, la maquette change et un nouvel auteur, Franceso Rosi, est adoubé par la revue. Bernard Cohn et Freddy Buache entrent au comité de rédaction.


 C'est au dernier moment que je me suis aperçu que le film d'Emmanuel Mouret diffusé par Arte hier soir n'était pas
C'est au dernier moment que je me suis aperçu que le film d'Emmanuel Mouret diffusé par Arte hier soir n'était pas  [Seconde contribution personnelle au
[Seconde contribution personnelle au 


 1964 : Comme l'année précédente, les livraisons de Positif se font plutôt thématiques : comédie à l'italienne, cinéma américain (classique ou indépendant) et bien sûr l'irrésistible numéro spécial consacré à l'érotisme. Robert Benayoun parle avec Roger Corman et Buñuel est une nouvelle fois à la fête.
1964 : Comme l'année précédente, les livraisons de Positif se font plutôt thématiques : comédie à l'italienne, cinéma américain (classique ou indépendant) et bien sûr l'irrésistible numéro spécial consacré à l'érotisme. Robert Benayoun parle avec Roger Corman et Buñuel est une nouvelle fois à la fête.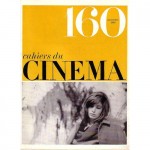
 Quitte à choisir : Joker pour le Roger Corman, mais l'année de Positif ressemble à un sans-faute. Cependant, la faiblesse quantitative biaise une nouvelle fois la confrontation. Demy, Bergman, (Godard ?), Mizoguchi, Antonioni (partagé avec la concurrence qui l'affichera en janvier 65) : à part les interrogations sur David et Lisa et La bataille de France, en face, c'est aussi du solide. Allez, pour 1964 : Match nul.
Quitte à choisir : Joker pour le Roger Corman, mais l'année de Positif ressemble à un sans-faute. Cependant, la faiblesse quantitative biaise une nouvelle fois la confrontation. Demy, Bergman, (Godard ?), Mizoguchi, Antonioni (partagé avec la concurrence qui l'affichera en janvier 65) : à part les interrogations sur David et Lisa et La bataille de France, en face, c'est aussi du solide. Allez, pour 1964 : Match nul. Le parcours du jeune couple Hans-Lammchen dans l'Allemagne en crise du début des années 30, leurs difficultés financières, leurs rencontres, le frottement de leur idéalisme au contact d'une société en quête de repères, la fortification de leur amour et le maintien de leur volonté combative...
Le parcours du jeune couple Hans-Lammchen dans l'Allemagne en crise du début des années 30, leurs difficultés financières, leurs rencontres, le frottement de leur idéalisme au contact d'une société en quête de repères, la fortification de leur amour et le maintien de leur volonté combative...
 1963 : Howard Hawks a enfin son dossier et sa couverture des Cahiers. Mais pour la revue, le bouleversement se réalise en interne : Rohmer est poussé vers la sortie et un comité de rédaction (officieusement dirigé par Jacques Rivette) prend les commandes. Un éditorial présente la chose en juillet. La ligne tendra désormais vers le cinéma moderne (principalement européen) plutôt que vers les grands classiques (essentiellement hollywoodiens). Les pages des Cahiers s'ouvriront aussi à d'autres disciplines : ainsi, un entretien avec Roland Barthes parait dans le n°147.
1963 : Howard Hawks a enfin son dossier et sa couverture des Cahiers. Mais pour la revue, le bouleversement se réalise en interne : Rohmer est poussé vers la sortie et un comité de rédaction (officieusement dirigé par Jacques Rivette) prend les commandes. Un éditorial présente la chose en juillet. La ligne tendra désormais vers le cinéma moderne (principalement européen) plutôt que vers les grands classiques (essentiellement hollywoodiens). Les pages des Cahiers s'ouvriront aussi à d'autres disciplines : ainsi, un entretien avec Roland Barthes parait dans le n°147.
 Quitte à choisir : Le déséquilibre toujours flagrant dans le nombre de numéros parus profite encore une fois aux Cahiers (en premier lieu : Les oiseaux, Le feu follet, Muriel, Main basse sur la ville), même si Positif ne démérite pas (Jerry Lewis et Tony Richardson). Allez, pour 1963 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Le déséquilibre toujours flagrant dans le nombre de numéros parus profite encore une fois aux Cahiers (en premier lieu : Les oiseaux, Le feu follet, Muriel, Main basse sur la ville), même si Positif ne démérite pas (Jerry Lewis et Tony Richardson). Allez, pour 1963 : Avantage Cahiers. Un mélodrame de Borzage assez mauvais, qui fait illusion pendant une quarantaine de minutes avant de sombrer vers les limites du supportable. Bien sûr, nous ne croyons pas une seule seconde à cette histoire, celle de Myra, jeune femme élevée à la campagne par son père, autrefois pianiste célèbre en Europe, et qui devient la protégée du Maestro Goronof avant de lui faire de l'ombre sur la prestigieuse scène du Carnegie Hall. Toutefois, les péripéties du début s'enchaînent avec suffisamment d'assurance et la caractérisation des personnages oscille assez plaisamment entre stéréotypes et touches plus originales. Surtout, Borzage laisse toute sa place à la musique : le chemin balisé qui nous mène de l'audition au premier concert, en passant par les nombreuses répétitions, grâce sans doute à la sensibilité du cinéaste, évite les raccourcis et les escamotages habituels.
Un mélodrame de Borzage assez mauvais, qui fait illusion pendant une quarantaine de minutes avant de sombrer vers les limites du supportable. Bien sûr, nous ne croyons pas une seule seconde à cette histoire, celle de Myra, jeune femme élevée à la campagne par son père, autrefois pianiste célèbre en Europe, et qui devient la protégée du Maestro Goronof avant de lui faire de l'ombre sur la prestigieuse scène du Carnegie Hall. Toutefois, les péripéties du début s'enchaînent avec suffisamment d'assurance et la caractérisation des personnages oscille assez plaisamment entre stéréotypes et touches plus originales. Surtout, Borzage laisse toute sa place à la musique : le chemin balisé qui nous mène de l'audition au premier concert, en passant par les nombreuses répétitions, grâce sans doute à la sensibilité du cinéaste, évite les raccourcis et les escamotages habituels.