(Ken Loach / Grande-Bretagne / 2009)
■■□□
 Initié par Cantona (*), le projet Looking for Eric a permis à Ken Loach, non pas d'alléger son cinéma, comme l'ont assuré quelques journalistes incompétents se pressant à Cannes pour rencontrer la star du foot (**), mais de proposer une variation sur le thème de la passion et sur le rapport entre l'amateur et le modèle. De ce point de vue, le film est réussi. Loach est un passionné de football, de musique : cela se sait et cela se sent sur l'écran, au fil de séquences qui coulent de source. La passion qui anime Eric Bishop (formidable Steve Evets), le héros mal en point, n'est pas présentée comme dévorante mais vivifiante et aidant à supporter bien des aléas (Loach prend d'ailleurs soin de caractériser le personnage sans aborder ce sujet tout de suite, commençant par le situer socialement).
Initié par Cantona (*), le projet Looking for Eric a permis à Ken Loach, non pas d'alléger son cinéma, comme l'ont assuré quelques journalistes incompétents se pressant à Cannes pour rencontrer la star du foot (**), mais de proposer une variation sur le thème de la passion et sur le rapport entre l'amateur et le modèle. De ce point de vue, le film est réussi. Loach est un passionné de football, de musique : cela se sait et cela se sent sur l'écran, au fil de séquences qui coulent de source. La passion qui anime Eric Bishop (formidable Steve Evets), le héros mal en point, n'est pas présentée comme dévorante mais vivifiante et aidant à supporter bien des aléas (Loach prend d'ailleurs soin de caractériser le personnage sans aborder ce sujet tout de suite, commençant par le situer socialement).
Inutile de dire que, dès le début, l'on ne cesse de guetter l'articulation, le moment où va débouler le King dans le triste quotidien de banlieue mancunéenne qui nous est décrit. Or, ce bouleversement qui arrive, Loach ne l'explique tout simplement pas. L'amour du ballon rond, un poster dans une chambre, un prénom commun suffisent à faire accepter l'intrusion soudaine du "bon génie". Le dialogue entamé est filmé avec le plus grand naturel, en repoussant tout effet (les plans révélant in fine l'absence de Cantona, en raison notamment de l'arrivée d'une tierce personne, sont rares). Cette frontalité nous pousse à faire nôtre l'explication la plus banale : celle du soliloque intérieur.
Drôles et émouvants, les échanges entre les deux Eric ouvrent les vannes de la confession et de l'introspection douloureuse. Une passion (celle du foot) se met au service d'une autre, la plus importante. Parfois, le deux se mêlent : un montage alterné fait de deux discussions distinctes d'Eric, l'une avec Cantona, l'autre avec son ex-femme à reconquérir, un seul et même moment d'apesanteur, une brèche dans le réel où tout deviendrait possible. Mais l'émotion la plus intense provient peut-être de ces quelques emballements des deux Eric se remémorant les grands moments de la carrière du joueur mythique de Manchester United : une joie partagée, dans un souffle commun, transmise à merveille par le rythme de séquences calées sur la vigueur des deux comédiens et s'ouvrant sur des extraits de matchs, fort bien intégrés et magnifiés, notamment par une remarquable bande son. Looking for Eric est clairement l'un des plus beaux film sur l'amour du foot jamais réalisé.
A travers le "personnage" de Cantona passe bien plus qu'un jeu sur l'image publique (les réparties à base de proverbes cantoniens sont très réjouissantes), car c'est surtout l'appropriation d'une personnalité par un fan qui touche, une appropriation toute amicale, une recherche de complicité. Qui n'a jamais rêvé une fois dans sa vie de se lier secrètement et simplement avec une vedette admirée ?
Il est fort dommage que Looking for Eric ne se limite pas à ce petit programme. Si j'ai parlé de "bon génie" plus haut, il ne faudrait pas trop me pousser pour me faire écrire que Paul Laverty est, lui, le "mauvais génie" de Loach. Pourquoi doit-il ponctuer ses scénarios, à un moment ou à un autre, d'un inévitable événement dramatique sur-signifiant, supposé rendre plus intense encore le récit ? Ici, la découverte d'un revolver nous embarque, pendant toute la deuxième partie, loin de ce qui nous intéressait alors et le morceau de bravoure final, malgré son incongruité, peine par conséquent à rattraper le retard pris sur ce chemin hyper-balisé. Loach serait bien plus inspiré en se cantonnant (ah ah ah) dans ses infra-intrigues du quotidien (ces vibrations qu'il capte de manière unique lors des scènes de groupe), en tenant sa ligne jusqu'au bout, comme au temps de Kes, sans sur-dramatiser des récits suffisamment parlants. A partir des huit scénarios que Laverty lui a écrit, le cinéaste n'a offert qu'un grand film (Le vent se lève, dans lequel le contexte justifiait tous les excès dramatiques), deux à la rigueur (It's a free world, qui contenait aussi, sur sa fin, quelques grosses ficelles). Tous les autres (Bread and roses, le seul que je ne connaisse pas, semble ne pas faire exception) souffrent de scories plus ou moins rédhibitoires (Carla's song, My name is Joe, Sweet sixteen, Just a kiss).
Si emballant pendant une heure, Looking for Eric, dernier film en date de l'un des meilleurs portraitistes en activité, laisse au final pas mal de regrets.
(*) Le générique annonce un film coproduit par Canto Bros Productions, ce qui fit dire à une gourde assise devant moi : "Il est malin, il veut du pognon..."
(**) C'est Cantona lui-même, en admirateur sincère du cinéaste, qui était obligé d'expliquer à ses incultes interviewers que Loach n'avait pas attendu son arrivée pour réserver une bonne place à l'humour à l'intérieur de l'un ses films.
D'autres avis sont à lire chez Vincent, Dasola et Rob Gordon.



 Initié par Cantona (*), le projet Looking for Eric a permis à Ken Loach, non pas d'alléger son cinéma, comme l'ont assuré quelques journalistes incompétents se pressant à Cannes pour rencontrer la star du foot (**), mais de proposer une variation sur le thème de la passion et sur le rapport entre l'amateur et le modèle. De ce point de vue, le film est réussi. Loach est un passionné de football, de musique : cela se sait et cela se sent sur l'écran, au fil de séquences qui coulent de source. La passion qui anime Eric Bishop (formidable Steve Evets), le héros mal en point, n'est pas présentée comme dévorante mais vivifiante et aidant à supporter bien des aléas (Loach prend d'ailleurs soin de caractériser le personnage sans aborder ce sujet tout de suite, commençant par le situer socialement).
Initié par Cantona (*), le projet Looking for Eric a permis à Ken Loach, non pas d'alléger son cinéma, comme l'ont assuré quelques journalistes incompétents se pressant à Cannes pour rencontrer la star du foot (**), mais de proposer une variation sur le thème de la passion et sur le rapport entre l'amateur et le modèle. De ce point de vue, le film est réussi. Loach est un passionné de football, de musique : cela se sait et cela se sent sur l'écran, au fil de séquences qui coulent de source. La passion qui anime Eric Bishop (formidable Steve Evets), le héros mal en point, n'est pas présentée comme dévorante mais vivifiante et aidant à supporter bien des aléas (Loach prend d'ailleurs soin de caractériser le personnage sans aborder ce sujet tout de suite, commençant par le situer socialement). Isabelle, la directrice : " - Ooohhh, le joli dessin que vous nous avez fait là, Monsieur Resnais ! Cette lumière, ces couleurs, cette composition... Cela me rappelle vos anciens tableaux... Écoutez, nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Infirmiers !!! Infirmiers !!! Est-ce qu'il nous reste un porte-clef pour Monsieur Resnais ? Non ? Ou alors un pin's ? Ah, voilà, celui-là est très joli... Bien, bien... Il me reste à vous dire au revoir. L'infirmier va vous reconduire... Non, non... C'est que, voyez-vous, il ne faut pas rester là, Monsieur, nous avons une compétition, ici, d'accord ? J'ai rendez-vous avec le Dr Mendoza et je suis déjà affreusement en retard... Allez, portez-vous bien... Amitiés à Sabine..."
Isabelle, la directrice : " - Ooohhh, le joli dessin que vous nous avez fait là, Monsieur Resnais ! Cette lumière, ces couleurs, cette composition... Cela me rappelle vos anciens tableaux... Écoutez, nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Infirmiers !!! Infirmiers !!! Est-ce qu'il nous reste un porte-clef pour Monsieur Resnais ? Non ? Ou alors un pin's ? Ah, voilà, celui-là est très joli... Bien, bien... Il me reste à vous dire au revoir. L'infirmier va vous reconduire... Non, non... C'est que, voyez-vous, il ne faut pas rester là, Monsieur, nous avons une compétition, ici, d'accord ? J'ai rendez-vous avec le Dr Mendoza et je suis déjà affreusement en retard... Allez, portez-vous bien... Amitiés à Sabine..."

 1960 : C'est l'année Godard pour les Cahiers (texte de Luc Moullet sur A bout de souffle). La Nouvelle Vague est à son zénith et la revue s'en félicite, même si la défense du mouvement est finalement moins véhémente que ne le laisse croire l'abondance des couvertures, comme si cela allait de soi. Un numéro rend hommage au disparu Jacques Becker, un autre est consacré à Joseph Losey (préparé par Pierre Rissient et l'école du Mac-Mahon). Cannes 1960 est l'édition du double scandale L'avventura / La dolce vita et l'on est alors sommé de choisir : Antonioni ou Fellini. Sous l'impulsion d'André S. Labarthe, les Cahiers penchent du côté du premier.
1960 : C'est l'année Godard pour les Cahiers (texte de Luc Moullet sur A bout de souffle). La Nouvelle Vague est à son zénith et la revue s'en félicite, même si la défense du mouvement est finalement moins véhémente que ne le laisse croire l'abondance des couvertures, comme si cela allait de soi. Un numéro rend hommage au disparu Jacques Becker, un autre est consacré à Joseph Losey (préparé par Pierre Rissient et l'école du Mac-Mahon). Cannes 1960 est l'édition du double scandale L'avventura / La dolce vita et l'on est alors sommé de choisir : Antonioni ou Fellini. Sous l'impulsion d'André S. Labarthe, les Cahiers penchent du côté du premier.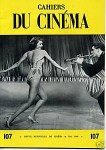
 Quitte à choisir : Antonioni en vedette des deux côtés, le merveilleux film de Franju également choisi à la fin de l'année précédente par les Cahiers... Il ne reste plus beaucoup de munitions pour Positif, qui peine toujours à paraître régulièrement. Becker, Godard, Losey, Ray et Hitchcock font la différence. Allez, pour 1960 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Antonioni en vedette des deux côtés, le merveilleux film de Franju également choisi à la fin de l'année précédente par les Cahiers... Il ne reste plus beaucoup de munitions pour Positif, qui peine toujours à paraître régulièrement. Becker, Godard, Losey, Ray et Hitchcock font la différence. Allez, pour 1960 : Avantage Cahiers. Troisième long-métrage de Rabah Ameur-Zaïmeche après les remarqués Wesh wesh, qu'est-ce qui se passe ? et Bled Number One, Dernier maquis est une drôle de fable politique née d'un double désir de cinéaste : réaliser une œuvre à la fois engagée et plastiquement marquante. Abordant frontalement des problématiques religieuses et sociétales, le filme relate un conflit opposant un groupe de manœuvres musulmans à leur patron, ce dernier tentant d'acheter la paix sociale avec la mise à disposition d'un lieu de prière. L'ambition politique est explicite mais nuancée, notamment dans le portrait complexe qui est fait du patron de cette entreprise de rénovation de palettes. En cantonnant son récit dans un lieu quasi-unique, Ameur-Zaïmeche élude le rapport à la société extérieure et l'éventuelle confrontation qui pourrait en découler, posant ainsi la situation comme étant naturelle, ici et maintenant. Il est donc difficile de parler de film social, au sens où nous l'entendons habituellement, Dernier maquis ne se pliant pas aux codes du genre.
Troisième long-métrage de Rabah Ameur-Zaïmeche après les remarqués Wesh wesh, qu'est-ce qui se passe ? et Bled Number One, Dernier maquis est une drôle de fable politique née d'un double désir de cinéaste : réaliser une œuvre à la fois engagée et plastiquement marquante. Abordant frontalement des problématiques religieuses et sociétales, le filme relate un conflit opposant un groupe de manœuvres musulmans à leur patron, ce dernier tentant d'acheter la paix sociale avec la mise à disposition d'un lieu de prière. L'ambition politique est explicite mais nuancée, notamment dans le portrait complexe qui est fait du patron de cette entreprise de rénovation de palettes. En cantonnant son récit dans un lieu quasi-unique, Ameur-Zaïmeche élude le rapport à la société extérieure et l'éventuelle confrontation qui pourrait en découler, posant ainsi la situation comme étant naturelle, ici et maintenant. Il est donc difficile de parler de film social, au sens où nous l'entendons habituellement, Dernier maquis ne se pliant pas aux codes du genre. C'est calme en ce moment, non ? Tiens, si l'on parlait de Tavernier ?
C'est calme en ce moment, non ? Tiens, si l'on parlait de Tavernier ?
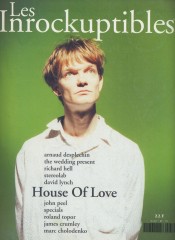
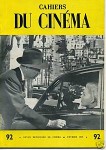
 1959 : Il se passe un truc, non ? Après quelques signes annonciateurs, vient donc la naissance "officielle" de la Nouvelle Vague : sortie du Beau Sergeet évènement cannois créé par Truffaut. Les Cahiers sont bien sûr en première ligne pour soutenir le mouvement : couvertures, comptes-rendus, entretiens, table ronde (autour d'Hiroshima mon amour)... On note le renouvellement (forcé par les passages à la mise en scène des cadors) des plumes (Moullet, Douchet, Domarchi) et l'arrivée des "Mac-Mahoniens" (et donc de leurs cinéastes : Lang, Losey, Walsh, Fuller...). Un numéro spécial est consacré à André Bazin et le centième paraît sous une couverture signée par Jean Cocteau.
1959 : Il se passe un truc, non ? Après quelques signes annonciateurs, vient donc la naissance "officielle" de la Nouvelle Vague : sortie du Beau Sergeet évènement cannois créé par Truffaut. Les Cahiers sont bien sûr en première ligne pour soutenir le mouvement : couvertures, comptes-rendus, entretiens, table ronde (autour d'Hiroshima mon amour)... On note le renouvellement (forcé par les passages à la mise en scène des cadors) des plumes (Moullet, Douchet, Domarchi) et l'arrivée des "Mac-Mahoniens" (et donc de leurs cinéastes : Lang, Losey, Walsh, Fuller...). Un numéro spécial est consacré à André Bazin et le centième paraît sous une couverture signée par Jean Cocteau.
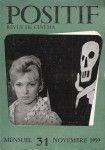 Quitte à choisir : Même en faisant la fine bouche sur Le beau Serge, il est difficile de ne pas reconnaître que les Cahiersfont un sans faute, mêlant sans problème les valeurs sûres et les petits nouveaux pour donner, au final, une image parfaitement juste de l'époque. De l'autre côté, les choix d'Antonioni et Wajda sont tout aussi pertinents mais nous ne saurons jamais ce qu'il en aurait été réellement si la revue avait tenu un rythme normal cette année-là. Allez, pour 1959 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Même en faisant la fine bouche sur Le beau Serge, il est difficile de ne pas reconnaître que les Cahiersfont un sans faute, mêlant sans problème les valeurs sûres et les petits nouveaux pour donner, au final, une image parfaitement juste de l'époque. De l'autre côté, les choix d'Antonioni et Wajda sont tout aussi pertinents mais nous ne saurons jamais ce qu'il en aurait été réellement si la revue avait tenu un rythme normal cette année-là. Allez, pour 1959 : Avantage Cahiers. Les trois royaumes (Chi bi) c'est :
Les trois royaumes (Chi bi) c'est : Après dix ans de rendez-vous manqués, je rencontre enfin Kiyoshi Kurosawa. Il me plaît.
Après dix ans de rendez-vous manqués, je rencontre enfin Kiyoshi Kurosawa. Il me plaît.