
Peter Watkins faisant un cinéma d'interpellation, souvent ardu, la possibilité de la rencontre nécessite une disponibilité et une attention sans faille de la part du spectateur. Ayant assisté fatigué à une projection des deux heures quarante cinq de la version cinéma d'Edvard Munch, je dois au film une revanche car je n'ai pu l'apprécier comme je l'aurai souhaité et comme, je le soupçonne, il le mérite. Voici tout de même ce que j’en retiens…
Commençons par dire qu'avec ce si singulier biopic de Munch, Peter Watkins rend l'acte de peindre comme rarement cela a été (ou sera ultérieurement) fait au cinéma. Le contact entre la toile et le pinceau (mais aussi le couteau, puis entre le ciseau et le bois, entre l'instrument de gravure et la plaque...) est filmé au plus près pour que soit transmise la sensation de la matière travaillée, au point que la notion de couleur est ici moins importante que celle d'épaisseur. Munch est un peintre qui s'acharne à superposer et à effacer, qui ajoute des détails pour mieux les recouvrir, qui donne à voir des visages indéterminés.
La mise en scène recherche une sorte d’équivalence à cet art. Les décors sont repoussés hors du cadre par la focalisation sur les visages et, dans les nombreuses scènes à deux personnages, les zooms permettent de faire le point sur l’un tout en laissant l’autre dans le vague. En ces occasions, les visages sont donc rendus aussi flous que dans les tableaux. Les couleurs dans l’image subissent elles aussi une désaturation comparable à celle qui est à l’œuvre chez le peintre. Elle touche jusqu’au rouge du soleil couchant, aux couleurs primaires des robes des danseuses du music hall.
Munch est un artiste qui, pour chaque tableau, progresse à travers l’établissement de couches successives, techniquement mais également "psychologiquement", puisqu’il y fait remonter ses blessures familiales (une enfance dramatique où l’ombre de la mort aura été omniprésente) et amoureuses. Et Watkins va faire de même pour structurer son film. Le son, tout d’abord, est traité de manière particulière. Plusieurs pistes se succèdent ou se mêlent : le son de ce qui se déroule à l’écran, les données biographiques classiques d’un récitant, la lecture d’extraits d’un journal écrit par Munch lui-même… Déjà complexe de par ses sources multiples et ses différences de niveaux, cette bande son ne raccorde pas toujours avec l’image et des chevauchements se créent, parfois même des oppositions ou des dissociations. Le montage s’y met aussi. Des flashs-backs, presque subliminaux à certains endroits, comme autant de réminiscences, viennent constamment s’insérer et bouleverser la linéarité du récit. Le plus souvent, une friction se fait ainsi entre des images de la passion amoureuse et celles de l’enfance douloureuse. On ne compte plus les plans de la sœur de Munch mourante qui se voient accolés à ceux évoquant la relation du peintre avec sa maîtresse, prolongeant l’angoisse jusqu’à ces séquences pourtant lumineuses. Il n’est pas excessif de qualifier Edvard Munch de film morbide.
Les traumatismes et les inquiétudes fondamentales font sans cesse retour. Cela s’accorde avec le travail de Munch qui aime revenir plusieurs fois sur les mêmes motifs et donner vie à des séries. Watkins s’y emploie aussi et cela confère à son film une certaine monotonie. Le récit est stoppé sans signaler de véritable point d’orgue, alors qu’il reste une quinzaine d’années d’activité à traiter. Toute la dernière partie est recouverte de la voix-off du récitant-pédagogue, à peu d’exceptions près, et le cinéaste, y abordant la réception de l’œuvre de Munch par le public et les institutions, insiste énormément sur les rejets qu’elle suscita. Nul doute, alors, que Watkins s’identifie pleinement au peintre.
Reste encore une chose, à propos d’Edvard Munch, assez mystérieuse : le recours systématique, à l’intérieur des plans de la fiction, au regard caméra. Pas un seul plan sur l’acteur principal qui n’en contienne. Watkins a certes passé sa vie de cinéaste à brouiller les repères servant à distinguer documentaire et fiction mais ici, que veulent dire ces regards ? Ils nous provoquent ? Ils dénoncent l’imposture de la reconstitution ? Ils nous rappellent notre position ? Dans ces moments-là, c’est comme si Edvard Munch, pourtant sujet du film, s’extirpait de la représentation. C’est très étrange.
****
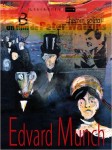 EDVARD MUNCH
EDVARD MUNCH
de Peter Watkins
(Norvège - Suède / 165 min / 1974)

 SHAME
SHAME
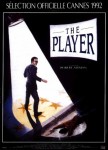 THE PLAYER
THE PLAYER

 BULLHEAD (Rundskop)
BULLHEAD (Rundskop)
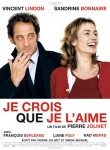 JE CROIS QUE JE L'AIME
JE CROIS QUE JE L'AIME
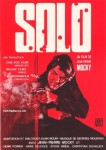 SOLO
SOLO