(Henry Hathaway / Etats-Unis / 1946, Joseph H. Lewis / Etats-Unis / 1955 & Fred Zinnemann / Etats-Unis / 1948)
■■■□ / ■■■□ / ■■■■
Allez, comme je suis parti dans le film noir classique, je reviens sur de courtes notes prises il y a deux ou trois ans de ça, soit bien avant la naissance de ce blog génial et au retentissement international (j'ai de la famille à Montréal). C'était à l'occasion d'un cycle du Cinéma de minuit, si je me souviens bien. Relisons les ensemble :
 L'impasse tragique (The dark corner)
L'impasse tragique (The dark corner)
Le détective privé Bradford Galt vient de purger injustement une peine de prison. Il reprend son activité à New York mais se sent bientôt observé et menacé, lui et sa charmante secrétaire, par un intrigant bonhomme en costume blanc. Celui-ci dit travailler pour Anthony Jardine, l'ancien associé de Bradford. Mais la mort de Jardine montre au héros qu'il y a encore quelqu'un à découvrir derrière toute l'histoire.
La première qualité de cet excellent film est sa distribution homogène : Mark Stevens, Lucille Ball, Clifton Webb et William Bendix, qui campe ce formidable personnage de gros détective corrompu, toujours en costume blanc. Violence et sadisme caractérisent tout le monde ou presque (l'impressionnant interrogatoire que Bradford fait subir à son suiveur). Hathaway est à son aise dans ce domaine mais il offre aussi de très jolis moments de pause à son héros et sa secrétaire amoureuse, notamment dans une belle scène de dancing. Comme souvent chez ce cinéaste, c'est le réalisme des comportements, basé sur des geste crédibles, des petits détails, qui fait accepter l'intrigue solide mais un peu tordue et expédiée sur la fin.

Association criminelle (The big combo)
Le lieutenant de police Leonard Diamond tente par tous les moyens de coincer le chef de bande Mr Brown, malgré le refus de sa hiérarchie de poursuivre les frais. Autant que son devoir, c'est son attirance pour Susan, la maîtresse de Brown, qui le pousse à aller jusqu'au bout.
Violence et sadisme sont bien les mamelles du genre. Mr Brown (diabolique Richard Conte) fait penser à d'autres figures bien plus modernes du film noir, par sa névrose, son autoritarisme, la conscience de sa toute puissance et son débit mitraillette. Il semble évident que Quentin Tarantino connaît et apprécie cette Association criminelle. Tout d'abord, "Mr Brown" est un nom qui reviendra bien sûr dans Reservoir dogs. Mais il y a surtout cette séance de torture du policier ligoté sur une chaise, forcé d'écouter la radio dans un sonotone branché à fond pour lui crever les tympans. Tarantino, lui, préfère couper l'oreille, mais il me semble que le panoramique vers le poste de radio au plus fort de la tension est le même dans les deux films. En maître de la série B (n'oublions pas évidemment le génial Démon des armes, cinq ans plus tôt), Joseph Lewis tire le meilleur parti possible du manque de moyen, en accentuant la pénombre autour de sources lumineuses particulièrement vives ou en filmant en longs plans mobiles. Cerise sur le gâteau, Jean Wallace, blonde très troublante luttant plus ou moins pour se défaire de l'emprise de Mr Brown nous gratifie d'une scène sidérante quand son visage s'illumine en gros plan au moment où son homme disparaît derrière ses épaules pour descendre on se demande bien où. Voilà une série B toute proche du chef d'oeuvre.
Acte de violence (Act of violence)
Tiens, le chef d'oeuvre, le voici. Frank Enley vit paisiblement avec sa femme et son fils lorsqu'il s'aperçoit qu'un certain Joe Parkson rôde autour de chez lui. Ce dernier vient accomplir une vengeance, liée à leur expérience commune de la guerre.

Ce fabuleux Acte de violence est d'abord le récit d'une obsession, celle qui taraude Joe Parkson depuis la sortie de la guerre. Évoquant les traumatismes consécutifs à cette catastrophe, Zinnemann nous décrit deux caractères : le soldat cassé (physiquement et moralement) et l'officier refoulant sa lâcheté et sa trahison passées. Le cinéaste évite le flash-back redouté et préfère faire parler les personnages plusieurs minutes après le début du film et donc de la chasse à l'homme. Sans aucune fioriture, on entre de suite dans le vif du sujet et l'histoire se dévoile petit à petit. Il pèse sur le film une ambiance de violence rentrée, admirablement rendue lors du chassé-croisé en barques sur le lac ou quand Parkson rôde toute la nuit autour de la maison du couple. Comme chez Fritz Lang, la morale et le dilemme, prennent le pas sur l'enquête.

Le rôle dévolu à l'épouse de Frank (Janet Leigh impeccable), est loin d'être convenu, plein d'ambiguités. Le dénouement du film, attendu, est "heureusement malheureux" pour Enley et prive du même coup Parkson de sa vengeance. Les deux acteurs principaux sont superbes. Van Heflin est à l'aise au foyer comme dans les bas-fonds de Los Angeles (magnifiquement filmés) et Robert Ryan est imperturbable, boitant, engoncé dans son imperméable. Fred Zinnemann laisse les scènes durer, privilégie les long plans lors des dialogues (très peu de champs/contre-champs) et signe au final un très grand film noir.
 Déception devant cette Grande guerre (La grande guerra) concoctée par un Mario Monicelli sortant pourtant tout juste du Pigeon. Le sujet est prometteur, qui lance deux bons à rien dans la bataille que se livrent italiens et autrichiens pendant la première guerre mondiale. Dino De Laurentiis a mis le paquet pour permettre au cinéaste de réaliser une fresque ambitieuse et documentée mais pimentée d'ironie. Seulement, Monicelli ne trouve pas l'équilibre nécessaire entre la peinture réaliste d'une époque et sa critique. Tournant essentiellement en plans séquences (et en scope) pour faire bouger le maximum de figurants, il étire inutilement la plupart des scènes et plante un cadre peu propice à l'épanouissement du comique. Ainsi paralysée par le poids de la reconstitution, la première partie est extrêmement bavarde, accumulant blagues de militaires et traits d'humours provinciaux.
Déception devant cette Grande guerre (La grande guerra) concoctée par un Mario Monicelli sortant pourtant tout juste du Pigeon. Le sujet est prometteur, qui lance deux bons à rien dans la bataille que se livrent italiens et autrichiens pendant la première guerre mondiale. Dino De Laurentiis a mis le paquet pour permettre au cinéaste de réaliser une fresque ambitieuse et documentée mais pimentée d'ironie. Seulement, Monicelli ne trouve pas l'équilibre nécessaire entre la peinture réaliste d'une époque et sa critique. Tournant essentiellement en plans séquences (et en scope) pour faire bouger le maximum de figurants, il étire inutilement la plupart des scènes et plante un cadre peu propice à l'épanouissement du comique. Ainsi paralysée par le poids de la reconstitution, la première partie est extrêmement bavarde, accumulant blagues de militaires et traits d'humours provinciaux.

 Lorsque quelqu'un parle de L'homme perdu (Der verlorene), il en arrive presque toujours à placer un mot sur La nuit du chasseur(ce que n'a pas manqué de faire Patrick Brion dans sa présentation de l'autre soir). La mise en parallèle n'est, il est vrai, pas idiote puisque nous avons là les uniques réalisations de deux acteurs mythiques, tournées à quatre années d'écart. Et si l'on peut dire que le film de Peter Lorre n'atteint pas à la poésie de celui de Charles Laughton, il s'en dégage un même sentiment de singularité.
Lorsque quelqu'un parle de L'homme perdu (Der verlorene), il en arrive presque toujours à placer un mot sur La nuit du chasseur(ce que n'a pas manqué de faire Patrick Brion dans sa présentation de l'autre soir). La mise en parallèle n'est, il est vrai, pas idiote puisque nous avons là les uniques réalisations de deux acteurs mythiques, tournées à quatre années d'écart. Et si l'on peut dire que le film de Peter Lorre n'atteint pas à la poésie de celui de Charles Laughton, il s'en dégage un même sentiment de singularité.

 Ayant lu ma note récente
Ayant lu ma note récente  Le pickpocket Skip McCoy, officiant dans le métro, plonge sa main dans le sac d'une brunette et la soulage de son portefeuille. Au milieu des billets, il trouve un microfilm. Le voilà entre deux feux : une groupe d'espions à la solde des communistes et la police, sans compter le double-jeu mené par la jeune femme qu'il a dupé. L'histoire des mésaventures françaises de Pick up on South Street est assez connue, mais il est toujours plaisant de la rappeler (un bonus concis mais édifiant s'en charge sur le dvd édité par Carlotta). Devant la virulente propagande anti-rouge véhiculée par le film, les distributeurs d'ici décidèrent, par le détournement des dialogues de la version française, de transformer les informations liées à la défense nationale contenues dans le microfilm en données sur la fabrication d'une nouvelle drogue et les agents communistes en dealers de came. Voici pourquoi Pick up on South Street est devenu en France Le port de la drogue, alors que la version originale n'évoque jamais la moindre substance illégale.
Le pickpocket Skip McCoy, officiant dans le métro, plonge sa main dans le sac d'une brunette et la soulage de son portefeuille. Au milieu des billets, il trouve un microfilm. Le voilà entre deux feux : une groupe d'espions à la solde des communistes et la police, sans compter le double-jeu mené par la jeune femme qu'il a dupé. L'histoire des mésaventures françaises de Pick up on South Street est assez connue, mais il est toujours plaisant de la rappeler (un bonus concis mais édifiant s'en charge sur le dvd édité par Carlotta). Devant la virulente propagande anti-rouge véhiculée par le film, les distributeurs d'ici décidèrent, par le détournement des dialogues de la version française, de transformer les informations liées à la défense nationale contenues dans le microfilm en données sur la fabrication d'une nouvelle drogue et les agents communistes en dealers de came. Voici pourquoi Pick up on South Street est devenu en France Le port de la drogue, alors que la version originale n'évoque jamais la moindre substance illégale. L'impasse tragique (The dark corner)
L'impasse tragique (The dark corner)



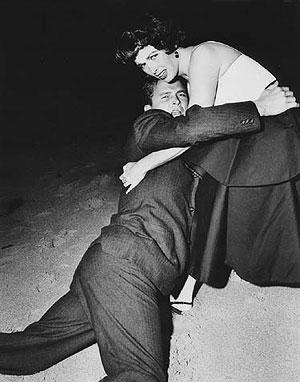
 Séance télé familiale pour finir ce week-end pascal, avec le "sommet" du divertissement de cape et d'épée à la française : Le bossu, très mauvais film d'André Hunebelle. Inutile d'en appeller à la nostalgie de l'enfance et au plaisir de retrouvailles avec des acteurs populaires, l'ensemble est aussi plat que le dos de Lagardère est bombé. La trame du roman de Paul Féval en vaut bien d'autres. Encore faut-il donner du rythme, une forme ou une profondeur, toutes choses dont est incapable Hunebelle. Le cinéma français ne parvient pratiquement jamais à filmer correctement l'action et la vitesse nécessaires au genre, cela crève les yeux ici, encore une fois. Le choix des angles, des cadrages et des coupes donne des chevauchées à deux à l'heure. Les séquences de combat trichent grossièrement avec les distances physiques et la vitesse d'exécution. Bourvil doit se charger de gags paresseux et Jean Marais ne s'en sort pas mieux, lui qui est censé vieillir de vingt ans et qui ne change pas d'un cheveu. Les méchants sont empâtés et transparents. Au contraire des productions hollywoodiennes équivalentes, celle-ci a pu bénéficier de décors réels, mais rien n'accroche l'oeil. La comparaison avec, au hasard, l'agréable Trois mousquetaires de George Sidney (on ne veut même pas parler de Scaramouche) est écrasante. Je suis persuadé que le remake de Philippe de Broca avec Daniel Auteuil, sorti en 97, est meilleur que la version de Hunebelle, contrairement à ce qui a été dit à l'époque. C'est pas possible autrement.
Séance télé familiale pour finir ce week-end pascal, avec le "sommet" du divertissement de cape et d'épée à la française : Le bossu, très mauvais film d'André Hunebelle. Inutile d'en appeller à la nostalgie de l'enfance et au plaisir de retrouvailles avec des acteurs populaires, l'ensemble est aussi plat que le dos de Lagardère est bombé. La trame du roman de Paul Féval en vaut bien d'autres. Encore faut-il donner du rythme, une forme ou une profondeur, toutes choses dont est incapable Hunebelle. Le cinéma français ne parvient pratiquement jamais à filmer correctement l'action et la vitesse nécessaires au genre, cela crève les yeux ici, encore une fois. Le choix des angles, des cadrages et des coupes donne des chevauchées à deux à l'heure. Les séquences de combat trichent grossièrement avec les distances physiques et la vitesse d'exécution. Bourvil doit se charger de gags paresseux et Jean Marais ne s'en sort pas mieux, lui qui est censé vieillir de vingt ans et qui ne change pas d'un cheveu. Les méchants sont empâtés et transparents. Au contraire des productions hollywoodiennes équivalentes, celle-ci a pu bénéficier de décors réels, mais rien n'accroche l'oeil. La comparaison avec, au hasard, l'agréable Trois mousquetaires de George Sidney (on ne veut même pas parler de Scaramouche) est écrasante. Je suis persuadé que le remake de Philippe de Broca avec Daniel Auteuil, sorti en 97, est meilleur que la version de Hunebelle, contrairement à ce qui a été dit à l'époque. C'est pas possible autrement. A la découverte d'Albert Lamorisse, réalisateur spécialisé dans les oeuvres pour jeunes spectateurs, à travers deux moyens-métrages en particulier, qui ont eu un succès incroyable dans les années 50 : Crin-Blanc et Le ballon rouge.
A la découverte d'Albert Lamorisse, réalisateur spécialisé dans les oeuvres pour jeunes spectateurs, à travers deux moyens-métrages en particulier, qui ont eu un succès incroyable dans les années 50 : Crin-Blanc et Le ballon rouge. A la suite de Crin-Blanc, Le ballon rouge apparaît quelque peu en retrait. Un petit garçon trouve sur le chemin de l'école un ballon rouge. Celui-ci s'avère doté de pouvoirs magiques : il obéit au doigt et à l'oeil, le suit dans la rue, l'attend sagement à la porte de l'école... Cette touche de couleur vive dans la ville attire vite la convoitise de tous les autres enfants, plus ou moins bien intentionnés.
A la suite de Crin-Blanc, Le ballon rouge apparaît quelque peu en retrait. Un petit garçon trouve sur le chemin de l'école un ballon rouge. Celui-ci s'avère doté de pouvoirs magiques : il obéit au doigt et à l'oeil, le suit dans la rue, l'attend sagement à la porte de l'école... Cette touche de couleur vive dans la ville attire vite la convoitise de tous les autres enfants, plus ou moins bien intentionnés.