50s - Page 5
-
Les Affameurs (Anthony Mann, 1952)
****Je ne me rappelais plus l'avoir vu et je me demande bien pourquoi. Peut-être est-ce dû tout bêtement au fait que le grand écran rend beaucoup plus justice à la mise en scène de Mann. Revu en salles, donc, ce western sur des pionniers et leurs chariots qui avait tout, malgré le format "carré", pour jouer de l'horizontalité. Or c'est d'abord la verticalité qui frappe, les hommes qui se tiennent droits (mais pas rigides) dans le cadre, la façon dont Mann y impose Stewart et Kennedy, bientôt rejoints par Hudson (comment constituer un trio par le scénario et la mise en scène, dans la séquence de la fusillade de Portland, pour mieux, plus tard, le défaire). Et donc le remplissage de ce cadre, qui donne de la vigueur et accentue le réalisme (les personnages divers affluent). Et encore et surtout, partout et tout le temps, le travail sur la profondeur. Dans la deuxième scène de tension, après le sauvetage de Kennedy, Stewart avance vers nous (et les Indiens) en rampant. Dès lors, on ressent cette profondeur des plans à chaque instant, Mann semblant faire naître mouvements et actions moins des côtés que du fond ou même du premier plan (l'homme qui surgit comme une ombre devant Arthur Kennedy, prenant tout à coup tout le cadre avant de se faire aussitôt descendre). On peut y voir aussi un creux duquel revient, violemment, le passé. C'est que la profondeur caractérise autant l'image que le scénario (formidable, de Borden Chase) et les personnages. Et au centre de tout cela, il y a le génie de James Stewart, de son visage et de ses expressions qui transpercent littéralement, qu'elles soient amoureuses, attendries, terrifiées, explosives, incontrôlées, rageuses, surprises... -
Le Septième Voyage de Sinbad (Nathan Juran, 1958)
*Célèbre film d'aventures merveilleuses réalisé sans génie (hi hi hi) par Nathan Juran. Les scènes de navigation sont interminables comme le sont souvent les histoires de marins et celles d'exploration ne sont guère palpitantes malgré quelques touches de cruauté qui pimentent un peu la sauce. Tout juste relève-t-on un effet de lumière par ci, une belle contre-plongée par là (le méchant magicien attrapant la princesse lilliputienne). Le couple d'amoureux Kerwin Mathews/Kathryn Grant est seulement mignon à regarder. On est un peu obligé de soupeser les mérites du divertissement, très daté, département par département, faute de véritable maître à bord. Toujours peu ému par les créations de Ray Harryhausen, en tout cas celles-ci, je ne trouve réellement convaincante et "poétique" que la séquence de duel au sabre avec le squelette, d'autant plus qu'elle se tient au centre du passage le plus intéressant, celui quasi-hammerien du sauvetage dans l'antre du magicien. Finalement, le seul vainqueur indiscutable dans cette aventure est Bernard Hermann, dont la partition est pleine de puissance et d'inventivité. -
Trois bébés sur les bras (Frank Tashlin, 1958)
**Évidemment pas le meilleur Tashlin (je n'ai, de toute façon, jamais trouvé qu'il planait à des hauteurs stratosphériques) mais pas non plus la catastrophe qu'on peut craindre. Ce scénario emprunté à Preston Sturges donne une comédie inégale, où Jerry Lewis, débarrassé de Dean Martin, cherche à émouvoir plus qu'auparavant. Il n'y parvient pas vraiment, choisissant d'en passer beaucoup trop souvent par des chansons sirupeuses, mais il semble sincère. Ce qui empêche de s'ennuyer, c'est l'alternance de ces moments gentillets et de séquences comiques souvent efficaces. Tashlin y est peut-être un peu bridé par rapport à certaines autres de ses réalisations mais il en ressort finalement un certain équilibre. Deux ou trois gags s'étirent de façon assez surprenante, la première apparition de Lewis est tonitruante (dévastation de tout un quartier avec une lance à incendie incontrôlable), sa brève prestation de rocker est irrésistible et le dénouement, comme dans la meilleure comédie américaine classique, est à la fois moral (la famille heureuse) et immoral (la valse des couples jusqu'à la "bigamie involontaire"). -
Il Bidone (Federico Fellini, 1955)
***Sombre Fellini, bien gris en tout cas, dans lequel le comique reste toujours attaché à une certaine gêne. Si la vigueur de la forme et les lueurs d'espoir (dans les regards amoureux ou dans les rares personnages innocents) empêchent l'ensemble de sombrer totalement, il apparaît évident qu'en 1955, le monde allait (toujours, ou déjà) bien mal. Fellini montre une série d'humiliations verticales, son petit groupe d'arnaqueurs abusant des plus pauvres mais se voyant aussi rabaissé par les plus puissants. Comme il était encore dans sa première période réaliste, sans proposer d'échappée dans l'imaginaire, et qu'il ne sauve pas du tout, au final, son personnage principal, son film garde un ton désespéré qui l'a rendu assez mal-aimé. Même à la deuxième vision, il est pourtant à la hauteur des autres, par moments extraordinaire (la fête du nouvel an chez les bourgeois dévergondés), et construit très solidement (l'ultime arnaque qui rappelle la première et boucle la boucle tragique). -
Courrier du cœur / Le Sheik blanc (Federico Fellini, 1952)
***Le deuxième Fellini, premier en solo, est déjà remarquable. Après la mise en place, l'arrivée du couple de jeunes mariés à Rome pour leur voyage de noces, on dépasse aussitôt l'aimable chronique néo-réaliste et on part ailleurs, sur les chemins de traverse. Scindé en deux temps, le film commence par faire l'éloge de la fiction et de la vie rêvée (à travers les romans photos exotiques) avant de montrer une désillusion (la jeune admiratrice à failli perdre son honneur, son mari et sa vie en fricotant avec la vedette, cette sauvegarde de la morale faisant la petite limite du film). Mais même après avoir goûté aux plaisirs de la (fabrique de la) fiction (étourdissante séquence des prises de vue sur la plage), le spectateur, lui, continue à en profiter. Grâce à la partition géniale de Nino Rota (avec multiples variations et surprises de placement), à la prestation d'Albert Sordi (d'abord presque inquiétant sous le maquillage du "Sheik blanc" puis pathétique), à l'apparition de Giulieta Masina (prénommée Cabiria !), à la manière unique de raconter, Fellini changeant constamment de rythme et donnant à voir de belles ramifications en tournant brièvement sa caméra, de temps à autre, vers les à-côtés, les silhouettes de passage. La scène de la fontaine par exemple nous marque parce que l'on se tourne, pendant quelques secondes à peine, vers un passant que Masina connaît et qu'elle va voir cracher du feu, s'eloignant alors de sa copine et du mari en pleurs. Ce sont ces détails, cette façon d'attraper le monde autour, qui donnent un surcroît de vie et d'énergie. -
7 contre 7
Il y a entre Les Sept Samouraïs et Les Sept Mercenaires un océan, une culture et six ans d'écart. Il y a aussi, entre le jidai-geki d'Akira Kurosawa et le western de John Sturges, l'espace qui sépare un chef d'œuvre du cinéma d'aventures historiques et un honnête film populaire. Sur l'écran, les samouraïs s'activent une bonne heure de plus que les mercenaires. Cette différence de durée est-elle la conséquence logique de l'opposition entre contemplation orientale et concision hollywoodienne ? Assurément non, le rythme étant aussi rapide d'un côté que de l'autre. Le défaut du film américain, plus visible encore lorsqu'il est placé juste à côté de son modèle, est de rendre au spectateur les choses, les actions, les caractères et les décisions trop évidentes. Il suffit à Kurosawa d'un trait lorsque Sturges s'acharne à nous faire tout le dessin.
Si l'on peut qualifier le premier film de grande fresque historique, c'est que la matière y est d'une richesse incroyable. Mais celle-ci nous est offerte avec une vigueur et une simplicité éblouissantes. Et cela tout le long du film. Prenons par exemple, à la fin, l'expression du choix du plus jeune du groupe (Katsushiro le samouraï ou Chico le mercenaire), pris entre son désir de poursuivre sa route avec les deux autres survivants et celui de rester au village auprès de la paysanne qu'il aime. Kurosawa fait se succéder quelques plans emplis de dignité, laisse sortir son jeune personnage du cadre dans lequel reste ses deux amis, le reprend un peu plus loin, droit, observant la jeune femme, et s'arrête là. La mise en scène est claire sans être insistante. Sturges, lui, ne signale pas esthétiquement la séparation et, accompagnant Chico jusqu'à sa bien aimée, le montrant en train de se retrousser les manches et de détacher son ceinturon, joue uniquement sur la corde émotionnelle.


Chez Kurosawa : une vivacité du trait qui n'empêche jamais la préservation de zones de flou. Chez Sturges : la tentation de l'efficacité qui entraîne plus d'une fois vers la facilité dramaturgique. On peut également évoquer la différence d'approche du monde des paysans. Dans le western, la méfiance que peuvent inspirer ces derniers est essentiellement nourrie par des retournements de situation, comme lorsque quelques pleutres font entrer le tyran Calvera dans le village en l'absence provisoire des mercenaires. Kurosawa, de son côté, ne cherche pas à trancher de manière aussi simpliste mais préfère avancer dans sa description par notations successives. L'évolution du rapport de confiance entre les victimes et leurs défenseurs se fait par petites découvertes mettant la volonté d'engagement de ces derniers à l'épreuve : vieilles armures de samouraïs tués, nourriture et saké la veille du combat décisif...
Le cinéaste japonais s'intéresse-t-il moins à ces paysans ? Sans doute. Mais la caractérisation peu poussée, en regard de celle qui à cours dans le Sturges, peut être aussi considérée comme une moins grande concession au goût du public. On trouve en effet moins de rires d'enfants (le rapport entre ceux-ci et Kikuchiyo/Mifune est beaucoup moins développé dramatiquement que celui concernant Bernardo/Bronson) et moins de héros révélés. Dans Les Sept Samouraïs, les combats ressemblent souvent à des mêlées et, vu sous cet angle, le film se révèle déjà moins individualiste (sans même que l'on s'étende sur le discours autour de la solidarité en temps de guerre proféré par Kambei ou sur la réalisation de l'étendard représentant les sept samouraïs au-dessus du village). La grande violence qui se dégage de ces séquences, accentuée bien sûr par le déchaînement des éléments et l'utilisation des lances et des sabres, est aussi celle de la lutte d'un corps social tout entier contre chaque bandit piégé. Si certains personnages de ce corps prennent plus d'épaisseur que d'autres, ils ne s'en détachent pas par un basculement arbitraire qui les ferait passer du retrait prudent à l'héroïsme guerrier. L'extrême violence dont fait preuve le jeune paysan Rikichi au fil de la bataille est contenue déjà dans la blessure béante causée par la perte de sa femme, dans la nervosité dont il fait preuve à chaque question innocente posée à ce sujet. L'affrontement est une catharsis et les plans que le cinéaste consacre à son regard halluciné, s'ils ne vont pas jusqu'à condamner cette violence, traduisent au moins l'effroi qu'elle suscite.
Mais repassons par la dernière séquence évoquée plus haut. La sortie du cadre de Katsushiro laissait deviner un choix sans avoir à l'illustrer. Cette sortie signale aussi une recherche visuelle, impose un sens plastique. De fait, Les Sept Samouraïs est un festival de formes et de figures qui rend bien pâle l'effort westernien qui le suit. On en retient notamment l'opposition entre le haut et le bas (bandits et samouraïs viennent du sommet de la colline et surplombent le village dans sa cuvette, les tombes des sauveurs sont sur un monticule...), les images que rayent les trombes d'eau tombant du ciel comme les lances et les flèches s'abattant sur les hommes, l'omniprésence, lors du dernier affrontement, d'une boue qui ne permet plus de différencier les combattants et qui ramène, en quelque sorte, les samouraïs à la terre des paysans (en ce sens, effectivement, comme l'assène le chef, ce sont bien ces derniers qui ont gagné). Kurosawa excelle par ailleurs dans sa gestion du terrain, sa caméra embrassant le décor pour mieux relayer l'importance de la notion d'espace et aider à saisir la stratégie de défense de ses personnages, comme dans celle de la météorologie. A ce propos, il convient de rappeler que le film n'est, sur sa durée, pas si pluvieux que cela et qu'il est même assez souvent ensoleillé. Ceci est clairement un prolongement du travail de modulation des émotions effectué par le cinéaste au sein même des séquences. L'humeur y est changeante et le mélange le plus explosif est tout entier concentré dans le personnage endossé par un Toshiro Mifune semblant jouer au-delà de toute contrainte, en liberté absolue. Il faut bien l'ampleur et l'aisance des cadrages de Kurosawa pour capter toute l'énergie de cet homme en fusion, ce caractère éruptif.

Chez les samouraïs, la mort frappe comme la foudre, sans discernement moral, au hasard (l'un des sept disparaît bien avant le combat final). Elle n'est donnée par personne en particulier, les bandits étant chez Kurosawa encore moins caractérisés que les paysans. Elle signale bien, cependant, la fin d'une époque (ce que l'on ressentait déjà lors du recrutement, en voyant ces samouraïs réduits à s'engager pour de si modestes causes) puisque elle est à chaque fois, pour les vaillants sabreurs, donnée par balles. Le film japonais apparaît donc beaucoup plus sombre et dur que son homologue trans-Pacifique. Il privilégie l'éclair tragique plutôt que le coup de force dramatique. Kurosawa saisit le spectateur avec la révélation du sort réservé à la femme de Rikichi quand Sturges distille à peine quelques sensations liées au danger. De même, il étudie les rapports sociaux avec beaucoup plus d'attention, traçant des frontières impossibles à franchir sans une grande douleur, et, n'en restant nullement à une chaste amourette comme le fera Hollywood, évoque une véritable passion sexuelle butant sur la rigidité de la société.
Après tout cela, que reste-t-il aux Mercenaires ? Une histoire prenante, une musique entêtante, une certaine force iconique (mais tenant bien plus au métier et au casting qu'à l'inspiration, assez faible, de Sturges).

-
Toutes les pierres du puits
Il suffit d’un rien pour avoir à nouveau l’envie de revenir à Moonfleet. Cette fois-ci, ce ne fut pas "rien", mais un beau texte de Ludovic Maubreuil sur Cinématique. Alors au risque d'enfoncer des portes largement ouvertes par d'autres depuis près de soixante ans...
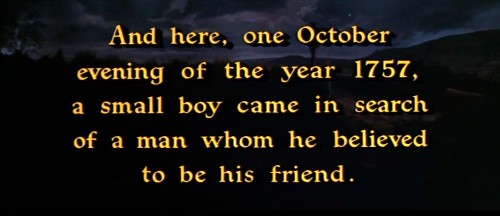
Lang n’aimait pas le CinemaScope. Il l’avait bien dit lors de ses entretiens avec Peter Bogdanovich et chez Godard, mais il suffit de regarder Les Contrebandiers de Moonfleet pour s’en assurer, film dont le format lui fut imposé par la MGM (tout comme cette fin, ce plan final ensoleillé et presque guilleret, en totale opposition de ton avec les quatre-vingt minutes qui le précèdent). Moonfleet n’est assurément pas un film horizontal mais bien un film vertical, sur l’ascendance/la descendance (se trouver un père/un fils).
Lang ne cesse "tout du long" de contrarier la propension naturelle du CinemaScope à l’étalement. Oeuvrant dans l’aventure, on s’attendrait à ce qu’il nous gratifie de chevauchées fantastiques. Or, quand Jeremy Fox s’échappe du fort sur un cheval volé, Lang ne le suit pas au-delà de la porte d’entrée, restant dans la cour, et quand les carrosses ou les cavaliers de l’armée traversent la lande, nous les voyons uniquement négocier des virages serrés sur ces pistes escarpées et étroites (presque tous les plans du film sont de studio). De même, l’évocation de contrebandiers et autres pirates appellerait de larges prises de vue sur l’océan illimité mais ici seules des petites criques à peine mordues par les vagues apparaissent à l’écran.

Sous le cimetière de Moonfleet, les contrebandiers ont aménagé un ingénieux réseau souterrain relié à la mer. Ces boyaux de terre sont ils vus en coupe ? Oui mais transversale. La forme de l’arcade y est soulignée, comme partout ailleurs dans le film. Et pour dessiner une arcade dans le format large, il faut remplir les côtés, ou les noircir.
Assiste-t-on à un duel ? Celui-ci n’est nullement organisé autour des avancées et des reculs des deux adversaires. Parfaitement contenu dans l’espace de la petite pièce principale de la taverne, il se termine dans l’escalier qui la dessert, et donc sur la hauteur.
Cette verticalité implique la mise en scène de chutes. Celles-ci sont nombreuses, volontaires ou non, éléments déterminants de la narration. Leur caractère imprévisible et brutal est souvent rendu par la sècheresse du montage et le foudroiement musical (dans les premières minutes, la terreur du jeune John Mohune est ainsi aisément partagée).

Le cinéphile ne cesse de revenir à Moonfleet, comme les personnages ne cessent de revenir à Moonfleet. Jeremy Fox a quitté les îles pour retrouver le domaine des Mohune et le fantôme d’Olivia, la femme aimée. Le petit John est soumis à la même attraction : toutes les tentatives pour l’éloigner se soldent par des échecs. Leurs trajectoires sont celles d’un boomerang : John saute du carrosse qui l’emmène vers la pension et débarque au domaine, Fox finit par descendre (et de quelle façon !) de celui de ses riches associés pour revenir vers le garçon…

Le retour, la boucle, le cercle, entier ou demi, structurent le film, comme le font les tensions verticales. Pour se battre avec Fox, le tavernier délaisse l’épée pour une hallebarde (éclair admirable et dans la continuité de l’action : on le voit faire son choix, en un instant) et le voilà qui se met à faire tourner celle-ci à bout de bras, au-dessus de lui. Ce duel est le point culminant de la révolte des contrebandiers contre leur chef. Fox est en effet constamment mis en péril, menacé d’encerclement. Dans la taverne ou la grotte, on observe parfaitement les légers déplacements des contrebandiers autour de lui.
Il est un lieu qui conjugue idéalement verticalité et circularité : le puits. C’est donc logiquement ici, dans cette construction particulièrement "anti-cinémascopique", que Jeremy Fox va faire descendre le jeune Mohune pour récupérer le diamant et enclencher alors toute la dernière phase du récit.

Ce lieu, un message crypté l’a désigné préalablement. L'un des contrebandiers a involontairement mis John et son protecteur sur la voie en remarquant que le bout de papier comportait des versets bibliques correctement retranscris mais mal numérotés. Voilà, donc, à ce moment-là, justifiées deux interventions précédentes de ce brigand, deux citations de la bible. Ceci est l'un des multiples détails prouvant l'efficacité langienne. Quand Fox corrige Glennie et que celui-ci se redresse pour quitter les lieux, on remarque quelque chose dépassant de sa botte. Et oui, ce doit bien être le couteau qui manque, quelques secondes plus tard, de tuer Fox par surprise ! Quand le personnage de Jack Elam s'assoie sur une barrique dans la grotte, il fait tomber, sans s'en apercevoir, son chapeau, laissant seulement dans son dos celui de John, tapie dans l'ombre. Peu après, le gag du chapeau trop petit peut advenir. Quand Jeremy, déguisé en major, et John, se dirigent vers le puits au milieu du fort, ils disparaissent de notre vue mais le plan continue "anormalement" pour ne nous montrer qu'un garde en croisant un autre et le saluant. Tout simplement, cette fin de plan prépare la scène qui succèdera à l'épisode de la recherche du diamant : Fox a été pris réellement pour un officier et doit passer la troupe en revue.
Cette efficacité ne souffre d'aucune facilité, tous ces plans étant "d'ensemble". Aucune coupe, aucun plan rapproché, aucune insistance sur le détail ne viennent mâcher le travail ni mettre en péril l'ordonnancement.

Et qu'il est beau que cette rigueur ne tue pas l'émotion ! Le jeune Jon Whiteley joue juste d'un bout à l'autre. Quant à Stanley Granger, il rend admirablement le sentiment d'une froideur, d'une distance, d'une dureté tout à coup ébranlée, cela dès la première rencontre avec ce "fils d'Olivia", puis dans toutes les autres séquences, y compris les plus simples comme celle de la proposition faite par le couple Ashwood repoussée à cause d'un départ précipité. John trouvé dans la grotte par les contrebandiers, Fox doit intervenir. L'enjeu dramatique est triple : refus apparent de jouer le jeu pervers des Ashwood, inquiétude devant la découverte d'une cachette et attachement au gosse.
Ainsi, de chaque pierre composant le puits sans fond qu'est Moonfleet, on peut tirer un trésor.

-
Convoi de femmes
Cent quarante femmes à accompagner jusqu'à la Californie de 1851 pour un périple de trois mois, à travers rocailles, étendues désertiques et territoires indiens : voici la mission assignée à Buck Wyatt par son ami Roy, propriétaire d'un vaste ranch où ne s'affairent que des pionniers célibataires. Ces femmes, elles sont résolues à tout quitter, pour des raisons restant enfouies la plupart du temps, et à refaire leur vie auprès d'un mari choisi d'après un simple photographie.
Convoi de femmes, avant de réunir, ne fait que séparer bien nettement. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les migrantes et les quelques cowboys qui les escortent sous les ordres de Buck ont l'interdiction absolue de s'approcher de trop près les uns des autres. Le mur ainsi dressé entre les deux groupes donne à voir de manière fascinante cette différence entre les sexes (différence que Buck ne pensera longtemps qu'en termes de domination, de force et de faiblesse). Ce mur ne fait aussi, bien sûr, qu'exacerber les désirs, tant l'interdit est énorme et intenable.
Ce principe posé à partir d'un argument déjà fort original à nos yeux, il ne peut se passer que des événements sortant de l'ordinaire, ainsi que des épreuves absolument terribles. Wellman, qui fond littéralement ses personnages dans le décor bien réel de pierre, de sable ou de boue, qui épure jusqu'à sa bande son dénuée de musique (ce sont les bruits des chariots, des coups de feu ou de fouet, des femmes qui chantent des berceuses, qui aident à accoucher et qui s'exclament, ce sont tous ces bruits qui font la musique la musique du film), n'épargne rien au spectateur des effrayants coups du sort. Buck avait prévenu : pour ramener cent femmes, il fallait partir avec un tiers de plus afin de prendre en compte les pertes. Personne, alors, n'est à l'abri. En un éclair, tel personnage auquel le récit semblait s'attacher particulièrement peut disparaître et la jeunesse ou l'amour ne met nullement à l'abri. La sècheresse de la mise en scène rend ces coups de tonnerre saisissants. Ils seraient mélodramatiques si le cadre westernien et l'avancée perpétuelle des membres du convoi n'empêchaient de s'apesantir dessus. Wellman ne fait pas de concessions. La violence et la dureté des événements qu'il choisit de traiter, la tension qu'il instaure, l'intransigeance et la droiture qu'il prête à ses personnages sont tels que les touches humoristiques, les plaisirs de la pause, les attendrissements passagers, n'apparaissent jamais comme des facilités mais comme des moyens d'enrichir la fresque, d'y glisser toutes les contradictions de la vraie vie.
Remarquablement mis en images, alignant les plans noirs et blancs travaillés dans toutes leurs dimensions, Convoi de femmes est l'un des plus beaux et surtout l'un des plus émouvants westerns qui soient.
CONVOI DE FEMMES de William Wellman (Westward the women, Etats-Unis, 118 min, 1951) ****

-
Des monstres attaquent la ville

Si, à propos de la série B, l'expression "charme désuet" revient souvent, elle sert parfois à masquer trop facilement ce qui s'avère très insuffisant, voire totalement nul.
Faire entrer un monde dans les étroites limites d'un cadre mis sous pression par les contraintes économiques et techniques, voilà l'un des buts communs à ces productions. Ici, dans le pourtant assez réputé Des monstres attaquent la ville, la tentative se solde par un échec. Malgré les efforts déployés, notamment au niveau d'un scénario qui impose pendant longtemps l'idée du maintien d'un secret absolu entre une poignée de personnes, le film de Gordon Douglas n'arrive jamais à justifier de façon convaincante que, dans une mésaventure aux répercutions si inquiétantes (est en jeu l'avenir de l'humanité, rien que cela), seulement quatre personnes (un policier, un agent du FBI, un scientifique et sa fille) se chargent de tout (enquête policière, exploration scientifique, décisions politiques, actions militaires...) et soient partout (parcourant le sud-est des Etats-Unis), du début à la fin, tout juste aidés (logistiquement pourrait-on dire) par l'armée dans la seconde partie.
Parmi les aberrations narratives, la gestion du temps, court ou long, pose de sérieux problèmes au spectateur le mieux disposé. A peine l'appel à un gars du FBI est-il évoqué dans un bureau qu'il y déboule dans le plan suivant. De manière plus générale, la rapidité avec laquelle arrivent les événements laisse sceptique. L'idée du film est celle-ci : suite aux essais nucléaires de 1945 au Nouveau-Mexique, des fourmis ont muté pour atteindre une taille gigantesque. Les autorités s'en rendent compte lorsque, en l'espace de quelques heures, plusieurs personnes disparaissent ou sont retrouvées mutilées. Les maladroites tentatives d'explication du scientifique n'y font rien : on se demande bien pourquoi de telles bestioles (présentes par centaines) n'ont jamais été repérées auparavant, l'une des deux fourmilières ayant pourtant trouvé sa place dans les égouts de Los Angeles !
Si dans les premières minutes Gordon Douglas parvient à créer une tension certaine en montrant uniquement le résultat de deux attaques dans le désert, celle-ci s'évanouit lorsqu'apparaissent les monstres sanguinaires, grandes et lentes peluches mécaniques bien inoffensives auxquelles même votre grand-mère, qui n'est pourtant pas bien vaillante, parviendrait à échapper. Ajoutons à cela des personnages transparents, l'invraisemblable sauvetage de deux jeunes garçons entourés par plusieurs mandibules ou le pauvre message final véhiculant l'inquiétude post-atomique...
Certes, plus positivement, relevons aussi quelques passages évitant au film de sombrer entièrement, comme l'introduction déjà citée, traversée notamment par une petite fille rendue muette par la terreur, ou l'exploration du réseau d'une fourmilière géante en plein désert. Mais le film ne propose pas plus d'un plan marquant. Celui-ci arrive assez tôt. Il s'agit d'un surgissement, à la sortie d'un trou, qui toutefois n'a rien de terrible et ne donne rien de poilu à voir. C'est l'apparition, à la descente d'un avion, des jambes de la jeune scientifique à la jupe courte. Un instant coincée à mi hauteur de l'échelle verticale tombant du ventre de l'appareil, elle se présente d'abord ainsi à ceux qui l'accueille sur la piste : par ses belles gambettes.
Ce moment mis à part, le film n'est vraiment pas fourmidable.
****
 DES MONSTRES ATTAQUENT LA VILLE (Them !)
DES MONSTRES ATTAQUENT LA VILLE (Them !)de Gordon Douglas
(Etats-Unis / 92 min / 1954)
-
Barbe-Noire le pirate

Barbe-Noire le pirate, se tenant aussi loin des réussites du genre que de celles de Raoul Walsh, est encore moins bon que dans mon souvenir. Ce film manque terriblement de souffle et, réalisé sans grande inspiration, il possède l'étrange défaut pour une œuvre tendue vers le large de paraître fort étriqué et bavard.
Etriqué surtout dans sa première demi-heure, durant laquelle il prend la forme d'une pièce de théâtre de fond de cale. Si l'arrivée sur une île nous fait par la suite enfin respirer un peu du grand air, nous déchantons rapidement devant ce décor de studio imposant l'usage quasi-exclusif de plans rapprochés, les rares prises de vue en extérieurs réels s'intercalant difficilement. Le format presque carré du cadre contraint l'aventure et, le carton-pâte et les transparences aidant, le monde semble ne pas exister au-delà, s'arrêtant à chaque bord de l'image.
Bavard, le film l'est pour expliquer les multiples péripéties jalonnant le récit et pour donner vie à la fameuse truculence walshienne. C'est essentiellement Robert Newton, héritant du rôle-titre, qui prend en charge cette dernière, cabotin cannibale attirant tout à lui et roulant des yeux comme il me semblait impossible de faire.
La désinvolture de la mise en scène peut certes devenir, accidentellement, un atout, son "étroitesse" servant bien à rendre le tohu-bohu d'un abordage, mais nombre de plans tournés par Walsh sont anodins, peu travaillés (les fausses scènes de nuit, les inserts à la longue vue) ou naïvement conçus (les amoureux au bord de l'eau, l'arrivée de Sir Morgan sur la plage). L'intérêt de histoire et l'utilité de la plupart des personnages ne dépendent que des caprices du scénario, des suprises et des coïncidences qu'il ménage. La cruauté qui peut habiter Barbe-Noire, elle-même, s'efface.
Le jeune spectateur peut s'en contenter mais le plus âgé n'est guère passionné par le spectacle.
****
 BARBE-NOIRE LE PIRATE (Blackbeard, the pirate)
BARBE-NOIRE LE PIRATE (Blackbeard, the pirate)de Raoul Walsh
(Etats-Unis / 99 min / 1952)