L'Indonésie appelle (Indonesia calling) (Joris Ivens / Australie / 1946) ■□□□
La Seine a rencontré Paris (Joris Ivens / France / 1957) ■■■□
... A Valparaiso (Joris Ivens / Chili - France / 1963) ■■■□
Rotterdam - Europort (Rotterdam - Europoort) (Joris Ivens / Pays-Bas - France / 1966) ■■□□
Pour le mistral (Joris Ivens / France / 1966) ■□□□
Le 17ème parallèle (Joris Ivens / France / 1968) ■■■□
Comment Yukong déplaça les montagnes : Une histoire de ballon (Joris Ivens et Marceline Loridan / France / 1976) ■■□□
Comment Yukong déplaça les montagnes : La pharmacie n°3 (Joris Ivens et Marceline Loridan / France / 1976) ■■■□
Une histoire de vent (Joris Ivens et Marceline Loridan / France / 1988) ■■■□
Le deuxième volume du coffret Joris Ivens couvre 40 ans de travail au service du documentaire et nous fait voyager aux quatre coins du monde, jamais en touriste mais toujours en témoin (pour le 1er coffret, voir ici).
Du tract au poème
 Nous retrouvons Ivens à la sortie de la guerre aux Antipodes. L'Indonésie appelle est un court film-tract relatant la lutte des dockers indonésiens travaillant dans les ports australiens et organisant le blocage des navires hollandais. L'Indonésie avait profité de la fin du conflit mondial pour proclamer son indépendance. Pour les natifs de l'archipel, il était donc primordial de contrer toute tentative de reprise en main militaire pas les anciens colonisateurs. Ivens nous montre le rassemblement des forces ouvrières, l'organisation du blocus et l'aide internationale apportée par les syndicats. Les informations sont classiquement amenées par un commentaire, qui laisse cependant la place à des discours enregistrés sur place ou à la post-synchronisation pour certaines séquences. Ce nouvel usage de la parole apporte un surcroît de réalisme, bien que celui-ci soit d'un autre côté entamé par d'évidentes reconstitutions. L'efficacité du film est quelque peu lénifiante et son esthétique ne l'élève guère au-dessus du simple reportage.
Nous retrouvons Ivens à la sortie de la guerre aux Antipodes. L'Indonésie appelle est un court film-tract relatant la lutte des dockers indonésiens travaillant dans les ports australiens et organisant le blocage des navires hollandais. L'Indonésie avait profité de la fin du conflit mondial pour proclamer son indépendance. Pour les natifs de l'archipel, il était donc primordial de contrer toute tentative de reprise en main militaire pas les anciens colonisateurs. Ivens nous montre le rassemblement des forces ouvrières, l'organisation du blocus et l'aide internationale apportée par les syndicats. Les informations sont classiquement amenées par un commentaire, qui laisse cependant la place à des discours enregistrés sur place ou à la post-synchronisation pour certaines séquences. Ce nouvel usage de la parole apporte un surcroît de réalisme, bien que celui-ci soit d'un autre côté entamé par d'évidentes reconstitutions. L'efficacité du film est quelque peu lénifiante et son esthétique ne l'élève guère au-dessus du simple reportage.
Avec La Seine a rencontré Paris, le militantisme est mis en veilleuse pour se tourner vers la pure poésie du réel. Cette ode fluviale est un régal pour les yeux puisque bénéficiant d'une magnifique photographie et d'un sens très sûr du cadrage, jusque dans les captations à l'improviste de ces trains et autres voitures croisant sur les ponts la ligne tracée par le bâteau-caméra. Quoi de plus fluide qu'un travelling glissant sur l'eau, qu'il soit avant ou latéral, captant la vie des berges ? Exerçant son oeil de peintre et d'architecte, Ivens double le plaisir de la composition plastique par celui du mouvement. Mouvements d'appareils et mouvements des corps. Car tout autant que le fleuve, c'est l'activité humaine qui se développe autour qui intéresse le documentariste. Les instants volés aux passants ou aux travailleurs peuvent passer parfois pour du pittoresque, mais il faut voir comment la vie s'y glisse, grâce à ces brefs regards-caméra, ces discussions que l'on devine animées, ce labeur lesté tant de noblesse que de pénibilité. La narration se cale sur une journée, d'une aube à l'autre, comme le poème de Prévert, lu par Serge Reggiani, englobe toute une vie. Ivens s'accorde avec le poète pour célébrer les enfants, les travailleurs, les vieillards, les pêcheurs, les clochards et surtout les amoureux. Charmant, drôle et inventif, La Seine a rencontré Paris a reçu le Grand Prix du court-métrage à Cannes en 1958.
 Plus admirable encore, ...A Valparaiso est la pépite de ce deuxième coffret. Valparaiso, ville du Chili, coincée entre la mer et les collines : Ivens a une nouvelle fois le génie du lieu et tire toutes les possibilités de cette cité verticale où tout s'organise en va-et-vient entre haut et bas, via les multiples escaliers et ascenseurs téléphériques. Ce portrait d'une ville et de ses habitants, il le trace au rythme d'un montage d'une grande modernité (jouant du coq à l'âne, libérant quelques notations humoristiques...) et l'encadre comme à son habitude par un commentaire. Mais le ton a évolué. Nous sommes en 1963 et les cinémas de Resnais et de Marker sont bien passés par là, se dit-on, jusqu'à ce que le générique de fin nous confirme la participation de ce dernier. Le texte est en effet signé par l'auteur de La jetée, qui apporte son regard en apparence plus détaché mais pas moins intense ni pertinent et qui permet à Ivens de mêler idéalement au sein d'une même oeuvre la démarche militante et l'ambition poétique. Le discours se fait ainsi moins directif et, sans perdre ses qualités d'organisation, la mise en scène est elle aussi plus libre, le tout rendant possible le maintien d'une force de conviction sans les oeillères de la propagande. Ce très grand documentaire se charge de plus, dans sa dernière partie, d'une certaine émotion lorsque l'on voit le cinéaste passer sous nos yeux, pour la première fois et à l'intérieur même de son film, à la couleur, au moment d'aborder l'histoire de ce peuple chilien, par le biais de l'art.
Plus admirable encore, ...A Valparaiso est la pépite de ce deuxième coffret. Valparaiso, ville du Chili, coincée entre la mer et les collines : Ivens a une nouvelle fois le génie du lieu et tire toutes les possibilités de cette cité verticale où tout s'organise en va-et-vient entre haut et bas, via les multiples escaliers et ascenseurs téléphériques. Ce portrait d'une ville et de ses habitants, il le trace au rythme d'un montage d'une grande modernité (jouant du coq à l'âne, libérant quelques notations humoristiques...) et l'encadre comme à son habitude par un commentaire. Mais le ton a évolué. Nous sommes en 1963 et les cinémas de Resnais et de Marker sont bien passés par là, se dit-on, jusqu'à ce que le générique de fin nous confirme la participation de ce dernier. Le texte est en effet signé par l'auteur de La jetée, qui apporte son regard en apparence plus détaché mais pas moins intense ni pertinent et qui permet à Ivens de mêler idéalement au sein d'une même oeuvre la démarche militante et l'ambition poétique. Le discours se fait ainsi moins directif et, sans perdre ses qualités d'organisation, la mise en scène est elle aussi plus libre, le tout rendant possible le maintien d'une force de conviction sans les oeillères de la propagande. Ce très grand documentaire se charge de plus, dans sa dernière partie, d'une certaine émotion lorsque l'on voit le cinéaste passer sous nos yeux, pour la première fois et à l'intérieur même de son film, à la couleur, au moment d'aborder l'histoire de ce peuple chilien, par le biais de l'art.
La collaboration avec Chris Marker s'est poursuie avec Rotterdam-Europort, essai-filmé sur la grande cité industrielle hollandaise. Le rythme du documentaire se calque sur celui de la ville : constamment en mouvement, bruyante, envahie par les fumées des cheminées d'usine. Les changements de plans sont brusques et rapides, le texte (dit par Yves Montand) relativement obscur. L'aspect décousu est également accentué par l'intrusion de la fiction (l'apparition du Hollandais volant, personnage mythique), contaminant le regard porté sur la réalité et complexifiant encore une oeuvre assez ardue.
Avec Pour le mistral, Ivens continue dans cette voie de l'essai. Survolant la Provence, il tente de filmer le vent, sa trace et ses effets. Le commentaire, poétique, climatique et géographique est l'un des moins heureux de l'oeuvre d'Ivens, par sa tendance à alourdir les images. Les paysages défilent et l'ennui pointe son nez. C'est la présence humaine qui réhausse l'intérêt : quelques paysans au travail et des passants luttant chacun à leur manière contre les bourrasques balayant les rues lors d'une délicieuse séquence. Au deux tiers de ces trente minutes un peu longues, le cinéaste nous refait le passage à la couleur. Dans ...A Valparaiso, le basculement esthétique était lié à l'arrivée du thème du sang alors qu'il manque ici une justification.
Du témoignage au testament
 Ces diverses expériences cinématographiques n'empèchent pas Joris Ivens de continuer à combattre par caméra interposée. Réalisé en 1968, Le 17ème parallèle est un document essentiel sur la guerre du Vietnam par l'immersion à laquelle s'est adonné le cinéaste, pendant deux mois, au sein de la population de Vinh Linh, petite ville du Nord située tout près de la ligne de démarcation et donc des bases américaines. Les bombardements incessants détruisent les habitations, les rizières et les routes, qui sont aussitôt remises en état. Un impressionnant réseau souterrain est construit, le plus souvent par les femmes. Minh, la responsable locale de la sécurité est d'ailleurs la figure principale du film. Ivens décrit patiemment tous les faits et gestes de cette population de paysans et de défenseurs (râteau à la main et fusil en bandoulière), des plus anodins aux plus engagés. De la durée et de la répétition naît la vision précise d'un peuple en résistance : Le 17ème parallèle montre ainsi parfaitement ce sur quoi la puissance américaine se casse les dents. Sans musique, la bande-son est saturée du bruit des avions yankees, le danger venant du ciel. On trouve dans le film peu d'images spectaculaires, noyées qu'elles sont dans celles consacrées à l'attente ou au travail quotidien d'une vie en temps de guerre et le commentaire est parcimonieux, s'équilibrant avec le son enregistré sur place. Ivens tient l'émotion à distance avant un finale (capture d'un soldat US, mots d'enfants) relayant la promesse calme mais ferme qui émane d'un peuple debout.
Ces diverses expériences cinématographiques n'empèchent pas Joris Ivens de continuer à combattre par caméra interposée. Réalisé en 1968, Le 17ème parallèle est un document essentiel sur la guerre du Vietnam par l'immersion à laquelle s'est adonné le cinéaste, pendant deux mois, au sein de la population de Vinh Linh, petite ville du Nord située tout près de la ligne de démarcation et donc des bases américaines. Les bombardements incessants détruisent les habitations, les rizières et les routes, qui sont aussitôt remises en état. Un impressionnant réseau souterrain est construit, le plus souvent par les femmes. Minh, la responsable locale de la sécurité est d'ailleurs la figure principale du film. Ivens décrit patiemment tous les faits et gestes de cette population de paysans et de défenseurs (râteau à la main et fusil en bandoulière), des plus anodins aux plus engagés. De la durée et de la répétition naît la vision précise d'un peuple en résistance : Le 17ème parallèle montre ainsi parfaitement ce sur quoi la puissance américaine se casse les dents. Sans musique, la bande-son est saturée du bruit des avions yankees, le danger venant du ciel. On trouve dans le film peu d'images spectaculaires, noyées qu'elles sont dans celles consacrées à l'attente ou au travail quotidien d'une vie en temps de guerre et le commentaire est parcimonieux, s'équilibrant avec le son enregistré sur place. Ivens tient l'émotion à distance avant un finale (capture d'un soldat US, mots d'enfants) relayant la promesse calme mais ferme qui émane d'un peuple debout.
Après plusieurs documentaires vietnamiens, Joris Ivens et sa compagne Marceline Loridan se lancent au début des années 70 dans un projet ambitieux, celui de Comment Yukong déplaça les montagnes, soit 12 films de durées variables (de 15 minutes à 2 heures) consacrés à la société chinoise contemporaine. Deux épisodes sont proposés dans ce coffret. Sur un plan technique, on note tout d'abord la révolution qu'apporte l'usage du son direct. Bien sûr, cadrage et montage résultent toujours d'un choix mais la synchronisation de l'image et du son sur toute la durée semble permettre d'atteindre un niveau supérieur du réel. Suivant l'évolution logique, le commentaire n'est plus surplombant mais se fait personnel (employant le "nous" du couple de réalisateurs) et accompagne le spectateur plus qu'il ne le guide. Ce dernier se sent donc plus libre, impression redoublée par le calme du montage et cela malgré le cadre idéologique. Car l'idéologie est ici comme mise à nu. Devant ce peuple chinois sortant de la Révolution Culturelle, plus que la reprise régulière et naturelle de slogans politiques, le plus surprenant pour nous est cette tendance irrépressible à l'auto-critique en public. Que la caméra soit braquée sur une salle de classe, une pharmacie ou vers la rue, il y a dans Yukong une dimension d'exemplarité qui se développe sous le regard bienveillant d'Ivens et Loridan. Les contradictions ne sont pas extirpées par les auteurs, elles sortent d'elles-mêmes de la bouche des hommes et femmes cotoyés. Le nez sur le quotidien, il n'y a certes pas de "recul" politique ici. Mais cette écoute attentive permet de saisir sur la durée l'âme d'un peuple et de comprendre bien des rouages d'une société mal connue.
 A la fin des années 80, très diminué, Joris Ivens arrive au bout du voyage. Marceline Loridan le fait passer de l'autre côté de la caméra : un vieil homme de 90 ans repart en Chine afin de filmer (à nouveau) le vent. Entre imagerie de contes et extraits d'anciens films, entre captations documentaires et petites fictions, entre symphonie de paysages et décors de carton-pâte, Une histoire de vent est un patchwork avançant par associations d'idées. Si le fil conducteur est bien celui du vent (donnant d'ailleurs prétexte à de superbes vues, magnifiées par la belle musique de Michel Portal), le périple est autant géographique qu'autobiographique et offre à Ivens l'occasion de réfléchir sur son propre cinéma. A cet égard, la plus belle scène du film nous le montre, tenant une perche et un micro, en train d'enregistrer le vent et de capter, en même temps, des bribes de conversations dans toutes les langues possibles, métaphore parfaite de son travail et du but qu'il a poursuivi pendant cinquante ans. Plus étonnant encore, cet essai kaléidoscopique, inégal mais émouvant, est réalisé avec humour, en particulier lorsqu'il s'agit de revenir sur la méthode Ivens et ses petits arrangements possibles avec la réalité. Il faut certes connaître suffisamment son oeuvre pour goûter pleinement la saveur de ce dernier fruit, faute de quoi quelques séquences paraîtront particulièrement incongrues (telle cette reconstitution kitch et théatrâle des grandes heures de la Révolution Culturelle). Toutefois, lorsque l'on a suivi le parcours de l'homme, on ne peut que se réjouir de cette malice de vieux sage qui, sans renier ses engagements passés, montrant avec humour l'envers des choses, semble nous dire que la transparence n'est jamais totale mais aussi que sous la propagande peut cheminer la vérité.
A la fin des années 80, très diminué, Joris Ivens arrive au bout du voyage. Marceline Loridan le fait passer de l'autre côté de la caméra : un vieil homme de 90 ans repart en Chine afin de filmer (à nouveau) le vent. Entre imagerie de contes et extraits d'anciens films, entre captations documentaires et petites fictions, entre symphonie de paysages et décors de carton-pâte, Une histoire de vent est un patchwork avançant par associations d'idées. Si le fil conducteur est bien celui du vent (donnant d'ailleurs prétexte à de superbes vues, magnifiées par la belle musique de Michel Portal), le périple est autant géographique qu'autobiographique et offre à Ivens l'occasion de réfléchir sur son propre cinéma. A cet égard, la plus belle scène du film nous le montre, tenant une perche et un micro, en train d'enregistrer le vent et de capter, en même temps, des bribes de conversations dans toutes les langues possibles, métaphore parfaite de son travail et du but qu'il a poursuivi pendant cinquante ans. Plus étonnant encore, cet essai kaléidoscopique, inégal mais émouvant, est réalisé avec humour, en particulier lorsqu'il s'agit de revenir sur la méthode Ivens et ses petits arrangements possibles avec la réalité. Il faut certes connaître suffisamment son oeuvre pour goûter pleinement la saveur de ce dernier fruit, faute de quoi quelques séquences paraîtront particulièrement incongrues (telle cette reconstitution kitch et théatrâle des grandes heures de la Révolution Culturelle). Toutefois, lorsque l'on a suivi le parcours de l'homme, on ne peut que se réjouir de cette malice de vieux sage qui, sans renier ses engagements passés, montrant avec humour l'envers des choses, semble nous dire que la transparence n'est jamais totale mais aussi que sous la propagande peut cheminer la vérité.
Une histoire de vent est donc une oeuvre singulière et un testament idéal car tendu vers la vie. Ses facettes en sont multiples, à l'image de l'oeuvre entière de Joris Ivens, trop souvent réduite au reportage. Une carrière exemplaire, voilà ce qui se dégage du panorama. Non dans le sens d'une qualité supérieure de chaque opus, mais bien dans celui de l'accompagnement de l'histoire du documentaire sur plus d'un demi-siècle, épousant son évolution formelle, la devançant parfois.
(Chronique DVD pour Kinok)
 Quand il aborde, de biais ou de front, la question de l'emprisonnement, tout documentaire qui se respecte doit à un moment ou à un autre travailler la notion d'espace. À côté, le beau film de la réalisatrice Stéphane Mercurio s'efforce de faire parler les femmes, les enfants, les pères et les mères de détenus dans les locaux de la maison d'accueil jouxtant la prison pour hommes de Rennes. Cette structure est avant tout un lieu de rencontres et d'échanges, à l'abri des regards pesants de la société, un lieu où l'entraide et le réconfort sont possibles, un lieu où sont facilitées les démarches administratives comme la prise de rendez-vous pour le parloir. C'est aussi un espace de transition et les témoignages recueillis, tout comme les choix de mise en scène, nous font prendre conscience de l'importance de cet état d'entre-deux. La maison d'accueil est pour ces personnes en visite, très majoritairement des femmes, l'une des étapes du passage, toujours douloureux, d'un monde à l'autre, l'un des lieux, avec la voiture ou le train permettant le trajet, où s'effectue un changement psychologique destiné à absorber, plus ou moins efficacement, le choc du face à face dans le parloir.
Quand il aborde, de biais ou de front, la question de l'emprisonnement, tout documentaire qui se respecte doit à un moment ou à un autre travailler la notion d'espace. À côté, le beau film de la réalisatrice Stéphane Mercurio s'efforce de faire parler les femmes, les enfants, les pères et les mères de détenus dans les locaux de la maison d'accueil jouxtant la prison pour hommes de Rennes. Cette structure est avant tout un lieu de rencontres et d'échanges, à l'abri des regards pesants de la société, un lieu où l'entraide et le réconfort sont possibles, un lieu où sont facilitées les démarches administratives comme la prise de rendez-vous pour le parloir. C'est aussi un espace de transition et les témoignages recueillis, tout comme les choix de mise en scène, nous font prendre conscience de l'importance de cet état d'entre-deux. La maison d'accueil est pour ces personnes en visite, très majoritairement des femmes, l'une des étapes du passage, toujours douloureux, d'un monde à l'autre, l'un des lieux, avec la voiture ou le train permettant le trajet, où s'effectue un changement psychologique destiné à absorber, plus ou moins efficacement, le choc du face à face dans le parloir. Tournage clandestin dans les rues et les caves de Téhéran, sujet inattendu (de la dfficulté et du danger de monter un groupe de rock en Iran), bel accueil cannois : une fois satisfaite la curiosité initiale provoquée par ces diverses informations, je dois dire que Les chats persans (Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh), malgré son potentiel de chambardement, n'ont pas fait varier d'un pouce mon jugement sur Bahman Ghobadi. Je reste sur la même impression que lors de ma découverte d'Un temps pour l'ivresse des chevaux (2000) et des Chansons du pays de ma mère(2002), deux de ses quatre autres longs-métrages : s'il réalise des travaux très estimables, le cinéaste n'atteint jamais l'excellence de ses compatriotes Abbas Kiarostami, Jafar Panahi et Mohsen Makhmalbaf. La principale réserve est que chez Ghobadi la forme est souvent délaissée au profit du discours.
Tournage clandestin dans les rues et les caves de Téhéran, sujet inattendu (de la dfficulté et du danger de monter un groupe de rock en Iran), bel accueil cannois : une fois satisfaite la curiosité initiale provoquée par ces diverses informations, je dois dire que Les chats persans (Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh), malgré son potentiel de chambardement, n'ont pas fait varier d'un pouce mon jugement sur Bahman Ghobadi. Je reste sur la même impression que lors de ma découverte d'Un temps pour l'ivresse des chevaux (2000) et des Chansons du pays de ma mère(2002), deux de ses quatre autres longs-métrages : s'il réalise des travaux très estimables, le cinéaste n'atteint jamais l'excellence de ses compatriotes Abbas Kiarostami, Jafar Panahi et Mohsen Makhmalbaf. La principale réserve est que chez Ghobadi la forme est souvent délaissée au profit du discours. L'institution que Frederick Wiseman a décidé de radiographier cette fois-ci est l'Opéra de Paris. Il le fait en long, en large et en travers, filmant aussi bien le bureau de la directrice artistique que les ruches sur le toit du bâtiment ou le dédale des sous-sols. Toutefois, l'essentiel se passe bien sûr au cours des répétitions et des représentations.
L'institution que Frederick Wiseman a décidé de radiographier cette fois-ci est l'Opéra de Paris. Il le fait en long, en large et en travers, filmant aussi bien le bureau de la directrice artistique que les ruches sur le toit du bâtiment ou le dédale des sous-sols. Toutefois, l'essentiel se passe bien sûr au cours des répétitions et des représentations. A l'aide de sa petite caméra numérique, Alain Cavalier filme autour de lui tout ce qui peut évoquer Irène, sa compagne décédée il y a près de quarante de cela. Il cadre des objets, du mobilier, des pièces, des paysages susceptibles de se recharger de sa présence. Se situant à l'une des extrémités du spectre du cinéma, le film contient tout de même, en son centre, une sorte de morceau de bravoure (preuve qu'il y a bien, malgré les apparences, une dramaturgie) : le récit de ce terrible après-midi de janvier 1972, au cours duquel Alain Cavalier perdit sa femme. La séquence est bouleversante au point de nous faire dire qu'une telle chose, si proche de l'indicible, ne peut finalement être racontée et partagée que comme cela, en passant par une remémoration clinique des faits et des gestes dans les lieux inchangés du traumatisme. Cette déambulation dans un salon sous-éclairé et vide de toute présence humaine autre que celle du cinéaste derrière sa caméra dit tout de l'absence et traduit très précisément l'interrogation insoutenable et paralysante, la montée de l'angoisse et l'incompréhension.
A l'aide de sa petite caméra numérique, Alain Cavalier filme autour de lui tout ce qui peut évoquer Irène, sa compagne décédée il y a près de quarante de cela. Il cadre des objets, du mobilier, des pièces, des paysages susceptibles de se recharger de sa présence. Se situant à l'une des extrémités du spectre du cinéma, le film contient tout de même, en son centre, une sorte de morceau de bravoure (preuve qu'il y a bien, malgré les apparences, une dramaturgie) : le récit de ce terrible après-midi de janvier 1972, au cours duquel Alain Cavalier perdit sa femme. La séquence est bouleversante au point de nous faire dire qu'une telle chose, si proche de l'indicible, ne peut finalement être racontée et partagée que comme cela, en passant par une remémoration clinique des faits et des gestes dans les lieux inchangés du traumatisme. Cette déambulation dans un salon sous-éclairé et vide de toute présence humaine autre que celle du cinéaste derrière sa caméra dit tout de l'absence et traduit très précisément l'interrogation insoutenable et paralysante, la montée de l'angoisse et l'incompréhension. Capitalism : a love story est bien sûr moins passionnant que les trois premiers documentaires de Michael Moore, il est même moins intéressant, du point de vue des tiraillements que provoquent les méthodes et les choix du cinéaste, que
Capitalism : a love story est bien sûr moins passionnant que les trois premiers documentaires de Michael Moore, il est même moins intéressant, du point de vue des tiraillements que provoquent les méthodes et les choix du cinéaste, que  Étranges étrangers est au centre de la nouvelle livraison de la collection "Histoire d'un film, mémoire d'une lutte", dirigée par Tangui Perron pour Scope Editions et Périphérie, centre de création cinématographique. Après un premier livre-dvd qui s'appuyait sur le film de Jean-Pierre Thorn, Le dos au mur, ce deuxième numéro confirme que nous tenons là l'une des initiatives éditoriales les plus passionnantes de ces dernières années, redonnant vie à des oeuvres cinématographiques militantes rares et les accompagnant d'une documentation extrèmement riche et instructive.
Étranges étrangers est au centre de la nouvelle livraison de la collection "Histoire d'un film, mémoire d'une lutte", dirigée par Tangui Perron pour Scope Editions et Périphérie, centre de création cinématographique. Après un premier livre-dvd qui s'appuyait sur le film de Jean-Pierre Thorn, Le dos au mur, ce deuxième numéro confirme que nous tenons là l'une des initiatives éditoriales les plus passionnantes de ces dernières années, redonnant vie à des oeuvres cinématographiques militantes rares et les accompagnant d'une documentation extrèmement riche et instructive.
 La guerre de sécession (The civil war) est le premier documentaire au long cours de Ken Burns (qui réalisera notamment par la suite : Baseball, Jazz,
La guerre de sécession (The civil war) est le premier documentaire au long cours de Ken Burns (qui réalisera notamment par la suite : Baseball, Jazz,  Nous retrouvons Ivens à la sortie de la guerre aux Antipodes. L'Indonésie appelle est un court film-tract relatant la lutte des dockers indonésiens travaillant dans les ports australiens et organisant le blocage des navires hollandais. L'Indonésie avait profité de la fin du conflit mondial pour proclamer son indépendance. Pour les natifs de l'archipel, il était donc primordial de contrer toute tentative de reprise en main militaire pas les anciens colonisateurs. Ivens nous montre le rassemblement des forces ouvrières, l'organisation du blocus et l'aide internationale apportée par les syndicats. Les informations sont classiquement amenées par un commentaire, qui laisse cependant la place à des discours enregistrés sur place ou à la post-synchronisation pour certaines séquences. Ce nouvel usage de la parole apporte un surcroît de réalisme, bien que celui-ci soit d'un autre côté entamé par d'évidentes reconstitutions. L'efficacité du film est quelque peu lénifiante et son esthétique ne l'élève guère au-dessus du simple reportage.
Nous retrouvons Ivens à la sortie de la guerre aux Antipodes. L'Indonésie appelle est un court film-tract relatant la lutte des dockers indonésiens travaillant dans les ports australiens et organisant le blocage des navires hollandais. L'Indonésie avait profité de la fin du conflit mondial pour proclamer son indépendance. Pour les natifs de l'archipel, il était donc primordial de contrer toute tentative de reprise en main militaire pas les anciens colonisateurs. Ivens nous montre le rassemblement des forces ouvrières, l'organisation du blocus et l'aide internationale apportée par les syndicats. Les informations sont classiquement amenées par un commentaire, qui laisse cependant la place à des discours enregistrés sur place ou à la post-synchronisation pour certaines séquences. Ce nouvel usage de la parole apporte un surcroît de réalisme, bien que celui-ci soit d'un autre côté entamé par d'évidentes reconstitutions. L'efficacité du film est quelque peu lénifiante et son esthétique ne l'élève guère au-dessus du simple reportage. Plus admirable encore, ...A Valparaiso est la pépite de ce deuxième coffret. Valparaiso, ville du Chili, coincée entre la mer et les collines : Ivens a une nouvelle fois le génie du lieu et tire toutes les possibilités de cette cité verticale où tout s'organise en va-et-vient entre haut et bas, via les multiples escaliers et ascenseurs téléphériques. Ce portrait d'une ville et de ses habitants, il le trace au rythme d'un montage d'une grande modernité (jouant du coq à l'âne, libérant quelques notations humoristiques...) et l'encadre comme à son habitude par un commentaire. Mais le ton a évolué. Nous sommes en 1963 et les cinémas de Resnais et de Marker sont bien passés par là, se dit-on, jusqu'à ce que le générique de fin nous confirme la participation de ce dernier. Le texte est en effet signé par l'auteur de La jetée, qui apporte son regard en apparence plus détaché mais pas moins intense ni pertinent et qui permet à Ivens de mêler idéalement au sein d'une même oeuvre la démarche militante et l'ambition poétique. Le discours se fait ainsi moins directif et, sans perdre ses qualités d'organisation, la mise en scène est elle aussi plus libre, le tout rendant possible le maintien d'une force de conviction sans les oeillères de la propagande. Ce très grand documentaire se charge de plus, dans sa dernière partie, d'une certaine émotion lorsque l'on voit le cinéaste passer sous nos yeux, pour la première fois et à l'intérieur même de son film, à la couleur, au moment d'aborder l'histoire de ce peuple chilien, par le biais de l'art.
Plus admirable encore, ...A Valparaiso est la pépite de ce deuxième coffret. Valparaiso, ville du Chili, coincée entre la mer et les collines : Ivens a une nouvelle fois le génie du lieu et tire toutes les possibilités de cette cité verticale où tout s'organise en va-et-vient entre haut et bas, via les multiples escaliers et ascenseurs téléphériques. Ce portrait d'une ville et de ses habitants, il le trace au rythme d'un montage d'une grande modernité (jouant du coq à l'âne, libérant quelques notations humoristiques...) et l'encadre comme à son habitude par un commentaire. Mais le ton a évolué. Nous sommes en 1963 et les cinémas de Resnais et de Marker sont bien passés par là, se dit-on, jusqu'à ce que le générique de fin nous confirme la participation de ce dernier. Le texte est en effet signé par l'auteur de La jetée, qui apporte son regard en apparence plus détaché mais pas moins intense ni pertinent et qui permet à Ivens de mêler idéalement au sein d'une même oeuvre la démarche militante et l'ambition poétique. Le discours se fait ainsi moins directif et, sans perdre ses qualités d'organisation, la mise en scène est elle aussi plus libre, le tout rendant possible le maintien d'une force de conviction sans les oeillères de la propagande. Ce très grand documentaire se charge de plus, dans sa dernière partie, d'une certaine émotion lorsque l'on voit le cinéaste passer sous nos yeux, pour la première fois et à l'intérieur même de son film, à la couleur, au moment d'aborder l'histoire de ce peuple chilien, par le biais de l'art. Ces diverses expériences cinématographiques n'empèchent pas Joris Ivens de continuer à combattre par caméra interposée. Réalisé en 1968, Le 17ème parallèle est un document essentiel sur la guerre du Vietnam par l'immersion à laquelle s'est adonné le cinéaste, pendant deux mois, au sein de la population de Vinh Linh, petite ville du Nord située tout près de la ligne de démarcation et donc des bases américaines. Les bombardements incessants détruisent les habitations, les rizières et les routes, qui sont aussitôt remises en état. Un impressionnant réseau souterrain est construit, le plus souvent par les femmes. Minh, la responsable locale de la sécurité est d'ailleurs la figure principale du film. Ivens décrit patiemment tous les faits et gestes de cette population de paysans et de défenseurs (râteau à la main et fusil en bandoulière), des plus anodins aux plus engagés. De la durée et de la répétition naît la vision précise d'un peuple en résistance : Le 17ème parallèle montre ainsi parfaitement ce sur quoi la puissance américaine se casse les dents. Sans musique, la bande-son est saturée du bruit des avions yankees, le danger venant du ciel. On trouve dans le film peu d'images spectaculaires, noyées qu'elles sont dans celles consacrées à l'attente ou au travail quotidien d'une vie en temps de guerre et le commentaire est parcimonieux, s'équilibrant avec le son enregistré sur place. Ivens tient l'émotion à distance avant un finale (capture d'un soldat US, mots d'enfants) relayant la promesse calme mais ferme qui émane d'un peuple debout.
Ces diverses expériences cinématographiques n'empèchent pas Joris Ivens de continuer à combattre par caméra interposée. Réalisé en 1968, Le 17ème parallèle est un document essentiel sur la guerre du Vietnam par l'immersion à laquelle s'est adonné le cinéaste, pendant deux mois, au sein de la population de Vinh Linh, petite ville du Nord située tout près de la ligne de démarcation et donc des bases américaines. Les bombardements incessants détruisent les habitations, les rizières et les routes, qui sont aussitôt remises en état. Un impressionnant réseau souterrain est construit, le plus souvent par les femmes. Minh, la responsable locale de la sécurité est d'ailleurs la figure principale du film. Ivens décrit patiemment tous les faits et gestes de cette population de paysans et de défenseurs (râteau à la main et fusil en bandoulière), des plus anodins aux plus engagés. De la durée et de la répétition naît la vision précise d'un peuple en résistance : Le 17ème parallèle montre ainsi parfaitement ce sur quoi la puissance américaine se casse les dents. Sans musique, la bande-son est saturée du bruit des avions yankees, le danger venant du ciel. On trouve dans le film peu d'images spectaculaires, noyées qu'elles sont dans celles consacrées à l'attente ou au travail quotidien d'une vie en temps de guerre et le commentaire est parcimonieux, s'équilibrant avec le son enregistré sur place. Ivens tient l'émotion à distance avant un finale (capture d'un soldat US, mots d'enfants) relayant la promesse calme mais ferme qui émane d'un peuple debout. A la fin des années 80, très diminué, Joris Ivens arrive au bout du voyage. Marceline Loridan le fait passer de l'autre côté de la caméra : un vieil homme de 90 ans repart en Chine afin de filmer (à nouveau) le vent. Entre imagerie de contes et extraits d'anciens films, entre captations documentaires et petites fictions, entre symphonie de paysages et décors de carton-pâte, Une histoire de vent est un patchwork avançant par associations d'idées. Si le fil conducteur est bien celui du vent (donnant d'ailleurs prétexte à de superbes vues, magnifiées par la belle musique de Michel Portal), le périple est autant géographique qu'autobiographique et offre à Ivens l'occasion de réfléchir sur son propre cinéma. A cet égard, la plus belle scène du film nous le montre, tenant une perche et un micro, en train d'enregistrer le vent et de capter, en même temps, des bribes de conversations dans toutes les langues possibles, métaphore parfaite de son travail et du but qu'il a poursuivi pendant cinquante ans. Plus étonnant encore, cet essai kaléidoscopique, inégal mais émouvant, est réalisé avec humour, en particulier lorsqu'il s'agit de revenir sur la méthode Ivens et ses petits arrangements possibles avec la réalité. Il faut certes connaître suffisamment son oeuvre pour goûter pleinement la saveur de ce dernier fruit, faute de quoi quelques séquences paraîtront particulièrement incongrues (telle cette reconstitution kitch et théatrâle des grandes heures de la Révolution Culturelle). Toutefois, lorsque l'on a suivi le parcours de l'homme, on ne peut que se réjouir de cette malice de vieux sage qui, sans renier ses engagements passés, montrant avec humour l'envers des choses, semble nous dire que la transparence n'est jamais totale mais aussi que sous la propagande peut cheminer la vérité.
A la fin des années 80, très diminué, Joris Ivens arrive au bout du voyage. Marceline Loridan le fait passer de l'autre côté de la caméra : un vieil homme de 90 ans repart en Chine afin de filmer (à nouveau) le vent. Entre imagerie de contes et extraits d'anciens films, entre captations documentaires et petites fictions, entre symphonie de paysages et décors de carton-pâte, Une histoire de vent est un patchwork avançant par associations d'idées. Si le fil conducteur est bien celui du vent (donnant d'ailleurs prétexte à de superbes vues, magnifiées par la belle musique de Michel Portal), le périple est autant géographique qu'autobiographique et offre à Ivens l'occasion de réfléchir sur son propre cinéma. A cet égard, la plus belle scène du film nous le montre, tenant une perche et un micro, en train d'enregistrer le vent et de capter, en même temps, des bribes de conversations dans toutes les langues possibles, métaphore parfaite de son travail et du but qu'il a poursuivi pendant cinquante ans. Plus étonnant encore, cet essai kaléidoscopique, inégal mais émouvant, est réalisé avec humour, en particulier lorsqu'il s'agit de revenir sur la méthode Ivens et ses petits arrangements possibles avec la réalité. Il faut certes connaître suffisamment son oeuvre pour goûter pleinement la saveur de ce dernier fruit, faute de quoi quelques séquences paraîtront particulièrement incongrues (telle cette reconstitution kitch et théatrâle des grandes heures de la Révolution Culturelle). Toutefois, lorsque l'on a suivi le parcours de l'homme, on ne peut que se réjouir de cette malice de vieux sage qui, sans renier ses engagements passés, montrant avec humour l'envers des choses, semble nous dire que la transparence n'est jamais totale mais aussi que sous la propagande peut cheminer la vérité.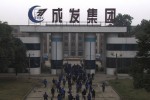 Moi qui, il y a peu, trouvais que l'année cinéma 2009 démarrait bien et promettait une belle moisson dès le printemps, je commence à déchanter sérieusement. Je prie pour que le prochain Barnum cannois change la donne, sans quoi je vais finir par limiter mon activité de cinéphile au cercle domestique et à la chronique de dvd (sur lesquelles j'ai d'ailleurs du retard). La déconvenue du jour vient de Jia Zhangke, duquel j'attendais pourtant beaucoup. Mais après avoir trouvé ses trois premiers longs-métrages admirables (Xiao Wu pickpocket, Platform, Unknown pleasures) puis émis quelques réserves sur les deux suivants (The World, Still life), il était sans doute fatal que le sixième m'ennuie pour de bon.
Moi qui, il y a peu, trouvais que l'année cinéma 2009 démarrait bien et promettait une belle moisson dès le printemps, je commence à déchanter sérieusement. Je prie pour que le prochain Barnum cannois change la donne, sans quoi je vais finir par limiter mon activité de cinéphile au cercle domestique et à la chronique de dvd (sur lesquelles j'ai d'ailleurs du retard). La déconvenue du jour vient de Jia Zhangke, duquel j'attendais pourtant beaucoup. Mais après avoir trouvé ses trois premiers longs-métrages admirables (Xiao Wu pickpocket, Platform, Unknown pleasures) puis émis quelques réserves sur les deux suivants (The World, Still life), il était sans doute fatal que le sixième m'ennuie pour de bon.