(Cristian Nemescu / Roumanie / 2007)
■■■□
 La réussite roumaine du semestre, California dreamin' (Nesfarsit) est le premier et donc unique film de Cristian Nemescu, décédé en août 2006 en pleine post-production de son long métrage. Comme ses plus talentueux compatriotes, le jeune cinéaste souhaitait se pencher sur l'histoire récente de son pays et, partant d'une matière réaliste, dériver vers la fable politique. Mandaté par l'OTAN pour le soutien technologique des raids américains sur Belgrade lors de la guerre du Kosovo de 99, un convoi ferroviaire se retrouve bloqué par Doiaru, chef de gare d'un coin perdu de Roumanie. Démunis et privilégiant, parfois à contre-coeur, la diplomatie, le Capitaine Jones et son petit groupe de Marines n'ont d'autre choix que de tuer le temps pendant cinq jours en se mêlant à la population locale.
La réussite roumaine du semestre, California dreamin' (Nesfarsit) est le premier et donc unique film de Cristian Nemescu, décédé en août 2006 en pleine post-production de son long métrage. Comme ses plus talentueux compatriotes, le jeune cinéaste souhaitait se pencher sur l'histoire récente de son pays et, partant d'une matière réaliste, dériver vers la fable politique. Mandaté par l'OTAN pour le soutien technologique des raids américains sur Belgrade lors de la guerre du Kosovo de 99, un convoi ferroviaire se retrouve bloqué par Doiaru, chef de gare d'un coin perdu de Roumanie. Démunis et privilégiant, parfois à contre-coeur, la diplomatie, le Capitaine Jones et son petit groupe de Marines n'ont d'autre choix que de tuer le temps pendant cinq jours en se mêlant à la population locale.
Il faut se laisser aller devant ce montage désarçonnant, ce rythme chaotique, cette caméra une nouvelle fois portée. Si on commence par se demander si ce style est adéquat quand sont posés situation et enjeux et si l'intérêt tiendra jusqu'à la ligne d'arrivée, fixée 2h35 plus tard, au bout de quelques minutes, la question ne se pose plus dès lors que Nemescu, suivant la rumeur puis les ballades des soldats aux alentours, trace des cercles concentriques autour de la gare, nous présentant toujours plus de personnages et donnant une belle ampleur au film. Cette manière, qui prend son temps en restant précise, trouve sans doute sa plus belle expression dans la longue séquence de la fête du village, à laquelle sont invités les Américains, où le fait d'entendre massacrer Love me tender par un Elvis de campagne n'empêche pas l'émotion devant ces rapprochements de corps dont le désir n'est qu'à grand peine entravé par la maladresse.
La comédie se joue essentiellement sur le choc des cultures, thème propice au rire et développé très subtilement ici (dès la scène de l'hymne américain joué pour mettre au garde à vous le Capitaine qui commençait à sérieusement s'énerver). De même, l'idée de barrière linguistique peut donner de si belles séquences, pour peu qu'elles soient menées patiemment et honnêtement, qu'on se lamente en pensant à tous ces films mêlant diverses nationalités et se limitant régulièrement au seul anglais. Après le tissage d'un subtil réseau de relations entre les uns et les autres et l'écoulement de la chronique, revient sur la fin la parabole politique, que l'on avait un peu oubliée. Parfaitement amenée par le scénario, lancée par la formidable diatribe de Jones face aux villageois réunis, elle prend une forme limpide. Ainsi, comme à leur habitude, les Américains exacerbent et détournent les antagonismes locaux vers leurs intérêts personnels, sous couvert d'ingérence humanitaire, et finissent par quitter une région qu'ils ont contribué à mener un peu plus vers le chaos.
L'un des tours de force du film est de dénoncer des traditions ou des agissements par la caricature, tout en laissant sa chance à chaque personnage. Celui du Capitaine Jones pourrait endosser toutes les critiques faîtes à l'Américain trop sûr de lui. Des petites touches repoussent cette tentation. Voyez la façon qu'il a de répondre d'un simple "Je ne le suis plus" à la question de Doiaru "Êtes-vous marié ?". Il n'en faut pas plus, pas besoin d'un gros plan ou d'une relance dans le dialogue. Le lien avec le spectateur est noué. Pareil sort est réservé au chef de gare aux tendances mafieuses. Par la grâce de l'interprète fétiche de Pintilie, Razvan Vasilescu, ce personnage par ailleurs si peu recommandable peut retourner tout notre jugement par sa réplique imparable : "Je vous ai attendu depuis tout ce temps" (depuis la fin de la seconde guerre mondiale où la Roumanie attendait plutôt l'arrivée des G.I. que celle des soldats russes) "vous pouvez attendre quelques jours...". Parallèlement, notre sympathie, cette fois dénuée d'ambiguïté, se porte logiquement sur le principal couple qui se forme sous nos yeux. Un sensible Jamie Elman se lie à une brunette à croquer : Maria Dinulescu. La fille rêve, non pas bêtement de partir pour L.A., comme le croit son camarade de lycée, mais tout simplement de quitter cet endroit. Nemescu aime ses amoureux et leur offre une petite parenthèse enchantée dans un enchaînement parfait : la plus belle scène d'amour vue depuis longtemps, une coupure d'électricité générale, de l'eau qui jaillit des canalisations quand ils s'embrassent et un trajet musical en bus pour le retour. Le moment est magique mais naturel et a même des conséquences ironiques, non pour les deux jeunes gens mais pour l'entourage. Qu'aurait fait de cette suite de séquences un cinéaste bien de chez nous, genre Klapisch, sinon un truc vaguement poético-gnangnan à base d'images hyper lêchées ? Ici, ça palpite, tout simplement.
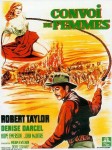
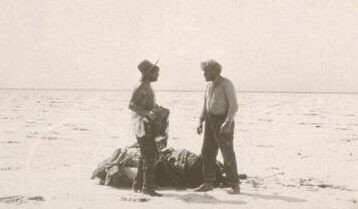

 Tom c'est Tom Chomont, photographe et cinéaste underground, new-yorkais, homosexuel, et très affaibli par la maladie quand le documentariste Mike Hoolbloom décide de mettre en images sa biographie sous forme d'essai poétique. Une longue et énigmatique introduction pose l'esthétique du film. Hoolboom colle, avec un sens du montage confondant, des bouts de documents amateurs, de classiques du cinéma, de prises de vues documentaires de New York de toutes les époques. Sur ces images d'origines très diverses, arrivent de temps à autre des confidences faites par Tom. Les sources iconographiques sont quelques fois reconnaissables (des plans de La terre tremble, Il était une fois en Amérique, Titanic...), mais généralement, leur entremêlement, leur brièveté et parfois leur altération par superpositions, changements de vitesse ou colorisation, empêchent de les situer clairement. Si ce re-travail d'images déjà tournées peut faire penser aux Histoires du cinéma de Godard, le procédé semble poussé ici encore plus loin dans la diversité et la vitesse.
Tom c'est Tom Chomont, photographe et cinéaste underground, new-yorkais, homosexuel, et très affaibli par la maladie quand le documentariste Mike Hoolbloom décide de mettre en images sa biographie sous forme d'essai poétique. Une longue et énigmatique introduction pose l'esthétique du film. Hoolboom colle, avec un sens du montage confondant, des bouts de documents amateurs, de classiques du cinéma, de prises de vues documentaires de New York de toutes les époques. Sur ces images d'origines très diverses, arrivent de temps à autre des confidences faites par Tom. Les sources iconographiques sont quelques fois reconnaissables (des plans de La terre tremble, Il était une fois en Amérique, Titanic...), mais généralement, leur entremêlement, leur brièveté et parfois leur altération par superpositions, changements de vitesse ou colorisation, empêchent de les situer clairement. Si ce re-travail d'images déjà tournées peut faire penser aux Histoires du cinéma de Godard, le procédé semble poussé ici encore plus loin dans la diversité et la vitesse. Puisque Tim Burton croit aux maléfices, risquons cette hypothèse : le fait d'avoir accepté de réaliser un inutile et impersonnel remake de La planète des singes en 2001 a provoqué une malédiction qui lui vaut d'accumuler pendant 10 ans les ratages. Cette commande, venant après une décennie dorée, a laissé tout le monde insatisfait, lui y compris, et surtout, elle semble l'avoir complètement déboussolé. Suivirent donc son film le plus personnel sur le papier et transformé à l'écran en conte bêta et inoffensif (Big fish), puis la Rolls du film pour enfants qui ennuie les parents (Charlie et la chocolaterie), pour arriver à ce Sweeney Todd, où le plus grave est bien de constater que rien n'y fait; le cadre, l'histoire, l'ambiance, le ton ont beau changer, le bilan de santé de l'homme à la coiffure en pétard est toujours aussi alarmant.
Puisque Tim Burton croit aux maléfices, risquons cette hypothèse : le fait d'avoir accepté de réaliser un inutile et impersonnel remake de La planète des singes en 2001 a provoqué une malédiction qui lui vaut d'accumuler pendant 10 ans les ratages. Cette commande, venant après une décennie dorée, a laissé tout le monde insatisfait, lui y compris, et surtout, elle semble l'avoir complètement déboussolé. Suivirent donc son film le plus personnel sur le papier et transformé à l'écran en conte bêta et inoffensif (Big fish), puis la Rolls du film pour enfants qui ennuie les parents (Charlie et la chocolaterie), pour arriver à ce Sweeney Todd, où le plus grave est bien de constater que rien n'y fait; le cadre, l'histoire, l'ambiance, le ton ont beau changer, le bilan de santé de l'homme à la coiffure en pétard est toujours aussi alarmant. Le tracé suivi par No country for old men est sans doute le plus clair de tout le cinéma des frères Coen : un homme tombe par hasard sur une valise pleine de dollars et devient la proie d'un tueur, lui-même poursuivi, le tout sous le regard d'un vieux sheriff. Pas de machination, pas de plan minutieusement préparé qui foire par la bétise des personnages, on va ici droit à l'essentiel en suivant une course-poursuite violente vers le Mexique et retour. L'humour est délibérément absent, ne laissant que quelques traces de grotesque, trop noir pour que l'on en rigole, et même les habituels seconds rôles aux physiques peu avenants (les coiffures improbables, les obèses...) ne sont pas source de gags cartoonesques. Gardant ainsi la seule ossature du récit, les Coen ne s'embarrassent pas de psychologie et ne filment que des figures. Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) est le sheriff, Llewelyn Moss (Josh Brolin) est l'homme traqué, Anton Chigurh (Javier Bardem) est le tueur omniscient. Llewelyn est caractérisé par ses seuls mouvements et réactions, notamment dans les extraordinaires séquences qui le voient s'affairer autour du lieu du massacre, et Chigurh porte toute la mythologie du tueur, sans autre explication à son efficacité et sa violence. Seul le sheriff prend de la distance (puisqu'il est toujours en retard d'un coup) et élabore un discours. Un discours d'impuissance totale face au mal et d'incompréhension face à la nature humaine. No country for old men est donc un film peu bavard. Le seul homme prolixe se le voit aussitôt reprocher et disparaît rapidement de l'écran. De la même façon, on se demandera soudain au moment du générique de fin si l'on a entendu une seule note de musique au cours du film (mis à part la chanson mexicaine entonnée par les quatre musiciens de rue).
Le tracé suivi par No country for old men est sans doute le plus clair de tout le cinéma des frères Coen : un homme tombe par hasard sur une valise pleine de dollars et devient la proie d'un tueur, lui-même poursuivi, le tout sous le regard d'un vieux sheriff. Pas de machination, pas de plan minutieusement préparé qui foire par la bétise des personnages, on va ici droit à l'essentiel en suivant une course-poursuite violente vers le Mexique et retour. L'humour est délibérément absent, ne laissant que quelques traces de grotesque, trop noir pour que l'on en rigole, et même les habituels seconds rôles aux physiques peu avenants (les coiffures improbables, les obèses...) ne sont pas source de gags cartoonesques. Gardant ainsi la seule ossature du récit, les Coen ne s'embarrassent pas de psychologie et ne filment que des figures. Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) est le sheriff, Llewelyn Moss (Josh Brolin) est l'homme traqué, Anton Chigurh (Javier Bardem) est le tueur omniscient. Llewelyn est caractérisé par ses seuls mouvements et réactions, notamment dans les extraordinaires séquences qui le voient s'affairer autour du lieu du massacre, et Chigurh porte toute la mythologie du tueur, sans autre explication à son efficacité et sa violence. Seul le sheriff prend de la distance (puisqu'il est toujours en retard d'un coup) et élabore un discours. Un discours d'impuissance totale face au mal et d'incompréhension face à la nature humaine. No country for old men est donc un film peu bavard. Le seul homme prolixe se le voit aussitôt reprocher et disparaît rapidement de l'écran. De la même façon, on se demandera soudain au moment du générique de fin si l'on a entendu une seule note de musique au cours du film (mis à part la chanson mexicaine entonnée par les quatre musiciens de rue).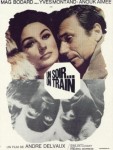 Il est difficile de rendre compte d'Un soir, un train et d'en dégager les mérites sans en déflorer la trame jusqu'à son aboutissement. Je tenterai donc de m'arrêter avant de trop en dire. Mathias (Yves Montand) est professeur de linguistique dans une université flamande. Sans être marié, il vit avec Anne (Anouk Aimée), costumière de théâtre, française un peu perdue dans cette province non-francophone. Le couple semble en crise, atteint par cette maladie bien connue, découverte en Italie au début des années 60 : l'incommunicabilité. Le soir, Mathias doit prendre le train qui l'amènera vers une université voisine où il doit donner une conférence. Il se dispute avec Anne, mais cette dernière finit par revenir vers lui et s'installer dans le même compartiment, juste avant le départ. C'est en plein trajet, après s'être assoupi, qu'un événement semble faire basculer Mathias dans une autre dimension : Anne a disparu, les passagers dorment tous, le train s'arrête puis abandonne Mathias et deux autres personnes dans une campagne qu'ils ne reconnaissent pas. Des flashs d'accident au moment critique et l'omiprésence, dans les minutes précédentes, de la mort sous diverses formes (du sujet de la pièce de théâtre sur laquelle travaille Anne à la visite de Mathias au cimetière), laissent peu de doutes quant à la nature du passage auquel est contraint le héros. Sauf que...
Il est difficile de rendre compte d'Un soir, un train et d'en dégager les mérites sans en déflorer la trame jusqu'à son aboutissement. Je tenterai donc de m'arrêter avant de trop en dire. Mathias (Yves Montand) est professeur de linguistique dans une université flamande. Sans être marié, il vit avec Anne (Anouk Aimée), costumière de théâtre, française un peu perdue dans cette province non-francophone. Le couple semble en crise, atteint par cette maladie bien connue, découverte en Italie au début des années 60 : l'incommunicabilité. Le soir, Mathias doit prendre le train qui l'amènera vers une université voisine où il doit donner une conférence. Il se dispute avec Anne, mais cette dernière finit par revenir vers lui et s'installer dans le même compartiment, juste avant le départ. C'est en plein trajet, après s'être assoupi, qu'un événement semble faire basculer Mathias dans une autre dimension : Anne a disparu, les passagers dorment tous, le train s'arrête puis abandonne Mathias et deux autres personnes dans une campagne qu'ils ne reconnaissent pas. Des flashs d'accident au moment critique et l'omiprésence, dans les minutes précédentes, de la mort sous diverses formes (du sujet de la pièce de théâtre sur laquelle travaille Anne à la visite de Mathias au cimetière), laissent peu de doutes quant à la nature du passage auquel est contraint le héros. Sauf que... Un peu écrasé, coincé entre les deux films les plus reconnus d'Arthur Penn (Bonnie and Clyde, 1967, et Little Big Man, 1970), Alice's restaurant est une chronique s'attachant à la vie d'une petite communauté hippie du Massachussets. Le scénario est inspiré par un récit autobiographique du chanteur-compositeur Arlo Guthrie, qui joue ici son propre rôle. Arlo est le fils de Woody Guthrie, mythe de la musique populaire américaine, grand chroniqueur de l'époque de la dépression et père spirituel de tous les musiciens de folk et de country modernes, Bob Dylan en tête. Woody Guthrie est décédé en 1967, des suites d'une longue maladie lui ayant fait perdre toute autonomie dans les dernières années de sa vie. D'un côté, nous suivons donc son fils, ses visites au père malade, ses amours, son activité musicale et surtout son amitié avec Ray et Alice. Ce couple plus âgé, offrant dans une église transformée en squat ou dans un restaurant, des refuges pour tous les hippies de la région, est l'autre pôle du film.
Un peu écrasé, coincé entre les deux films les plus reconnus d'Arthur Penn (Bonnie and Clyde, 1967, et Little Big Man, 1970), Alice's restaurant est une chronique s'attachant à la vie d'une petite communauté hippie du Massachussets. Le scénario est inspiré par un récit autobiographique du chanteur-compositeur Arlo Guthrie, qui joue ici son propre rôle. Arlo est le fils de Woody Guthrie, mythe de la musique populaire américaine, grand chroniqueur de l'époque de la dépression et père spirituel de tous les musiciens de folk et de country modernes, Bob Dylan en tête. Woody Guthrie est décédé en 1967, des suites d'une longue maladie lui ayant fait perdre toute autonomie dans les dernières années de sa vie. D'un côté, nous suivons donc son fils, ses visites au père malade, ses amours, son activité musicale et surtout son amitié avec Ray et Alice. Ce couple plus âgé, offrant dans une église transformée en squat ou dans un restaurant, des refuges pour tous les hippies de la région, est l'autre pôle du film. Si différents et étalés sur plus de 15 ans, les trois derniers films évoqués sur ce blog (Le couperet, Une époque formidable et It's a free world, auxquels on peut ajouter La graine et le mulet) ont le même point de départ : "A la suite d'un licenciement brutal, le héros décide de...". Comme quoi, l'époque est toujours aussi formidable.
Si différents et étalés sur plus de 15 ans, les trois derniers films évoqués sur ce blog (Le couperet, Une époque formidable et It's a free world, auxquels on peut ajouter La graine et le mulet) ont le même point de départ : "A la suite d'un licenciement brutal, le héros décide de...". Comme quoi, l'époque est toujours aussi formidable. La découverte très tardive d'Une époque formidable est pour moi une bonne surprise. Tout d'abord, cette déchéance d'un cadre vers la clochardisation, bénéficie avec Jugnot-acteur de la personne adéquate pour incarner le personnage principal de Michel Berthier. Son registre de français médiocre, peaufiné au fil des ans, rend parfaitement crédible la trajectoire vers le bas décrite ici. Quand débute l'histoire (après un savoureux prologue relatant un cauchemar du héros), Berthier est déjà licencié et, ressort classique, il fait croire à sa compagne qu'il travaille toujours. Le récit de la déchéance est très bien amené, dans un enchaînement autant dramatique que, chose plus difficile, comique. On relève bien une scène trop facile de rébellion envers une journaliste interviewant complaisamment les SDF et un inévitable clin d'oeil au "Salauds de pauvres !" de La traversée de Paris. Ces excès sont cependant bien rares, au milieu de répliques bien senties, modulées de salves vulgaires en mots d'auteurs plus écrits. Bien rythmé, solidement interprété jusque dans les personnages secondaires (Charlotte de Turkheim, pas mal en prostituée de garage beuglant "Au suivant..."), le film a une vraie mise en scène, utilisant très bien les espaces urbains. La musique, souvent atroce dans ce genre de production, n'est pas désagréable (on se pince d'autant plus en découvrant qu'elle est signée de Francis Cabrel).
La découverte très tardive d'Une époque formidable est pour moi une bonne surprise. Tout d'abord, cette déchéance d'un cadre vers la clochardisation, bénéficie avec Jugnot-acteur de la personne adéquate pour incarner le personnage principal de Michel Berthier. Son registre de français médiocre, peaufiné au fil des ans, rend parfaitement crédible la trajectoire vers le bas décrite ici. Quand débute l'histoire (après un savoureux prologue relatant un cauchemar du héros), Berthier est déjà licencié et, ressort classique, il fait croire à sa compagne qu'il travaille toujours. Le récit de la déchéance est très bien amené, dans un enchaînement autant dramatique que, chose plus difficile, comique. On relève bien une scène trop facile de rébellion envers une journaliste interviewant complaisamment les SDF et un inévitable clin d'oeil au "Salauds de pauvres !" de La traversée de Paris. Ces excès sont cependant bien rares, au milieu de répliques bien senties, modulées de salves vulgaires en mots d'auteurs plus écrits. Bien rythmé, solidement interprété jusque dans les personnages secondaires (Charlotte de Turkheim, pas mal en prostituée de garage beuglant "Au suivant..."), le film a une vraie mise en scène, utilisant très bien les espaces urbains. La musique, souvent atroce dans ce genre de production, n'est pas désagréable (on se pince d'autant plus en découvrant qu'elle est signée de Francis Cabrel).