(Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper / Etats-unis / 1933, 1933 & 1949)
■■■□ / ■■□□ / ■□□□
En matière de cinéma, nous sommes d'ordinaire trop accablés par l'offre télévisuelle, hors câble et satellite, pour ne pas applaudir cette fois-ci la programmation par Arte d'une soirée "King Kong", le 22 juin dernier, et cela d'autant plus que le choix des versions était, pour une fois, cohérent : sur la TNT, King Kong était diffusé en multilingue, laissant donc le choix à chacun et permettant ainsi la découverte de ce classique par le plus jeune public, et les deux "suites" que sont Le fils de Kong et Monsieur Joe, plutôt destinées aux curieux, l'étaient en VO.
 En revoyant le King Kong de Schoedsack et Cooper, frappe d'abord l'évidence d'un coup de génie des auteurs, celui d'avoir voulu faire de leur grand film d'aventure, un film qui réfléchit en même temps sur le pouvoir extraordinaire du cinéma. Grâce au choix initial du scénario de lancer l'expédition sous le prétexte d'un tournage exotique, nombre de séquences acquièrent par la suite une toute autre dimension. L'essai filmé que Carl Denham demande à son actrice Ann Darrow, sur le pont du navire en route pour Skull Island, consiste à la faire crier et à enregistrer son effroi. Celui-ci inquiète par anticipation Jack Driscoll, compagnon bientôt amoureux de la belle. A travers cette scène, le spectateur, lui, perçoit bien plus que cela : l'affirmation que de l'artifice pourra naître l'émotion.
En revoyant le King Kong de Schoedsack et Cooper, frappe d'abord l'évidence d'un coup de génie des auteurs, celui d'avoir voulu faire de leur grand film d'aventure, un film qui réfléchit en même temps sur le pouvoir extraordinaire du cinéma. Grâce au choix initial du scénario de lancer l'expédition sous le prétexte d'un tournage exotique, nombre de séquences acquièrent par la suite une toute autre dimension. L'essai filmé que Carl Denham demande à son actrice Ann Darrow, sur le pont du navire en route pour Skull Island, consiste à la faire crier et à enregistrer son effroi. Celui-ci inquiète par anticipation Jack Driscoll, compagnon bientôt amoureux de la belle. A travers cette scène, le spectateur, lui, perçoit bien plus que cela : l'affirmation que de l'artifice pourra naître l'émotion.
Au cinéma, tout est plus grand et le film commence donc véritablement lorsque l'immense porte séparant le village des indigènes et le monde de King Kong s'ouvre, au rythme d'un superbe travelling avant qui met en valeur ce qui, à partir de là, constituera l'un des fondements esthétiques et thématiques de l'oeuvre : la différence d'échelle entre l'humain et les éléments qui le dépasse. Passé ce seuil, tout devient possible. Produire de l'émerveillement est le but premier de Schoedsack et Cooper. Remarquons que lors de la présentation du monstre dans le théâtre new yorkais, nous suivons l'agitation ayant cours derrière le rideau, en compagnie des trois protagonistes principaux et des journalistes, mais le contrechamp révélant le point fixé par leurs regards nous est longuement refusé. Nous sommes rélégués à la même place que les spectateurs assis dans la salle de spectacle et nous devons attendre comme eux le lever de rideau pour voir la "huitième merveille du monde" enchaînée sur la scène.
Le personnage de Denham, le cinéaste, est intéressant car il n'évolue pas. Sa quète obsessionelle a beau se finir en désastre, il ne culpabilise jamais. D'autre part, le caractère intrusif de l'expédition de cette équipe est bien marqué, ce qui amène à considérer le regard porté par les auteurs sur les indigènes. Ce type de récit d'aventures exotiques véhicule souvent les plus agaçants stéréotypes et libère régulièrement des relents colonialistes et racistes. Or, dans King Kong, la cruauté des rituels des insulaires vaut bien le cynisme de Denham. Plus remarquable encore, les Noirs et les Blancs sont égaux dans la panique. Le gorille géant ne choisit pas ses victimes en fonction de leur race, comme peuvent le faire les animaux féroces de Tarzan, uniquement friands de porteurs noirs. Ceux qui courent affolés entre leurs cases ne sont pas plus ridicules que ceux qui, partis au secours d'Ann, tombent d'un tronc d'arbre secoué par le monstre. La gueule de ce dernier est autant satisfaite à Skull Island qu'à New York.
Il faudrait revenir aussi sur cette construction en trois temps (le voyage, l'île, New York), sur la longueur assumée des séquences d'animation et sur certaines scènes en particulier, comme celle de l'Empire State Building, extraordinairement découpée et harmonisant parfaitement des plans de nature très différente. Rappelons tout de même l'érotisme toujours prégnant des mésaventures d'Ann Darrow - Fay Wray. Le déshabillage dont elle est la victime reste toujours aussi délicieux. Coincée dans cette main gigantesque, elle est réduite à l'état de proie, objet de convoitise de multiples créatures. Notons d'ailleurs, et pour finir, que le T-Rex, le monstre de la grotte et l'oiseau préhistorique règnent sur trois domaines précis, la terre, l'eau et l'air, mais que King Kong les terrasse. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier soit aussi à l'aise dans la jungle que dans un lac (comment fait-il pour le traverser ?) ou dans les nuages, là où l'aviation peine à l'abattre.
 Rééditer l'exploit à la faveur d'une suite rapidement mise en chantier (pour une sortie en salles seulement neuf mois après le premier) était une gageure impossible à tenir. Certaines des beautés de King Kong, telles que la charge érotique et la libération de l'imaginaire sont tellement volatiles que l'on peut considérer qu'elles ont échappé aux auteurs. Fatalement, Le fils de Kong (The son of Kong) est loin d'être porteur de la même fascination. Beaucoup plus court (65 minutes), il est bâti en deux parties distinctes et très inégales.
Rééditer l'exploit à la faveur d'une suite rapidement mise en chantier (pour une sortie en salles seulement neuf mois après le premier) était une gageure impossible à tenir. Certaines des beautés de King Kong, telles que la charge érotique et la libération de l'imaginaire sont tellement volatiles que l'on peut considérer qu'elles ont échappé aux auteurs. Fatalement, Le fils de Kong (The son of Kong) est loin d'être porteur de la même fascination. Beaucoup plus court (65 minutes), il est bâti en deux parties distinctes et très inégales.
La relance est assez habile et l'intrigue bien ficelée. Carl Denham commence à connaître le remords. Surtout, les victimes de la catastrophe new yorkaise ne cessent de le poursuivre en justice. Retrouvant son capitaine de navire, il reprend la mer. A voir ce bateau se diriger vers le Pacifique et tourner en rond autour de Skull island, on ressent parfaitement l'intensité d'une obsession qui n'ose dire son nom. L'évocation, fantaisiste ou non, d'un trésor oublié arrivera à point nommé pour fournir un prétexte à une nouvelle expédition sur l'île.
Les surprises de cette première partie sont bonnes : une figure féminine attachante, une mutinerie "communiste" sur le navire... Schoedsack est parfois très inspiré : lors d'une formidable séquence d'incendie dans un petit cirque, la jeune femme sauve (provisoirement) son père et la caméra accompagne ses efforts en travelling latéral, à travers les tentures successives du chapiteau.
Malheureusement, une fois toute l'équipe débarquée sur l'île, les auteurs ne savent plus trop quoi faire. L'apparition du "Petit Kong" est totalement ratée, l'accent étant mis tout de suite sur la compassion (on découvre le singe alors qu'il est prisonnier de sables mouvants). La violence animale a cédé la place à l'attendrissement et à la compréhension mutuelle, rendue possible par un anthropomorphisme disneyen. Cette nouvelle visite n'a pas d'autre enjeu qu'une sélection naturelle (seul le méchant du groupe se fera croquer) et une ultime prise de conscience de Denham, au terme d'un tremblement de terre assez laid et invraisemblable dans ses conséquences, malgré l'astucieuse reprise du motif de l'humain tenu dans la main du primate.
 Nouvelle variation, seize ans plus tard. Joe est un gorille géant vivant depuis sa naissance près de Jill, aujourd'hui une jeune femme héritière du domaine africain de son père. Max O'Hara (interprété, comme le personnage de Carl Denham, par Robert Armstrong), un entrepreneur de spectacle américain, finit par les rencontrer et faire signer un contrat à Jill afin de produire Joe dans son nouveau night-club new yorkais.
Nouvelle variation, seize ans plus tard. Joe est un gorille géant vivant depuis sa naissance près de Jill, aujourd'hui une jeune femme héritière du domaine africain de son père. Max O'Hara (interprété, comme le personnage de Carl Denham, par Robert Armstrong), un entrepreneur de spectacle américain, finit par les rencontrer et faire signer un contrat à Jill afin de produire Joe dans son nouveau night-club new yorkais.
Monsieur Joe (Mighty Joe Young) est lui-même inférieur à Son of Kong, le temps n'ayant guère joué qu'en la faveur des trucages, plus fluides dans le rendu des mouvements et dans la co-présence dans le plan d'acteurs et d'éléments animés. De manière très étonnante, une séquence d'incendie est teintée de rouge, comme au temps du muet. Les interprètes sont d'une rigidité désarmante (la palme à Ben Johnson en cowboy engagé pour attraper les fauves au lasso).
Problématique est la question de l'exotisme, alors que la trame se veut plus réaliste que celle des deux précédents. En 1933, les îles du Pacifique étaient la promesse d'un ailleurs ouvrant sur l'inconnu et l'imaginaire. En 1949, l'Afrique n'est plus vue que comme le lieu d'un safari géant. En conséquence, le merveilleux se trouve déplacé et re-créé à New York, dans ce fantastique night-club que l'on arpente au rythme des sinuosités de la caméra, dans la seule séquence vraiment marquante du film.
Ce n'est donc plus la magie du cinéma que l'on convoque mais l'entertainment. La violence est donc bannie. Contrairement à King Kong, Joe n'est dangereux que lorsqu'il se défend d'une attaque ou qu'il est sous l'emprise de l'alcool et sa seule victime sera un lion. Chutes sans conséquence, vols-planés rigolos, tout est édulcoré. Nous sommes dans un monde de bons sentiments amusés et enfantins, sans l'ombre d'une trace d'ambiguïté dans les rapports qu'entretiennent la belle et la bête.
Une course-poursuite automobile incohérente (on s'arrête pour regonfler un pneu mais pas pour passer moins dangereusement d'un véhicule à l'autre) s'achève en apothéose lorsque les fugitifs stoppent leur périple afin de sauver les pensionnaires d'un orphelinat en flammes sur le bord de la route. Le détour est assez ahurissant. Seul son étirement en atténue le caractère arbitraire, offrant notamment un nouveau renvoi iconographique : le singe grimpe jusqu'en haut d'un arbre comme son ancêtre gravissait le célèbre building, avec toujours quelqu'un dans la main, la proie féminine étant cependant devenue une fillette à sauver.
Si faible soit-il, j'ai suivi ce Monsieur Joe sans trop de déplaisir, ce qui m'empêche de le considérer aussi "nul" que Tavernier et Coursodon dans leur dictionnaire, par exemple.
La vision successive de ces trois films dégage donc un intérêt particulier, dû aux reprises qui s'y font jour, mais nul doute que les deux derniers ne perdent beaucoup à être découverts séparément, Le fils de Kong et Monsieur Joe n'ajoutant finalement rien à la gloire des auteurs de Chang et des Chasses du comte Zaroff.








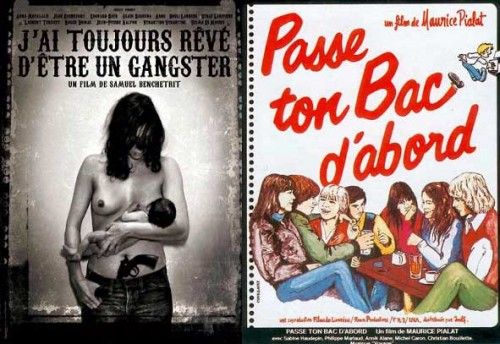




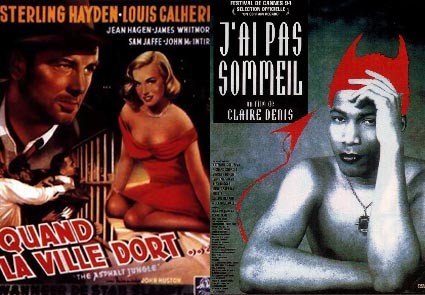





 Whatever works commence avec l'interpellation du spectateur par le personnage principal, Boris Yellnikoff. Cette apostrophe est déstabilisante tout d'abord par l'indécision du degré de distanciation qui la caractérise : débarquant au milieu d'une conversation entre amis, nous croyons bien déceler deux ou trois coups d'oeil de l'un des protagonistes vers la caméra avant que celui-ci s'adresse à nous directement, à la surprise de ses compagnons, qui continuent tout de même, tous comme les passants, à vivre leur vie de fiction.
Whatever works commence avec l'interpellation du spectateur par le personnage principal, Boris Yellnikoff. Cette apostrophe est déstabilisante tout d'abord par l'indécision du degré de distanciation qui la caractérise : débarquant au milieu d'une conversation entre amis, nous croyons bien déceler deux ou trois coups d'oeil de l'un des protagonistes vers la caméra avant que celui-ci s'adresse à nous directement, à la surprise de ses compagnons, qui continuent tout de même, tous comme les passants, à vivre leur vie de fiction. En revoyant le King Kong de Schoedsack et Cooper, frappe d'abord l'évidence d'un coup de génie des auteurs, celui d'avoir voulu faire de leur grand film d'aventure, un film qui réfléchit en même temps sur le pouvoir extraordinaire du cinéma. Grâce au choix initial du scénario de lancer l'expédition sous le prétexte d'un tournage exotique, nombre de séquences acquièrent par la suite une toute autre dimension. L'essai filmé que Carl Denham demande à son actrice Ann Darrow, sur le pont du navire en route pour Skull Island, consiste à la faire crier et à enregistrer son effroi. Celui-ci inquiète par anticipation Jack Driscoll, compagnon bientôt amoureux de la belle. A travers cette scène, le spectateur, lui, perçoit bien plus que cela : l'affirmation que de l'artifice pourra naître l'émotion.
En revoyant le King Kong de Schoedsack et Cooper, frappe d'abord l'évidence d'un coup de génie des auteurs, celui d'avoir voulu faire de leur grand film d'aventure, un film qui réfléchit en même temps sur le pouvoir extraordinaire du cinéma. Grâce au choix initial du scénario de lancer l'expédition sous le prétexte d'un tournage exotique, nombre de séquences acquièrent par la suite une toute autre dimension. L'essai filmé que Carl Denham demande à son actrice Ann Darrow, sur le pont du navire en route pour Skull Island, consiste à la faire crier et à enregistrer son effroi. Celui-ci inquiète par anticipation Jack Driscoll, compagnon bientôt amoureux de la belle. A travers cette scène, le spectateur, lui, perçoit bien plus que cela : l'affirmation que de l'artifice pourra naître l'émotion. Rééditer l'exploit à la faveur d'une suite rapidement mise en chantier (pour une sortie en salles seulement neuf mois après le premier) était une gageure impossible à tenir. Certaines des beautés de King Kong, telles que la charge érotique et la libération de l'imaginaire sont tellement volatiles que l'on peut considérer qu'elles ont échappé aux auteurs. Fatalement, Le fils de Kong (The son of Kong) est loin d'être porteur de la même fascination. Beaucoup plus court (65 minutes), il est bâti en deux parties distinctes et très inégales.
Rééditer l'exploit à la faveur d'une suite rapidement mise en chantier (pour une sortie en salles seulement neuf mois après le premier) était une gageure impossible à tenir. Certaines des beautés de King Kong, telles que la charge érotique et la libération de l'imaginaire sont tellement volatiles que l'on peut considérer qu'elles ont échappé aux auteurs. Fatalement, Le fils de Kong (The son of Kong) est loin d'être porteur de la même fascination. Beaucoup plus court (65 minutes), il est bâti en deux parties distinctes et très inégales. Nouvelle variation, seize ans plus tard. Joe est un gorille géant vivant depuis sa naissance près de Jill, aujourd'hui une jeune femme héritière du domaine africain de son père. Max O'Hara (interprété, comme le personnage de Carl Denham, par Robert Armstrong), un entrepreneur de spectacle américain, finit par les rencontrer et faire signer un contrat à Jill afin de produire Joe dans son nouveau night-club new yorkais.
Nouvelle variation, seize ans plus tard. Joe est un gorille géant vivant depuis sa naissance près de Jill, aujourd'hui une jeune femme héritière du domaine africain de son père. Max O'Hara (interprété, comme le personnage de Carl Denham, par Robert Armstrong), un entrepreneur de spectacle américain, finit par les rencontrer et faire signer un contrat à Jill afin de produire Joe dans son nouveau night-club new yorkais.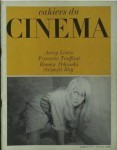
 1966 : Dans la deuxième moitié des années 60, le soutien apporté au "Nouveau Cinéma" venant des quatre coins du monde tend à faire converger les lignes des deux revues. Elles se retrouvent notamment dans la présentation et la défense de Milos Forman, de Marco Bellocchio, de Vera Chytilova, de Dusan Makavejev, d'Andreï Kontchalovski ou de Glauber Rocha (ces cinéastes entraînant progressivement les rédacteurs des Cahiers vers la politique). Le combat contre la censure dont est victime Rivette et sa Religieuse est également commun (Positif, plus aguerri sur ce terrain-là, réagissant plus rapidement). Le temps est donc à la détente.
1966 : Dans la deuxième moitié des années 60, le soutien apporté au "Nouveau Cinéma" venant des quatre coins du monde tend à faire converger les lignes des deux revues. Elles se retrouvent notamment dans la présentation et la défense de Milos Forman, de Marco Bellocchio, de Vera Chytilova, de Dusan Makavejev, d'Andreï Kontchalovski ou de Glauber Rocha (ces cinéastes entraînant progressivement les rédacteurs des Cahiers vers la politique). Le combat contre la censure dont est victime Rivette et sa Religieuse est également commun (Positif, plus aguerri sur ce terrain-là, réagissant plus rapidement). Le temps est donc à la détente.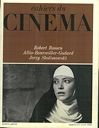
 Quitte à choisir : Les films de Welles et de Hawks m'étant inconnus, je dirai qu'une bonne moitié des couvertures Cahiers est indiscutable (Polanski, Rivette, Mankiewicz, Godard, Hitchcock, Bresson), à côté d'un intéressant Arthur Penn et d'un mauvais Truffaut. En face, je ne peux juger ni du Rocha, ni du Wajda. Le reste est impeccable mais insuffisant, le rythme de parution souffrant toujours de quelques "trous". L'année suivante, ça changera enfin. Allez, pour 1966 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Les films de Welles et de Hawks m'étant inconnus, je dirai qu'une bonne moitié des couvertures Cahiers est indiscutable (Polanski, Rivette, Mankiewicz, Godard, Hitchcock, Bresson), à côté d'un intéressant Arthur Penn et d'un mauvais Truffaut. En face, je ne peux juger ni du Rocha, ni du Wajda. Le reste est impeccable mais insuffisant, le rythme de parution souffrant toujours de quelques "trous". L'année suivante, ça changera enfin. Allez, pour 1966 : Avantage Cahiers. Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S.
Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S. Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation.
Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation. Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).
Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).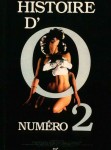 En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend.
En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend. Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.
Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.