(Francesco Rosi / Italie / 1962)
■■■□
 Salvatore Giuliano, film-enquête de Francesco Rosi, se base tout entier sur un mouvement analytique. Un mouvement de rapprochement allant du général au particulier, du paysage aux individus. Mais contrairement à l'habitude, ce resserrement ne fait qu'épaissir et complexifier le mystère de départ. Démarrant sur la découverte du cadavre du célèbre bandit sicilien au cours de l'été 1950, le récit se déploie en deux lignes temporelles. De la fin de la guerre, où lui et ses hommes, instruments des indépendantistes, se battent contre l'armée italienne, à son assassinat, nous suivons les principales étapes du parcours de Giuliano, dont le massacre de Portella delle Ginestre (une dizaine de personnes assistant à une réunion organisée par les communistes, le 1er mai 1947, abattue par la bande à Giuliano, sur demande d'un commanditaire resté inconnu). Parallèlement, nous sont montrés quelques événements suivant sa mort, jusqu'au procès de ses compagnons.
Salvatore Giuliano, film-enquête de Francesco Rosi, se base tout entier sur un mouvement analytique. Un mouvement de rapprochement allant du général au particulier, du paysage aux individus. Mais contrairement à l'habitude, ce resserrement ne fait qu'épaissir et complexifier le mystère de départ. Démarrant sur la découverte du cadavre du célèbre bandit sicilien au cours de l'été 1950, le récit se déploie en deux lignes temporelles. De la fin de la guerre, où lui et ses hommes, instruments des indépendantistes, se battent contre l'armée italienne, à son assassinat, nous suivons les principales étapes du parcours de Giuliano, dont le massacre de Portella delle Ginestre (une dizaine de personnes assistant à une réunion organisée par les communistes, le 1er mai 1947, abattue par la bande à Giuliano, sur demande d'un commanditaire resté inconnu). Parallèlement, nous sont montrés quelques événements suivant sa mort, jusqu'au procès de ses compagnons.
Francesco Rosi a choisi une esthétique radicale, d'abord basée sur une multitude de plans larges au détriment des plans rapprochés. Ni Giuliano, ni ses camarades ne sont réellement individualisés par l'image (le "héros" n'est même jamais vu de près autrement qu'allongé mort). C'est bien plutôt le peuple sicilien qu'a voulu filmer Rosi. De longs panoramiques circulaires décrivent les lieux, ces montagnes, ces villages, ces fiefs ratissés sans succès par les forces de l'ordre. La focalisation se fait par moments, à l'aide de zooms rapides, lors des attaques des convois de carabiniers. Plus tard, ce sont plutôt de brusques raccords, des changements d'échelles saisissants qui prennent le relais pour saisir la réalité de plus près (la conversation entre Pisciotta et le mafioso dans la carrière).
Adepte du réalisme, le cinéaste tourne sur les lieux mêmes, avec des acteurs non-professionnels et seulement une dizaine d'années après les faits. Mais réalisme ne veut pas dire pauvreté d'expression. Salvatore Giulianose fait démystificateur tout en gardant son lyrisme. Une scène pivot montre si besoin en était que la quête de la vérité menée par Rosi passe aussi par la composition plastique : celle de la reconnaissance du corps de Giuliano par sa mère. Ce moment marque l'emploi plus régulier des gros plans qui nous étaient refusé pendant une heure. Et lors du procès, les panoramiques ne seront plus destinés à embrasser la campagne sicilienne mais les visages des accusés dans leur box.
Du combat bipolaire entre bandits séparatistes siciliens et soldats italiens, on passe ensuite à une partie à joueurs multiples. Et plus la vision devient précise et proche des hommes, plus le réseau se révèle dense et indémélable. Si la caméra parvient à mieux cerner les protagonistes, ceux-ci ne cessent de renvoyer vers d'autres, de citer de nouveaux noms, de mettre à jour des liens insoupçonnables entre chaque entité : bandits, mafia, politiciens, magistrats, carabiniers... A tous les niveaux, les choses se compliquent. Car l'analyse se fait aussi par le montage : Giuliano est celui qui prenait aux riches pour donner aux pauvres, dit un témoin local (et la mémoire populaire) et Rosi de coller l'un à l'autre la révolte des femmes du village, la douleur de la mère de Giuliano et les images du massacre des militants communistes. De tout cela ne ressort qu'une victime véritable : le paysan sicilien.
L'épilogue, situé en 1960, reprend la figure du début : un homme abattu au milieu de la foule. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Rosi ne boucle pas la boucle. Franchement pessimiste, il montre plutôt que la gangrène n'en finit pas de bouffer la société sicilienne. Salvatore Giuliano est bien un acte fondateur, tant pour son auteur que pour tout un cinéma politique européen et jusqu'aux films de complots américains des années 70. C'est aussi, peut-être, un bonne préparation avant de découvrir cette semaine en salles Gomorra.
 Depuis quelques années moins attentif aux sorties de films d'animation en général et des productions Pixar en particulier (dont je n'avais finalement vu, comme longs-métrages, que les excellents 1001 pattes et Monstres et Cie, puisque ne connaissant que quelques passages de Cars ou Nemo, croisés au hasard de ces fins de soirées entre amis où les enfants se calment devant un dvd), je me suis laissé porté vers ce nouveau Wall-E, cédant à la fois à une critique enthousiaste et à une forte pression familiale. Après la projection, le dessin animé événement de 2008 me laissa un brin perplexe : proprement stupéfait par la technique mais désappointé par la faiblesse du scénario et la réflexion sérieuse mais limitée que propose le film.
Depuis quelques années moins attentif aux sorties de films d'animation en général et des productions Pixar en particulier (dont je n'avais finalement vu, comme longs-métrages, que les excellents 1001 pattes et Monstres et Cie, puisque ne connaissant que quelques passages de Cars ou Nemo, croisés au hasard de ces fins de soirées entre amis où les enfants se calment devant un dvd), je me suis laissé porté vers ce nouveau Wall-E, cédant à la fois à une critique enthousiaste et à une forte pression familiale. Après la projection, le dessin animé événement de 2008 me laissa un brin perplexe : proprement stupéfait par la technique mais désappointé par la faiblesse du scénario et la réflexion sérieuse mais limitée que propose le film. Cinquième volet de la série des Morts-vivantsde Romero, Diary of the deada, depuis sa sortie en juin dernier, partagé un peu la critique et beaucoup les bloggeurs (voir plus bas). Personnellement, seul le quatrième épisode (Land of the dead) m'est inconnu. Les trois premiers (dont Le jour des morts-vivants auquel j'ai consacré une note
Cinquième volet de la série des Morts-vivantsde Romero, Diary of the deada, depuis sa sortie en juin dernier, partagé un peu la critique et beaucoup les bloggeurs (voir plus bas). Personnellement, seul le quatrième épisode (Land of the dead) m'est inconnu. Les trois premiers (dont Le jour des morts-vivants auquel j'ai consacré une note  Je précise d'emblée que vous ne trouverez ici nulle remarque sur "l'affaire Brisseau" qui occupa bien du monde en 2005. Je n'en connais précisément ni les détails ni les conséquences actuelles. Des deux positions les plus affirmées par les commentateurs de l'époque aucune ne me convient : ni le lynchage d'une personnalité hors-norme, ni l'excuse de tout écart au nom d'une grande oeuvre. Je ne tiens pas à ajouter d'autres sottises.
Je précise d'emblée que vous ne trouverez ici nulle remarque sur "l'affaire Brisseau" qui occupa bien du monde en 2005. Je n'en connais précisément ni les détails ni les conséquences actuelles. Des deux positions les plus affirmées par les commentateurs de l'époque aucune ne me convient : ni le lynchage d'une personnalité hors-norme, ni l'excuse de tout écart au nom d'une grande oeuvre. Je ne tiens pas à ajouter d'autres sottises. Le trio infernal, premier film de Francis Girod, est inspiré d'un sordide fait divers de l'entre-deux-guerres. Le notable Georges Sarret, rencontre les deux soeurs Schmidt : Philomène et Catherine, belles, d'origines allemandes et avides d'argent. Le ménage à trois se forme. Les femmes se marient avec des vieillard et l'homme monte les escroqueries à l'assurance vie qui portent leurs fruits à la mort rapide des maris. Cette première partie, plutôt enlevée, est une satire de la bourgeoisie provinciale. La respectabilité est synonyme de ridicule ou de monstruosité cachée. Au-delà d'une esthétique rétro guère renouvelée (mais Resnais lui-même, avec Stavisky, n'avait pas totalement réussi à la dépasser), l'humour noir et les audaces sexuelles propres à l'époque tirent vers la farce. La peinture grinçante évoque Chabrol, le trio, les uniformes, la cruauté, renvoient aux Folies de femmesde Stroheim. Georges et Philomène, c'est le couple de vedettes Romy Schneider et Michel Piccoli, utilisé à contre-emploi. Ce dernier est assez impressionnant dans le registre du clown réactionnaire et dépravé. La troisième est la découverte Mascha Gonska qui montre bien plus que ses charmes physiques.
Le trio infernal, premier film de Francis Girod, est inspiré d'un sordide fait divers de l'entre-deux-guerres. Le notable Georges Sarret, rencontre les deux soeurs Schmidt : Philomène et Catherine, belles, d'origines allemandes et avides d'argent. Le ménage à trois se forme. Les femmes se marient avec des vieillard et l'homme monte les escroqueries à l'assurance vie qui portent leurs fruits à la mort rapide des maris. Cette première partie, plutôt enlevée, est une satire de la bourgeoisie provinciale. La respectabilité est synonyme de ridicule ou de monstruosité cachée. Au-delà d'une esthétique rétro guère renouvelée (mais Resnais lui-même, avec Stavisky, n'avait pas totalement réussi à la dépasser), l'humour noir et les audaces sexuelles propres à l'époque tirent vers la farce. La peinture grinçante évoque Chabrol, le trio, les uniformes, la cruauté, renvoient aux Folies de femmesde Stroheim. Georges et Philomène, c'est le couple de vedettes Romy Schneider et Michel Piccoli, utilisé à contre-emploi. Ce dernier est assez impressionnant dans le registre du clown réactionnaire et dépravé. La troisième est la découverte Mascha Gonska qui montre bien plus que ses charmes physiques.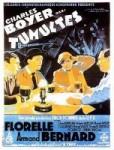 Ralph Schwartz est un bon gars un peu brute, un voyou qui en impose tout en sachant mettre tout le monde dans sa poche par sa gouaille naturelle. Grâce à sa bonne conduite, il sort plus tôt que prévu de taule, où il a passé deux ans comme en colonie de vacances. Il court retrouver sa donzelle Ania. Elle est surprise mais heureuse. Elle pense un peu trop à la bagatelle alors que Ralph doit ouvrir tout son courrier. Elle lui fout du rouge à lèvres sur la joue. Faut pas pousser : Ralph lui en colle une. Quelque chose nous dit qu'elle l'a bien méritée. Les potes qui s'ramènent, ça détend l'atmosphère. Alors qu'on n'attend pas pour mettre au jus Ralph du casse à venir, Ania parle en douce à Gustave, son amant, "photographe d'art" (pour qui elle a posé nue, la garce). Le manège éveille les soupçons de Willy, le jeune garçon (d'une bonne trentaine d'années), que Ralph a été sortir de maison de correction (dette d'honneur). Doit-il tout balancer à son protecteur ? Il ne tient pas longtemps et c'est le drame : Gustave finit éclaté dans la mare. Ralph en colle une autre à Ania, mais cède à nouveau devant ses appâts, avant de s'enfuir pour pas se faire choper par les flics. Mais elle le trahit encore, et doublement même : elle le donne à la police et met le grappin sur Willy. Retour en taule pour Ralph. Il faut qu'il se fasse la malle pour se venger. Le différend se règle à coups de couteau et de poings, entre vrais hommes. Les deux se relèvent tant bien que mal. Ralph laisse volontiers cette grue à Willy, en lui souhaitant bon courage pour les années à venir. Au bon commissaire, il dit qu'il préfère encore la taule à toutes ces saloperies.
Ralph Schwartz est un bon gars un peu brute, un voyou qui en impose tout en sachant mettre tout le monde dans sa poche par sa gouaille naturelle. Grâce à sa bonne conduite, il sort plus tôt que prévu de taule, où il a passé deux ans comme en colonie de vacances. Il court retrouver sa donzelle Ania. Elle est surprise mais heureuse. Elle pense un peu trop à la bagatelle alors que Ralph doit ouvrir tout son courrier. Elle lui fout du rouge à lèvres sur la joue. Faut pas pousser : Ralph lui en colle une. Quelque chose nous dit qu'elle l'a bien méritée. Les potes qui s'ramènent, ça détend l'atmosphère. Alors qu'on n'attend pas pour mettre au jus Ralph du casse à venir, Ania parle en douce à Gustave, son amant, "photographe d'art" (pour qui elle a posé nue, la garce). Le manège éveille les soupçons de Willy, le jeune garçon (d'une bonne trentaine d'années), que Ralph a été sortir de maison de correction (dette d'honneur). Doit-il tout balancer à son protecteur ? Il ne tient pas longtemps et c'est le drame : Gustave finit éclaté dans la mare. Ralph en colle une autre à Ania, mais cède à nouveau devant ses appâts, avant de s'enfuir pour pas se faire choper par les flics. Mais elle le trahit encore, et doublement même : elle le donne à la police et met le grappin sur Willy. Retour en taule pour Ralph. Il faut qu'il se fasse la malle pour se venger. Le différend se règle à coups de couteau et de poings, entre vrais hommes. Les deux se relèvent tant bien que mal. Ralph laisse volontiers cette grue à Willy, en lui souhaitant bon courage pour les années à venir. Au bon commissaire, il dit qu'il préfère encore la taule à toutes ces saloperies.

 Troisième long de Godard, après A bout de souffle et Le petit soldat (ce dernier sorti plus tard, suite aux problèmes que l'on sait), Une femme est une femmeest une petite chose au milieu d'oeuvres bien plus consistantes. Abordant la couleur pour la première fois, JLG annonce une comédie, parfois musicale, sous les auspices de René Clair et de Ernst Lubitsch (convoqués dans l'un de ces génériques aussi percutants que succincts dont notre homme a le secret).
Troisième long de Godard, après A bout de souffle et Le petit soldat (ce dernier sorti plus tard, suite aux problèmes que l'on sait), Une femme est une femmeest une petite chose au milieu d'oeuvres bien plus consistantes. Abordant la couleur pour la première fois, JLG annonce une comédie, parfois musicale, sous les auspices de René Clair et de Ernst Lubitsch (convoqués dans l'un de ces génériques aussi percutants que succincts dont notre homme a le secret). Je n'avais jamais vu Un homme et une femme. L'ensemble de la filmographie de Claude Lelouch m'est d'ailleurs inconnu. Les seules exceptions sont Itinéraire d'un enfant gâté et Il y a des jours et des lunes, vus à l'époque de leurs sorties en salles. A 16 ans, facilement impressionnable, en général on trouve ça bien Lelouch. Et souvent on abandonne ensuite, en suivant, à tort ou à raison, les conseils de contournement des critiques.
Je n'avais jamais vu Un homme et une femme. L'ensemble de la filmographie de Claude Lelouch m'est d'ailleurs inconnu. Les seules exceptions sont Itinéraire d'un enfant gâté et Il y a des jours et des lunes, vus à l'époque de leurs sorties en salles. A 16 ans, facilement impressionnable, en général on trouve ça bien Lelouch. Et souvent on abandonne ensuite, en suivant, à tort ou à raison, les conseils de contournement des critiques. Par rapport à
Par rapport à