(George A. Romero / Etats-Unis / 2008)
■□□□
 Cinquième volet de la série des Morts-vivantsde Romero, Diary of the deada, depuis sa sortie en juin dernier, partagé un peu la critique et beaucoup les bloggeurs (voir plus bas). Personnellement, seul le quatrième épisode (Land of the dead) m'est inconnu. Les trois premiers (dont Le jour des morts-vivants auquel j'ai consacré une note ici) m'avaient fortement intéressé, sans toutefois me faire prendre George A. Romero pour autre chose qu'un petit maître de l'horreur (si je considère l'après-Mario Bava, je ne qualifierai d'ailleurs personne, dans le genre, de grand maître : ni Argento, ni Carpenter, ni Craven, en sachant que si Cronenberg mérite l'appellation c'est qu'il est vite passé à autre chose. Fin de la parenthèse, début des commentaires outrés ?). J'attendais cependant avec une certaine impatience de voir cette variation. Assez cruelle fut la déception.
Cinquième volet de la série des Morts-vivantsde Romero, Diary of the deada, depuis sa sortie en juin dernier, partagé un peu la critique et beaucoup les bloggeurs (voir plus bas). Personnellement, seul le quatrième épisode (Land of the dead) m'est inconnu. Les trois premiers (dont Le jour des morts-vivants auquel j'ai consacré une note ici) m'avaient fortement intéressé, sans toutefois me faire prendre George A. Romero pour autre chose qu'un petit maître de l'horreur (si je considère l'après-Mario Bava, je ne qualifierai d'ailleurs personne, dans le genre, de grand maître : ni Argento, ni Carpenter, ni Craven, en sachant que si Cronenberg mérite l'appellation c'est qu'il est vite passé à autre chose. Fin de la parenthèse, début des commentaires outrés ?). J'attendais cependant avec une certaine impatience de voir cette variation. Assez cruelle fut la déception.
Il y a plusieurs raisons à cela, mais l'une dépasse toutes les autres. On le sait, chaque film de la série traitait en creux d'un mal de l'époque. Le Romero 2008 s'attaque à la multiplication des images, au nouvelles technologies et aux nouvelles sources d'informations qui en découlent. Je viens d'écrire, concernant les épisodes précédents, "traitait en creux" : le problème se limitait à un fond politique ou à un cadre symbolique. Or, Diary of the deadest un discours et il n'est presque que cela. Une poignée d'étudiants en cinéma part tourner un film d'horreur dans leur mini-bus quand se déclare la fameuse épidémie. Le metteur en scène du groupe décide alors de tout filmer autour de lui, pour témoigner, via internet, du chaos (que l'on ne ressent guère de par le dispositif choisi par Romero, j'y reviendrai). Ses compagnons lui rappellent sans cesse qu'il y a autre chose à faire que de filmer (mais comme les morts entraînent les morts, le virus de la caméra-témoin se propage lui aussi à toute l'équipe). Tourner au lieu de (sur-)vivre, être dépendant des flots d'images, se laisser avaler par tous ces écrans sans exercer de sens critique : voilà le mal dénoncé par Romero dans une mise en garde qui ne se distingue pas par sa nouveauté. Si seulement tout cela était dit à une ou deux occasions... Mais non, absolument chaque scène rabâche cette même idée et le plus souvent en passant par les dialogues, ce qui ajoute encore à la lourdeur.
Diary of the dead, hormis quelques inserts venant d'internet, a pour unique source d'image les rushes tournés par l'équipe d'étudiants. Ce choix, encore une fois peu original (Le projet Blair Witchm'avait, à l'époque, plus bluffé sur ce plan-là), nous prive de la mise en scène des espaces clôts sur laquelle les précédents volets étaient basés. Mise à part la luxueuse résidence du dénouement, aucun décor n'est marquant. Et nous de nous dire qu'un film au regard classiquement objectif, qui permettrait d'élargir le cadre, quitte à le mélanger avec ces prises de vues documentaires, aurait très bien pu aborder pertinemment le thème tout en bénéficiant d'une plus ample mise en scène. Le profit que tire Romero de son dispositif est bien mince : quelques jeux plaisants autour des images manquantes (problèmes de batteries déchargées, place du cameraman trop éloignée de l'action) et crédibilisation des attaques des zombies par le resserrement du cadre.
Mais, autres soucis, Romero ne propose toujours pas une direction d'acteurs convaincante ni des dialogues brillants et l'habituel renversement des valeurs (les milices Noires généreuses et la Garde Nationale qui pille) devient routinier. Le meilleur réside donc encore une fois dans la façon de filmer les morts-vivants, toujours inventive et très poussée ici vers le hors-champ. Un léger redressement se remarque dans le dernier quart d'heure, si l'on excepte le passage ridicule de la répétition dans la réalité de la scène de la momie et de la fuite de Tracy avec le bus. La contamination de l'acte de filmer, déjà évoqué, la démarche alcoolisée qui devient zombiesque, l'enfermement des survivants, la séquence-choc finale qui interroge frontalement notre voyeurisme, nous font un peu oublier la lourdeur du dispositif. Mais on note aussi que pour la première fois dans la série, les gestes et les stratégies sont très peu réfléchis au regard du danger, ce qui facilite grandement les morsures. Une chose étonne : ces étudiants en cinéma, connectés et sur-informés n'ont manifestement jamais vu aucun film de Romero.
Autres avis, très partagés, à lire chez : Ishmael, Doc Orlof, Shangols, Pibe San, Rob Gordon, Norman Bates.
 Je précise d'emblée que vous ne trouverez ici nulle remarque sur "l'affaire Brisseau" qui occupa bien du monde en 2005. Je n'en connais précisément ni les détails ni les conséquences actuelles. Des deux positions les plus affirmées par les commentateurs de l'époque aucune ne me convient : ni le lynchage d'une personnalité hors-norme, ni l'excuse de tout écart au nom d'une grande oeuvre. Je ne tiens pas à ajouter d'autres sottises.
Je précise d'emblée que vous ne trouverez ici nulle remarque sur "l'affaire Brisseau" qui occupa bien du monde en 2005. Je n'en connais précisément ni les détails ni les conséquences actuelles. Des deux positions les plus affirmées par les commentateurs de l'époque aucune ne me convient : ni le lynchage d'une personnalité hors-norme, ni l'excuse de tout écart au nom d'une grande oeuvre. Je ne tiens pas à ajouter d'autres sottises. Le trio infernal, premier film de Francis Girod, est inspiré d'un sordide fait divers de l'entre-deux-guerres. Le notable Georges Sarret, rencontre les deux soeurs Schmidt : Philomène et Catherine, belles, d'origines allemandes et avides d'argent. Le ménage à trois se forme. Les femmes se marient avec des vieillard et l'homme monte les escroqueries à l'assurance vie qui portent leurs fruits à la mort rapide des maris. Cette première partie, plutôt enlevée, est une satire de la bourgeoisie provinciale. La respectabilité est synonyme de ridicule ou de monstruosité cachée. Au-delà d'une esthétique rétro guère renouvelée (mais Resnais lui-même, avec Stavisky, n'avait pas totalement réussi à la dépasser), l'humour noir et les audaces sexuelles propres à l'époque tirent vers la farce. La peinture grinçante évoque Chabrol, le trio, les uniformes, la cruauté, renvoient aux Folies de femmesde Stroheim. Georges et Philomène, c'est le couple de vedettes Romy Schneider et Michel Piccoli, utilisé à contre-emploi. Ce dernier est assez impressionnant dans le registre du clown réactionnaire et dépravé. La troisième est la découverte Mascha Gonska qui montre bien plus que ses charmes physiques.
Le trio infernal, premier film de Francis Girod, est inspiré d'un sordide fait divers de l'entre-deux-guerres. Le notable Georges Sarret, rencontre les deux soeurs Schmidt : Philomène et Catherine, belles, d'origines allemandes et avides d'argent. Le ménage à trois se forme. Les femmes se marient avec des vieillard et l'homme monte les escroqueries à l'assurance vie qui portent leurs fruits à la mort rapide des maris. Cette première partie, plutôt enlevée, est une satire de la bourgeoisie provinciale. La respectabilité est synonyme de ridicule ou de monstruosité cachée. Au-delà d'une esthétique rétro guère renouvelée (mais Resnais lui-même, avec Stavisky, n'avait pas totalement réussi à la dépasser), l'humour noir et les audaces sexuelles propres à l'époque tirent vers la farce. La peinture grinçante évoque Chabrol, le trio, les uniformes, la cruauté, renvoient aux Folies de femmesde Stroheim. Georges et Philomène, c'est le couple de vedettes Romy Schneider et Michel Piccoli, utilisé à contre-emploi. Ce dernier est assez impressionnant dans le registre du clown réactionnaire et dépravé. La troisième est la découverte Mascha Gonska qui montre bien plus que ses charmes physiques.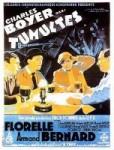 Ralph Schwartz est un bon gars un peu brute, un voyou qui en impose tout en sachant mettre tout le monde dans sa poche par sa gouaille naturelle. Grâce à sa bonne conduite, il sort plus tôt que prévu de taule, où il a passé deux ans comme en colonie de vacances. Il court retrouver sa donzelle Ania. Elle est surprise mais heureuse. Elle pense un peu trop à la bagatelle alors que Ralph doit ouvrir tout son courrier. Elle lui fout du rouge à lèvres sur la joue. Faut pas pousser : Ralph lui en colle une. Quelque chose nous dit qu'elle l'a bien méritée. Les potes qui s'ramènent, ça détend l'atmosphère. Alors qu'on n'attend pas pour mettre au jus Ralph du casse à venir, Ania parle en douce à Gustave, son amant, "photographe d'art" (pour qui elle a posé nue, la garce). Le manège éveille les soupçons de Willy, le jeune garçon (d'une bonne trentaine d'années), que Ralph a été sortir de maison de correction (dette d'honneur). Doit-il tout balancer à son protecteur ? Il ne tient pas longtemps et c'est le drame : Gustave finit éclaté dans la mare. Ralph en colle une autre à Ania, mais cède à nouveau devant ses appâts, avant de s'enfuir pour pas se faire choper par les flics. Mais elle le trahit encore, et doublement même : elle le donne à la police et met le grappin sur Willy. Retour en taule pour Ralph. Il faut qu'il se fasse la malle pour se venger. Le différend se règle à coups de couteau et de poings, entre vrais hommes. Les deux se relèvent tant bien que mal. Ralph laisse volontiers cette grue à Willy, en lui souhaitant bon courage pour les années à venir. Au bon commissaire, il dit qu'il préfère encore la taule à toutes ces saloperies.
Ralph Schwartz est un bon gars un peu brute, un voyou qui en impose tout en sachant mettre tout le monde dans sa poche par sa gouaille naturelle. Grâce à sa bonne conduite, il sort plus tôt que prévu de taule, où il a passé deux ans comme en colonie de vacances. Il court retrouver sa donzelle Ania. Elle est surprise mais heureuse. Elle pense un peu trop à la bagatelle alors que Ralph doit ouvrir tout son courrier. Elle lui fout du rouge à lèvres sur la joue. Faut pas pousser : Ralph lui en colle une. Quelque chose nous dit qu'elle l'a bien méritée. Les potes qui s'ramènent, ça détend l'atmosphère. Alors qu'on n'attend pas pour mettre au jus Ralph du casse à venir, Ania parle en douce à Gustave, son amant, "photographe d'art" (pour qui elle a posé nue, la garce). Le manège éveille les soupçons de Willy, le jeune garçon (d'une bonne trentaine d'années), que Ralph a été sortir de maison de correction (dette d'honneur). Doit-il tout balancer à son protecteur ? Il ne tient pas longtemps et c'est le drame : Gustave finit éclaté dans la mare. Ralph en colle une autre à Ania, mais cède à nouveau devant ses appâts, avant de s'enfuir pour pas se faire choper par les flics. Mais elle le trahit encore, et doublement même : elle le donne à la police et met le grappin sur Willy. Retour en taule pour Ralph. Il faut qu'il se fasse la malle pour se venger. Le différend se règle à coups de couteau et de poings, entre vrais hommes. Les deux se relèvent tant bien que mal. Ralph laisse volontiers cette grue à Willy, en lui souhaitant bon courage pour les années à venir. Au bon commissaire, il dit qu'il préfère encore la taule à toutes ces saloperies.

 Troisième long de Godard, après A bout de souffle et Le petit soldat (ce dernier sorti plus tard, suite aux problèmes que l'on sait), Une femme est une femmeest une petite chose au milieu d'oeuvres bien plus consistantes. Abordant la couleur pour la première fois, JLG annonce une comédie, parfois musicale, sous les auspices de René Clair et de Ernst Lubitsch (convoqués dans l'un de ces génériques aussi percutants que succincts dont notre homme a le secret).
Troisième long de Godard, après A bout de souffle et Le petit soldat (ce dernier sorti plus tard, suite aux problèmes que l'on sait), Une femme est une femmeest une petite chose au milieu d'oeuvres bien plus consistantes. Abordant la couleur pour la première fois, JLG annonce une comédie, parfois musicale, sous les auspices de René Clair et de Ernst Lubitsch (convoqués dans l'un de ces génériques aussi percutants que succincts dont notre homme a le secret). Je n'avais jamais vu Un homme et une femme. L'ensemble de la filmographie de Claude Lelouch m'est d'ailleurs inconnu. Les seules exceptions sont Itinéraire d'un enfant gâté et Il y a des jours et des lunes, vus à l'époque de leurs sorties en salles. A 16 ans, facilement impressionnable, en général on trouve ça bien Lelouch. Et souvent on abandonne ensuite, en suivant, à tort ou à raison, les conseils de contournement des critiques.
Je n'avais jamais vu Un homme et une femme. L'ensemble de la filmographie de Claude Lelouch m'est d'ailleurs inconnu. Les seules exceptions sont Itinéraire d'un enfant gâté et Il y a des jours et des lunes, vus à l'époque de leurs sorties en salles. A 16 ans, facilement impressionnable, en général on trouve ça bien Lelouch. Et souvent on abandonne ensuite, en suivant, à tort ou à raison, les conseils de contournement des critiques. Par rapport à
Par rapport à  Valse avec Bachir (Waltz with Bashir) est, au départ, un documentaire, auquel s’ajoutent des séquences de rêves et de souvenirs, de fiction donc, le tout étant soumis, chacun le sait maintenant, au traitement du cinéma d'animation. Documentaire et fiction : le voisinage de ces deux termes au sein d’une oeuvre cinématographique est toujours extrêmement délicat à manier. Il se trouve qu'ils sont ici dépassés, neutralisés et unifiés par le troisième, l'animation. Quelque chose d'unique se produit sous nos yeux (comme tout le monde, sans en être totalement sûr, je suppose qu’Ari Folman agit en précurseur et crée un nouveau genre) : la question de la frontière entre réalité et fiction ne se pose absolument pas, l'entremêlement des divers registres n’est jamais un problème. Avant la projection, je croyais que le mode d’expression choisi permettait à l’auteur de toucher le non-représentable. Or, il ne s’agit pas vraiment de trouver une autre voie pour approcher l'insoutenable (la guerre et les massacres). Les images dessinées de Valse avec Bachir ne brisent pas de tabou et la violence qu'elles montrent ne va pas au-delà des limites de la représentation habituelle. Non, l'intérêt est ailleurs : dans la création d'un objet esthétique singulier et cohérent, qui agrège des éléments aussi disparates que des entretiens enregistrés, des récits de guerre et des cauchemars. Valse avec Bachir, c'est une certaine ambiance, une certaine lumière.
Valse avec Bachir (Waltz with Bashir) est, au départ, un documentaire, auquel s’ajoutent des séquences de rêves et de souvenirs, de fiction donc, le tout étant soumis, chacun le sait maintenant, au traitement du cinéma d'animation. Documentaire et fiction : le voisinage de ces deux termes au sein d’une oeuvre cinématographique est toujours extrêmement délicat à manier. Il se trouve qu'ils sont ici dépassés, neutralisés et unifiés par le troisième, l'animation. Quelque chose d'unique se produit sous nos yeux (comme tout le monde, sans en être totalement sûr, je suppose qu’Ari Folman agit en précurseur et crée un nouveau genre) : la question de la frontière entre réalité et fiction ne se pose absolument pas, l'entremêlement des divers registres n’est jamais un problème. Avant la projection, je croyais que le mode d’expression choisi permettait à l’auteur de toucher le non-représentable. Or, il ne s’agit pas vraiment de trouver une autre voie pour approcher l'insoutenable (la guerre et les massacres). Les images dessinées de Valse avec Bachir ne brisent pas de tabou et la violence qu'elles montrent ne va pas au-delà des limites de la représentation habituelle. Non, l'intérêt est ailleurs : dans la création d'un objet esthétique singulier et cohérent, qui agrège des éléments aussi disparates que des entretiens enregistrés, des récits de guerre et des cauchemars. Valse avec Bachir, c'est une certaine ambiance, une certaine lumière. Ah ouais, quand même… J’ai déjà vu quelques films de tarés mais dans le genre "on fait n’importe quoi" El Topose pose là. Si la vision du délire culte de Jodorowsky me fût plutôt pénible, en résumer l’argument est cependant un plaisir. Un étrange cavalier, tout de noir vêtu et que l’on nommera au choix El Topo (la Taupe) ou Dieu, sillonne le désert accompagné d’un enfant de sept ans seulement habillé d’un chapeau. En chemin, ils tombent sur un terrible charnier, puis retrouvent les coupables dans un monastère avant de les occire. Au moment de repartir, El Topo abandonne le gamin et emporte sur son cheval une femme qu’il vient de sauver et qui maintenant n’a d’yeux que pour lui. Il la prend violemment dans les dunes. Elle lui répond qu’elle l’aimera plus encore lorsqu’il aura affronté les quatre meilleurs tireurs du désert. Ce qu’il ne tarde pas à faire : trépassent donc l’aveugle rapide, le Russe vivant avec sa mère et son lion, le musicien entouré de centaines de lapins et le vieil ermite dont le filet à papillons détourne les balles de revolver. Malgré tout, la femme le quitte pour une autre beauté rencontrée entre temps et qui porte admirablement la veste de cowboy en laissant entrevoir sa poitrine. Laissé à moitié mort, El Topo reprend ses esprits quelques années plus tard dans une grotte entouré de miséreux le vénérant tel un saint. Il décide d’aider cette communauté de pestiférés en creusant un tunnel qui leur permettrait d’aller vivre dans la ville voisine, tenue toutefois par une horde de vieilles femmes très dignes mais libidineuses et esclavagistes. Notre homme ne pourra éviter un nouveau massacre d’innocents et même si l’enfant qu’il a jadis abandonné ré-apparaît et si sa nouvelle femme naine vient d’accoucher, il s’immole.
Ah ouais, quand même… J’ai déjà vu quelques films de tarés mais dans le genre "on fait n’importe quoi" El Topose pose là. Si la vision du délire culte de Jodorowsky me fût plutôt pénible, en résumer l’argument est cependant un plaisir. Un étrange cavalier, tout de noir vêtu et que l’on nommera au choix El Topo (la Taupe) ou Dieu, sillonne le désert accompagné d’un enfant de sept ans seulement habillé d’un chapeau. En chemin, ils tombent sur un terrible charnier, puis retrouvent les coupables dans un monastère avant de les occire. Au moment de repartir, El Topo abandonne le gamin et emporte sur son cheval une femme qu’il vient de sauver et qui maintenant n’a d’yeux que pour lui. Il la prend violemment dans les dunes. Elle lui répond qu’elle l’aimera plus encore lorsqu’il aura affronté les quatre meilleurs tireurs du désert. Ce qu’il ne tarde pas à faire : trépassent donc l’aveugle rapide, le Russe vivant avec sa mère et son lion, le musicien entouré de centaines de lapins et le vieil ermite dont le filet à papillons détourne les balles de revolver. Malgré tout, la femme le quitte pour une autre beauté rencontrée entre temps et qui porte admirablement la veste de cowboy en laissant entrevoir sa poitrine. Laissé à moitié mort, El Topo reprend ses esprits quelques années plus tard dans une grotte entouré de miséreux le vénérant tel un saint. Il décide d’aider cette communauté de pestiférés en creusant un tunnel qui leur permettrait d’aller vivre dans la ville voisine, tenue toutefois par une horde de vieilles femmes très dignes mais libidineuses et esclavagistes. Notre homme ne pourra éviter un nouveau massacre d’innocents et même si l’enfant qu’il a jadis abandonné ré-apparaît et si sa nouvelle femme naine vient d’accoucher, il s’immole.