Comme promis, après la version espagnole, vient la VF.
*****
Juin n'est déjà qu'un lointain souvenir. Abordons donc les rivages cinématographiques qui s'offraient à nous en Juillet-Août 1985 :
Une fois que le tri est fait, afin de garder le meilleur pour la fin, nous nous retrouvons devant une vague estivale de sous-produits qui commence par donner à ce panorama l'apparence d'un morne catalogue de médiocrités. Anciennes réalisations de metteurs en scène ayant entre-temps rencontré le succès, productions plagiant sans vergogne des réussites antérieures, suites à l'utilité contestable, films de série dont on se débarasse en attendant la rentrée... en cette période, rien n'est épargné au spectateur.
 Qu'il vienne de France, d'Angleterre ou des Etats-Unis, le genre comique n'offre a priori rien de remarquable, à en juger par cette série de titres : Le facteur de Saint-Tropez (de Richard Balducci, avec Paul Préboist), L'amour propre (premier film de Martin Veyron), Les débiles de l'espace (de Mike Hodges), Les zéros de conduite (de Neal Israel), Police Academy 2 : Au boulot ! (de Jerry Paris), Porky's contre-attaque (de James Komack), Une défense canon (de Willard Huyck avec Dudley Moore et Eddie Murphy). On suppose tout de même moins insignifiants Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill (avec Richard Pryor) et les deux premiers longs métrages d'un Robert Zemeckis profitant du récent succès public de son A la poursuite du diamant vert (Crazy day, 1978, chronique autour de la Beatlemania en 64 aux USA et La grosse magouille, 1980, satire de l'Amérique profonde avec Kurt Russell).
Qu'il vienne de France, d'Angleterre ou des Etats-Unis, le genre comique n'offre a priori rien de remarquable, à en juger par cette série de titres : Le facteur de Saint-Tropez (de Richard Balducci, avec Paul Préboist), L'amour propre (premier film de Martin Veyron), Les débiles de l'espace (de Mike Hodges), Les zéros de conduite (de Neal Israel), Police Academy 2 : Au boulot ! (de Jerry Paris), Porky's contre-attaque (de James Komack), Une défense canon (de Willard Huyck avec Dudley Moore et Eddie Murphy). On suppose tout de même moins insignifiants Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill (avec Richard Pryor) et les deux premiers longs métrages d'un Robert Zemeckis profitant du récent succès public de son A la poursuite du diamant vert (Crazy day, 1978, chronique autour de la Beatlemania en 64 aux USA et La grosse magouille, 1980, satire de l'Amérique profonde avec Kurt Russell).
Dans le film d'action, l'heure est au cassage de gueule des Jaunes (Nom de code : Oies sauvages, italo-ouest-allemand d'Antonio Margheriti, avec Lee Van Cleef, Klaus Kinski et Ernest Borgnine ; Gymkata, de Robert Clouse, dans lequel un brave Américain gagne une chasse à l'homme organisée dans un petit royaume d'Asie) et à la dénonciation des Rouges (Goulag de Roger Young, dont le héros est un journaliste sportif, encore une fois américain, qui s'évade d'un camp soviétique). Avec Amazonia, la jungle blanche, l'Italien Ruggero Deodato, réalisateur de Cannibal Holocaust, nous éclaire (?) sur le trafic de drogue en Amazonie, avec La cavale impossible, Stephen Gyllenhaal invente la virée entre femmes bien avant Thelma et Louise, avec Marathon killer, Robert L. Rosen filme un énième survival, avec Même les anges tirent à droite, E.B. Clucher donne une suite (datée de 1974) aux Anges mangent aussi des fayots, avec Prison de femmes en furie, Michele Massimo Tarantini propose une nouvelle variation dans le sous genre... prison de femmes.
 Au rayon SF et horreur, nous ne sommes pas mieux lotis avec 2072, les mercenaires du futur (de Lucio Fulci), Diesel (de Robert Kramer, dans lequel Gérard Klein, Agnès Soral, Richard Bohringer et Niels Arestrup jouent à Mad Max), Horror (de Philippe Mora, avec Christopher Lee), Les frénétiques (de David Winters, crimes au Festival de Cannes, vus sous l'angle parodique, dix ans avant Les Nuls) et Vendredi 13 – Chapitre 5 (de Danny Steinmann, où l'on se rend compte que le "chapitre final" sorti quelques mois auparavant n'était donc pas le dernier...). Dans ce désert, ne semblent exister que quatre oasis éventuelles. Dreamscape, de Joseph Ruben, montre un homme, Dennis Quaid, qui se bat dans les rêves des autres. Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, conte le combat mené par Tom Selleck contre les robots. De son côté, Ridley Scott, sortant d'Alien et de Blade runner, proposait sa fable médiévalisante et merveilleuse Legend. Derrière le travail visuel époustouflant, perce-t-il quelque chose de consistant ? A vrai dire, ma mémoire me trahit... Enfin, Starman, avec sa trame ET-esque de la créature venue d'ailleurs, ne semble pas vraiment être considéré comme un John Carpenter majeur mais mérite sans doute le détour.
Au rayon SF et horreur, nous ne sommes pas mieux lotis avec 2072, les mercenaires du futur (de Lucio Fulci), Diesel (de Robert Kramer, dans lequel Gérard Klein, Agnès Soral, Richard Bohringer et Niels Arestrup jouent à Mad Max), Horror (de Philippe Mora, avec Christopher Lee), Les frénétiques (de David Winters, crimes au Festival de Cannes, vus sous l'angle parodique, dix ans avant Les Nuls) et Vendredi 13 – Chapitre 5 (de Danny Steinmann, où l'on se rend compte que le "chapitre final" sorti quelques mois auparavant n'était donc pas le dernier...). Dans ce désert, ne semblent exister que quatre oasis éventuelles. Dreamscape, de Joseph Ruben, montre un homme, Dennis Quaid, qui se bat dans les rêves des autres. Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, conte le combat mené par Tom Selleck contre les robots. De son côté, Ridley Scott, sortant d'Alien et de Blade runner, proposait sa fable médiévalisante et merveilleuse Legend. Derrière le travail visuel époustouflant, perce-t-il quelque chose de consistant ? A vrai dire, ma mémoire me trahit... Enfin, Starman, avec sa trame ET-esque de la créature venue d'ailleurs, ne semble pas vraiment être considéré comme un John Carpenter majeur mais mérite sans doute le détour.
En cet été 85, les polars de série, eux aussi, étaient légion, la plupart du temps ressassant le thème de la vengeance personnelle. Alain Delon était de retour en ex-policier devenu justicier (Parole de flic de José Pinheiro), après les promesses de Tir groupé, Jean-Claude Missiaen continuait de décevoir avec son nouveau polar banlieusard La baston, Michel Gérard se mettait au cinéma "sérieux" en réalisant Blessure, film noir situé dans le milieu du rock et interprété et co-écrit par Florent Pagny (!), tandis que Michel Vianney signait Spécial police. Habitués du genre, Chuck Norris et Burt Reynolds occupaient toujours l'espace, avec, respectivement, Sale temps pour un flic d'Andy Davis et Stick, le justicier de Miami de Reynolds lui-même. Mentionnons également Un été pourri de Phillip Borsos, polar journalistique avec Kurt Russell. En ce qui concerne le film de kung fu, on note, en plus des productions courantes (Les enragés du kung fu et La rage bouddhiste du kung fu de Godfrey Ho, Shaolin contre Mandchou de Marlon Lee, Shaolin, temple de la tradition de Kwok Siu Ho), quelques hybridations trans-continentales entre l'Asie et l'Amérique (Le dernier dragon de Michael Schultz, Le retour du Chinois de James Glickenhaus, avec Jackie Chan qui s'associe à Danny Aiello et va de NY à HK).
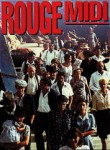 Dans des démarches plus auteuristes, les propositions de Dominique Crevecœur (le film-rêve Contes clandestins), de Lazlo Szabo (le décousu David, Thomas et les autres, production franco-hongroise avec Trintignant, Rochefort et Cottençon) et de Joy Fleury (Tristesse et beauté, d'après Yasunari Kawabata, avec Charlotte Rampling et Andrzej Zulawski) n'ont guère fait date, mais Pierre Jolivet séduisait avec son premier film, Strictement personnel, polar rêveur avec Pierre Arditti, Alain Tanner poursuivait son singulier parcours avec No man's land (quelques personnages, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, exposent leur désir de vivre une autre vie) et Robert Guédiguian faisait déjà preuve d'une belle ambition en contant 50 ans de la vie d'un quartier marseillais dans Rouge midi (avec, bien sûr, Gérard Meylan et Ariane Ascaride). Toutefois, le projet le plus intrigant est à chercher du côté des Etats-Unis : dans Strangers kiss, Matthew Chapman imagine ce qui aurait pu se passer lors du tournage du Baiser du tueur (Killer's kiss, 1955), le deuxième long métrage de Stanley Kubrick, les interprètes vivant dans la réalité, peu ou prou, les mêmes (més)aventures que dans la fiction.
Dans des démarches plus auteuristes, les propositions de Dominique Crevecœur (le film-rêve Contes clandestins), de Lazlo Szabo (le décousu David, Thomas et les autres, production franco-hongroise avec Trintignant, Rochefort et Cottençon) et de Joy Fleury (Tristesse et beauté, d'après Yasunari Kawabata, avec Charlotte Rampling et Andrzej Zulawski) n'ont guère fait date, mais Pierre Jolivet séduisait avec son premier film, Strictement personnel, polar rêveur avec Pierre Arditti, Alain Tanner poursuivait son singulier parcours avec No man's land (quelques personnages, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, exposent leur désir de vivre une autre vie) et Robert Guédiguian faisait déjà preuve d'une belle ambition en contant 50 ans de la vie d'un quartier marseillais dans Rouge midi (avec, bien sûr, Gérard Meylan et Ariane Ascaride). Toutefois, le projet le plus intrigant est à chercher du côté des Etats-Unis : dans Strangers kiss, Matthew Chapman imagine ce qui aurait pu se passer lors du tournage du Baiser du tueur (Killer's kiss, 1955), le deuxième long métrage de Stanley Kubrick, les interprètes vivant dans la réalité, peu ou prou, les mêmes (més)aventures que dans la fiction.
 Pour beaucoup, l'événement de l'été fut la sortie de Pale rider de Clint Eastwood. Ce western à la fois classique et détaché, mythique et réaliste, j'avoue l'avoir apprécié à chaque vision mais jamais "totalement". Le caractère non-chronologique de ma découverte de l'œuvre eastwoodienne y est sans doute pour quelque chose mais j'ai toujours préféré à ce titre Josey Wales ou Impitoyable. Le véritable film-phare de juillet-août 85 serait alors le Sang pour sang de Joel Coen (à peine mentionnait-on à l'époque le prénom de son frère-scénariste Ethan). Le jugement me paraît cependant légèrement biaisé : l'amour que l'on peut lui porter dépendant à mon sens beaucoup plus de ce que l'on connaît de la suite que de la réalité du film lui-même, habile exercice de style annonçant des vertiges plus prononcés. Pour moi, donc, le chef-d'œuvre est ailleurs. Dans la case "Documentaire". Il ne s'agit certes pas de Carné, l'homme à la caméra, hommage plan-plan au réalisateur du Jour se lève par Christian-Jacque, ni de Pumping Iron 2, l'enquête de George Butler sur le culturisme féminin, mais de Stop making sense, indépassable sommet du film-concert. Derrière la caméra : Jonathan Demme (dont le premier film, Cinq femmes à abattre, série B cormanienne de 1974 sortait au même moment). Devant : David Byrne et ses Talking Heads. Scénographie, son, lumières, montage : tout concourt à faire de cette prestation, donnée spécialement pour le film et gardant pourtant la fraîcheur et l'intensité d'un live "classique", le modèle du genre. Le génie du groupe et l'amour du réalisateur pour la musique achèvent de rendre le résultat miraculeux.
Pour beaucoup, l'événement de l'été fut la sortie de Pale rider de Clint Eastwood. Ce western à la fois classique et détaché, mythique et réaliste, j'avoue l'avoir apprécié à chaque vision mais jamais "totalement". Le caractère non-chronologique de ma découverte de l'œuvre eastwoodienne y est sans doute pour quelque chose mais j'ai toujours préféré à ce titre Josey Wales ou Impitoyable. Le véritable film-phare de juillet-août 85 serait alors le Sang pour sang de Joel Coen (à peine mentionnait-on à l'époque le prénom de son frère-scénariste Ethan). Le jugement me paraît cependant légèrement biaisé : l'amour que l'on peut lui porter dépendant à mon sens beaucoup plus de ce que l'on connaît de la suite que de la réalité du film lui-même, habile exercice de style annonçant des vertiges plus prononcés. Pour moi, donc, le chef-d'œuvre est ailleurs. Dans la case "Documentaire". Il ne s'agit certes pas de Carné, l'homme à la caméra, hommage plan-plan au réalisateur du Jour se lève par Christian-Jacque, ni de Pumping Iron 2, l'enquête de George Butler sur le culturisme féminin, mais de Stop making sense, indépassable sommet du film-concert. Derrière la caméra : Jonathan Demme (dont le premier film, Cinq femmes à abattre, série B cormanienne de 1974 sortait au même moment). Devant : David Byrne et ses Talking Heads. Scénographie, son, lumières, montage : tout concourt à faire de cette prestation, donnée spécialement pour le film et gardant pourtant la fraîcheur et l'intensité d'un live "classique", le modèle du genre. Le génie du groupe et l'amour du réalisateur pour la musique achèvent de rendre le résultat miraculeux.
Terminons notre survol de façon plus anecdotique en remarquant qu'à côté des (soft) Nuits chaudes de Cléopâtre (de Cesar Todd) et parmi les films X distribués alors mais dont nous rechignons à égrenner les titres, se retrouvent pas moins de six réalisations de José Benazeraf (Olinka, grande prêtresse de l'amour, Le yacht des partouzes, Perverse Isabelle, Orgies révolutionnaires, Le cul des mille plaisirs et Lady Winter, perversités à l'Anglaise).
 Dans les kiosques, hormis Positif (293-294) et La Revue du Cinéma (407) qui mettent le même film en couverture (La forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en juin), les revues et magazines font preuve de diversité. Le choix se porte sur le Nostalghia d'Andreï Tarkovski (sorti en mai) pour Cinéma 85 (319-320), sur Les enfants de Marguerite Duras (sorti en mai) pour les Cahiers du Cinéma (374), sur l'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine (sorti en mai) pour Jeune Cinéma (168), sur Starman pour L'Ecran Fantastique (58). Du côté de Cinématographe (112), on propose un dossier sur le cinéma beur (avec Abdellatif Kechiche, alors acteur, en couverture) et à Premiere, on fête le centième numéro.
Dans les kiosques, hormis Positif (293-294) et La Revue du Cinéma (407) qui mettent le même film en couverture (La forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en juin), les revues et magazines font preuve de diversité. Le choix se porte sur le Nostalghia d'Andreï Tarkovski (sorti en mai) pour Cinéma 85 (319-320), sur Les enfants de Marguerite Duras (sorti en mai) pour les Cahiers du Cinéma (374), sur l'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine (sorti en mai) pour Jeune Cinéma (168), sur Starman pour L'Ecran Fantastique (58). Du côté de Cinématographe (112), on propose un dossier sur le cinéma beur (avec Abdellatif Kechiche, alors acteur, en couverture) et à Premiere, on fête le centième numéro.
Voilà pour l'été 1985. La suite à la rentrée...

 SPACE COWBOYS
SPACE COWBOYS
 J. EDGAR
J. EDGAR
 AU-DELÀ (Hereafter)
AU-DELÀ (Hereafter) Qu'il vienne de France, d'Angleterre ou des Etats-Unis, le genre comique n'offre a priori rien de remarquable, à en juger par cette série de titres : Le facteur de Saint-Tropez (de Richard Balducci, avec Paul Préboist), L'amour propre (premier film de Martin Veyron), Les débiles de l'espace (de Mike Hodges), Les zéros de conduite (de Neal Israel), Police Academy 2 : Au boulot ! (de Jerry Paris), Porky's contre-attaque (de James Komack), Une défense canon (de Willard Huyck avec Dudley Moore et Eddie Murphy). On suppose tout de même moins insignifiants Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill (avec Richard Pryor) et les deux premiers longs métrages d'un Robert Zemeckis profitant du récent succès public de son A la poursuite du diamant vert (Crazy day, 1978, chronique autour de la Beatlemania en 64 aux USA et La grosse magouille, 1980, satire de l'Amérique profonde avec Kurt Russell).
Qu'il vienne de France, d'Angleterre ou des Etats-Unis, le genre comique n'offre a priori rien de remarquable, à en juger par cette série de titres : Le facteur de Saint-Tropez (de Richard Balducci, avec Paul Préboist), L'amour propre (premier film de Martin Veyron), Les débiles de l'espace (de Mike Hodges), Les zéros de conduite (de Neal Israel), Police Academy 2 : Au boulot ! (de Jerry Paris), Porky's contre-attaque (de James Komack), Une défense canon (de Willard Huyck avec Dudley Moore et Eddie Murphy). On suppose tout de même moins insignifiants Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill (avec Richard Pryor) et les deux premiers longs métrages d'un Robert Zemeckis profitant du récent succès public de son A la poursuite du diamant vert (Crazy day, 1978, chronique autour de la Beatlemania en 64 aux USA et La grosse magouille, 1980, satire de l'Amérique profonde avec Kurt Russell). Au rayon SF et horreur, nous ne sommes pas mieux lotis avec 2072, les mercenaires du futur (de Lucio Fulci), Diesel (de Robert Kramer, dans lequel Gérard Klein, Agnès Soral, Richard Bohringer et Niels Arestrup jouent à Mad Max), Horror (de Philippe Mora, avec Christopher Lee), Les frénétiques (de David Winters, crimes au Festival de Cannes, vus sous l'angle parodique, dix ans avant Les Nuls) et Vendredi 13 – Chapitre 5 (de Danny Steinmann, où l'on se rend compte que le "chapitre final" sorti quelques mois auparavant n'était donc pas le dernier...). Dans ce désert, ne semblent exister que quatre oasis éventuelles. Dreamscape, de Joseph Ruben, montre un homme, Dennis Quaid, qui se bat dans les rêves des autres. Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, conte le combat mené par Tom Selleck contre les robots. De son côté, Ridley Scott, sortant d'Alien et de Blade runner, proposait sa fable médiévalisante et merveilleuse Legend. Derrière le travail visuel époustouflant, perce-t-il quelque chose de consistant ? A vrai dire, ma mémoire me trahit... Enfin, Starman, avec sa trame ET-esque de la créature venue d'ailleurs, ne semble pas vraiment être considéré comme un John Carpenter majeur mais mérite sans doute le détour.
Au rayon SF et horreur, nous ne sommes pas mieux lotis avec 2072, les mercenaires du futur (de Lucio Fulci), Diesel (de Robert Kramer, dans lequel Gérard Klein, Agnès Soral, Richard Bohringer et Niels Arestrup jouent à Mad Max), Horror (de Philippe Mora, avec Christopher Lee), Les frénétiques (de David Winters, crimes au Festival de Cannes, vus sous l'angle parodique, dix ans avant Les Nuls) et Vendredi 13 – Chapitre 5 (de Danny Steinmann, où l'on se rend compte que le "chapitre final" sorti quelques mois auparavant n'était donc pas le dernier...). Dans ce désert, ne semblent exister que quatre oasis éventuelles. Dreamscape, de Joseph Ruben, montre un homme, Dennis Quaid, qui se bat dans les rêves des autres. Runaway, l'évadé du futur, de Michael Crichton, conte le combat mené par Tom Selleck contre les robots. De son côté, Ridley Scott, sortant d'Alien et de Blade runner, proposait sa fable médiévalisante et merveilleuse Legend. Derrière le travail visuel époustouflant, perce-t-il quelque chose de consistant ? A vrai dire, ma mémoire me trahit... Enfin, Starman, avec sa trame ET-esque de la créature venue d'ailleurs, ne semble pas vraiment être considéré comme un John Carpenter majeur mais mérite sans doute le détour.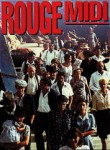 Dans des démarches plus auteuristes, les propositions de Dominique Crevecœur (le film-rêve Contes clandestins), de Lazlo Szabo (le décousu David, Thomas et les autres, production franco-hongroise avec Trintignant, Rochefort et Cottençon) et de Joy Fleury (Tristesse et beauté, d'après Yasunari Kawabata, avec Charlotte Rampling et Andrzej Zulawski) n'ont guère fait date, mais Pierre Jolivet séduisait avec son premier film, Strictement personnel, polar rêveur avec Pierre Arditti, Alain Tanner poursuivait son singulier parcours avec No man's land (quelques personnages, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, exposent leur désir de vivre une autre vie) et Robert Guédiguian faisait déjà preuve d'une belle ambition en contant 50 ans de la vie d'un quartier marseillais dans Rouge midi (avec, bien sûr, Gérard Meylan et Ariane Ascaride). Toutefois, le projet le plus intrigant est à chercher du côté des Etats-Unis : dans Strangers kiss, Matthew Chapman imagine ce qui aurait pu se passer lors du tournage du Baiser du tueur (Killer's kiss, 1955), le deuxième long métrage de Stanley Kubrick, les interprètes vivant dans la réalité, peu ou prou, les mêmes (més)aventures que dans la fiction.
Dans des démarches plus auteuristes, les propositions de Dominique Crevecœur (le film-rêve Contes clandestins), de Lazlo Szabo (le décousu David, Thomas et les autres, production franco-hongroise avec Trintignant, Rochefort et Cottençon) et de Joy Fleury (Tristesse et beauté, d'après Yasunari Kawabata, avec Charlotte Rampling et Andrzej Zulawski) n'ont guère fait date, mais Pierre Jolivet séduisait avec son premier film, Strictement personnel, polar rêveur avec Pierre Arditti, Alain Tanner poursuivait son singulier parcours avec No man's land (quelques personnages, de part et d'autre de la frontière franco-suisse, exposent leur désir de vivre une autre vie) et Robert Guédiguian faisait déjà preuve d'une belle ambition en contant 50 ans de la vie d'un quartier marseillais dans Rouge midi (avec, bien sûr, Gérard Meylan et Ariane Ascaride). Toutefois, le projet le plus intrigant est à chercher du côté des Etats-Unis : dans Strangers kiss, Matthew Chapman imagine ce qui aurait pu se passer lors du tournage du Baiser du tueur (Killer's kiss, 1955), le deuxième long métrage de Stanley Kubrick, les interprètes vivant dans la réalité, peu ou prou, les mêmes (més)aventures que dans la fiction. Pour beaucoup, l'événement de l'été fut la sortie de Pale rider de Clint Eastwood. Ce western à la fois classique et détaché, mythique et réaliste, j'avoue l'avoir apprécié à chaque vision mais jamais "totalement". Le caractère non-chronologique de ma découverte de l'œuvre eastwoodienne y est sans doute pour quelque chose mais j'ai toujours préféré à ce titre Josey Wales ou Impitoyable. Le véritable film-phare de juillet-août 85 serait alors le Sang pour sang de Joel Coen (à peine mentionnait-on à l'époque le prénom de son frère-scénariste Ethan). Le jugement me paraît cependant légèrement biaisé : l'amour que l'on peut lui porter dépendant à mon sens beaucoup plus de ce que l'on connaît de la suite que de la réalité du film lui-même, habile exercice de style annonçant des vertiges plus prononcés. Pour moi, donc, le chef-d'œuvre est ailleurs. Dans la case "Documentaire". Il ne s'agit certes pas de Carné, l'homme à la caméra, hommage plan-plan au réalisateur du Jour se lève par Christian-Jacque, ni de Pumping Iron 2, l'enquête de George Butler sur le culturisme féminin, mais de Stop making sense, indépassable sommet du film-concert. Derrière la caméra : Jonathan Demme (dont le premier film, Cinq femmes à abattre, série B cormanienne de 1974 sortait au même moment). Devant : David Byrne et ses Talking Heads. Scénographie, son, lumières, montage : tout concourt à faire de cette prestation, donnée spécialement pour le film et gardant pourtant la fraîcheur et l'intensité d'un live "classique", le modèle du genre. Le génie du groupe et l'amour du réalisateur pour la musique achèvent de rendre le résultat miraculeux.
Pour beaucoup, l'événement de l'été fut la sortie de Pale rider de Clint Eastwood. Ce western à la fois classique et détaché, mythique et réaliste, j'avoue l'avoir apprécié à chaque vision mais jamais "totalement". Le caractère non-chronologique de ma découverte de l'œuvre eastwoodienne y est sans doute pour quelque chose mais j'ai toujours préféré à ce titre Josey Wales ou Impitoyable. Le véritable film-phare de juillet-août 85 serait alors le Sang pour sang de Joel Coen (à peine mentionnait-on à l'époque le prénom de son frère-scénariste Ethan). Le jugement me paraît cependant légèrement biaisé : l'amour que l'on peut lui porter dépendant à mon sens beaucoup plus de ce que l'on connaît de la suite que de la réalité du film lui-même, habile exercice de style annonçant des vertiges plus prononcés. Pour moi, donc, le chef-d'œuvre est ailleurs. Dans la case "Documentaire". Il ne s'agit certes pas de Carné, l'homme à la caméra, hommage plan-plan au réalisateur du Jour se lève par Christian-Jacque, ni de Pumping Iron 2, l'enquête de George Butler sur le culturisme féminin, mais de Stop making sense, indépassable sommet du film-concert. Derrière la caméra : Jonathan Demme (dont le premier film, Cinq femmes à abattre, série B cormanienne de 1974 sortait au même moment). Devant : David Byrne et ses Talking Heads. Scénographie, son, lumières, montage : tout concourt à faire de cette prestation, donnée spécialement pour le film et gardant pourtant la fraîcheur et l'intensité d'un live "classique", le modèle du genre. Le génie du groupe et l'amour du réalisateur pour la musique achèvent de rendre le résultat miraculeux. Dans les kiosques, hormis Positif (293-294) et La Revue du Cinéma (407) qui mettent le même film en couverture (La forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en juin), les revues et magazines font preuve de diversité. Le choix se porte sur le Nostalghia d'Andreï Tarkovski (sorti en mai) pour Cinéma 85 (319-320), sur Les enfants de Marguerite Duras (sorti en mai) pour les Cahiers du Cinéma (374), sur l'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine (sorti en mai) pour Jeune Cinéma (168), sur Starman pour L'Ecran Fantastique (58). Du côté de Cinématographe (112), on propose un dossier sur le cinéma beur (avec Abdellatif Kechiche, alors acteur, en couverture) et à Premiere, on fête le centième numéro.
Dans les kiosques, hormis Positif (293-294) et La Revue du Cinéma (407) qui mettent le même film en couverture (La forêt d'émeraude de John Boorman, sorti en juin), les revues et magazines font preuve de diversité. Le choix se porte sur le Nostalghia d'Andreï Tarkovski (sorti en mai) pour Cinéma 85 (319-320), sur Les enfants de Marguerite Duras (sorti en mai) pour les Cahiers du Cinéma (374), sur l'Adieu Bonaparte de Youssef Chahine (sorti en mai) pour Jeune Cinéma (168), sur Starman pour L'Ecran Fantastique (58). Du côté de Cinématographe (112), on propose un dossier sur le cinéma beur (avec Abdellatif Kechiche, alors acteur, en couverture) et à Premiere, on fête le centième numéro. Lors de "leur" coupe du monde de rugby, qui arrivait, en 1995, trois ans après la fin du boycott international consécutif à la politique d'apartheid, l'Afrique du Sud a commencé par un coup d'éclat en battant l'Australie (27-18), ce qui leur assura un quart de finale facile (les deux autres matchs de poule n'étant qu'une formalité, contre la Roumanie [21-8] et le Canada [20-0]). Au stade suivant, les Samoa ne pesèrent effectivement pas bien lourd et s'inclinèrent 42 à 14. L'adversaire en demi-finale était d'un autre calibre puisqu'il s'agissait des Français. Les Springboks (surnom des locaux) gagnèrent 19-15 et eurent donc l'occasion de défier les All-Blacks, grands favoris du tournoi, en finale. Devant leurs supporters et leur président Nelson Mandela, ils réussissèrent l'exploit de l'emporter 15 à 12 (aucun essai ne fut marqué de part et d'autre).
Lors de "leur" coupe du monde de rugby, qui arrivait, en 1995, trois ans après la fin du boycott international consécutif à la politique d'apartheid, l'Afrique du Sud a commencé par un coup d'éclat en battant l'Australie (27-18), ce qui leur assura un quart de finale facile (les deux autres matchs de poule n'étant qu'une formalité, contre la Roumanie [21-8] et le Canada [20-0]). Au stade suivant, les Samoa ne pesèrent effectivement pas bien lourd et s'inclinèrent 42 à 14. L'adversaire en demi-finale était d'un autre calibre puisqu'il s'agissait des Français. Les Springboks (surnom des locaux) gagnèrent 19-15 et eurent donc l'occasion de défier les All-Blacks, grands favoris du tournoi, en finale. Devant leurs supporters et leur président Nelson Mandela, ils réussissèrent l'exploit de l'emporter 15 à 12 (aucun essai ne fut marqué de part et d'autre). Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S.
Le jeune ado que j'étais pu aller voir une petite poignée de films familiaux : Signé Lassiter (de Roger Young, avec Tom "Magnum" Selleck en Arsène Lupin au pays des Nazis) me laissa relativement indifférent tandis que Roar, probablement pas meilleur, me séduisit un peu plus (un film de Noel Marshall où, pour moi, les stars étaient les dizaines de fauves que l'on y croisait, plutôt que les inconnues Tippi Hedren et sa fille Melanie (Griffith)). Toutefois, sur le moment, l'expérience la plus emballante fut incontestablement la découverte d'un drôle de film d'aventures signé par un protégé de Spielberg, Robert Zemeckis : A la poursuite du diamant vert. Gros succès en salles (relativement inattendu, semble-t-il me rappeler, malgré sa "recette") puis à la télévision pendant de longues années, il reste peut-être encore aujourd'hui fréquentable, son auteur ayant par la suite assez vite prouvé qu'il était un peu plus qu'un sous-Steven S. Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation.
Vu d'ici et aujourd'hui, dans la liste de l'été 84, que regrette-t-on de ne pas encore connaître ? En premier lieu, Les années déclic, l'autoportrait de Raymond Depardon, sorti en catimini à l'époque et encore peu diffusé de nos jours. Ensuite, le remake, apparemment pas déshonorant, de L'homme qui aimait les femmes de Truffaut par Blake Edwards : L'homme à femmes (campé par Burt Reynolds). Enfin, malgré le peu d'enthousiasme réel qu'ont pu susciter chez moi les quelques films que j'ai pu voir d'Abel Ferrara (hormis Nos funérailles) : New York, deux heures du matin, l'un de ses polars poisseux s'étant taillé une petite réputation. Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).
Un second wagon fait un peu peur : Bingo Bongo (conte pour enfants autour d'un homme-singe, signé Pascale Festa-Campanile, avec Carole Bouquet), La nuit des loups (film de bande ouest-allemand de Rüdiger Nüchtern), Le challenger (film de David Fischer, sorti du fond du tiroir suite à la starification coppolesque de Matt Dillon), C'est dans la poche (une comédie de Daniel Mann sur un ex-champion de boxe et un kangourou, avec Elliot Gould et Robert Mitchum !), Tonnerre (Larry Ludman), Le gang des BMX (film d'aventures familial à l'Australienne, signé Brian Trenchard-Smith, avec notamment une certaine Nicole Kidman), Règlement de compte (de Paul Aaron, pas de Fritz Lang), Les maîtres du soleil (SF française de Jean-Jacques Aublanc), Le sang du dragon (polar hongkongais de Jimmy Tseng), Le palace en délire (Neel Israel).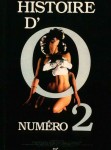 En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend.
En se tournant vers les productions érotiques soft, mis à part le Carmen cité plus avant, on ne tombe que sur des propositions peu engageantes : Où sont les hommes ? (espagnol de Ignacio F. Iquino) et Histoire d'O, chapitre 2 (Eric Rochat). Tant qu'à faire, autant choisir Sodopartouzes clandestines (de "Joanna Morgan") ou Pénétrations multiples (de "Mike Strong"), sans doute moins décevants par rapport à ce que l'on en attend. Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio.
Sur la plage, nous pouvions lire dans Cinématographe (n°102) un dossier sur le casting (avec Lambert Wilson en couverture, dans La femme publique) et dans Première (88) une interview de Catherine Deneuve qui "tourne à Montréal Paroles et musique". Starfix (17) piaffait d'impatience en attendant Indiana Jones et le temple maudit. La revue du Cinéma (396) anticipait également sur les films de la rentrée et Au-dessous du volcan de Huston. Positif (281-282) et Cinéma 84 (307-308) choisissaient la même une : Le succès à tout prix (le film de Skolimowski sorti sur les écrans en mai). Les Cahiers, eux, font relâche. Enfin, deux revues ont été jusque là scandaleusement oubliées par mes services et nous y remédions enfin : L'Écran Fantastique (47) revenait sur Le Bounty et Mel Gibson alors que Jeune Cinéma (160) rendait compte, comme la majorité des publications estivales, du festival de Cannes et mettait en couverture Henri IV de Marco Bellocchio. Plutôt que de rallumer la mèche dans six mois, profitons de la polémique actuelle (annuelle) autour de Clint Eastwood et continuons à danser sur les braises.
Plutôt que de rallumer la mèche dans six mois, profitons de la polémique actuelle (annuelle) autour de Clint Eastwood et continuons à danser sur les braises.