


****/****/****

(Chronique dvd parue sur Kinok)
Avouons-le, la découverte des "primitifs" - à l'exception, peut-être, des burlesques - demande une disposition particulière sinon un travail au spectateur, qui doit, sous peine de manquer d'apprécier à sa juste valeur l'objet retrouvé, se mettre les idées assez claires par rapport à l'histoire du cinéma et à l'évolution de ses formes. Les bouleversements qui apparaissent dans la pratique de cet art au cours des années 10 du vingtième siècle sont d'une telle ampleur que l'on peut avancer sans trop de provocation que l'on trouve moins de similitudes entre un Méliès de 1906 et un Fritz Lang de 1922 qu'entre ce dernier et un Lynch ou un Coen d'aujourd'hui. Ainsi, pour voir et commenter une série de films telle que le coffret Albert Capellani édité par Pathé nous le propose, mieux vaut-il sans doute s'en tenir à une approche chronologique.
Il faut donc commencer par le quatrième et dernier disque, sur lequel ont été regroupés plusieurs courts métrages du cinéaste. Drame passionnel, Mortelle idylle, La femme du lutteur, L'âge du cœur : ces bandes, toutes réalisées à ses débuts, en 1906, sont d'une durée équivalente (autour de cinq minutes), sont écrites par le même scénariste (André Heuzé) et proposent la même progression dramatique. Bâties sur la figure du trio, elles démarrent avec une rencontre amoureuse ou une vie de couple sans nuage pour instiller ensuite la suspicion et la trahison avant de se terminer sur une vengeance, par balle ou lame, ou par un suicide. Le reste n'est que variations, dont la plus notable concerne les statuts sociaux des personnages, assez divers. Nous sommes là dans la production de série et dans la spécialisation des réalisateurs-maison : chez Pathé-Frères, Albert Capellani se charge, aux côtés de Ferdinand Zecca, des films dramatiques. La mise en scène se fait "à plat", dans des échelles de plans bien définies, proches de celles que procure la vision d'un spectacle théâtral. La pantomime est de rigueur et un hiatus naît de chaque collage entre les plans tournés en extérieur et ceux tournés en intérieur.
Dans cette série de courts de 1906, quelques uns se distinguent toutefois, à divers titres. On remarque dans La fille du sonneur de timides panoramiques accompagnant des promeneurs avant qu'un mouvement de caméra plus affirmé balaie les toits de Paris. Un peu plus long que les autres, ce film ne résout cependant pas la délicate question de la gestion du temps cinématographique qui se pose devant ces œuvres. Pauvre mère est à la fois le mélodrame le plus simple et le plus complexe techniquement de cet échantillon. Des surimpressions et l'insertion sans heurt d'un plan plus rapproché dans une séquence sont les signes d'une recherche certaine. Sur toute la (courte) durée, l'organisation de l'espace semble plus inventive. Le fond est aussi plus dense et cette histoire de mère devenue folle à la suite de la mort de sa petite fille est une trame qui accueille plus facilement les excès de l'interprétation. Avec Aladin ou la lampe merveilleuse, Albert Capellani change de registre et marche dans les pas de Méliès. Il en reprend les trucages et l'idée d'un final en apothéose sous forme de petit ballet mais la fable orientalisante n'est déjà pas la veine la plus passionnante de l'œuvre du créateur du Voyage dans la lune... La tentative de Capellani n'est donc guère stimulante, sauf si l'on considère qu'elle lui ouvre la voie des films de prestige. L'aspect documentaire de ses mélodrames disparaît ici fâcheusement derrière les décors artificiels.
Trois ans (et une bonne vingtaine de titres) séparent ces courts du moyen métrage L'assommoir, soit à l'échelle du cinéma des premiers temps, un gouffre. Un récit plus purement cinématographique se met en place avec cette adaptation du roman de Zola. Les transitions se font plus souples entre les plans qui se délestent quelque peu de leur apparence de tableaux, y compris lorsqu'il s'agit de passer du dedans au dehors, et inversement. De même, dorénavant, la séquence n'équivaut pas toujours au plan, des inserts trouvant leur place. La gestuelle des comédiens est aussi plus mesurée et l'acquisition de cette maîtrise permet d'une part, une organisation plus claire de scènes de groupe et d'autre part l'émergence, en quelques endroits, du naturel. Bien sûr, la durée encore réduite, ainsi que le caractère primitif du déroulement des séquences, provoquent souvent d'étonnantes condensations du temps nécessaire aux actions. Dans le meilleur des cas, cela donne un morceau de bravoure, comme lorsque Alexandre Arquillière (du "Théâtre du Vaudeville de Paris", comme précisé au générique), dans le rôle de Coupeau, joue en une poignée de secondes le réveil, la tentation de l'alcool, le dilemme moral, l'abandon, l'ivresse, la folie furieuse et la mort...
Un nouveau saut temporel nous propulse en 1913-1914, à la découverte des trois longs métrages présents dans ce coffret. Ces dates ne sont pas anodines, le cinéma étant à ce moment-là en train de quitter l'âge primitif. Rappelons-nous qu'entre 1913 et 1916 sont réalisés Quo Vadis ? d'Enrico Guazzoni, Cabiria de Giovanni Pastrone, Forfaiture de Cecil B. DeMille, Naissance d'une nation et Intolérance de D.W. Griffith. Les durées de projection changent totalement, approchant parfois les trois heures, les moyens mis en œuvre ne sont plus les mêmes, le langage utilisé évolue forcément et le regard des spectateurs s'adapte. Les réalisateurs français ont pris leur part dans cette évolution, depuis le début des années 10, Capellani en tête.
Germinal, Le Chevalier de Maison Rouge et Quatre-vingt-treize ont bien des points communs mais, malgré leur proximité dans le temps, ils n'ont pas, à nos yeux, la même valeur et, étrangement, celle-ci n'est pas conditionnée par l'ordre dans lequel ces films ont été réalisés. Alors que les deux autres titres, sur plusieurs plans, constituent une avancée certaine par rapport aux exemples précédents de l'œuvre de Capellani, Le Chevalier de Maison Rouge marque un recul. Cette adaptation assez barbante d'Alexandre Dumas offre tout d'abord un festival de gestes déclamatoires. La Reine Marie-Antoinette, souffrante, implore constamment le ciel, le révolutionnaire enragé regarde toujours par en-dessous, le jeune officier amoureux garde en toute circonstance sa vivacité... La raison de ce retour à la pantomime s'explique peut-être par le choix du genre de la fantaisie historique. Un autre public que celui auquel était destiné les autres œuvres de prestige de Capellani était peut-être visé. Ou bien la trame rocambolesque a-t-elle poussé à cela ? Toujours est-il que le cinéaste autorise le jeu excessif de ses acteurs, la naïveté des comportements et la lourdeur des émotions exprimées.
L'agitation au sein des groupes est la règle, trop de monde s'évertuant à bouger dans un trop petit espace, ce qui a pour effet d'accentuer encore le statisme de la mise en scène. Les dispositions en demi-cercles ouverts vers nous et les visages tournés franchement vers la caméra pour émouvoir sont des effets ici bien artificiels. De même, les décors construits, notamment tous ceux de prison, jurent franchement avec les quelques rares extérieurs, soudain lestés d'un poids de réalité, d'une épaisseur grisâtre sans pareil. Dans un registre qui en demande, Capellani n'a pas la précision ni la vigueur d'un Feuillade. Il faut de plus noter le respect d'une morale très conventionnelle. Farouches royalistes et fervents révolutionnaires : les deux extrêmes n'ont pas les faveurs du cinéaste-adaptateur qui, au mépris du dénouement tragique du roman, choisit de sauver un couple d'amoureux loyaux envers leur famille politique sans être des acharnés.
La Révolution est également bien sûr au centre de Quatre-vingt-treize. La Terreur, plus exactement. Les enjeux et les tensions incroyables qui ont traversés cette période historique sont évidemment simplifiés (jusqu'à l'image d'Epinal quand est imaginée une réunion, dans l'arrière-salle d'un club, entre Marat, Danton et Robespierre), mais il arrive qu'une conversion comme celle du jeune aristocrate aux idées des Lumières émeuve par le bel enchaînement des évènements et la justesse des déplacements dans les décors. Si l'interprétation des comédiens est beaucoup plus supportable que dans Le Chevalier de Maison Rouge, il est vrai que brasser de grandes idées semble donner le droit de faire de grands gestes. Mais sans doute est-ce là le résultat de la tentative de transcription du lyrisme des mots de Victor Hugo dans les images de Capellani. On sent d'ailleurs que des moyens considérables sont à la disposition de celui-ci, qui donne la priorité au tournage en extérieurs. Cela ne va pas sans le paralyser quelque peu : le film est impressionnant, monumental, souvent figé. Les intertitres sont nombreux et longs, reprenant souvent des passages entiers du livre. Ainsi, la scène du débarquement de l'envoyé des royalistes, pourtant forte, souffre d'être abusivement découpée par le texte.
La variété des échelles de plans est sensible. La caméra se rapproche plus près des corps, rendant ainsi plus aisée l'identification du spectateur aux personnages. Quelques panoramiques et deux travellings se remarquent, ainsi que des raccords dans le mouvement par-delà le découpage. Très long métrage humaniste, Quatre-vingt-treize n'est donc pas seulement un fastueux et laborieux livre d'art, mais il reste aujourd'hui difficile à juger. Son histoire est effectivement chaotique. Le tournage en a été arrêté en 1914 par la déclaration de la guerre. Incomplet, il fut de toute façon bloqué par la censure de l'époque qui ne voulait pas sortir une œuvre rendant compte d'une guerre civile. La maison Pathé finit tout de même par le reprendre et André Antoine fut chargé de tourner les scènes manquantes et d'effectuer le montage définitif, en accord avec Capellani qui travaillait alors, et cela depuis le début des hostilités, aux Etats-Unis. La sortie effective eut donc lieu en 1921. Se posent alors les questions de datation (sept années, une éternité) et de paternité des différentes séquences (toute la dernière partie, pas la plus passionnante, est, semble-t-il, à mettre sur le compte d'Antoine).
C'est donc dans Germinal, le plus ancien des trois longs proposés dans ce coffret, que le cinéma de Capellani se montre sous son meilleur jour. Voici la première adaptation d'ampleur du roman de Zola, avant celles d'Yves Allégret en 1962 et de Claude Berri en 1993. Le tournage en décors réels semble s'imposer pour obtenir une correcte transposition, mais qu'en était-il en 1913 ? Et bien Capellani relève le défi de la même façon, s'installant sur les lieux où travaillent encore les mineurs de l'époque et allant jusqu'à mêler ses acteurs à la population lors de la fête locale, dans un geste documentaire assez surprenant. De plus, les transitions sont fluides entre intérieurs et extérieurs. La continuité n'est pas brisée et malgré leur longueur, les plans s'articulent dans une narration véritablement cinématographique.
Les acteurs, eux, apprennent à gérer leurs effets, y compris dans les scènes les plus physiques, comme la bagarre opposant Lantier à Chaval. Il suffit généralement d'un intertitre pour poser la situation, l'éloquence des gestes traduisant ensuite les échanges. L'alliance de cette retenue et de l'usage du plan séquence donne l'impression d'un jeu d'acteur pertinent. Elle permet aussi l'émotion, comme si le retrait la décuplait, à l'image de la scène où Lantier découvre, au fond de la mine, que son accompagnateur, qu'il pensait être le fils Maheu est en fait la fille Maheu (la révélation se fait par la libération de la longue chevelure cachée sous le bonnet, cette vision étant, à l'heure du dénouement, douloureusement redoublée, les cheveux de Catherine tombant vers le sol alors qu'elle est transportée sur un brancard). Le naturalisme de Zola appelle sans doute, plus que le lyrisme d'Hugo, un réalisme du geste.
Germinal se signale également par le dépassement de l'organisation "plate" des scènes. Les marches des mineurs se rendant à leur travail ou le quittant, l'alignement de leurs maisons, toutes similaires, et la profondeur des boyaux miniers sont autant de percées à la surface des décors. Le champ de la caméra est travaillé en strates : lorsque Lantier est sorti du puits, il est visible au premier plan ; au deuxième, la foule des mineurs se presse ; au troisième se distinguent les sauveteurs qui s'activent toujours au dessus du trou. La gestion des groupes est également assez remarquable, les placements en "cène" étant justifiés tant que possible, par exemple par la présence d'un poêle au premier plan. Mais c'est surtout la constante tenue à l'écart d'un personnage en particulier, le fascinant anarchiste russe Souvarine, qui donne sa valeur à ce type d'organisation dans l'espace : l'homme est toujours face à nous lorsque les autres nous tournent le dos et sur le bord du cadre lorsque la masse est au milieu. La caractérisation est ici extrêmement efficace.
Le message politique véhiculé par le roman est sans doute atténué dans le film. La violence et le désespoir sont forcément moins marqués. Il s'agissait de ménager la censure en ne montrant que ce qui était alors représentable, mais aussi de préserver l'honneur des mineurs (lors d'un tournage qui avait lieu seulement vingt-cinq ans après l'écriture du livre). Cela dit, la construction dramatique n'en souffre guère. Les scènes de couples ou de trio se répondent habilement entre l'univers des mineurs et celui des propriétaires et ces échos préparent le final sous forme de double deuil. Après une longue partie descriptive, le film entame un crescendo auquel il est difficile de résister. Capellani offre dans la dernière partie une série de séquences très fortes et des images inoubliables comme celles de la tuerie provoquée par l'armée ou celle d'un cadavre flottant au fond de la mine. Jamais l'ennui ne pointe pendant ces deux heures et vingt-huit minutes.
Ainsi, cette édition DVD d'œuvres qui n'étaient guère visibles depuis près d'un siècle et signées d'un réalisateur qui eut son heure de gloire avant de tomber dans l'oubli ne provoque pas de véritable choc. Mais elle permet au moins de profiter de la meilleure adaptation de Germinal et elle donne à voir les mutations considérables qu'a pu connaître l'art cinématographique dans sa prime jeunesse. Elle n'est donc aucunement destinée à l'usage exclusif des historiens.
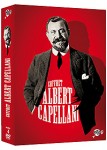 GERMINAL
GERMINAL
LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE
QUATRE-VINGT-TREIZE
d'Albert Capellani
(France / 148 mn, 108 mn, 165 mn / 1913, 1914, 1921)
+ 7 courts métrages de 1906 (5 à 13 mn) : DRAME PASSIONNEL / MORTELLE IDYLLE / PAUVRE MÈRE / LA FILLE DU SONNEUR / LA FEMME DU LUTTEUR / L'ÂGE DU CŒUR / ALADIN OU LA LAMPE MERVEILLEUSE
+ 1 moyen métrage de 1909 (35 mn) : L'ASSOMMOIR

 TOKYO !
TOKYO !
 BLACK SWAN
BLACK SWAN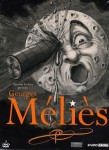 Ce coffret Studio Canal, sorti en 2008, s'il ne donne accès qu'à 1/18ème de la production de Georges Méliès (qui s'élèverait à 520 films), semble toutefois proposer un panel assez représentatif de l'œuvre du cinéaste-inventeur de Montreuil. Son travail est en effet présenté dans sa diversité, non réduit aux seuls appels de la magie et de la féérie.
Ce coffret Studio Canal, sorti en 2008, s'il ne donne accès qu'à 1/18ème de la production de Georges Méliès (qui s'élèverait à 520 films), semble toutefois proposer un panel assez représentatif de l'œuvre du cinéaste-inventeur de Montreuil. Son travail est en effet présenté dans sa diversité, non réduit aux seuls appels de la magie et de la féérie. Certains dépassent ce stade en trouvant une forme et un rythme plus remarquables. Ainsi dans Sorcellerie culinaire (1904, 4'08''), le crescendo organisé par le montage fait accéder la succession de farces théâtrales et gymnastiques réalisées par quelques diablotins au détriment d'un cuisinier au rang d'objet cinématographique singulier (semblant annoncer notamment, dans son accumulation irrépressible, le célèbre Tango de Zbigniew Rybczynski). Méliès en reprendra d'ailleurs l'idée, avec moins de bonheur, pour une séquence de ses Quatre cent farces du Diable (1906, 17'17''), pantomime plutôt inoffensive et gesticulante, plus laborieuse dans son ensemble. Le Diable l'inspire pourtant souvent, comme l'atteste Le chaudron infernal (1903, 1'44'') court récit coloré et morbide donnant à voir de très beaux fantômes en surimpression. Dans ce genre inquiétant, Une nuit terrible (1896, 1'05'') est en revanche anecdotique.
Certains dépassent ce stade en trouvant une forme et un rythme plus remarquables. Ainsi dans Sorcellerie culinaire (1904, 4'08''), le crescendo organisé par le montage fait accéder la succession de farces théâtrales et gymnastiques réalisées par quelques diablotins au détriment d'un cuisinier au rang d'objet cinématographique singulier (semblant annoncer notamment, dans son accumulation irrépressible, le célèbre Tango de Zbigniew Rybczynski). Méliès en reprendra d'ailleurs l'idée, avec moins de bonheur, pour une séquence de ses Quatre cent farces du Diable (1906, 17'17''), pantomime plutôt inoffensive et gesticulante, plus laborieuse dans son ensemble. Le Diable l'inspire pourtant souvent, comme l'atteste Le chaudron infernal (1903, 1'44'') court récit coloré et morbide donnant à voir de très beaux fantômes en surimpression. Dans ce genre inquiétant, Une nuit terrible (1896, 1'05'') est en revanche anecdotique. L'illustration de contes est un autre courant important. De Cendrillon (1899, 5'40'') et son remake Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse (1912, 27'43''), nous ne retenons pas grand chose. Le premier n'est qu'une suite de tableaux. Le second, plus long et plus lent, est un peu plus intéressant. On y décèle un plan rapproché à l'intérieur d'une séquence, le déroulement de deux actions parallèles, une procession presque absurde par sa durée excessive. Barbe Bleue (1901, 10'18'') apparaît beaucoup plus vif et plus inventif visuellement. Le conte est également plus cruel, captant ainsi plus rapidement notre attention. Cerise sur le gâteau : le film semble assumer de plus en plus nettement au fil de son déroulement son caractère de représentation jusqu'à un baisser de rideau final.
L'illustration de contes est un autre courant important. De Cendrillon (1899, 5'40'') et son remake Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse (1912, 27'43''), nous ne retenons pas grand chose. Le premier n'est qu'une suite de tableaux. Le second, plus long et plus lent, est un peu plus intéressant. On y décèle un plan rapproché à l'intérieur d'une séquence, le déroulement de deux actions parallèles, une procession presque absurde par sa durée excessive. Barbe Bleue (1901, 10'18'') apparaît beaucoup plus vif et plus inventif visuellement. Le conte est également plus cruel, captant ainsi plus rapidement notre attention. Cerise sur le gâteau : le film semble assumer de plus en plus nettement au fil de son déroulement son caractère de représentation jusqu'à un baisser de rideau final. Le premier film de Méliès est Une Partie de cartes (1896, 1'06''). Celle-ci répond bien sûr à celle des Frères Lumière mais elle ouvre aussi une piste que l'on ne pensait pas explorer, celle du documentaire et du film social. Avec Le sacre d'Edouard VII (1902, 5'18'') Méliès effectue la reconstitution d'un événement contemporain, qui s'avèrera finalement une anticipation et une amélioration (la véritable cérémonie ayant été reportée et écourtée). Avec Il y a un dieu pour les ivrognes (1908, 3'54''), en deux plans seulement, un extérieur, l'autre intérieur, il construit un récit édifiant sur les ravages de l'alcoolisme. Mais le film le plus surprenant du lot est titré Les incendiaires (1906, 7'21''). Loin de la féérie, Georges Méliès met en scène successivement un incendie criminel, une riposte policière, un coup de hache sur une tête, une course poursuite en décors réels (les seuls que j'ai remarqué dans ces œuvres). Il enchaîne par une ellipse très cinématographique en passant d'un plan du bandit entre les gendarmes à un autre montrant le même tourmenté dans sa cellule. Puis nous nous retrouvons dans la cour où trône la guillotine. Le plan est d'une longueur étonnante et d'une froideur glaçante: il détaille la préparation, les essais, l'arrivée du condamné, son exécution, sa bascule dans le cercueil, la récupération de sa tête et le nettoyage de la machine. Fin.
Le premier film de Méliès est Une Partie de cartes (1896, 1'06''). Celle-ci répond bien sûr à celle des Frères Lumière mais elle ouvre aussi une piste que l'on ne pensait pas explorer, celle du documentaire et du film social. Avec Le sacre d'Edouard VII (1902, 5'18'') Méliès effectue la reconstitution d'un événement contemporain, qui s'avèrera finalement une anticipation et une amélioration (la véritable cérémonie ayant été reportée et écourtée). Avec Il y a un dieu pour les ivrognes (1908, 3'54''), en deux plans seulement, un extérieur, l'autre intérieur, il construit un récit édifiant sur les ravages de l'alcoolisme. Mais le film le plus surprenant du lot est titré Les incendiaires (1906, 7'21''). Loin de la féérie, Georges Méliès met en scène successivement un incendie criminel, une riposte policière, un coup de hache sur une tête, une course poursuite en décors réels (les seuls que j'ai remarqué dans ces œuvres). Il enchaîne par une ellipse très cinématographique en passant d'un plan du bandit entre les gendarmes à un autre montrant le même tourmenté dans sa cellule. Puis nous nous retrouvons dans la cour où trône la guillotine. Le plan est d'une longueur étonnante et d'une froideur glaçante: il détaille la préparation, les essais, l'arrivée du condamné, son exécution, sa bascule dans le cercueil, la récupération de sa tête et le nettoyage de la machine. Fin. La première heure de L'exorciste relate très peu d'événements et place tout juste, de ci de là, quelques signes rendus volontairement énigmatiques par le défaut d'explication données, par l'éclatement spatio-temporel du récit et par la suspension de la plupart des séquences au sein desquelles ils apparaissent (nous retrouverons plus loin ce procédé). Il ne s'y passe donc pas grand chose mais ce prologue décrivant des fouilles archéologiques en Irak, ce suivi des faits et gestes d'un ecclésiastique en pleine crise de foi et ces scènes de famille à la teneur quasi-documentaire intriguent fortement par le parallélisme imposé par le montage. Friedkin joue du flottement et de l'attente du spectateur, multipliant en ces endroits les ellipses étonnantes (la mort de la mère du Père Karras, par exemple), reportant au plus tard possible le croisement des différentes trajectoires qu'il décrit. Ces trouées et ces prolongations nous laissent dans l'expectative, nous laissent aussi, parfois, dubitatifs (a-t-on là des défauts de construction ou pas ?). Mais le maillage tient pourtant, et l'étrange réalisme de Friedkin (ainsi que la qualité d'ensemble de l'interprétation) fait que l'on s'attache à ces personnages. Par conséquent - mais n'est-ce pas un mécanisme de protection de notre part, redoutant le pire, pourtant connu ? -, plus que la possession elle-même, ce sont les rapports de chacun (scientifique, prêtre, mère de famille) avec la notion d'exorcisme qui passionnent.
La première heure de L'exorciste relate très peu d'événements et place tout juste, de ci de là, quelques signes rendus volontairement énigmatiques par le défaut d'explication données, par l'éclatement spatio-temporel du récit et par la suspension de la plupart des séquences au sein desquelles ils apparaissent (nous retrouverons plus loin ce procédé). Il ne s'y passe donc pas grand chose mais ce prologue décrivant des fouilles archéologiques en Irak, ce suivi des faits et gestes d'un ecclésiastique en pleine crise de foi et ces scènes de famille à la teneur quasi-documentaire intriguent fortement par le parallélisme imposé par le montage. Friedkin joue du flottement et de l'attente du spectateur, multipliant en ces endroits les ellipses étonnantes (la mort de la mère du Père Karras, par exemple), reportant au plus tard possible le croisement des différentes trajectoires qu'il décrit. Ces trouées et ces prolongations nous laissent dans l'expectative, nous laissent aussi, parfois, dubitatifs (a-t-on là des défauts de construction ou pas ?). Mais le maillage tient pourtant, et l'étrange réalisme de Friedkin (ainsi que la qualité d'ensemble de l'interprétation) fait que l'on s'attache à ces personnages. Par conséquent - mais n'est-ce pas un mécanisme de protection de notre part, redoutant le pire, pourtant connu ? -, plus que la possession elle-même, ce sont les rapports de chacun (scientifique, prêtre, mère de famille) avec la notion d'exorcisme qui passionnent. ... et les bonnes intentions suffisent rarement à faire les meilleurs.
... et les bonnes intentions suffisent rarement à faire les meilleurs. Valse des titres au fil des présentations, des sorties et des reprises (Here is a man, A certain Mr Scratch, All that money can buy, The Devil and Daniel Webster, et, en France, Tous les biens de la terre) et distribution de plusieurs versions (dont une amputée de vingt minutes) : ces aléas en disent déjà beaucoup sur le caractère inclassable de ce film. Américain depuis 1937 mais ayant vécu en Allemagne jusqu'en 1930, William Dieterle, qui avait notamment interprété, en 1926, le rôle de Valentin dans le Faust de Murnau, propose là un déplacement géographique et temporel du mythe, une variation sur le thème de l'homme vendant son âme au diable, développée à partir d'une iconographie et d'une histoire appartenant au folklore des Etats-Unis naissants. Fort du succès de La vie de Louis Pasteur (1936), de La vie d'Emile Zola (1937), de Juarez (1939) et, surtout, de Quasimodo (1939), le cinéaste s'était fait producteur et profitait alors du savoir-faire des équipes de la RKO.
Valse des titres au fil des présentations, des sorties et des reprises (Here is a man, A certain Mr Scratch, All that money can buy, The Devil and Daniel Webster, et, en France, Tous les biens de la terre) et distribution de plusieurs versions (dont une amputée de vingt minutes) : ces aléas en disent déjà beaucoup sur le caractère inclassable de ce film. Américain depuis 1937 mais ayant vécu en Allemagne jusqu'en 1930, William Dieterle, qui avait notamment interprété, en 1926, le rôle de Valentin dans le Faust de Murnau, propose là un déplacement géographique et temporel du mythe, une variation sur le thème de l'homme vendant son âme au diable, développée à partir d'une iconographie et d'une histoire appartenant au folklore des Etats-Unis naissants. Fort du succès de La vie de Louis Pasteur (1936), de La vie d'Emile Zola (1937), de Juarez (1939) et, surtout, de Quasimodo (1939), le cinéaste s'était fait producteur et profitait alors du savoir-faire des équipes de la RKO.
 Écrire sur L'enterré vivant (Premature burial) est une torture. Il est en effet bien difficile d'en rendre compte sans en dévoiler la fin, qui remet brutalement en cause notre jugement sur le récit que l'on vient de nous conter (le film fait bien sûr partie du "cycle Edgar Poe" de Roger Corman). Marchons donc précautionneusement (d'autant plus que le brouillard est dense) et prenons les choses dans l'ordre.
Écrire sur L'enterré vivant (Premature burial) est une torture. Il est en effet bien difficile d'en rendre compte sans en dévoiler la fin, qui remet brutalement en cause notre jugement sur le récit que l'on vient de nous conter (le film fait bien sûr partie du "cycle Edgar Poe" de Roger Corman). Marchons donc précautionneusement (d'autant plus que le brouillard est dense) et prenons les choses dans l'ordre. Une simple idée peut-elle suffire à faire tenir un film droit ? Parfois oui, comme c'est le cas avec Cloverfield. A Manhattan, Hud se retrouve avec une caméra numérique dans les mains, chargé de couvrir la fête donnée en l'honneur de son pote Rob. En pleine nuit, coupures de courant et explosions sément la pagaille aux alentours. Des monstres attaquent New York et Hud va filmer l'incroyable. Sur l'écran, nous ne verrons rien d'autre que le déroulement intégral de cet enregistrement.
Une simple idée peut-elle suffire à faire tenir un film droit ? Parfois oui, comme c'est le cas avec Cloverfield. A Manhattan, Hud se retrouve avec une caméra numérique dans les mains, chargé de couvrir la fête donnée en l'honneur de son pote Rob. En pleine nuit, coupures de courant et explosions sément la pagaille aux alentours. Des monstres attaquent New York et Hud va filmer l'incroyable. Sur l'écran, nous ne verrons rien d'autre que le déroulement intégral de cet enregistrement. En revoyant le King Kong de Schoedsack et Cooper, frappe d'abord l'évidence d'un coup de génie des auteurs, celui d'avoir voulu faire de leur grand film d'aventure, un film qui réfléchit en même temps sur le pouvoir extraordinaire du cinéma. Grâce au choix initial du scénario de lancer l'expédition sous le prétexte d'un tournage exotique, nombre de séquences acquièrent par la suite une toute autre dimension. L'essai filmé que Carl Denham demande à son actrice Ann Darrow, sur le pont du navire en route pour Skull Island, consiste à la faire crier et à enregistrer son effroi. Celui-ci inquiète par anticipation Jack Driscoll, compagnon bientôt amoureux de la belle. A travers cette scène, le spectateur, lui, perçoit bien plus que cela : l'affirmation que de l'artifice pourra naître l'émotion.
En revoyant le King Kong de Schoedsack et Cooper, frappe d'abord l'évidence d'un coup de génie des auteurs, celui d'avoir voulu faire de leur grand film d'aventure, un film qui réfléchit en même temps sur le pouvoir extraordinaire du cinéma. Grâce au choix initial du scénario de lancer l'expédition sous le prétexte d'un tournage exotique, nombre de séquences acquièrent par la suite une toute autre dimension. L'essai filmé que Carl Denham demande à son actrice Ann Darrow, sur le pont du navire en route pour Skull Island, consiste à la faire crier et à enregistrer son effroi. Celui-ci inquiète par anticipation Jack Driscoll, compagnon bientôt amoureux de la belle. A travers cette scène, le spectateur, lui, perçoit bien plus que cela : l'affirmation que de l'artifice pourra naître l'émotion. Rééditer l'exploit à la faveur d'une suite rapidement mise en chantier (pour une sortie en salles seulement neuf mois après le premier) était une gageure impossible à tenir. Certaines des beautés de King Kong, telles que la charge érotique et la libération de l'imaginaire sont tellement volatiles que l'on peut considérer qu'elles ont échappé aux auteurs. Fatalement, Le fils de Kong (The son of Kong) est loin d'être porteur de la même fascination. Beaucoup plus court (65 minutes), il est bâti en deux parties distinctes et très inégales.
Rééditer l'exploit à la faveur d'une suite rapidement mise en chantier (pour une sortie en salles seulement neuf mois après le premier) était une gageure impossible à tenir. Certaines des beautés de King Kong, telles que la charge érotique et la libération de l'imaginaire sont tellement volatiles que l'on peut considérer qu'elles ont échappé aux auteurs. Fatalement, Le fils de Kong (The son of Kong) est loin d'être porteur de la même fascination. Beaucoup plus court (65 minutes), il est bâti en deux parties distinctes et très inégales. Nouvelle variation, seize ans plus tard. Joe est un gorille géant vivant depuis sa naissance près de Jill, aujourd'hui une jeune femme héritière du domaine africain de son père. Max O'Hara (interprété, comme le personnage de Carl Denham, par Robert Armstrong), un entrepreneur de spectacle américain, finit par les rencontrer et faire signer un contrat à Jill afin de produire Joe dans son nouveau night-club new yorkais.
Nouvelle variation, seize ans plus tard. Joe est un gorille géant vivant depuis sa naissance près de Jill, aujourd'hui une jeune femme héritière du domaine africain de son père. Max O'Hara (interprété, comme le personnage de Carl Denham, par Robert Armstrong), un entrepreneur de spectacle américain, finit par les rencontrer et faire signer un contrat à Jill afin de produire Joe dans son nouveau night-club new yorkais. Cette longue introduction désabusée pour évoquer brièvement L'autre, film attendu, film ambitieux, film à moitié réussi, film à moitié raté. Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic ont décidé d'aborder le thème de la folie et là réside à mon avis, le défaut de l'oeuvre. Même s'ils s'attachent à un personnage défini, ils décrivent moins un cas précis (comme l'a si puissamment fait Kerrigan avec Keane) qu'ils ne parlent du problème "en général", qu'ils l'illustrent. La mise en scène est surchargée de signes : champ large mais constamment obstrué par des caches en amorce, caméra fébrile et près des visages, bande son inquiétante, jeux de miroirs, raccords déstabilisants, ambiances nocturnes irréelles... Le sous-texte est lui aussi excessif : références à la magie et à l'antiquité, omniprésence de l'alcool, contamination de la misère sociale, caractère liberticide des nouvelles technologies... Cette insistance dans la forme et le fond semble traduire un manque de confiance dans la capacité (pourtant réelle chez les cinéastes) à emmener le spectateur aux confins du fantastique. Donnée pour perturbée dès le départ, l'héroïne, comme la mise en scène, n'évolue pas (alors que la description d'un glissement progressif vers la folie aurait été certainement plus satisfaisant, vu ce que peut proposer par moments Dominique Blanc, dans la modulation de sa voix par exemple). Dans L'autre, nous ne voyons pas le monde par les yeux du personnage, mais nous regardons celui-ci s'y débattre. Cela peut faire toute la différence entre un film bouleversant et un exercice de style brillant mais vain.
Cette longue introduction désabusée pour évoquer brièvement L'autre, film attendu, film ambitieux, film à moitié réussi, film à moitié raté. Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic ont décidé d'aborder le thème de la folie et là réside à mon avis, le défaut de l'oeuvre. Même s'ils s'attachent à un personnage défini, ils décrivent moins un cas précis (comme l'a si puissamment fait Kerrigan avec Keane) qu'ils ne parlent du problème "en général", qu'ils l'illustrent. La mise en scène est surchargée de signes : champ large mais constamment obstrué par des caches en amorce, caméra fébrile et près des visages, bande son inquiétante, jeux de miroirs, raccords déstabilisants, ambiances nocturnes irréelles... Le sous-texte est lui aussi excessif : références à la magie et à l'antiquité, omniprésence de l'alcool, contamination de la misère sociale, caractère liberticide des nouvelles technologies... Cette insistance dans la forme et le fond semble traduire un manque de confiance dans la capacité (pourtant réelle chez les cinéastes) à emmener le spectateur aux confins du fantastique. Donnée pour perturbée dès le départ, l'héroïne, comme la mise en scène, n'évolue pas (alors que la description d'un glissement progressif vers la folie aurait été certainement plus satisfaisant, vu ce que peut proposer par moments Dominique Blanc, dans la modulation de sa voix par exemple). Dans L'autre, nous ne voyons pas le monde par les yeux du personnage, mais nous regardons celui-ci s'y débattre. Cela peut faire toute la différence entre un film bouleversant et un exercice de style brillant mais vain.