(Paolo et Vittorio Taviani / Italie / 1973)
■■□□
 Quel étrange film que cet Allonsanfan, qui précède dans la filmographie des Taviani leur oeuvre la plus célèbre, Padre Padrone. Comme souvent chez eux, l'histoire italienne est vue à travers le prisme du conte. Les décors sont naturels, l'argument clairement situé dans le temps et l'espace, mais ce réalisme de départ est constamment perturbé par des éléments oniriques ou surnaturels. Si les Taviani procèdent par longues séquences, le rythme à l'intérieur de chacune est très heurté. La plupart des raccords sont particulièrement brutaux, ménageant ainsi constamment des surprises. Nombre de plans fixent le regard du héros, craintif ou étonné, joué par Marcello Mastroianni, pour enchaîner sur un contrechamp auquel rien ne nous prépare (par exemple, un gros plan de visage qui nous est inconnu). La mise en scène accumule ainsi les ruptures dans ses effets, aussi bien que dans les registres émotionnels. Une séquence peut passer du drame à la farce grotesque. Dans cet univers, tout peut donc arriver. Les hallucinations ont autant de réalité que le reste, les morts reviennent à la vie, les protagonistes se séparent puis se retrouvent nez à nez, où qu'ils aillent. La logique à l'oeuvre est celle du rêve et du cauchemar (autre élément tirant vers le fantastique et constitutif des réalisations italiennes de l'époque : le recours à la post-synchronisation, qui accentue les différences de niveau d'expression). Le film avance par a-coups et des longueurs y voisinent avec de très belles idées (la scène du repas avec la famille, la présence de la mer, la mort de Charlotte traitée en une ellipse brutale, la danse dans le repère des subversifs...).
Quel étrange film que cet Allonsanfan, qui précède dans la filmographie des Taviani leur oeuvre la plus célèbre, Padre Padrone. Comme souvent chez eux, l'histoire italienne est vue à travers le prisme du conte. Les décors sont naturels, l'argument clairement situé dans le temps et l'espace, mais ce réalisme de départ est constamment perturbé par des éléments oniriques ou surnaturels. Si les Taviani procèdent par longues séquences, le rythme à l'intérieur de chacune est très heurté. La plupart des raccords sont particulièrement brutaux, ménageant ainsi constamment des surprises. Nombre de plans fixent le regard du héros, craintif ou étonné, joué par Marcello Mastroianni, pour enchaîner sur un contrechamp auquel rien ne nous prépare (par exemple, un gros plan de visage qui nous est inconnu). La mise en scène accumule ainsi les ruptures dans ses effets, aussi bien que dans les registres émotionnels. Une séquence peut passer du drame à la farce grotesque. Dans cet univers, tout peut donc arriver. Les hallucinations ont autant de réalité que le reste, les morts reviennent à la vie, les protagonistes se séparent puis se retrouvent nez à nez, où qu'ils aillent. La logique à l'oeuvre est celle du rêve et du cauchemar (autre élément tirant vers le fantastique et constitutif des réalisations italiennes de l'époque : le recours à la post-synchronisation, qui accentue les différences de niveau d'expression). Le film avance par a-coups et des longueurs y voisinent avec de très belles idées (la scène du repas avec la famille, la présence de la mer, la mort de Charlotte traitée en une ellipse brutale, la danse dans le repère des subversifs...).
Dans Allonsanfan, les frères Taviani traitent de la période de la restauration italienne en situant l'action en 1816. Le héros de leur film est Fulvio Imbriani, leader d'une secte "Les Frères Sublimes" qui lutte pour faire triompher dans le Sud l'idéal révolutionnaire et renverser la noblesse en place. Lorsque nous faisons sa connaissance, Fulvio sort de prison et, empli de doutes, n'aspire à présent qu'à renouer les liens avec sa riche famille et couler une vie paisible et bourgeoise. Mais au gré de multiples pérégrinations, ses camarades n'auront de cesse de le ramener dans le chemin de la lutte armée. Ce que filment les Taviani, avec un bel aplomb, c'est une faillite révolutionnaire. Les actions d'éclats de la secte finissent toutes piteusement. La faute aux trahisons et à la tentation bourgeoise qui se niche en chacun. Mastroianni, à travers le rôle de Fulvio joue une nouvelle fois un homme sans qualité, prêt à tous les mensonges et ce à l'égard de tous, ses amis, ses camarades, sa femme, sa famille. Seul son fils, qu'il retrouve après six ans, a droit à une affection sincère (mais lors de la nuit qu'ils passent ensemble avant une nouvelle séparation, son père lui raconte une terrible histoire : il affabule et hallucine encore). Il est assez difficile de s'attacher à un personnage aussi ambigu, que l'acteur incarne comme en retrait.
Un mot pour finir, sur le titre, intrigant. Allonsanfan est en fait le prénom de l'un des subversifs. Le personnage est au second plan mais est ô combien important. Avec son regard souligné par un trait de lumière, il est celui qui portera jusqu'au bout l'espoir révolutionnaire.
 L'insoumisdémarre en Kabylie en 1959 avec une embuscade dans laquelle des soldats sont pris sous le feu de tireurs algériens. Thomas, l'un des légionnaires, tente un coup d'éclat en allant porter secours à un camarade amoché en contrebas. Arrivé difficilement à ses côtés, il s'aperçoit que l'homme est déjà mort. Le deuxième long-métrage d'Alain Cavalier, dès son introduction, annonce la couleur : noire. A ses débuts, le cinéaste, comme Claude Sautet à la même époque, oeuvrait dans le film noir (avec Le combat dans l'île en 1962, puis Mise à sac en 1967). L'insoumisest en plein dans le genre, mais son argument de départ, lié à la guerre d'Algérie, change déjà beaucoup de choses (et ce film, avec d'autres, tord encore le cou à la légende tenace selon laquelle le cinéma français aurait traîné pour traiter de la question).
L'insoumisdémarre en Kabylie en 1959 avec une embuscade dans laquelle des soldats sont pris sous le feu de tireurs algériens. Thomas, l'un des légionnaires, tente un coup d'éclat en allant porter secours à un camarade amoché en contrebas. Arrivé difficilement à ses côtés, il s'aperçoit que l'homme est déjà mort. Le deuxième long-métrage d'Alain Cavalier, dès son introduction, annonce la couleur : noire. A ses débuts, le cinéaste, comme Claude Sautet à la même époque, oeuvrait dans le film noir (avec Le combat dans l'île en 1962, puis Mise à sac en 1967). L'insoumisest en plein dans le genre, mais son argument de départ, lié à la guerre d'Algérie, change déjà beaucoup de choses (et ce film, avec d'autres, tord encore le cou à la légende tenace selon laquelle le cinéma français aurait traîné pour traiter de la question).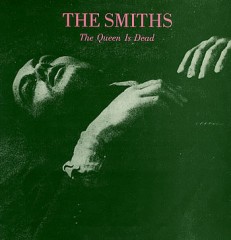
 Tout en privilégiant, comme la plupart de ses prédécesseurs cinéastes-enquêteurs, un regard documentaire, il ne s'agit plus maintenant pour Matteo Garrone de décrire les rouages de la mafia (plus précisément de la Camorra napolitaine) mais bien de se placer au centre et d'observer, médusé, les dégâts. Aux études verticales passées qui mettaient l'accent sur la structure pyramidale de l'organisation, Gomorrasubstitue une succession de visions horizontales. Cinq histoires parallèles se jouent, autour de Naples, à cinq niveaux différents : le très jeune Toto entre dans la bande qui contrôle son quartier; Marco et Ciro se veulent indépendants et n'arrêtent pas de "foutre la merde" dans la zone réservée; Don Ciro sillonne les barres d'immeubles, chargé par l'organisation de dédommager les familles des mafieux emprisonnés; Franco est un entrepreneur empoisonnant la terre avec ses décharges; et Pasquale est un tailleur remarquable qui ne se satisfait pas de son travail au sein d'un atelier clandestin et se lie, au péril de sa vie, à des collègues Chinois.
Tout en privilégiant, comme la plupart de ses prédécesseurs cinéastes-enquêteurs, un regard documentaire, il ne s'agit plus maintenant pour Matteo Garrone de décrire les rouages de la mafia (plus précisément de la Camorra napolitaine) mais bien de se placer au centre et d'observer, médusé, les dégâts. Aux études verticales passées qui mettaient l'accent sur la structure pyramidale de l'organisation, Gomorrasubstitue une succession de visions horizontales. Cinq histoires parallèles se jouent, autour de Naples, à cinq niveaux différents : le très jeune Toto entre dans la bande qui contrôle son quartier; Marco et Ciro se veulent indépendants et n'arrêtent pas de "foutre la merde" dans la zone réservée; Don Ciro sillonne les barres d'immeubles, chargé par l'organisation de dédommager les familles des mafieux emprisonnés; Franco est un entrepreneur empoisonnant la terre avec ses décharges; et Pasquale est un tailleur remarquable qui ne se satisfait pas de son travail au sein d'un atelier clandestin et se lie, au péril de sa vie, à des collègues Chinois. Salvatore Giuliano, film-enquête de Francesco Rosi, se base tout entier sur un mouvement analytique. Un mouvement de rapprochement allant du général au particulier, du paysage aux individus. Mais contrairement à l'habitude, ce resserrement ne fait qu'épaissir et complexifier le mystère de départ. Démarrant sur la découverte du cadavre du célèbre bandit sicilien au cours de l'été 1950, le récit se déploie en deux lignes temporelles. De la fin de la guerre, où lui et ses hommes, instruments des indépendantistes, se battent contre l'armée italienne, à son assassinat, nous suivons les principales étapes du parcours de Giuliano, dont le massacre de Portella delle Ginestre (une dizaine de personnes assistant à une réunion organisée par les communistes, le 1er mai 1947, abattue par la bande à Giuliano, sur demande d'un commanditaire resté inconnu). Parallèlement, nous sont montrés quelques événements suivant sa mort, jusqu'au procès de ses compagnons.
Salvatore Giuliano, film-enquête de Francesco Rosi, se base tout entier sur un mouvement analytique. Un mouvement de rapprochement allant du général au particulier, du paysage aux individus. Mais contrairement à l'habitude, ce resserrement ne fait qu'épaissir et complexifier le mystère de départ. Démarrant sur la découverte du cadavre du célèbre bandit sicilien au cours de l'été 1950, le récit se déploie en deux lignes temporelles. De la fin de la guerre, où lui et ses hommes, instruments des indépendantistes, se battent contre l'armée italienne, à son assassinat, nous suivons les principales étapes du parcours de Giuliano, dont le massacre de Portella delle Ginestre (une dizaine de personnes assistant à une réunion organisée par les communistes, le 1er mai 1947, abattue par la bande à Giuliano, sur demande d'un commanditaire resté inconnu). Parallèlement, nous sont montrés quelques événements suivant sa mort, jusqu'au procès de ses compagnons. Récit d'une odyssée criminelle couvrant la période la plus agitée que connût l'Italie après la guerre, soit les années terroristes 70 et 80, Romanzo criminalese place au coeur d'un genre bien établi dans la cinématographie transalpine, tout en s'appuyant sur une esthétique toute américaine. La première partie de cette fresque accumule ainsi les figures scorsesiennes dans sa description de l'ascension irrésistible d'une bande de malfrats dans le monde de la criminalité mafieuse. La pathologie de certains membres du gang, les éclats de violence et tous les signes constitutifs de la grande délinquance (armes à feu, liasses de billets, drogue) sont traités selon le rythme fiévreux et musical de l'auteur des Affranchis (la bande-son est également saturée de vieux tubes rock'n'roll). Et à l'image de son modèle, Michele Placido, nous plonge dès le générique dans la spirale, les présentations des principaux personnages se faisant dans la fébrilité d'un événement dramatique et violent. Ce début, qui voit les protagonistes à l'âge de l'adolescence se faire arrêter par la police au terme d'une folle virée nocturne, a valeur de moment traumatique fondateur pour les membres du groupe. A plusieurs reprises dans le récit, nous reviendrons (c'est l'un des choix de mise en scène discutables du film), par flash-back ou retour réel d'un personnage, sur cette plage où eu lieu l'arrestation.
Récit d'une odyssée criminelle couvrant la période la plus agitée que connût l'Italie après la guerre, soit les années terroristes 70 et 80, Romanzo criminalese place au coeur d'un genre bien établi dans la cinématographie transalpine, tout en s'appuyant sur une esthétique toute américaine. La première partie de cette fresque accumule ainsi les figures scorsesiennes dans sa description de l'ascension irrésistible d'une bande de malfrats dans le monde de la criminalité mafieuse. La pathologie de certains membres du gang, les éclats de violence et tous les signes constitutifs de la grande délinquance (armes à feu, liasses de billets, drogue) sont traités selon le rythme fiévreux et musical de l'auteur des Affranchis (la bande-son est également saturée de vieux tubes rock'n'roll). Et à l'image de son modèle, Michele Placido, nous plonge dès le générique dans la spirale, les présentations des principaux personnages se faisant dans la fébrilité d'un événement dramatique et violent. Ce début, qui voit les protagonistes à l'âge de l'adolescence se faire arrêter par la police au terme d'une folle virée nocturne, a valeur de moment traumatique fondateur pour les membres du groupe. A plusieurs reprises dans le récit, nous reviendrons (c'est l'un des choix de mise en scène discutables du film), par flash-back ou retour réel d'un personnage, sur cette plage où eu lieu l'arrestation. "La rue est entrée dans la chambre". Vers la fin d'Innocents (The dreamers), Isabelle explique ainsi le bris de glace, provoqué par un pavé, à Matthew et Theo, réveillés en sursaut. L'incident semble n'exister que comme tour scénaristique un peu forcé. Mais il y a le rythme que Bertolucci donne à sa scène, l'affairement d'Isabelle occupée à cacher quelque chose aux deux autres et surtout cette phrase, qui sonne comme une belle trouvaille, appropriée à la fois à l'instant et à l'heure et demie que nous venons de passer avec ces trois personnes. Tout le charme fragile du film est résumé dans cette scène.
"La rue est entrée dans la chambre". Vers la fin d'Innocents (The dreamers), Isabelle explique ainsi le bris de glace, provoqué par un pavé, à Matthew et Theo, réveillés en sursaut. L'incident semble n'exister que comme tour scénaristique un peu forcé. Mais il y a le rythme que Bertolucci donne à sa scène, l'affairement d'Isabelle occupée à cacher quelque chose aux deux autres et surtout cette phrase, qui sonne comme une belle trouvaille, appropriée à la fois à l'instant et à l'heure et demie que nous venons de passer avec ces trois personnes. Tout le charme fragile du film est résumé dans cette scène. Jean-Paul Rappeneau a raconté à la radio, il y a quelque temps, une anecdote intéressante. Ayant terminé La vie de château, il avait assisté à une projection de son film en compagnie de l'un des grands spécialistes de la comédie italienne (je ne me rappelle plus si il s'agit de Risi, Monicelli ou Comencini). Tout heureux d'avoir si bien réussi son coup, il demanda son avis à l'italien. Celui-ci finit par répondre à peu près ceci : "Oui, c'est pas mal, mais chez nous, les comédies à partir d'événements historiques importants, on fait ça depuis longtemps."
Jean-Paul Rappeneau a raconté à la radio, il y a quelque temps, une anecdote intéressante. Ayant terminé La vie de château, il avait assisté à une projection de son film en compagnie de l'un des grands spécialistes de la comédie italienne (je ne me rappelle plus si il s'agit de Risi, Monicelli ou Comencini). Tout heureux d'avoir si bien réussi son coup, il demanda son avis à l'italien. Celui-ci finit par répondre à peu près ceci : "Oui, c'est pas mal, mais chez nous, les comédies à partir d'événements historiques importants, on fait ça depuis longtemps." Tiens, v'la l'week-end...
Tiens, v'la l'week-end...

 Amelio et Schnabel ont choisit eux aussi des voies différentes. Les clefs de la maison, présenté à Venise en 2004, est sorti discrètement ensuite en France. Le cinéaste italien fait à nouveau appel à l'héritage néo-réaliste, comme il l'avait si bien fait avec Les enfants volés en 1992 (bien des points communs caractérisent les deux films, notamment la construction scénaristique). La situation de départ est posée d'emblée : le père rencontre pour la première fois l'enfant handicapé qu'il a abandonné à la naissance, quinze ans auparavant. Ce bouleversement est voulu par l'entourage de l'enfant, qui espère qu'un séjour en Allemagne auprès de ce père inconnu provoquera une évolution bénéfique. Mis à part ces données, très peu d'informations sont données sur les personnages, Amelio faisant confiance à son regard documentaire. La relation père-fils se construit patiemment, au fil des examens et des sorties, sans psychologie, avec peu de dialogues. Les explications arrivent à la moitié du film et l'alourdissent d'un coup. Les confessions sont provoquées par la rencontre entre Gianni, le père (Kim Rossi Stuart), et la mère d'une petite fille hospitalisée (Charlotte Rampling). Bien interprété et photographié (la dernière partie sous les cieux norvégiens), le film souffre d'un déroulement trop habituel : apprentissage mutuel, agacement devant des méthodes médicales jugées inefficaces et fuite vers un ailleurs synonyme de nouvelle sérénité.
Amelio et Schnabel ont choisit eux aussi des voies différentes. Les clefs de la maison, présenté à Venise en 2004, est sorti discrètement ensuite en France. Le cinéaste italien fait à nouveau appel à l'héritage néo-réaliste, comme il l'avait si bien fait avec Les enfants volés en 1992 (bien des points communs caractérisent les deux films, notamment la construction scénaristique). La situation de départ est posée d'emblée : le père rencontre pour la première fois l'enfant handicapé qu'il a abandonné à la naissance, quinze ans auparavant. Ce bouleversement est voulu par l'entourage de l'enfant, qui espère qu'un séjour en Allemagne auprès de ce père inconnu provoquera une évolution bénéfique. Mis à part ces données, très peu d'informations sont données sur les personnages, Amelio faisant confiance à son regard documentaire. La relation père-fils se construit patiemment, au fil des examens et des sorties, sans psychologie, avec peu de dialogues. Les explications arrivent à la moitié du film et l'alourdissent d'un coup. Les confessions sont provoquées par la rencontre entre Gianni, le père (Kim Rossi Stuart), et la mère d'une petite fille hospitalisée (Charlotte Rampling). Bien interprété et photographié (la dernière partie sous les cieux norvégiens), le film souffre d'un déroulement trop habituel : apprentissage mutuel, agacement devant des méthodes médicales jugées inefficaces et fuite vers un ailleurs synonyme de nouvelle sérénité. Le scaphandre et le papillon, succès à Cannes et en salles au printemps dernier, est donc l'adaptation du livre autobiographique de Jean-Dominique Bauby. Ce récit, dicté avec les battements de sa paupière par l'écrivain totalement paralysé à la suite d'une attaque, Julian Schnabel le déroule en privilégiant la subjectivité du regard. Toute la première partie du film est en caméra subjective. Nous voyons uniquement ce que voit Bauby, y compris des choses indistingables. D'abord audacieux, ce choix est pourtant remis en cause au fur et à mesure, Schnabel privilégiant de plus en plus, apparemment sans raison véritable, des plans objectifs "normaux". Mathieu Amalric se sort bien de ce rôle difficile, ce qui laisse à penser que Schnabel aurait mieux fait de filmer classiquement depuis le début. Les seconds rôles sont drôles (Patrick Chesnais et Isaak de Bankolé) et les filles sont parfaites (Marie-José Croze, Mathilde Seigner et Anne Consigny). Les notes humoristiques évitent de sombrer dans le pathos, qui guette parfois, associé à une prise de conscience de la futilité de la vie facile d'avant bien convenue. Autre aspect qui aurait gagné à être plus poussé : le mélange de fantasmes et de réalité, produit des divagations de l'esprit de l'écrivain.
Le scaphandre et le papillon, succès à Cannes et en salles au printemps dernier, est donc l'adaptation du livre autobiographique de Jean-Dominique Bauby. Ce récit, dicté avec les battements de sa paupière par l'écrivain totalement paralysé à la suite d'une attaque, Julian Schnabel le déroule en privilégiant la subjectivité du regard. Toute la première partie du film est en caméra subjective. Nous voyons uniquement ce que voit Bauby, y compris des choses indistingables. D'abord audacieux, ce choix est pourtant remis en cause au fur et à mesure, Schnabel privilégiant de plus en plus, apparemment sans raison véritable, des plans objectifs "normaux". Mathieu Amalric se sort bien de ce rôle difficile, ce qui laisse à penser que Schnabel aurait mieux fait de filmer classiquement depuis le début. Les seconds rôles sont drôles (Patrick Chesnais et Isaak de Bankolé) et les filles sont parfaites (Marie-José Croze, Mathilde Seigner et Anne Consigny). Les notes humoristiques évitent de sombrer dans le pathos, qui guette parfois, associé à une prise de conscience de la futilité de la vie facile d'avant bien convenue. Autre aspect qui aurait gagné à être plus poussé : le mélange de fantasmes et de réalité, produit des divagations de l'esprit de l'écrivain.