
****
"Car tel quel, le film paraît bloqué au même endroit
que son avatar robert-smithien de héros :
en plein milieu du pire des années 80"
(Joachim Lepastier, Cahiers du Cinéma n°669, juillet-août 2011)
Salut les potes !
Pfff… L'année scolaire n'a pas encore démarré que mes parents me mettent déjà la pression par rapport au Bac ! Du coup, hier, j'ai mis mon walkman sur les oreilles et je suis parti faire un tour. Comme le disquaire d'à côté n'a toujours pas reçu The Joshua Tree, le nouveau U2 qui a l'air d'enfer, je me suis fait une toile. Super 8 semble pas mal mais les films de Spielberg, je préfère les voir avec les copains et comme j'étais tout seul, j'ai choisi This must be the place de Paolo Sorrentino. Je n'étais pas spécialement chaud au départ mais la bande annonce, que j'ai vu l'autre jour avec Steph juste avant L'aventure intérieure, m'a plutôt accroché en me promettant de la bonne musique et un récit tordu.
Le problème, c'est que, en fait, j'ai perdu deux heures de mon temps à regarder un film débile.
Déjà, l'idée du cinéaste est bizarre : il a choisi de se lancer dans une sorte de science-fiction puisque son scénario se déroule dans le futur, en 2011 pour être précis. Il nous montre ce que pourrait devenir une star du rock d'aujourd'hui dans une vingtaine d'année. Il imagine donc la vie d'un certain Cheyenne alors que celui-ci, après avoir vendu des millions de disques, a arrêté les drogues et la musique et s'ennuie dans son immense baraque, en compagnie de sa femme et de son chien, tout en s'habillant et se maquillant chaque jour comme s'il allait monter sur scène.
Alors, dès le début, on touche le fond et jamais on ne remontera, au contraire de la caméra qui, elle, vole dans les airs autant que celle d'Alan Parker dans Birdy dont le sujet, au moins, justifiait les acrobaties. C'est clair, la photo est soignée, les cadres étudiés et les mouvements millimétrés. Tous les plans sont hyper-expressifs. Le hic, c'est qu'on ne respire plus, que tout se réduit à l'image. Inutile de chercher, il n'y a rien derrière les masques ou les décors.
Faisant tout tomber dans la caricature, Paolo Sorrentino n'évite aucun cliché sur la gloire passée, la rock'n'roll attitude et le décalage qu'elle peut créer avec la réalité environnante. Je préviens tout de suite : je ne suis pas en train de me plaindre que l'on se moque de cette culture-là, qui m’attire aussi. Récemment, j’ai adoré The Rutles d'Eric Idle ou Spinal Tap de Rob Reiner, qui montrent que l'on peut rire des travers des rockers sans prendre les spectateurs, amateurs ou pas, pour des cons. De toute façon, le film de Sorrentino n'est pas drôle un instant et joue en plus sur une corde sensible absolument détestable. Le réalisateur nous met en garde, nous les jeunes : écouter Cure trop longtemps peut nous conduire au suicide ! Voilà l'un des détails qui me font dire que Sorrentino, au fond, s'en cogne totalement de la musique. Il n'y a qu'à voir comment il la filme, mixée n'importe comment et sans aucune idée visuelle. Je suis prêt à parier que la séquence du concert a été pensée par David Byrne et non par lui, la trouvaille étant purement scénique.
David Byrne, justement, est présent à travers le titre du film (qui est bien sûr celui d’une chanson de ses Talking Heads) et, largement, sur la bande-son. Dans le scénario, il intervient dans son propre rôle et, pour le faire apparaître plus vieux de 25 ans, Sorrentino a en fait engager son père (enfin, je crois). Du coup, la version de This must be the place que l’on entend en concert est un peu mollassonne. Quant à la scène dialoguée qui suit, elle n’est là que pour offrir un nouveau grand moment d’émotion à Sean Penn, le père de Byrne n’étant qu’un faire valoir.
Oui, vous avez bien lu, c’est bien le petit Sean Penn qui est la star du film. Le mari de Madonna n’a pas de chance : à peine sorti du bide de Shanghai surprise, il se voit embarqué dans cette galère, maquillé, vieilli artificiellement pour qu’il ait l’air d’avoir 50 ans. Dans ce rôle, il en fait des caisses comme c'est pas permis, en alignant les tics énervants. À Côté, Robert De Niro dans Angel heart c’est Erland Josephson...
Bon bien sûr, il n’y a pas que la petite histoire du rocker fatigué dans le film, loin de là. Il y a aussi une errance à travers les States, une leçon sur la nécessité des liens familiaux et la recherche d’un ancien nazi. Vu que le début est déjà complètement nul, le reste ne nous étonne pas plus que cela, aussi improbable soit-il. Les dix dernières minutes vont certes encore plus loin dans le ridicule, mais je n’ai guère envie de m’appesantir dessus.
Il faut seulement que je vous parle, avant de partir, de deux personnes. La première est Wim Wenders. Sorrentino a fait, avec This must be the place, une espèce de Paris Texas pour les nuls. Il a même été chercher Harry Dean Stanton (qui a quand même pris un sacré coup de vieux en trois ans seulement !). A un moment, j’ai eu peur que la femme à la fenêtre, à Dublin, ce soit Nastassja Kinski. Mais non, ouf ! Sur la recherche du lien, sur l’espace traversé, sur la musicalité de la narration, sur l’étrangeté du réel, dois-je vraiment préciser que Wenders se situe cent coudées au dessus ? D’ailleurs, il est déjà passé à autre chose avec Les ailes du désir, que j’ai eu la chance de voir le mois dernier en avant-première. On y trouve une séquence de concert avec Nick Cave qui disqualifie déjà les pauvres petites tentatives de Sorrentino. Mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tous ce chef d'œuvre prochainement… La seconde personne est Jonathan Demme. Voilà sans doute un autre modèle de Sorrentino, modèle qu’il ne parvient pas à approcher de plus près que le premier. Demme, lui, est un authentique cinéaste rock (comme Wenders, d'ailleurs). Son récent film-concert avec les Talking Heads, Stop making sense, est peut-être le plus beau du genre (David Byrne a dû sentir la différence en passant de l’un à l’autre) et l’an dernier Dangereuse sous tous rapports réussissait un mélange des genres auquel Sorrentino ne parviendra certainement jamais. Mon magazine Première me dit que Demme prépare un film sur la mafia avec Michelle Pfeiffer. Je suis très impatient.
Quant à Sorrentino, que deviendra-t-il ? Peut-être doit-on lui conseiller de rester en Italie, de se tourner vers les problèmes de son pays, de s’exercer à la bouffonnerie à partir d’un sujet sur un homme politique par exemple (pas sûr que le résultat soit mémorable, mais cela ne pourra pas être pire). Sinon, je crains vraiment que dans 25 ans, personne ne se souvienne de lui…
Bon, il est temps que je vous laisse. Ma mère m’appelle pour manger et la note du Minitel va encore être salée (déjà que ma mob est en panne !). Et puis tout à l’heure, je dois aller chez Jean-Bapt regarder un concert d’Echo and the Bunnymen.
Allez, tchao !
PS : En cherchant bien, j’ai trouvé un mérite à Sorrentino, celui d’avoir fait participer (mais est-ce vraiment sa responsabilité ?), pour la bande originale, un certain Will Oldham. Celui-là n’a pour le moment sorti aucun disque (et pour cause, il n’aurait, apparemment que 17 ans !), mais s’il le fait dans l’avenir, je pense que je les achèterai tous, tellement ses chansons me plaisent.
 THIS MUST BE THE PLACE
THIS MUST BE THE PLACE
de Paolo Sorrentino
(Italie - France - Irlande / 118 min / 1987 - 2011)

 2004 : Pour les Cahiers, créent l'événement, successivement : le cinéma chinois de Tian Zhunangzhuang (Printemps dans une petite ville) à Wang Bing (A l'ouest des rails), S21, la machine de mort khmère rouge de Rithy Panh, Triple agent d'Eric Rohmer, Sarabande d'Ingmar Bergman, The Brown Bunny de Vincent Gallo et Shara de Naomi Kawase, Adieu d'Arnaud des Pallières et Clean d'Olivier Assayas, Le village de M. Night Shyamalan, Tropical malady d'Apichatpong Weerasethakul, Rois et reine d'Arnaud Desplechin (également à l'honneur pour Léo en jouant "Dans la compagnie des hommes"), Les temps qui changent d'André Téchiné et A tout de suite de Benoît Jacquot. Dans l'année sont publiés des entretiens avec Jafar Panahi (Sang et or), Kiyoshi Kurosawa (Séance), Lucrecia Martel (La niña santa), Wong Kar-wai (2046), Yousry Nasrallah (La porte du soleil) et Jonathan Caouette (Tarnation), ainsi que des textes de Jean-Louis Comolli et Arnaud Desplechin. Les rédacteurs se penchent sur les œuvres de Jacques Tourneur, Vincente Minnelli, Monte Hellman, Pier Paolo Pasolini, Jonas Mekas, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, Sergio Leone, Peter Weir, Jean Grémillon, Béla Tarr, Samuel Fuller, Paul Verhoeven, Alan Clarke, sur le cinéma allemand, l'enseignement du cinéma, le court métrage, le documentaire, sur L'hirondelle d'or de King Hu, Les idoles de Marc'O, La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, Les oliviers de la justice de James Blue, L'homme de la plaine d'Anthony Mann. François Truffaut est au cœur du numéro d'été, Mia Hansen-Love fait un éloge de Jacques Doillon et des hommages sont rendus à Jean Rouch et à Jean-Daniel Pollet.
2004 : Pour les Cahiers, créent l'événement, successivement : le cinéma chinois de Tian Zhunangzhuang (Printemps dans une petite ville) à Wang Bing (A l'ouest des rails), S21, la machine de mort khmère rouge de Rithy Panh, Triple agent d'Eric Rohmer, Sarabande d'Ingmar Bergman, The Brown Bunny de Vincent Gallo et Shara de Naomi Kawase, Adieu d'Arnaud des Pallières et Clean d'Olivier Assayas, Le village de M. Night Shyamalan, Tropical malady d'Apichatpong Weerasethakul, Rois et reine d'Arnaud Desplechin (également à l'honneur pour Léo en jouant "Dans la compagnie des hommes"), Les temps qui changent d'André Téchiné et A tout de suite de Benoît Jacquot. Dans l'année sont publiés des entretiens avec Jafar Panahi (Sang et or), Kiyoshi Kurosawa (Séance), Lucrecia Martel (La niña santa), Wong Kar-wai (2046), Yousry Nasrallah (La porte du soleil) et Jonathan Caouette (Tarnation), ainsi que des textes de Jean-Louis Comolli et Arnaud Desplechin. Les rédacteurs se penchent sur les œuvres de Jacques Tourneur, Vincente Minnelli, Monte Hellman, Pier Paolo Pasolini, Jonas Mekas, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, Sergio Leone, Peter Weir, Jean Grémillon, Béla Tarr, Samuel Fuller, Paul Verhoeven, Alan Clarke, sur le cinéma allemand, l'enseignement du cinéma, le court métrage, le documentaire, sur L'hirondelle d'or de King Hu, Les idoles de Marc'O, La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, Les oliviers de la justice de James Blue, L'homme de la plaine d'Anthony Mann. François Truffaut est au cœur du numéro d'été, Mia Hansen-Love fait un éloge de Jacques Doillon et des hommages sont rendus à Jean Rouch et à Jean-Daniel Pollet.
 Quitte à choisir : Deux listes avec quelques trous d'air. J'aime l'entrée en matière des Cahiers (Coppola/Panh/Rohmer) mais ensuite, je confesse plusieurs lacunes (Gallo, Weerasethakul, Mazuy). Pour le reste, le Jacquot me paraît intéressant mais bancal et surtout je déteste assez cordialement les deux films proposés conjointement en septembre. De l'autre côté, m'avaient beaucoup plu, à leur sortie, ces Iñarritu et Gondry-là. Les Kusturica, Wong Kar-wai et Desplechin de l'année, un cran en-dessous par rapport à leur régime habituel, me semblent tout de même bien figurer, tout comme Uzak. Les mentions de Murnau (comme de Truffaut en face) et de Lynch (pour ce qui ressemble tout de même à un "rattrapage" de l'oubli de
Quitte à choisir : Deux listes avec quelques trous d'air. J'aime l'entrée en matière des Cahiers (Coppola/Panh/Rohmer) mais ensuite, je confesse plusieurs lacunes (Gallo, Weerasethakul, Mazuy). Pour le reste, le Jacquot me paraît intéressant mais bancal et surtout je déteste assez cordialement les deux films proposés conjointement en septembre. De l'autre côté, m'avaient beaucoup plu, à leur sortie, ces Iñarritu et Gondry-là. Les Kusturica, Wong Kar-wai et Desplechin de l'année, un cran en-dessous par rapport à leur régime habituel, me semblent tout de même bien figurer, tout comme Uzak. Les mentions de Murnau (comme de Truffaut en face) et de Lynch (pour ce qui ressemble tout de même à un "rattrapage" de l'oubli de 
 LA PIEL QUE HABITO
LA PIEL QUE HABITO
 MELANCHOLIA
MELANCHOLIA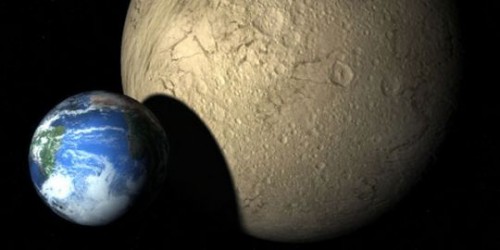



 THE GREEN HORNET
THE GREEN HORNET
 2003 : A la rentrée s'opèrent des bouleversements à la tête des Cahiers : Jean-Michel Frodon devient directeur de la rédaction et Emmanuel Burdeau rédacteur en chef. Mia Hansen Love, François Bégaudeau et Antoine Thirion entrent au comité de rédaction. Pour la revue, les principaux événements de l'année sont les sorties de Gangs of New York et d'Histoire de Marie et Julien, la palme d'or à Elephant, les nouvelles séries télévisées américaines, la ressortie des films de João César Monteiro. On peut lire au fil des numéros des entretiens avec Alain Resnais, Lucas Belvaux, Lars von Trier, Kiju Yoshida (Femmes en miroir), Mahamet-Saleh Haroun (Abouna), Arnaud et Jean-Marie Larrieu (Un homme un vrai), Lester James Peries (Le domaine), André Téchiné (Les égarés), Larry Clark (Ken Park) ou Woody Allen (Anything else). Une présentation est faite du cinéma de Daniele Cipri et Franco Maresco, comme de celui de Claire Doyon (Les lionceaux). Les rédacteurs reviennent sur Serge Daney, Numéro zéro de Jean Eustache, La nuit du chasseur de Charles Laughton, Wanda de Barbara Loden, Sans soleil de Chris Marker, sur le cinéma politique français des années 70, sur la RKO ou sur le cinéma chinois. Des disparus sont évoqués : Maurice Pialat, Stan Brackage, Leslie Cheung, Jean-Claude Biette, Ingmar Bergman (par Catherine Breillat et André Téchiné), Elia Kazan. Le cinéma américain est étudié à travers un spécial Hollywood (John McTiernan, Steven Soderbergh, Jonathan Mostow, Ed Lachman, Todd Haynes, Larry Clark, Gus Van Sant) et un dictionnaire de 100 nouveaux cinéastes. D'autres écrits portent sur l'explosion du DVD, une exposition Jean Cocteau, les rapports entre cinéma et art contemporain. Enfin, Blake Edwards, Claude Berri, France Gall (à propos de Godard), Jeanne Balibar, Eric Rohmer et Leonor Silveira sont successivement rencontrés.
2003 : A la rentrée s'opèrent des bouleversements à la tête des Cahiers : Jean-Michel Frodon devient directeur de la rédaction et Emmanuel Burdeau rédacteur en chef. Mia Hansen Love, François Bégaudeau et Antoine Thirion entrent au comité de rédaction. Pour la revue, les principaux événements de l'année sont les sorties de Gangs of New York et d'Histoire de Marie et Julien, la palme d'or à Elephant, les nouvelles séries télévisées américaines, la ressortie des films de João César Monteiro. On peut lire au fil des numéros des entretiens avec Alain Resnais, Lucas Belvaux, Lars von Trier, Kiju Yoshida (Femmes en miroir), Mahamet-Saleh Haroun (Abouna), Arnaud et Jean-Marie Larrieu (Un homme un vrai), Lester James Peries (Le domaine), André Téchiné (Les égarés), Larry Clark (Ken Park) ou Woody Allen (Anything else). Une présentation est faite du cinéma de Daniele Cipri et Franco Maresco, comme de celui de Claire Doyon (Les lionceaux). Les rédacteurs reviennent sur Serge Daney, Numéro zéro de Jean Eustache, La nuit du chasseur de Charles Laughton, Wanda de Barbara Loden, Sans soleil de Chris Marker, sur le cinéma politique français des années 70, sur la RKO ou sur le cinéma chinois. Des disparus sont évoqués : Maurice Pialat, Stan Brackage, Leslie Cheung, Jean-Claude Biette, Ingmar Bergman (par Catherine Breillat et André Téchiné), Elia Kazan. Le cinéma américain est étudié à travers un spécial Hollywood (John McTiernan, Steven Soderbergh, Jonathan Mostow, Ed Lachman, Todd Haynes, Larry Clark, Gus Van Sant) et un dictionnaire de 100 nouveaux cinéastes. D'autres écrits portent sur l'explosion du DVD, une exposition Jean Cocteau, les rapports entre cinéma et art contemporain. Enfin, Blake Edwards, Claude Berri, France Gall (à propos de Godard), Jeanne Balibar, Eric Rohmer et Leonor Silveira sont successivement rencontrés.
 Quitte à choisir : Les films de Belvaux, Soderbergh, Corneau, Kitano, Rappeneau, Chomet, Eastwood et Campion me furent à l'époque agréables, au contraire de ceux de Dumont et Lvovsky, Les sentiments prenant de surcroît la place d'Elephant en couverture d'une revue qui, malheureusement, tergiverse toujours quand il est question de Gus Van Sant. Dans la maison d'en face, je retiens la présence des films de von Trier, Haynes, Resnais. J'aime un peu moins ceux de Scorsese, Spielberg et Bruni Tedeschi. Ce sont donc plutôt mes lacunes (les séries TV, le Biette, le Rivette) qui font pencher la balance. Allez, pour 2003 : Avantage Positif.
Quitte à choisir : Les films de Belvaux, Soderbergh, Corneau, Kitano, Rappeneau, Chomet, Eastwood et Campion me furent à l'époque agréables, au contraire de ceux de Dumont et Lvovsky, Les sentiments prenant de surcroît la place d'Elephant en couverture d'une revue qui, malheureusement, tergiverse toujours quand il est question de Gus Van Sant. Dans la maison d'en face, je retiens la présence des films de von Trier, Haynes, Resnais. J'aime un peu moins ceux de Scorsese, Spielberg et Bruni Tedeschi. Ce sont donc plutôt mes lacunes (les séries TV, le Biette, le Rivette) qui font pencher la balance. Allez, pour 2003 : Avantage Positif.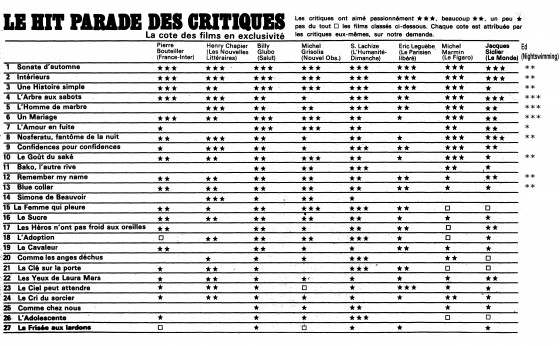


 UN AMOUR DE JEUNESSE
UN AMOUR DE JEUNESSE