
****

(Dernière chronique dvd pour Kinok)
A Joachim Lepastier
et à Olivier Eyquem.
Le journal de David Holzman est assurément un film précurseur et ce statut lui confère déjà une certaine valeur. Avant de découvrir cette œuvre rare et peu commentée depuis sa sortie en France en 1974 (soit sept ans après sa réalisation), il convient cependant de ne pas trop la fantasmer et de ne pas en attendre des choses qu'elle ne peut donner. Elle se présente sous la forme très directe d'un journal intime filmé. Mais David Holzman n'existe pas. Devant la caméra, l'acteur L. M. Kit Carson a endossé ce rôle, derrière, l'image a été réglée par Michael Wadleigh et la réalisation assurée par Jim McBride, débutant là une carrière dont la visibilité sera réelle dans les années quatre-vingt (A bout de souffle made in USA, The Big Easy, Great balls of fire). Le film est donc un précurseur dans ce genre très particulier qu'est le "documenteur".
Pour que l'ambivalence joue à plein, les auteurs choisissant d'œuvrer dans ce cadre-là doivent être parfaitement dans leur époque et doivent avoir le nez collé sur la vitre pour regarder la réalité de leur temps. Pour que l'illusion soit préservée et que le spectateur soit habilement manipulé, il doivent s'approprier, plus ou moins délibérément, plus ou moins ironiquement, les formes artistiques privilégiées par l'époque. Le journal de David Holzman dialogue donc avant tout avec l'art de 1967. Il annonce moins qu'il ne récapitule et, tout précurseur qu'il soit, il renvoie plus vers l'arrière qu'il ne se projette vers le futur. David Holzman (le film comme le personnage) nous parle donc de Jean-Luc Godard ou de Vincente Minnelli et se lance à corps perdu dans une des aventures artistiques les plus courantes alors : le cinéma-direct (appelé encore cinéma-vérité). C'est donc en feignant de reprendre toutes les caractéristiques (économiques, techniques, narratives et morales) de ce cinéma-là que Jim McBride va le parodier dans le but de démontrer que non, contrairement à ce que put avancer Godard, le cinéma n'est pas la vérité 24 fois par seconde et que oui, dès qu'une caméra est braquée sur quelqu'un, la réalité en est changée.
L'œuvre se présente sous l'apparence d'un assemblage de scènes arrachées à la (fausse) réalité. Le patchwork repose sur une alternance assez régulière entre les confessions de David Holzman ou de ses amis dans leurs appartements et les sorties de l'apprenti-cinéaste dans la rue. Une tendance assez marquée se dégage de cette construction narrative basée sur deux types de séquences : un air vivifiant circule dans les secondes (qui échappent à la recherche d'une signification) alors que les premières sont saturées de discours, qu'ils soient clairs ou balbutiants, directs ou indirects (le harcèlement, caméra au poing, par Holzman de sa petite amie). L'arsenal théorique tiré par la caravane du film plombe quelque peu celui-ci, l'étirement du temps des monologues accentuant cette impression. Malgré ce que laisse supposer le début de l'expérience, lorsque David Holzman nous présente ses amis le magnétophone Nagra et la caméra Eclair, la question de la fabrication, du "comment", est secondaire. Celle du "pourquoi" est un peu envahissante.
Il ne faut pas non plus attendre du Journal de David Holzman une montée en puissance car nous nous trouvons là devant l'histoire d'un échec. Un échec sur toute la ligne. Le diariste à la caméra subit des contrariétés constantes car rien ni personne ne semble disposé à s'approcher de ce que lui croit pouvoir montrer de leur vérité. Enregistrant sans relâche, afin de mieux comprendre le monde, il ne peut que constater que celui-ci ne cesse de lui glisser entre les doigts. Cette série de désappointements provoque une certaine baisse de tension sur le plan du récit, mais elle véhicule, il faut le dire, un réel potentiel comique. De même, si le spectateur peut être désarçonné par cet évidement narratif, il se voit rattrapé par le col au moment de la conclusion, particulièrement astucieuse et cohérente.
En elle même pas aussi troublante qu'attendu, l'œuvre le devient en fait un peu plus une fois mise en rapport avec la suivante, My girlfriend's wedding, deuxième film de McBride proposé ici en bonus par l'éditeur, avec beaucoup de pertinence. Mise en miroir devrait-on dire tant elle représente le double inversé du Journal, à tous les niveaux. Voici en effet un "vrai" documentaire dans lequel Jim McBride interroge sa compagne Clarissa sur sa vie passée, particulièrement chaotique, ses relations familiales, très difficiles, et ses aspirations, liées à une révolution moins politique que morale, avant de filmer son mariage... avec un autre homme que lui.
Tourné plus vite encore que le premier, cet essai, en couleurs cette fois-ci, est d'une esthétique plus ingrate mais la façon dont est tissé le lien avec le spectateur est opposée. Si la longueur et la répétition des plans demandent toujours de s'accrocher sérieusement, l'attachement se fait peu à peu. Bien sûr, le fait que nous rencontrions là une personnalité d'exception donnant une tournure constamment inattendue à ses propos y est pour beaucoup mais on sent également, à travers les échanges et le regard du cinéaste, l'authenticité du rapport amoureux. Et si mystification il y a dans My girlfriend's wedding, elle n'est pas basée sur son mode de fabrication, mais, au-delà d'un titre que l'on peut considérer comme trompeur, sur l'un des sujets abordés, le mariage blanc.
Ce passage par un cinéma dont McBride venait de souligner malicieusement les limites tout en en célébrant finalement l'existence ne laisse pas d'intriguer, comme le fait la suite de sa carrière, de sa fiction indépendante sur le péril atomique Glen and Randa (1971) à son activité pour la télévision durant les années quatre-vingt-dix, en passant bien sûr par ses estimables succès intermédiaires.
 LE JOURNAL DE DAVID HOLZMAN (David Holzman's diary)
LE JOURNAL DE DAVID HOLZMAN (David Holzman's diary)
MY GIRLFRIEND'S WEDDING
de Jim McBride
(Etats-Unis / 73 min, 61 min / 1967, 1969)

 CHARELL
CHARELL




 LES CHANSONS D'AMOUR
LES CHANSONS D'AMOUR


 RESTLESS
RESTLESS
 2007 : Les Cahiers organisent leurs numéros autour, successivement, de Johnnie To et du cinéma de Hong Kong, d'INLAND EMPIRE, du diptyque de Clint Eastwood sur Iwo Jima, de Ne touchez pas la hache et du cinéma de Jacques Rivette, de Quentin Tarantino, de l'élection présidentielle et des annonces des candidats en matière de politique pour le cinéma, des Correspondances Erice-Kiarostami à Beaubourg, de Francis Ford Coppola et de L'homme sans âge et de La graine et le mulet. Ils rencontrent Pedro Costa (En avant jeunesse), Albert Serra (Honor de cavalleria), Alexandre Sokourov (Alexandra), Jia Zhangke, Tsai Ming-liang (I don't want to sleep alone), Isild Le Besco (Charly), Quentin Dupieux, Eric et Ramzy (Steak), George Romero (Diary of the dead), Mia Hansen-Love (Tout est pardonné) et Eric Rohmer. Ils publient des écrits sur Jean Eustache, Etienne-Jules Marey, Kim Novak, Catherine Deneuve, Serguei Paradjanov, Luigi Comencini, Jean-Luc Godard, Twin Peaks de David Lynch, le cinéma et la photographie, le cinéma et l'histoire et l'année 1971. La revue présente dix films inédits (d'Arnaud Desplechin à Shinji Aoyama) et confie ses clés à Juliette Binoche le temps d'un numéro.
2007 : Les Cahiers organisent leurs numéros autour, successivement, de Johnnie To et du cinéma de Hong Kong, d'INLAND EMPIRE, du diptyque de Clint Eastwood sur Iwo Jima, de Ne touchez pas la hache et du cinéma de Jacques Rivette, de Quentin Tarantino, de l'élection présidentielle et des annonces des candidats en matière de politique pour le cinéma, des Correspondances Erice-Kiarostami à Beaubourg, de Francis Ford Coppola et de L'homme sans âge et de La graine et le mulet. Ils rencontrent Pedro Costa (En avant jeunesse), Albert Serra (Honor de cavalleria), Alexandre Sokourov (Alexandra), Jia Zhangke, Tsai Ming-liang (I don't want to sleep alone), Isild Le Besco (Charly), Quentin Dupieux, Eric et Ramzy (Steak), George Romero (Diary of the dead), Mia Hansen-Love (Tout est pardonné) et Eric Rohmer. Ils publient des écrits sur Jean Eustache, Etienne-Jules Marey, Kim Novak, Catherine Deneuve, Serguei Paradjanov, Luigi Comencini, Jean-Luc Godard, Twin Peaks de David Lynch, le cinéma et la photographie, le cinéma et l'histoire et l'année 1971. La revue présente dix films inédits (d'Arnaud Desplechin à Shinji Aoyama) et confie ses clés à Juliette Binoche le temps d'un numéro.
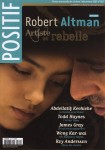 Quitte à choisir : Je retrouve huit de mes dix films préférés à l'époque et ceux-ci sont plus souvent du côté Cahiers (To, Lynch, Rivette, Tarantino, Fincher, Van Sant, Kechiche) que du côté Positif (Mungiu en plus de Rivette et Kechiche). Je peux y ajouter ensuite les titres d'Eastwood, Breillat et Cronenberg. En revanche, ceux de Ceylan, Jia et Lee avaient soulevé chez moi moins d'enthousiasme que prévu, tandis que j'avais totalement repoussé le film d'Ozon. Et comme je vois, dans la colonne de gauche, Juliette Binoche et un Rohmer que j'aimerai enfin découvrir... Allez, pour 2007 : Avantage Cahiers.
Quitte à choisir : Je retrouve huit de mes dix films préférés à l'époque et ceux-ci sont plus souvent du côté Cahiers (To, Lynch, Rivette, Tarantino, Fincher, Van Sant, Kechiche) que du côté Positif (Mungiu en plus de Rivette et Kechiche). Je peux y ajouter ensuite les titres d'Eastwood, Breillat et Cronenberg. En revanche, ceux de Ceylan, Jia et Lee avaient soulevé chez moi moins d'enthousiasme que prévu, tandis que j'avais totalement repoussé le film d'Ozon. Et comme je vois, dans la colonne de gauche, Juliette Binoche et un Rohmer que j'aimerai enfin découvrir... Allez, pour 2007 : Avantage Cahiers.
 LE CONVOI (Convoy)
LE CONVOI (Convoy)
 L'APOLLONIDE, SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE
L'APOLLONIDE, SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE
 DELTA
DELTA